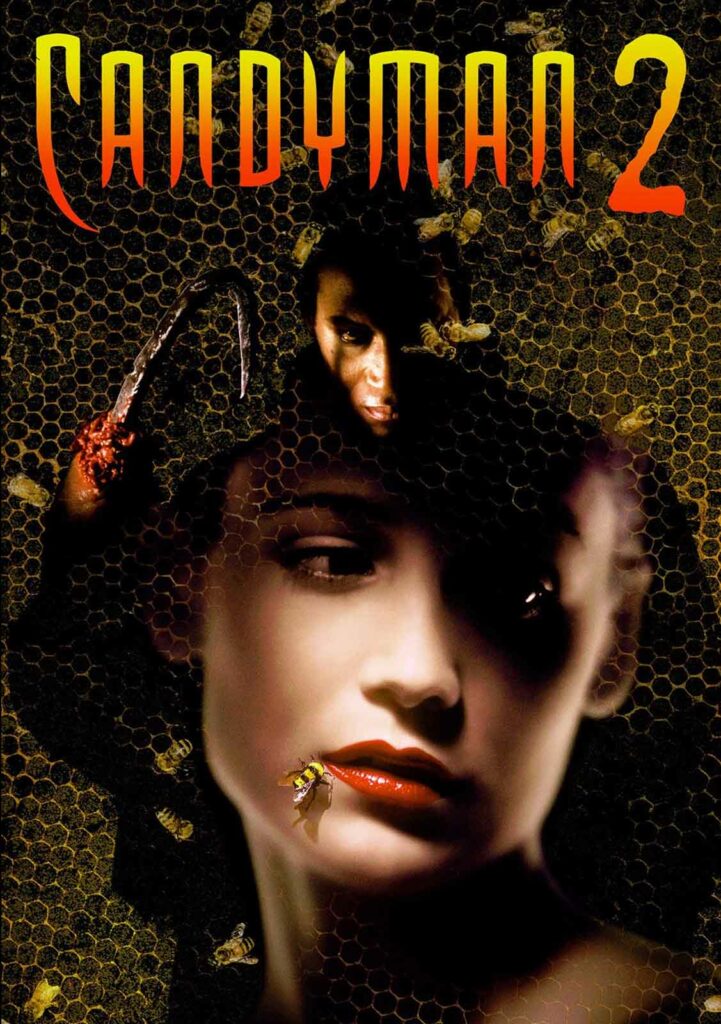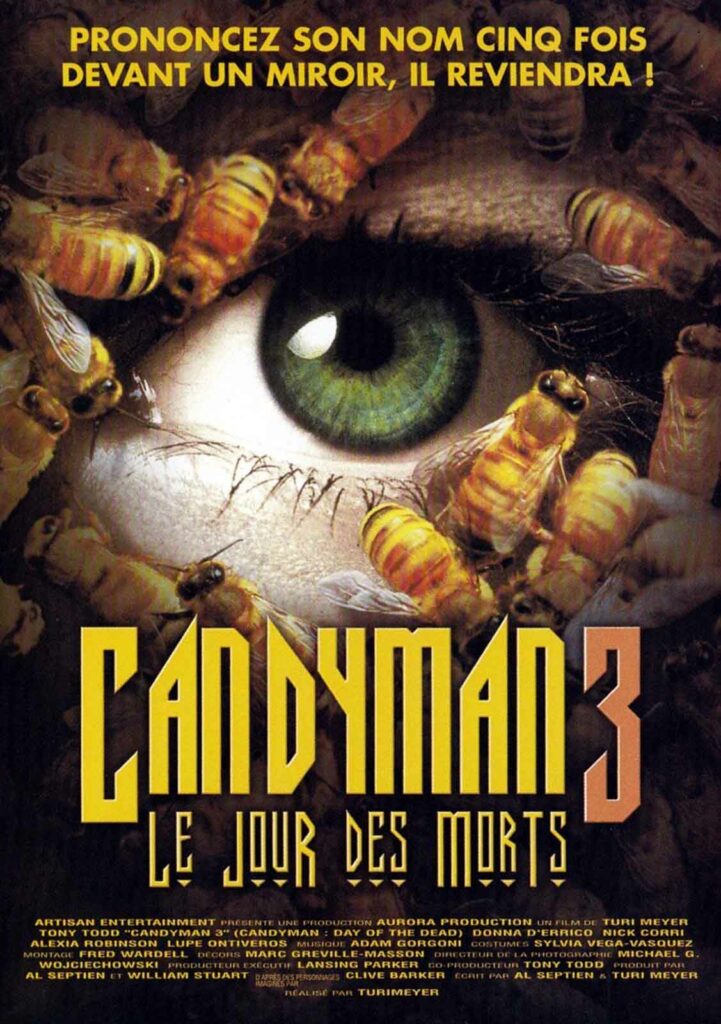La réalisatrice Nia DaCosta réinvente le célèbre croquemitaine inventé par Clive Barker en offrant une nouvelle séquelle au classique de Bernard Rose
CANDYMAN
2021 – USA
Réalisé par Nia DaCosta
Avec Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris, Nathan Stewart-Jarrett, Michael Hargrove, Vanessa A. Williams
THEMA DIABLE ET DÉMONS I SAGA CANDYMAN
1992 : Clive Barker adapte sa propre nouvelle The Forbidden, tirée des fameux Livres de sang, et transforme, un an après l’affaire Rodney King, son fantôme blanc et blond en géant noir, fils d’esclave d’un autre siècle massacré en punition de son amour pour une riche blanche. Devenu un martyr iconique dont la seule évocation fait frémir les quartiers chauds défavorisés, celui qu’on appelle désormais Candyman apparaît quand ses futures proies osent prononcer son nom en se regardant dans un miroir : la métaphore sur la culpabilité d’une Amérique face à ses démons historiques est claire, et fait instantanément de ce boogeyman une incarnation touchante et profonde à l’aura onirique, quelque part entre Freddy et Dracula (ou Blacula, fleuron de la Blaxploitation), qui entretient de fait un rapport romantico-vampirique avec Helen Lyle, étudiante en quête de frissons qui finira par fusionner avec le monstre et même par prendre sa triste succession, non sans laisser planer un parfum de schizophrénie sur les événements. Le film culte de Bernard Rose use délicieusement des fantasmes SM habituels de l’auteur d’Hellraiser et distille une atmosphère de cauchemar éveillé à la poésie macabre, sur les accents lyriques et sentencieux de la partition de Philip Glass. Nous passerons poliment sur les deux séquelles de l’œuvre dont fait intelligemment fi ce Candyman nouveau qui s’avère être, contrairement à ce que son titre laisse entendre, non pas un remake mais une suite directe à l’original.


Les ponts sont intelligemment construits dès l’introduction qui reprend de façon détournée celle de son modèle, jouant sur une architecture aliénante scrutée à l’envers. On sent la patte co-scénaristique de Jordan Peele, également producteur, les enjeux politiques du discours de fond se voyant accentués (avec beaucoup plus de finesse que le balourd Antebellum) : le tueur au crochet se mue ici en motif vengeur déclinable à l’infini à travers toutes les victimes de violences racistes, porte-étendard d’une charge frontale qui culminera dans un final où les brutalités et manipulations policières seront brocardées sans équivoque. Comme Rose avant elle, Nia DaCosta analyse la notion même de transmission de la peur par le prisme de la légende urbaine, offrant une mise en abîme vertigineuse au spectateur auquel on raconte les événements passés comme une histoire effrayante au coin du feu (conte qui se permet logiquement de travestir un minimum la réalité, si tant est qu’il y en ait une), en utilisant des figurines de papier découpé projetées en ombres chinoises (excellente idée qui contourne avec classe les flashbacks explicatifs de rigueur).
« Be My Victim »
La réalisatrice n’oublie pour autant pas une saine autocritique, apportant une impartialité bienvenue : les personnages principaux, cette fois noirs, se retrouvent douloureusement écartelés entre une « gentrification » embarrassante (à laquelle ils participent involontairement dans leur souci d’intégration) et la réappropriation brutale de leurs racines, qui ne peut passer que par un bain de sang. Une hémoglobine bel et bien présente, mais plus violente que gore, DaCosta privilégiant un certain réalisme mêlé d’esthétisme dans les mises à mort (la superbe séquence de la galerie d’art), ou jouant parfois avec le hors-champ (le massacre hommage au slasher dans les toilettes), voire avec la suggestion pure (un meurtre aperçu de loin par la fenêtre d’un immeuble alors que la caméra aérienne s’éloigne, vignette qui lorgne vers Ari Aster). On sera évidemment en droit de préférer la puissante étrangeté et la déviance dérangeante du Candyman premier du nom à ce pamphlet à l’engagement plus dénonciateur propre à son époque, comme on pourra regretter le charisme à la fois plus animal et plus aristocratique de Tony Todd (Yahya Abdul-Mateen demeurant assez inexpressif tout au long du métrage). Cependant en l’état cette relecture soignée qui sait explorer et embrasser pleinement ses thématiques se révèle être une réussite inattendue et une réponse revigorante au manque de témérité du cinéma de genre actuel.
© Julien Cassarino
À découvrir dans le même genre…
Partagez cet article