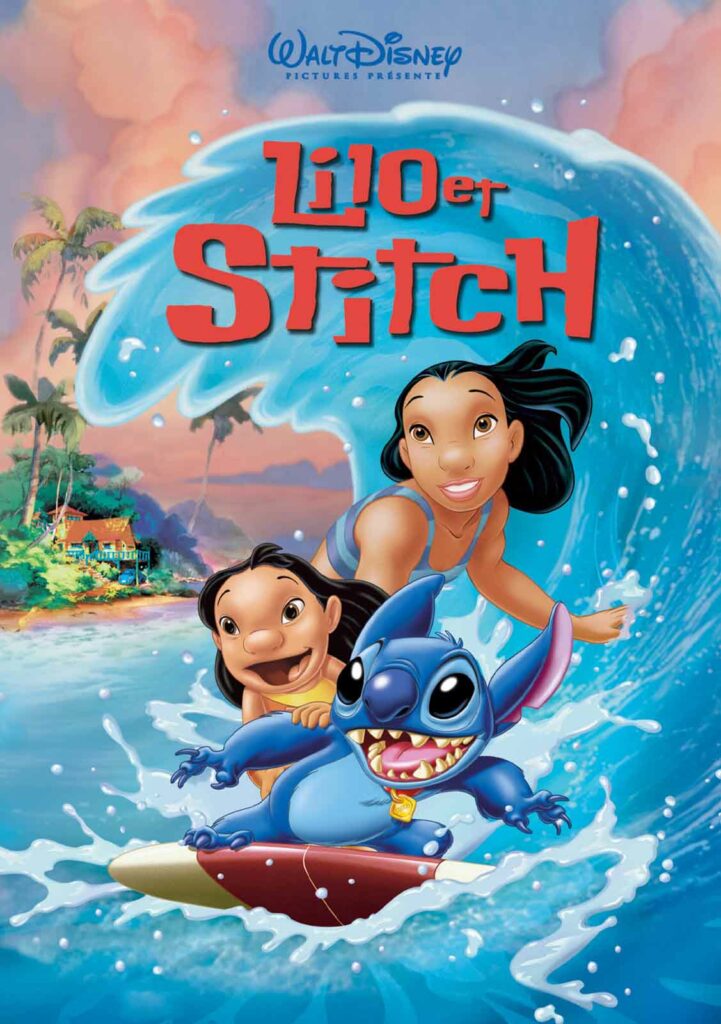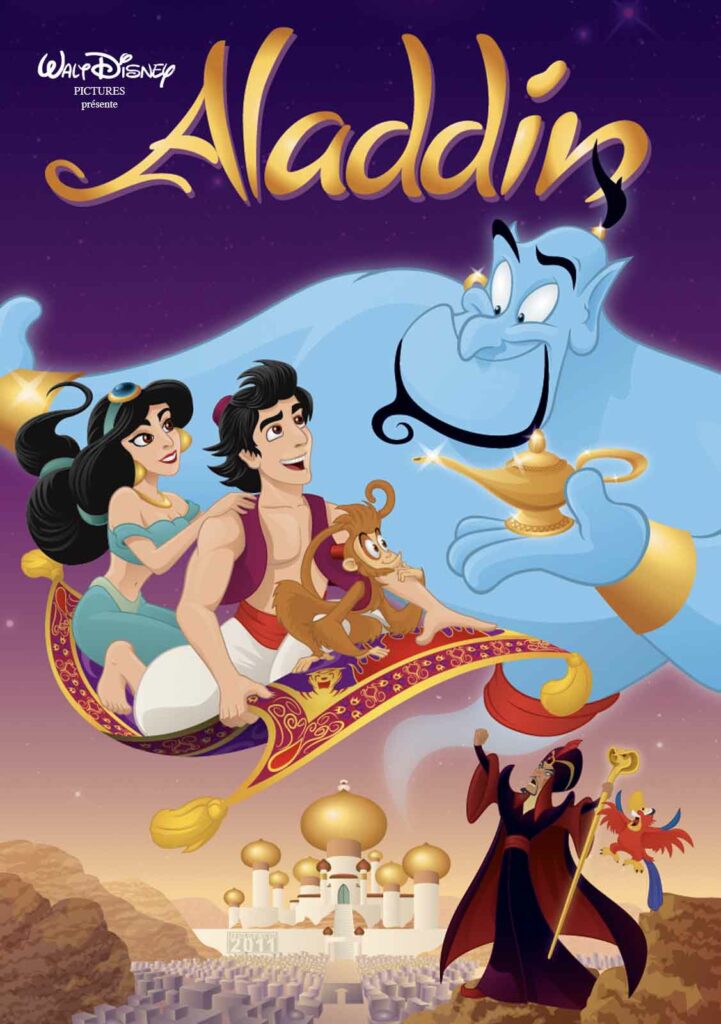
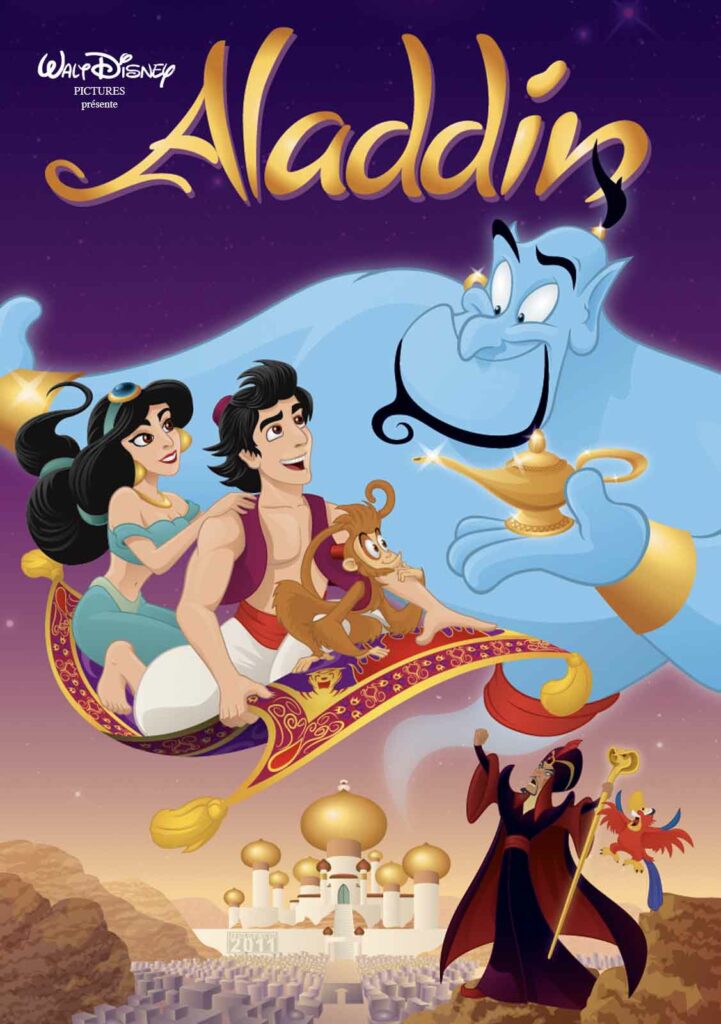
Disney réinvente les contes des 1001 nuits, intègre les images de synthèse dans ses dessins et laisse carte blanche à Robin Williams !
ALADDIN
1992 – USA
Réalisé par Ron Clements et John Musker
Avec les voix de Robin Williams, Scott Weigner, Linda Larkin, Jonathan Freeman, Frank Welker, Gilbert Gottfried, Douglas Seale, Charlie Adler, Jack Angel
THEMA MILLE ET UNE NUITS
L’idée d’adapter le célèbre conte des Mille et Une Nuits ne vient pas d’un cadre chez Disney, mais du parolier Howard Ashman lui-même, alors en pleine collaboration avec Alan Menken sur La Petite Sirène. Ashman propose un récit centré sur un jeune homme des rues rêvant de reconnaissance parentale, et imagine un génie inspiré du swingman Cab Calloway. Cette première mouture est poétique, jazzy et bien plus centrée sur les origines sociales du héros. Mais après la mort d’Ashman en 1991, l’histoire prend un tournant différent. Le personnage d’Aladdin est reconfiguré comme un adolescent plus impertinent, moins ancré dans la recherche d’approbation familiale que dans une quête d’identité. Son modèle devient Tom Cruise, et non plus Michael J. Fox, initialement évoqué. Le décor orientaliste passe de Bagdad à Agrabah, cité imaginaire et volontairement anachronique, tandis que plusieurs chansons d’Ashman sont retirées. L’un des tournants les plus brutaux de la production survient lorsque Jeffrey Katzenberg rejette en bloc la version du scénario alors en cours de production. L’équipe a une semaine pour tout réécrire sans que le calendrier de sortie ne soit modifié. En l’état, Aladdin peut s’apprécier comme une sorte de relecture exubérante du Voleur de Bagdad produit par les frères Korda. Le voleur, le génie, la princesse, le vil Jaffar et même le sautillant Sabu (ici transformé en singe et rebaptisé… Abu) y sont transfigurés sous une forme dessinée volontairement excessive.


Si Aladdin demeure un jalon important de l’histoire de Disney, c’est en grande partie grâce à l’apport phénoménal de Robin Williams. Dès les premiers stades de développement, les animateurs rêvent de lui pour incarner le Génie. Eric Goldberg réalise alors un test d’animation sur la base d’un sketch de l’acteur. Le résultat est si convaincant que Williams accepte sans hésiter. Ce n’est pas seulement une performance vocale, mais une tornade d’inventivité. Car en studio, l’acteur improvise des dizaines de personnages, accents, références et digressions, au point que le script original doit être reclassé en « scénario adapté » pour la cérémonie des Oscars. Plus de 16 heures de bandes sonores sont enregistrées pour le seul Génie. Certaines répliques sont néanmoins écartées, jugées trop politiques ou irrévérencieuses (comme une imitation de George Bush ou des références à Nancy Reagan). C’est un coup de poker artistique, mais aussi un tournant industriel. Disney découvre en effet qu’une star bankable peut vendre un film d’animation autant qu’un héros dessiné. L’industrie entière suivra cette logique, parfois au détriment de la qualité vocale elle-même.
Un coup de génie
Sur le plan graphique, Aladdin s’émancipe du réalisme pastel de La Belle et la Bête pour adopter une ligne plus caricaturale. Le travail du dessinateur Al Hirschfeld inspire le trait ondulant des personnages, tandis que les décors jouent la carte du conte oriental fantasmé, entre désert infini, palais d’ivoire et souks colorés. Les séquences d’action, comme la course poursuite du prologue ou le vol en tapis volant, tirent parti des avancées en animation numérique, avec des mouvements de caméra dynamiques, encore rares à l’époque dans le dessin animé traditionnel. Mais c’est l’humour débridé, souvent méta, qui différencie le plus Aladdin de ses prédécesseurs. Là où La Petite Sirène et La Belle et la Bête gardaient un certain classicisme de ton, Aladdin déborde d’énergie burlesque. Le Génie cite Arsenic et vieilles dentelles, pastiche Arnold Schwarzenegger et Jack Nicholson, sans oublier de briser régulièrement le quatrième mur. Avec son succès fulgurant (près de 504 millions de dollars de recettes mondiales ainsi qu’un triomphe critique et deux Oscars), Aladdin s’impose comme un sommet du studio Disney dans les années 90. Il inaugure une ère où la modernité se conjugue à la tradition, où la starification du doublage devient un argument de vente, et où l’humour visuel atteint une vitesse jamais vue dans un long-métrage animé. Le film sera suivi par deux longs-métrages animés, une série et un remake en prises de vues réelles.
© Gilles Penso
À découvrir dans le même genre…
Partagez cet article