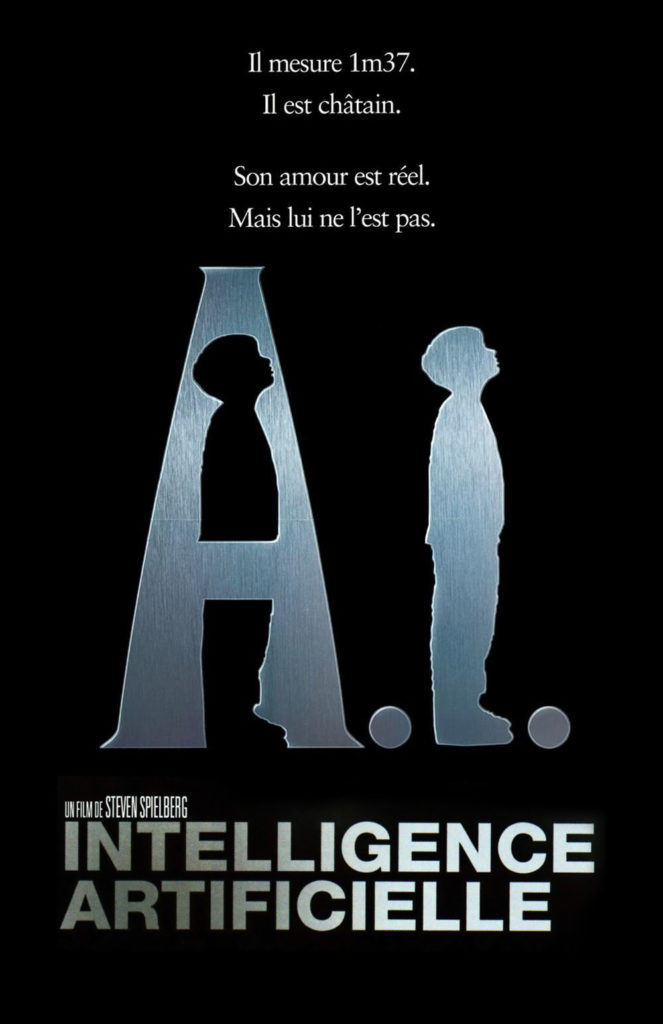
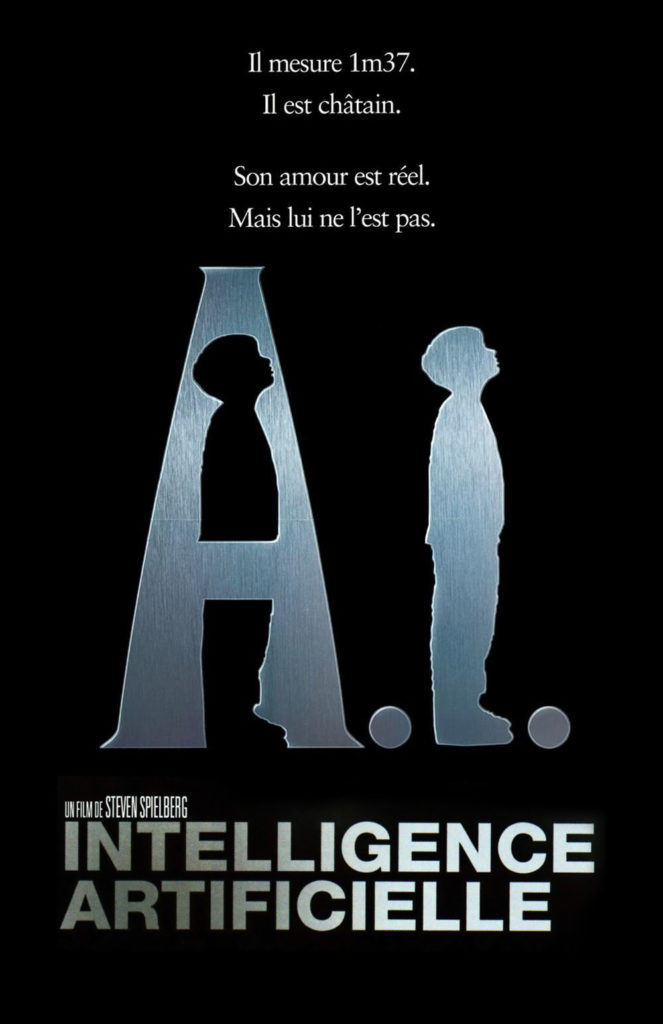
En 2001 - année ô combien symbolique - Steven Spielberg reprend un projet que lui avait confié Stanley Kubrick pour s'interroger sur l'âme des créatures artificielles
A.I. ARTIFICIAL INTELLIGENCE
2001 – USA
Réalisé par Steven Spielberg
Avec Haley Joel Osment, Jude Law, Frances O’Connor, Brendan Gleeson, Sam Robards, William Hurt, Jake Thomas
THEMA ROBOTS I FUTUR I SAGA STEVEN SPIELBERG
Lorsqu’il découvre la nouvelle “Les Supertoys durent tout l’été“, Stanley Kubrick décide d’en tirer un film. Pendant longtemps, le réalisateur d’Orange mécanique et l’écrivain Brian Aldiss travaillent sur la transformation du texte original en scénario. Mais après maintes réunions de travail, les deux hommes ne parviennent à rien de concret. En 1984, Stanley Kubrick parle du projet à Steven Spielberg, qui le trouve intéressant mais peine à entrer en phase avec cet univers noir et désespéré. Quinze ans plus tard, Spielberg se sent enfin prêt à reprendre le projet, avec la bénédiction du vénérable réalisateur de 2001. Mais ce dernier meurt le 7 mars 1999. Spielberg s’emploie alors à reprendre les rênes de ce projet dont rêvait Kubrick et se livre à un exercice qu’il n’avait pas pratiqué depuis plus de vingt ans : l’écriture de scénario. Il veille aussi à respecter l’envie farouche de Kubrick d’intégrer dans le film le motif de Pinocchio et de la Fée Bleue.


L’objet du film, ambitieux, est un questionnement sur l’émotion chez les robots. Hélas, le résultat pèche par trop d’ambition, mais aussi par une incapacité manifeste à savoir sous quel angle aborder sa thématique. Ainsi A.I. renferme-t-il plusieurs films en un, qui ne s’apprécient pas comme autant de niveaux de lecture parallèles, mais plutôt comme diverses approches du même sujet, pas forcément complémentaires, juxtaposées de manière un peu arbitraire. Cette sensation est due au respect des volontés initiales de Kubrick, qui souhaitait diviser le film en trois chapitres distincts. Mais la fluidité du récit en souffre terriblement. Nous sommes en l’an 2142. La plupart des villes côtières du monde ont été submergées par les océans suite au réchauffement climatique. Réfugiés à l’intérieur des terres, les survivants ont créé les « méchas », des androïdes qui imitent à la perfection l’anatomie et le comportement humain. Lorsque le professeur Hobby (William Hurt) finit par créer le premier enfant robot, David (Haley Joel Osment), on propose que ce dernier soit adopté par un couple dont le petit garçon souffre d’une maladie qui le cloue dans un caisson. Tout se passe à merveille, jusqu’au jour où le petit garçon est guéri et retrouve ses parents. S’ensuivent la jalousie, la rivalité et la cruauté enfantine, qui vont pousser le petit androïde à commettre une erreur et à être abandonné dans la forêt, comme un Petit Poucet solitaire. Nous qui espérions un film sur la difficulté d’intégration sociale des robots au sein des groupes humains, nous en sommes pour nos frais.
Un grand film malade
Car à partir de là, c’est une toute autre histoire qui commence. Égaré dans les bois, David semble devenir un nouveau de ces « enfants perdus » si chers à Spielberg, livré à lui-même à cause de l’absence de ses parents. Il rencontre tout un tas de freaks – en fait des robots en partie détruits qui se réparent comme ils peuvent en fouillant les décharges publiques – ainsi que Joe, un androïde gigolo interprété par Jude Law. Alors qu’ils sont en cavale, les deux robots échappent de peu à la « Foire de la Chair », une kermesse ultra-violente au cours de laquelle les humains détruisent les robots de mille et une manières. Cette ambiance post-apocalyptique façon Mad Max est soulignée par de maladroites guitares électriques que John Williams intègre comme il peut à sa partition trépidante. Malgré quelques idées visuelles saisissantes, nous sommes pour le moins déstabilisés. Il nous semble même assister à une sorte de mise à mort du cinéma de Spielberg tel que nous le connaissions jusqu’alors. La Lune par exemple, symbole de la liberté et de l’imagination des enfants spielbergiens, change soudain de signification. Ce n’est plus le cercle de lumière féerique devant lequel Eliott et E.T. passent avec leur vélo volant dans le logo d’Amblin, ni celui sur lequel repose l’enfant pêcheur de Dreamworks. C’est désormais un signe de mort et de destruction, une illusion sinistre, une montgolfière maquillée en astre pour mieux traquer, capturer et abattre les fugitifs ! Le film bascule peu à peu dans le chaos, s’achevant sur un étrange hommage au final de 2001, et laissant le spectateur complètement déboussolé. Séparément, Kubrick et Spielberg avaient su plonger dans une délicieuse ambigüité teintée d’espoir le climax de leurs deux chefs d’œuvre de science-fiction respectifs, 2001 l’odyssée de l’espace et Rencontres du troisième type. Mais la fusion de leurs deux univers n’aura pas été aussi heureuse. Kubrick jugeait le sujet trop chaleureux pour lui et c’est pour cette raison qu’il le confia à Spielberg. Ce dernier, à force de vouloir respecter les volontés, le style et l’univers de son mentor, semble s’être perdu lui-même. Ni l’ironie de Kubrick, ni la chaleur de Spielberg n’ont survécu à ce mariage de raison. On en trouve seulement des simulacres, dans un grand film malade où le pessimisme et la mélancolie s’immiscent de toute part et où les sentiments exprimés semblent finalement aussi artificiels que l’intelligence du petit David.
© Gilles Penso
Partagez cet article
