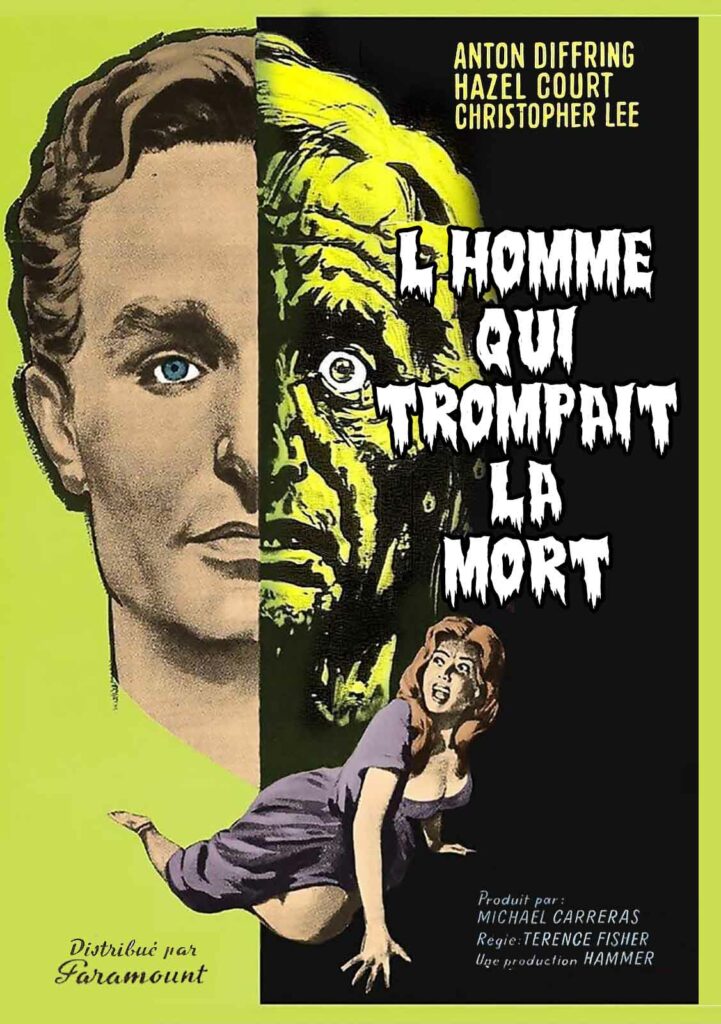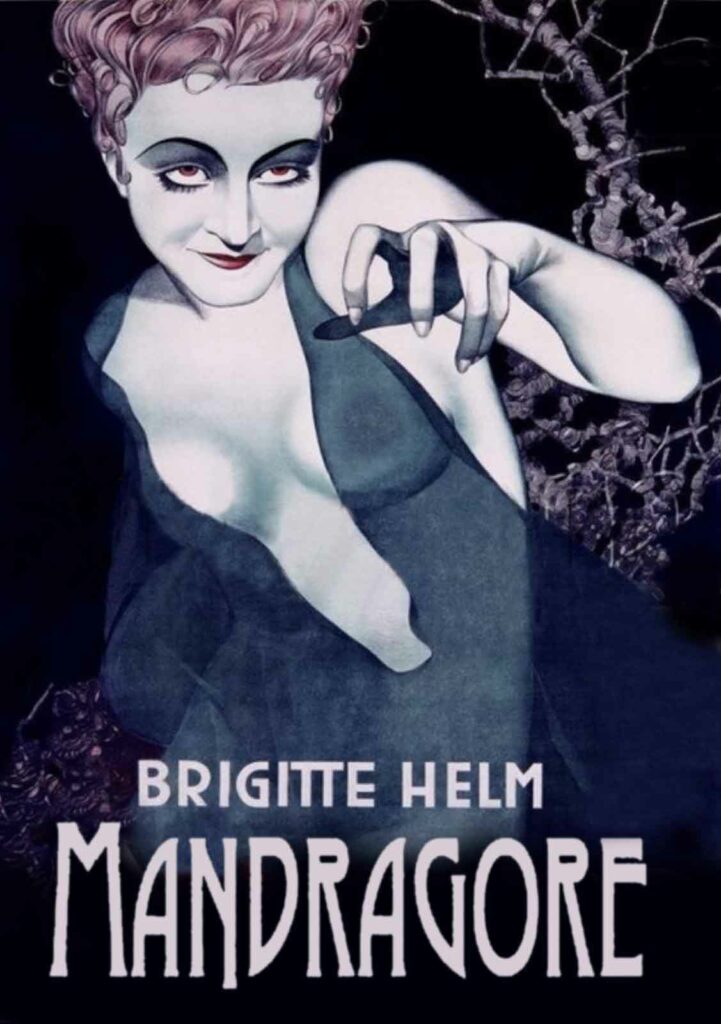Amoureux d’une femme qui a épousée son meilleur ami, un scientifique décide de la dupliquer grâce à une machine de son invention…
FOUR-SIDED TRIANGLE
1953 – GB
Réalisé par Terence Fisher
Avec Barbara Payton, James Hayter, Stephen Murray, John Van Eyssen, Percy Marmont, Jennifer Dearman, Glyn Dearman, Sean Barrett, Kynaston Reeves
THEMA DOUBLES
Quelques années avant de devenir le grand architecte du gothique de la Hammer, Terence Fisher se lance dans un film de science-fiction à petit budget adapté d’un roman de William F. Temple. Resté inédit en salles françaises, Le Triangle à quatre côtés n’a longtemps circulé que de manière très confidentielle, avant de connaître une discrète redécouverte à la télé et en DVD au début des années 2000. L’histoire se concentre sur deux amis d’enfance, Bill (Stephen Murray) et Robin (John Van Eyssen). Devenus scientifiques, ils conçoivent ensemble une machine capable de dupliquer la matière. Résultat : un objet copié n’est pas une imitation mais littéralement un second original, identique à l’atome près. L’expérience tourne à l’obsession lorsque Bill décide d’utiliser la machine pour créer un second exemplaire de leur amie commune Lena (Barbara Peyton), dont il est secrètement épris mais qui a choisi d’épouser Robin. Ainsi naît Helen, double parfait de Lena, identique dans son apparence et sa mémoire. Mais la duplication de l’amour se heurte à un paradoxe tragique : Helen, malgré son existence propre, reste amoureuse de Robin.


Ce postulat, simple et vertigineux, inscrit le film dans la grande tradition de la science-fiction morale, celle où la découverte scientifique met en lumière les zones d’ombre de l’âme humaine. La mise en scène de Fisher préfigure déjà son goût pour les laboratoires aux allures de sanctuaires. Car les scènes d’expérimentation, illuminées par des éclairs artificiels et des reflets de cornues, annoncent déjà Frankenstein s’est échappé. On sent le plaisir du cinéaste à manipuler l’espace clos, les lueurs froides et les instruments étranges. Mais si Le Triangle à quatre côtés emporte le morceau grâce à son concept fou et à son atmosphère, il souffre aussi d’un déséquilibre narratif. La dernière partie, plus mélodramatique, s’éloigne du potentiel tragique du roman. Là où la plume de Temple permettait de sonder la conscience du double, Fisher choisit une approche plus sentimentale, presque fataliste. Les questionnements scientifiques s’effacent au profit d’un drame de l’amour impossible. Ce parti pris empêche sans doute le film d’atteindre la fièvre romantique qu’un tel sujet pouvait inspirer.
Les dures lois de la géométrie
Les acteurs eux-mêmes contribuent à cette retenue. Stephen Murray compose un Bill plutôt rigide, tandis que John Van Eyssen (futur Jonathan Harker du Cauchemar de Dracula) incarne un Robin plus lisse que passionné. Quant à Barbara Peyton, l’interprète de Lena et de son double, elle peine malgré son charme à incarner cette figure idéalisée que convoitent les deux hommes. Son jeu parfois mécanique accentue involontairement l’étrangeté du sujet du film. James Hayter, dans le rôle du docteur Harvey, apporte un contrepoint bienvenu, celui du témoin moral, figure paternelle et raisonnable. Malgré ces limites, Le Triangle à quatre côtés demeure un jalon précieux de la carrière de Fisher. Non seulement il explore déjà ses obsessions pour le motif du double (qu’on retrouvera décliné tout au long de sa carrière, jusqu’à l’emblématique Les Deux visages du docteur Jekyll), mais il révèle aussi sa capacité à insuffler de la poésie dans la science-fiction. Œuvre mineure, certes, mais annonciatrice, Le Triangle à quatre côtés s’impose donc comme une sorte de brouillon fascinant, doublé d’une méditation sur l’amour et sur la tentation de défier les lois naturelles. Ce fameux motif de l’apprenti-sorcier deviendra l’enjeu majeur de Frankenstein s’est échappé quatre ans plus tard.
© Gilles Penso
À découvrir dans le même genre…
Partagez cet article