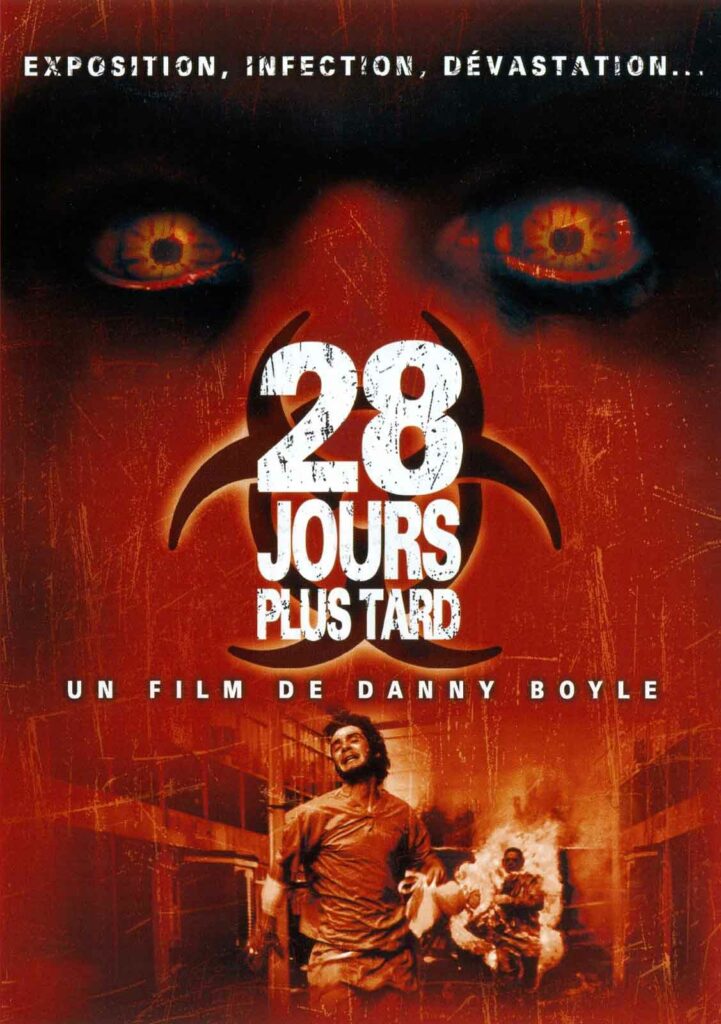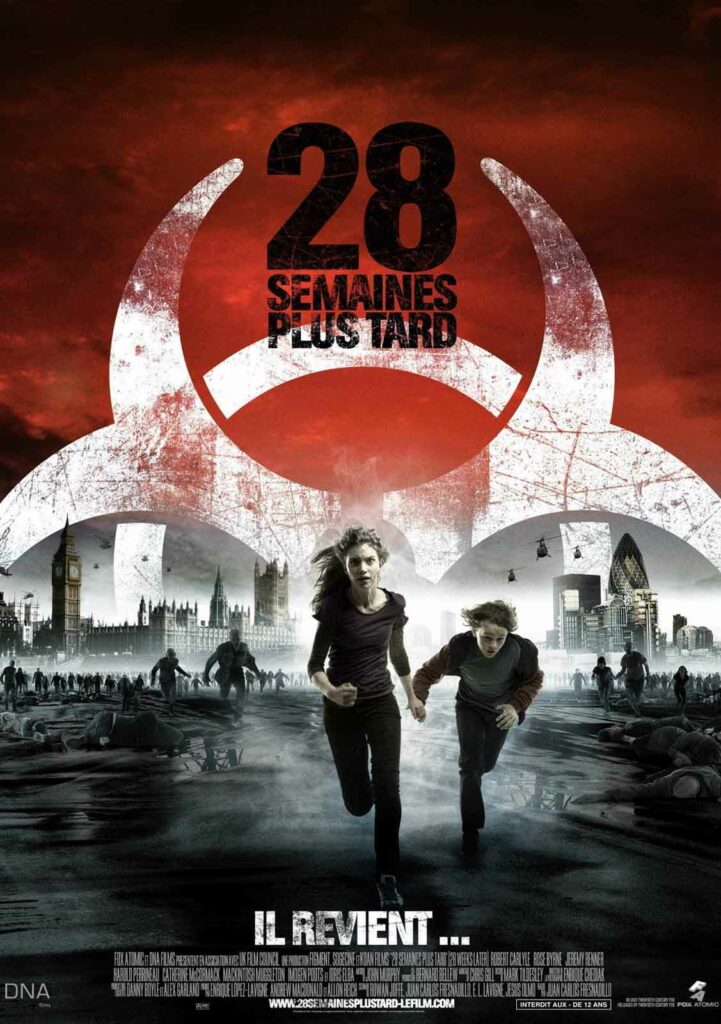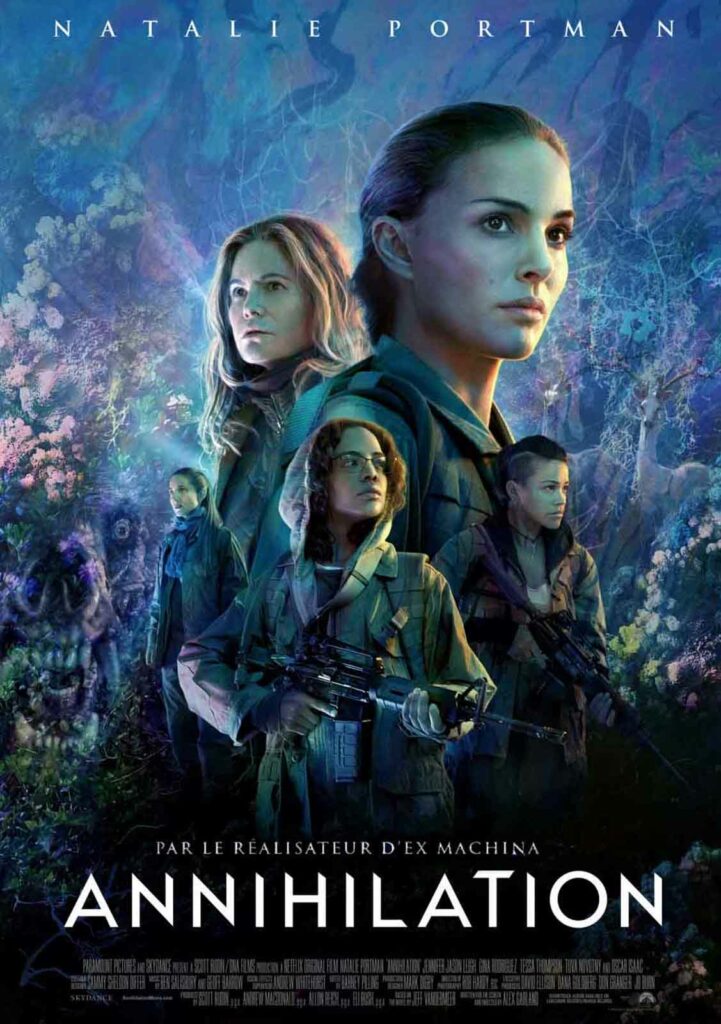Une suite tardive de 28 jours plus tard, dans laquelle un village de survivants s’organise pour vivre au milieu des infectés…
28 YEARS LATER
2025 – GB
Réalisé par Danny Boyle
Avec Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer, Alfie Williams, Ralph Fiennes, Chris Fulford, Emma Laird, Edvin Ryding, Jack O’Connell, Erin Kellyman, Chi Lewis-Parry
THEMA ZOMBIES I SAGA 28 JOURS PLUS TARD
Après 28 jours plus tard en 2002 et 28 semaines plus tard en 2007, 28 ans plus tard débarque enfin en 2025, le temps de l’action du film prenant cette fois de l’avance sur le calendrier réel. Et pourquoi ne pas avoir intitulé ce troisième volet « 28 mois plus tard » ? Il faut savoir que l’excellente suite façon Aliens réalisée par Juan Carlos Fresndillo était une production Fox Atomic, une filiale morte-née de la Fox qui a emmené les droits de la franchise avec elle dans son naufrage, ce qui explique que ce nouvel opus ait mis autant de temps à se monter, après que Sony Pictures ne les récupère. Danny Boyle et Alex Garland, respectivement réalisateur et scénariste de l’original, n’avaient d’ailleurs pas été directement impliqués dans ce projet. En effectuant un bond de 28 ans en avant dans l’histoire, ils évitent ainsi de devoir coller à 28 semaines plus tard, dont la fin ouverte aurait imposé de situer l’action en France après un laps de temps finalement peu déterminant pour la situation socio-politique de l’intrigue. Ce nouvel opus se présente à la fois comme une excroissance de 28 jours plus tard et un film indépendant, pour ne pas laisser les potentiels nouveaux spectateurs sur le carreau. Boyle revient à ses « zombies » avec le même élan rétro-créatif qui l’avait amené à réaliser la suite tardive de Trainspotting en 2017. Mais entretemps, Alex Garland est devenu lui-même un cinéaste accompli. Il affirme ne pas avoir mis un pied sur le tournage ou dans la salle de montage, ne voulant pas souffler de directives à l’oreille de Danny Boyle. Pourtant, si la réalisation porte bien la patte de ce dernier, les thématiques et la structure de 28 ans plus tard en font une œuvre à part entière de la filmographie de Garland.


28 ans plus tard : le virus ne s’est pas répandu dans le monde entier et a pu être circonscrit en Grande-Bretagne. Le territoire se retrouvant dès lors confiné, les survivants abandonnés à leur sort doivent s’organiser pour survivre en cohabitant avec les infectés. Alex Garland ne cherche pas à souligner la métaphore du Brexit, tout juste évoque-t-il le fait que la situation a forcément influencé son écriture avec ce qu’il décrit comme un « Brexit inversé » : « L’Angleterre a décidé de se couper de l’Europe mais dans mon scénario, c’est l’Europe qui isole le pays pour empêcher la propagation du virus. Le reste du monde peut se passer de nous. » (1) Il est intéressant de voir que la société décrite dans le film n’a ainsi rien à voir par exemple avec celle de Doomsday : les survivants vivent dans un petit village construit sur un îlot accessible uniquement à marée basse (une configuration qui donnera lieu à une très efficace course-poursuite), leur quotidien ressemblant à la vie rurale de la première moitié du 20ème siècle, jusqu’à l’absence d’armes à feu, remplacées par des arcs et des flèches. La réalisation de Danny Boyle conserve une certaine énergie « punk » dans sa façon d’établir parfois ses propres règles, à coup de mouvements de caméra et décadrages nerveux. Et puisqu’il avait choisi de tourner 28 jours plus tard avec de simples caméscopes numériques pour conférer un aspect plus cru et réaliste à l’image, il choisit de tourner cette suite avec le dernier iPhone en date (Steven Soderberg l’ayant devancé sur ce point avec Paranoïa en 2018) et nous immerge dans la campagne verdoyante du Royaume-Uni. Un parti-pris figurant bien sûr dans le scénario d’Alex Garland, qui s’inscrit dans la continuité thématique de ses réalisations précédentes.
Bienvenue à Zombie-Garland
Dans Ex Machina, Annihilation, Men et Civil War, les espaces forestiers omniprésents représentaient parfois un refuge, un havre de paix ou au contraire un territoire hostile. Dans tous les cas, la forêt/campagne figurait toujours une zone de non-droit pour les humains, la Nature n’étant pas « méchante », simplement sans pitié. Garland envoie ses protagonistes explorer une zone hostile (cf. Annihilation et Civil War) dans laquelle la Nature a repris ses droits : pas de villes délabrées à l’horizon, juste des forêts et des prairies à perte de vue. L’être humain y est insignifiant et Boyle explique avoir voulu montrer la nature « au naturel », telle que nous l’avions nous-mêmes laissée pendant le confinement de 2020. Il introduit également les alphas dans les hordes d’infectés, leur conférant ainsi un semblant d’organisation sociale et donc d’humanité, ce qu’illustrera la scène de l’accouchement d’une infectée dont l’instinct maternel occasionnera une trêve forcée avec le personnage interprété par Jody Comer. Mais si les mères savent faire la paix, les pères eux, ne savent faire que la guerre. D’ailleurs, l’alpha infecté n’est-il pas le reflet du personnage d’Aaron Taylor-Johnson ? Le double est un autre thème récurrent du cinéma de Garland : dans Ex Machina, l’humain se confondait avec la machine ; dans Annihilation, l’effet miroir était encore plus prononcé avec la « zone » qui clonait littéralement les lieux et les personnes. Ici, il se confond avec son double primitif. Le film est d’ailleurs lui-même découpé en deux parties thématiquement opposées (le père apprenant au fils à donner la mort et ce dernier cherchant ensuite à préserver la vie de sa mère malade) auxquelles le personnage de Ralph Fiennes apportera une alternative, un équilibre dans ce parcours initiatique : en honorant les morts, il célèbre avant tout la vie…
(1) Extrait d’un entretien publié sur le site Film Stories en juin 2025
© Jérôme Muslewski
À découvrir dans le même genre…
Partagez cet article