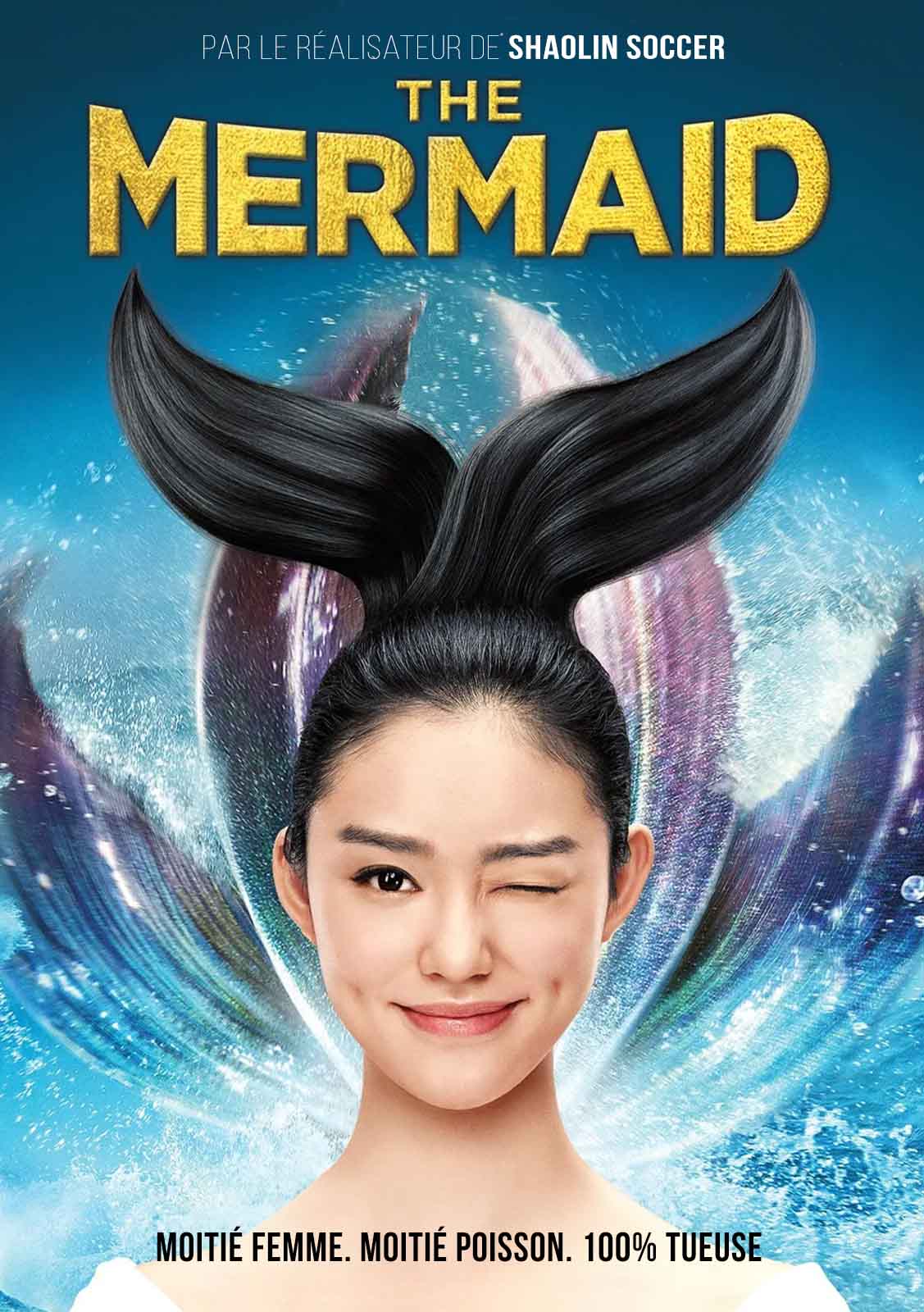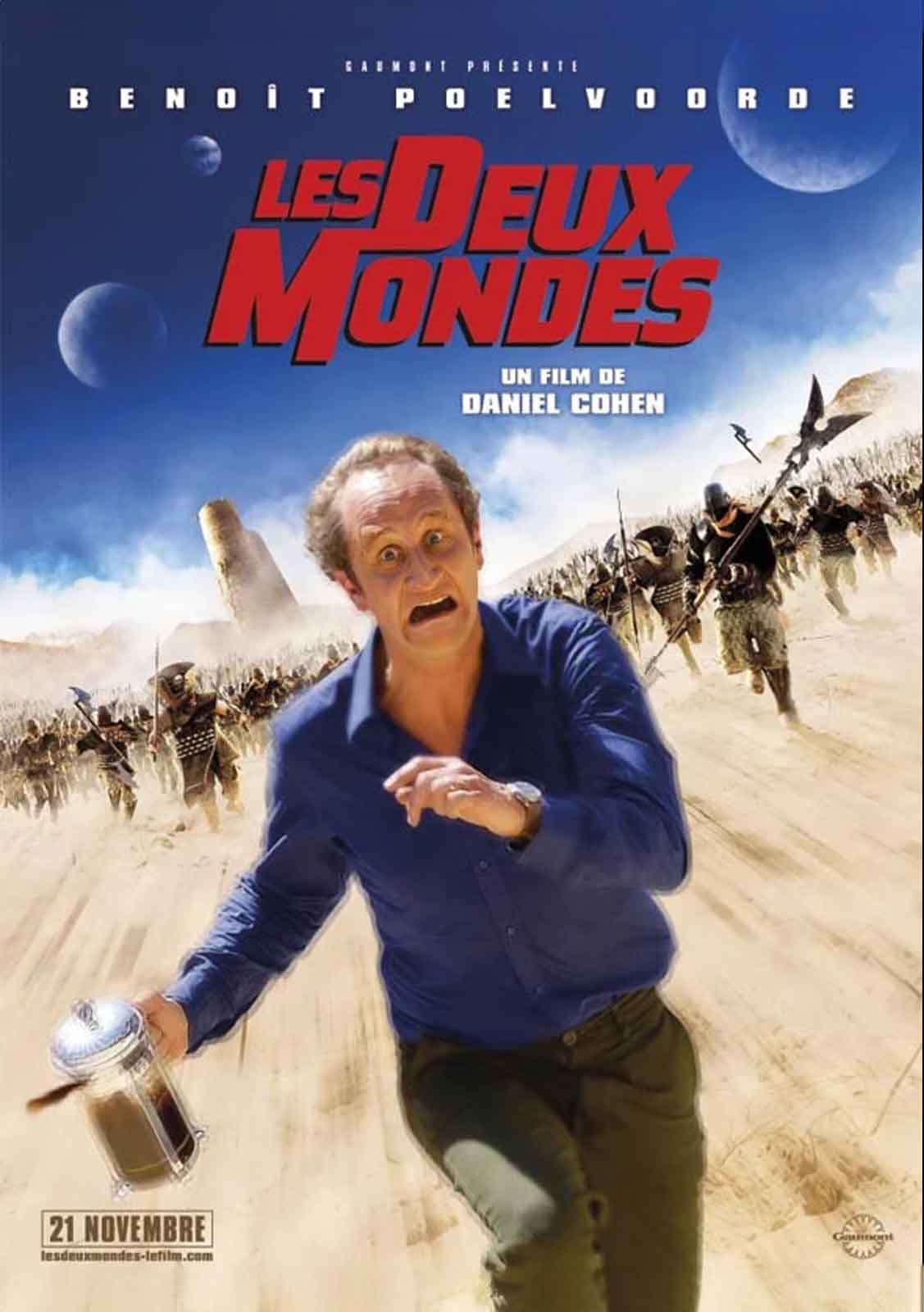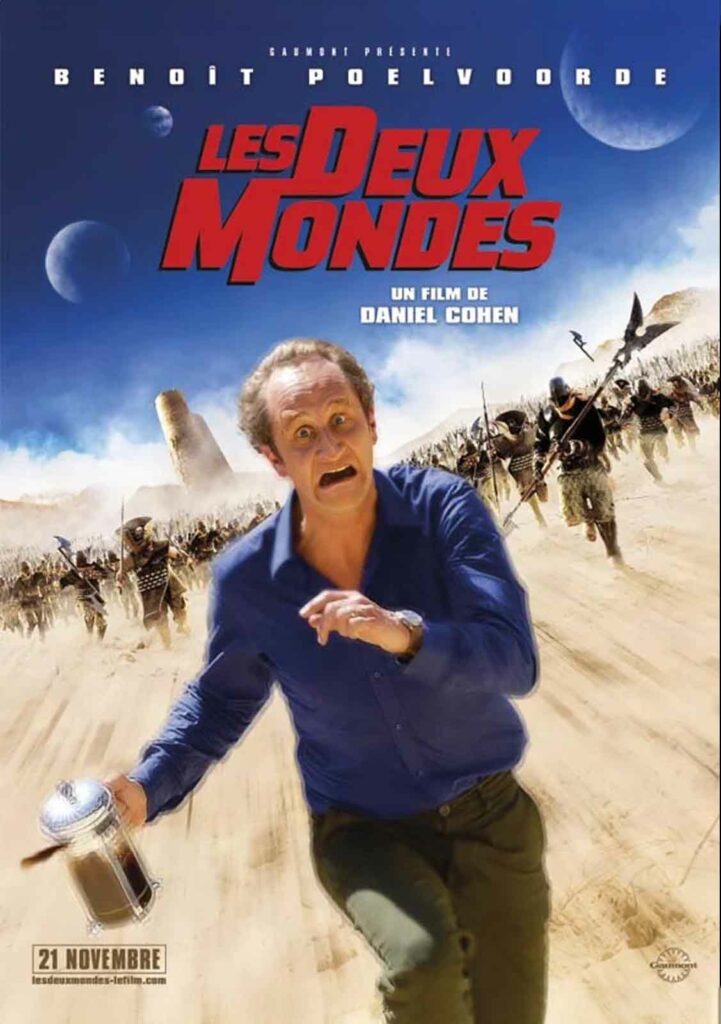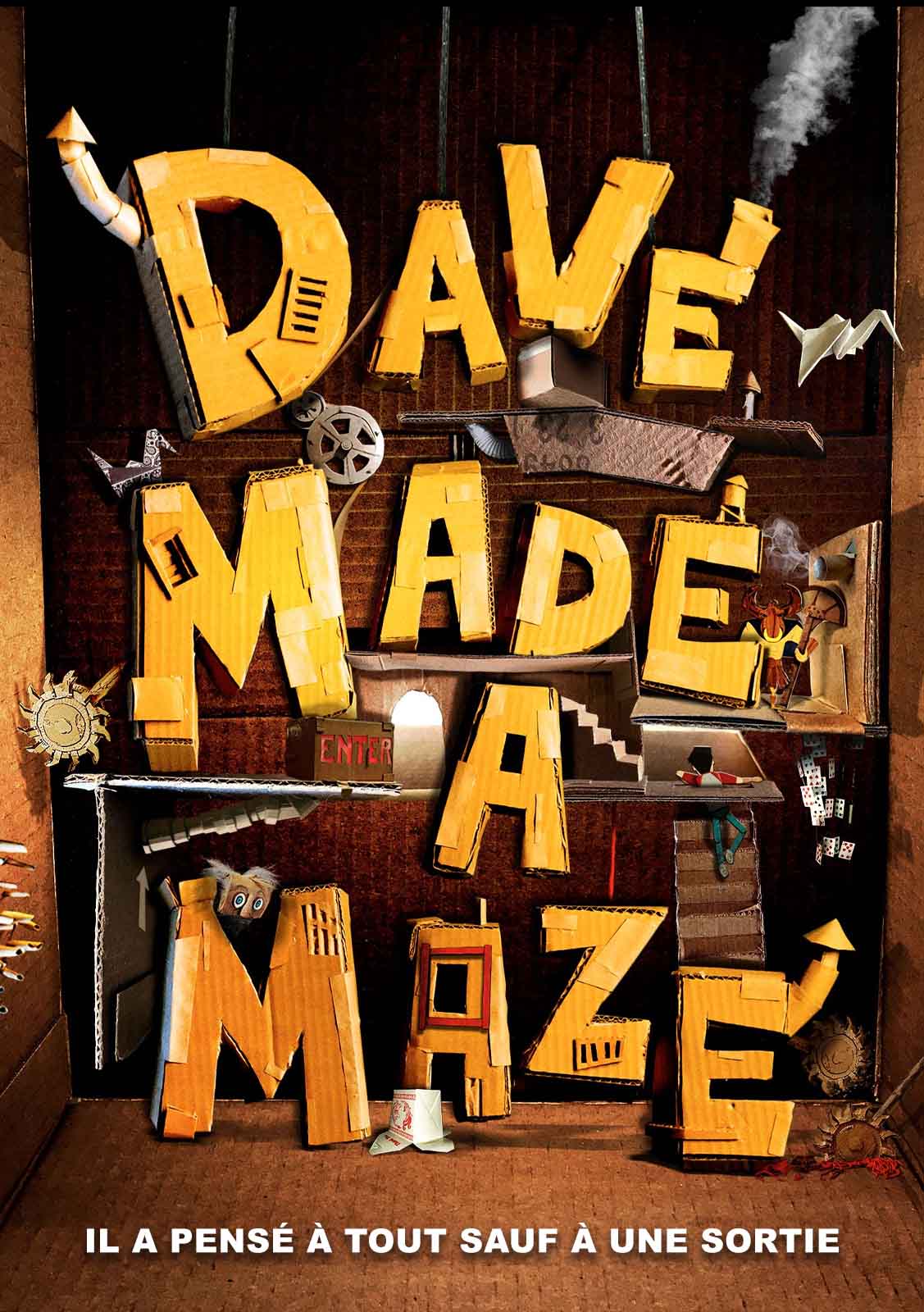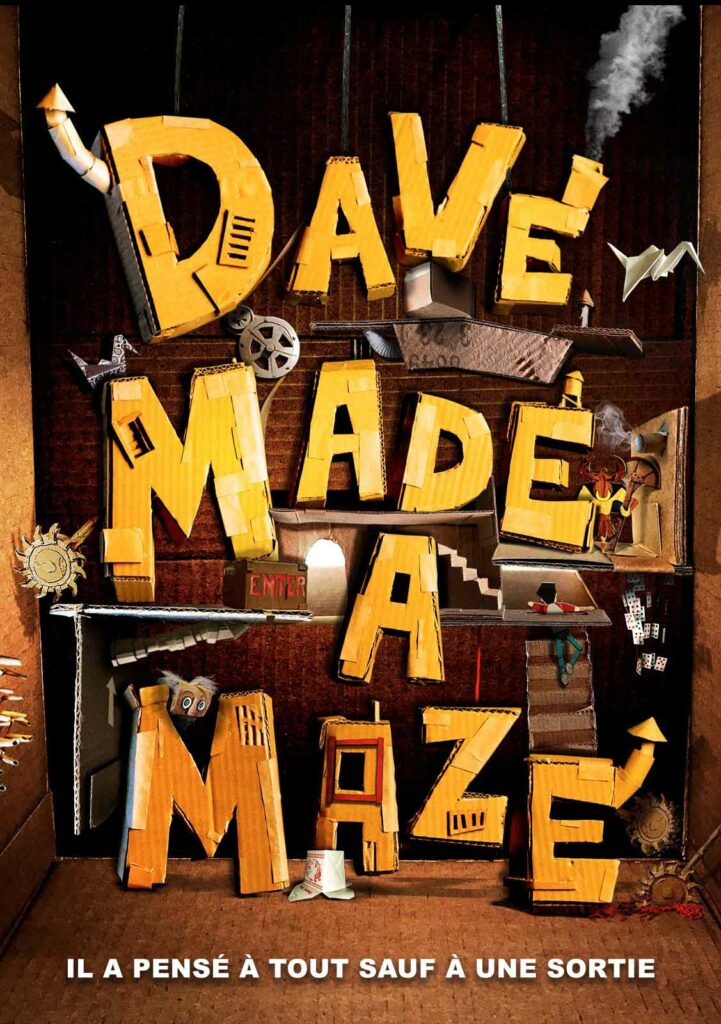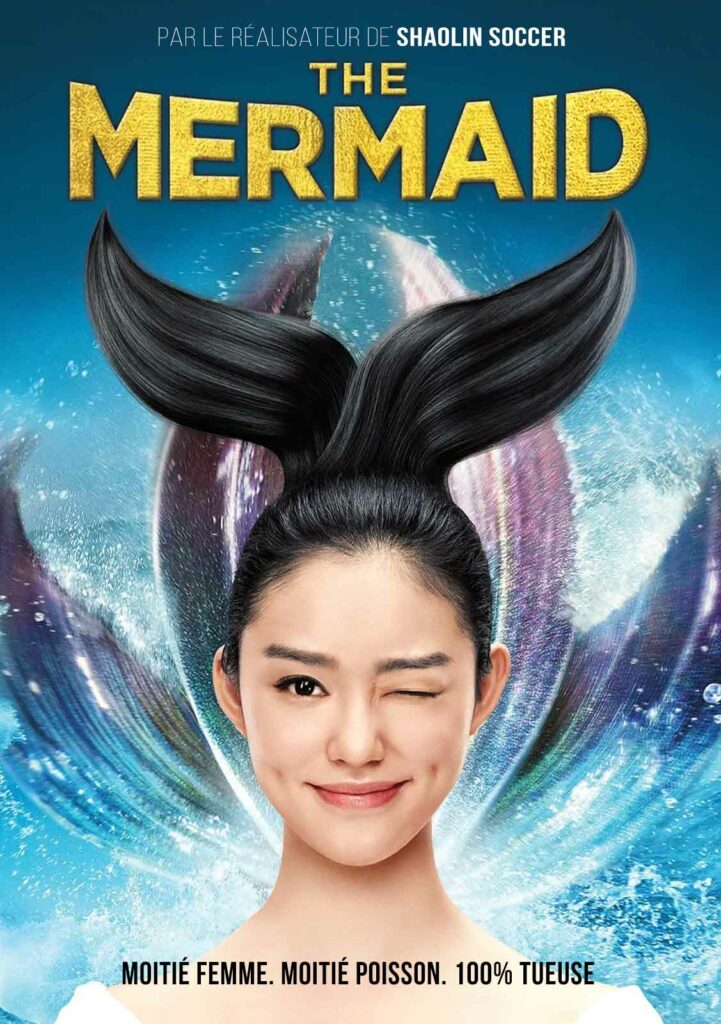
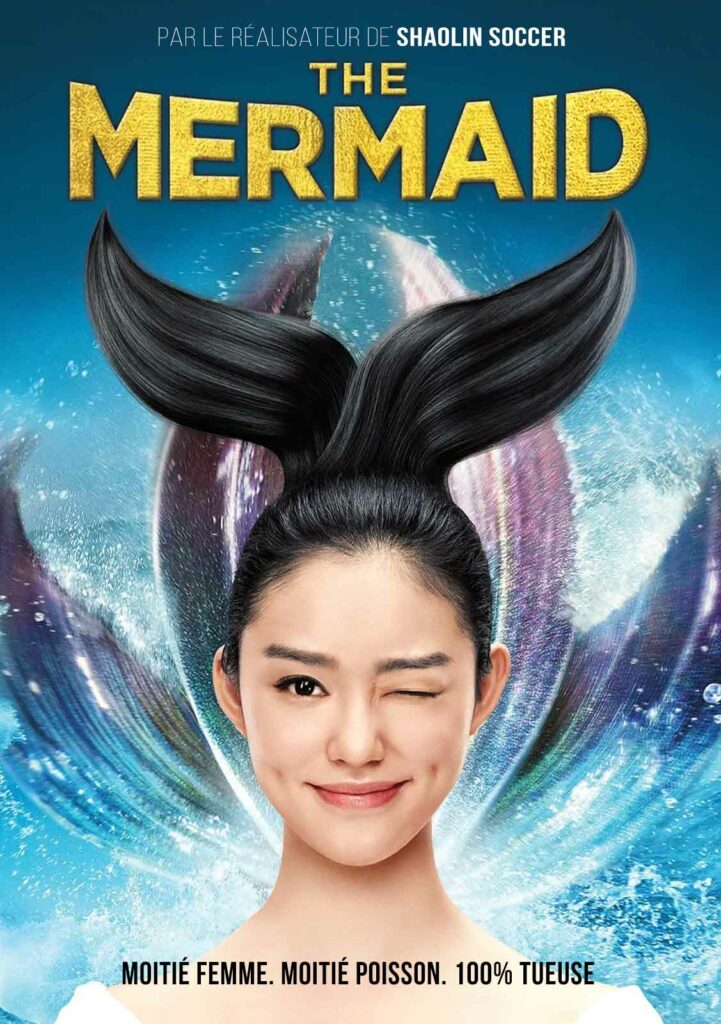
Le réalisateur de Shaolin Soccer réinvente La Petite sirène sous un angle joyeusement délirant en ne reculant devant aucun excès…
MEI REN YU
2016 – HONG-KONG
Réalisé par Stephen Chow
Avec Deng Chao, Lin Yun, Show Lo, Zhang Yuqi, Kris Wu, Lu Zhengyu, Fan Shuhzen, Li Shangzheng, Bo Xiaolong, Pierre Bourdaud, Ivan Kotik
THEMA MONSTRES MARINS I CONTES
Bons baisers de Pékin, Shaolin Soccer, Crazy Kung Fu… Les films réalisés par Stephen Chow (acteur prolifique et versatile depuis le début des années 80 avant son passage derrière la caméra en 1994), témoignent tous de son penchant pour la comédie débridée et les excès en tous genres. À l’occasion de son dixième long-métrage en tant que metteur en scène, Chow décide de s’attaquer frontalement à la mécanique du conte de fées. « Je suis un grand amateur des contes, et d’ailleurs tous mes films précédents peuvent être considérés comme des contes d’une certaine manière », déclarait-il à l’époque. « Dans le monde des contes de fées, les méchants sont punis et les gentils connaissent une fin heureuse. J’adhère à cette idée. » (1) La fable folklorique qu’il décide de revisiter est « La Petite sirène » d’Hans Christian Andersen, dans la mesure où lui-même entretient une relation de fascination/crainte de l’océan depuis sa plus tendre enfance. « J’ai vécu près de la mer très jeune et je la regardais tous les jours », raconte-t-il. « J’étais à la fois effrayé et curieux. Il m’arrivait d’être très nerveux lorsque je nageais dans la mer parce que j’avais l’impression que quelque chose pouvait s’y cacher » (2). Son sujet étant tout trouvé, il lui reste à dénicher la perle rare susceptible de donner corps à sa sirène. Après un casting monumental ayant sollicité 120 000 participantes, c’est la délicieuse Lin Yun, alors âgée de 18 ans, qui emporte le morceau.


The Mermaid nous apprend que Liu Xuan (Deng Chao), magnat de l’immobilier, playboy et millionnaire excentrique, a fait l’acquisition de la réserve naturelle côtière du Golfe Vert. Son projet consiste à assécher les marais littoraux pour en faire des terres cultivables, quitte à y éliminer toute vie marine. Ce que tout le monde à la surface ignore, c’est que le Golfe Vert est le sanctuaire d’une communauté de sirènes et de tritons qui se retrouvent décimés en masse à cause de la présence des sonars marins installés par le riche entrepreneur. Les quelques survivants vivent désormais dans une épave abandonnée et décident de contre-attaquer. L’une des créatures légendaires, une jeune sirène qui a été entraînée à marcher sur ses nageoires et à se cacher parmi les humains, va donc se faire passer pour une fille normale dans le but de séduire Liu Xuan et de l’assassiner. Le plan semble théoriquement infaillible. Mais rien ne va se passer comme prévu…
Toutes les facettes du cinéma comique
Pour les besoins de ce scénario rocambolesque co-écrit par huit auteurs, Stephen Chow sollicite toutes les facettes du cinéma comique, depuis le dialogue absurde (la scène hilarante du témoignage dans le commissariat) jusqu’à l’enchaînement de gags cartoonesques (les tentatives d’assassinat désastreuses) en passant par le pastiche exubérant (la séquence reprenant les codes de la comédie musicale). Si l’on accepte de jouer le jeu et d’entrer dans le délire du cinéaste, The Mermaid se révèle très drôle puis nous prend par surprise en changeant brusquement de ton lors de son dernier acte, au cours d’une fusillade finale sanglante et dramatique, avant de reprendre ses atours de conte fantasmagorique aux allures de plaidoyer pour la préservation de l’environnement. Seule ombre au tableau : de nombreux effets numériques bâclés qui gâchent un peu le spectacle. Très admiratif du travail de Stephen Chow, le producteur/réalisateur Tsui Hark participe au film en jouant l’un des rôles principaux, juste pour le plaisir de voir travailler son confrère. Gigantesque succès au box-office, The Mermaid rapportera près de dix fois son budget de départ.
(1) Extrait d’une interview publiée dans China Daily en février 2016
(2) Extrait d’une interview publiée dans Beijing Youth Daily en février 2016
© Gilles Penso
Partagez cet article