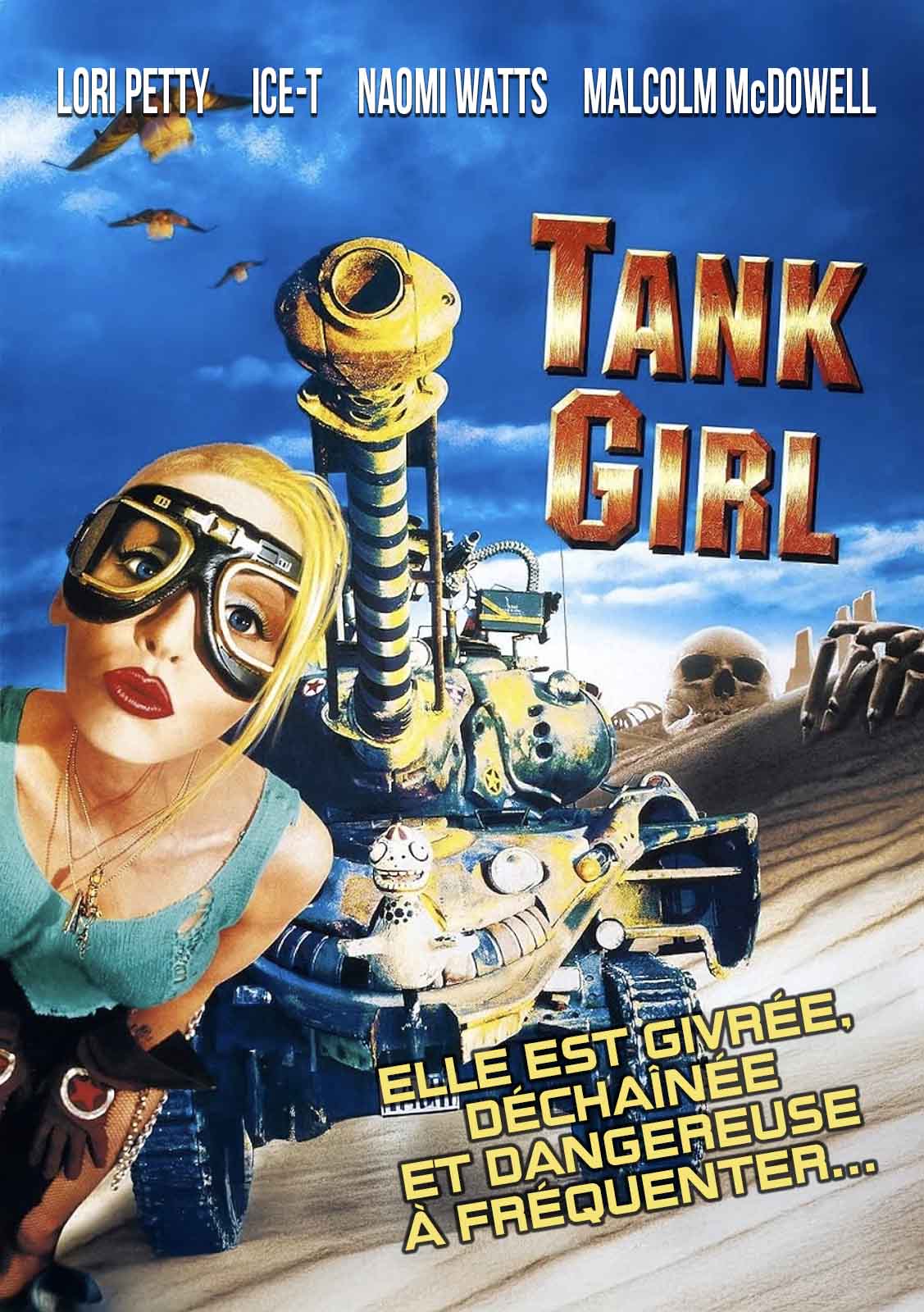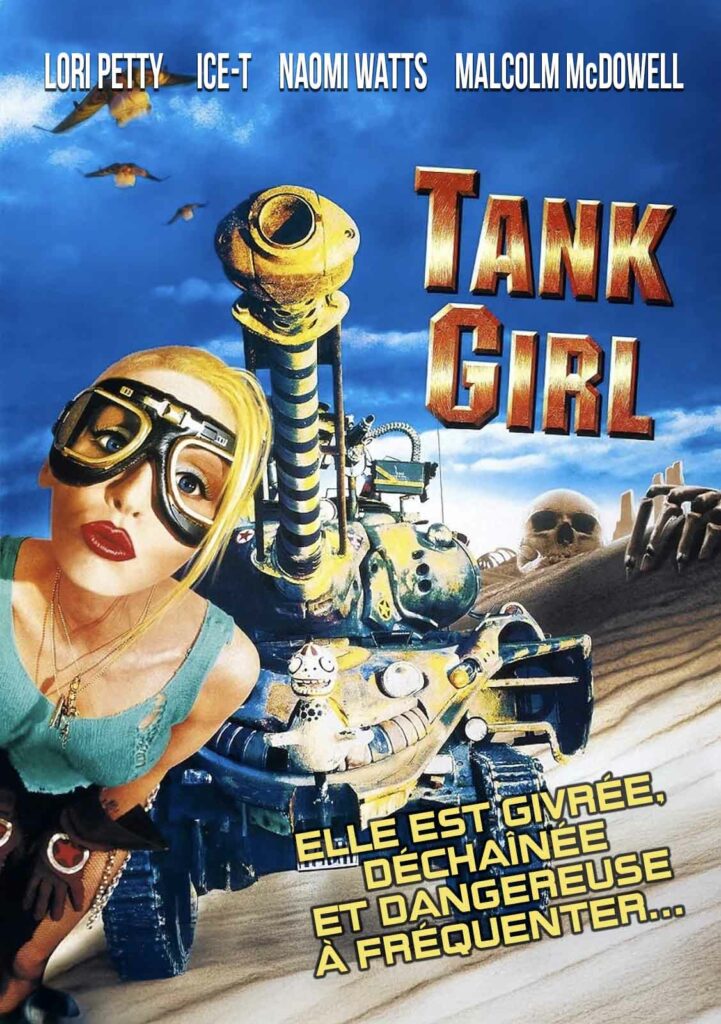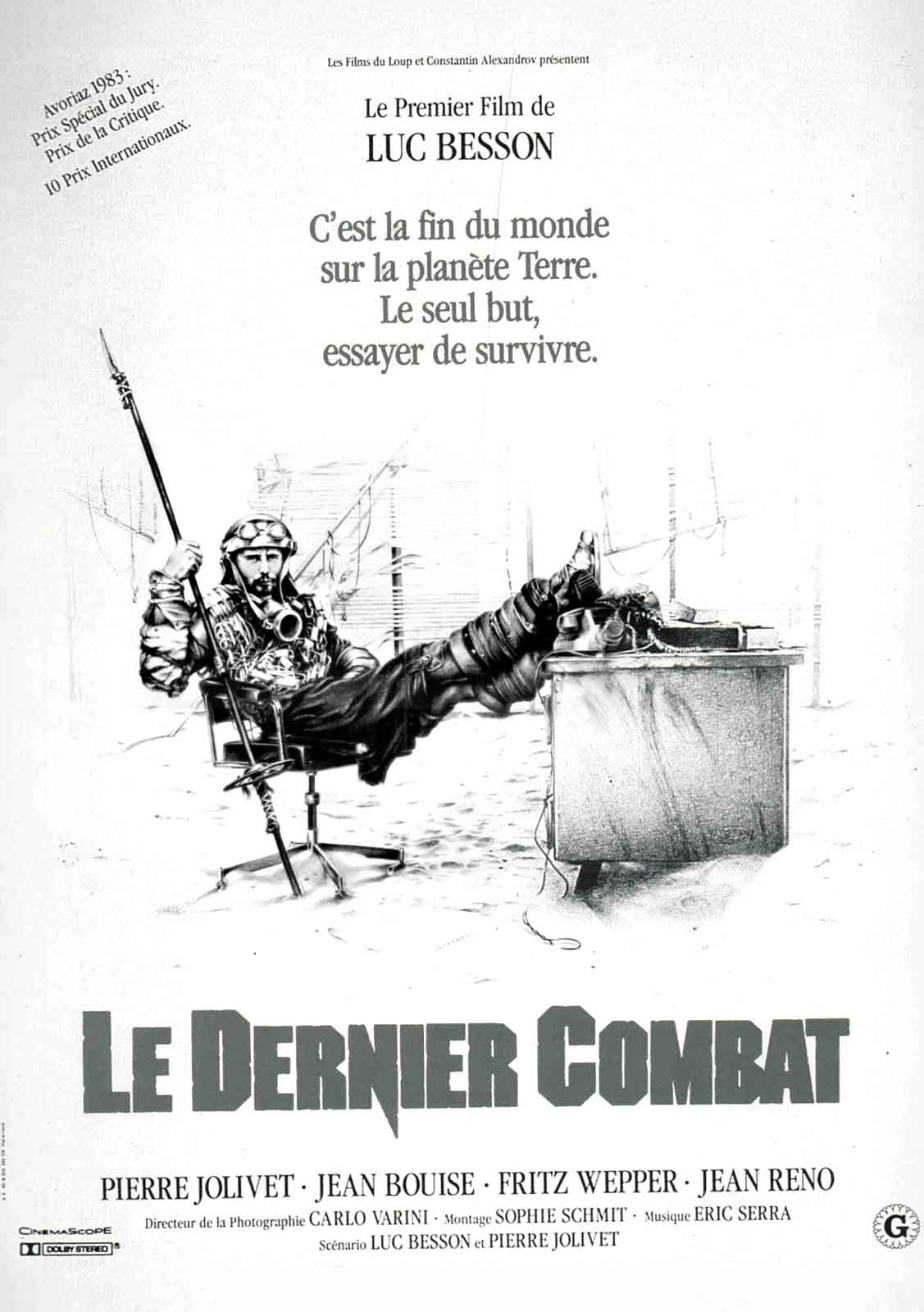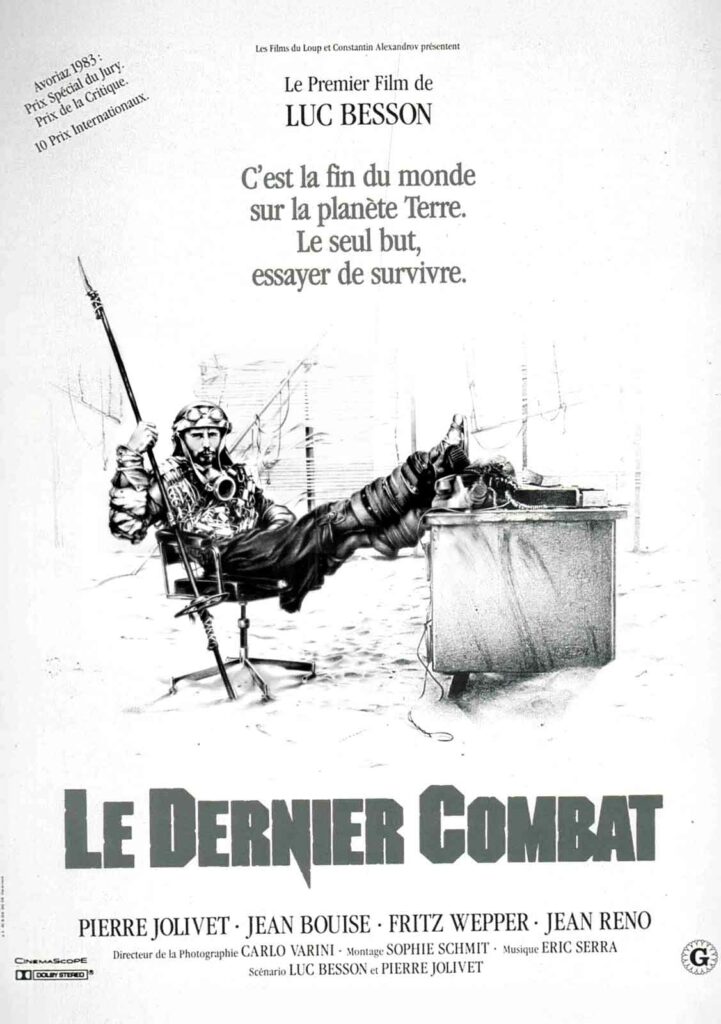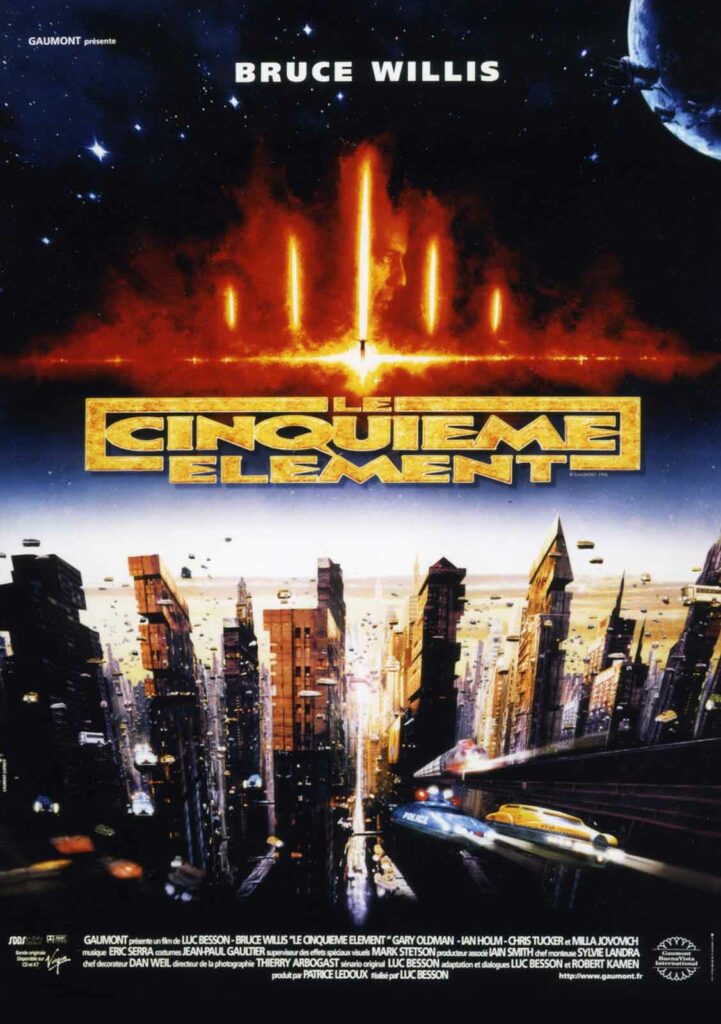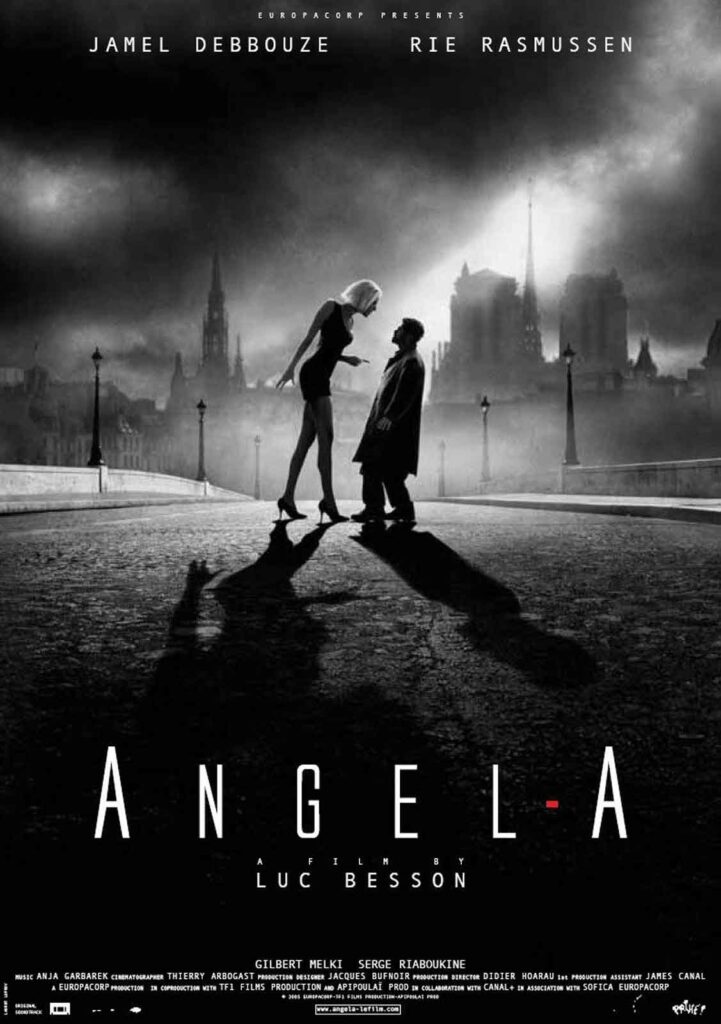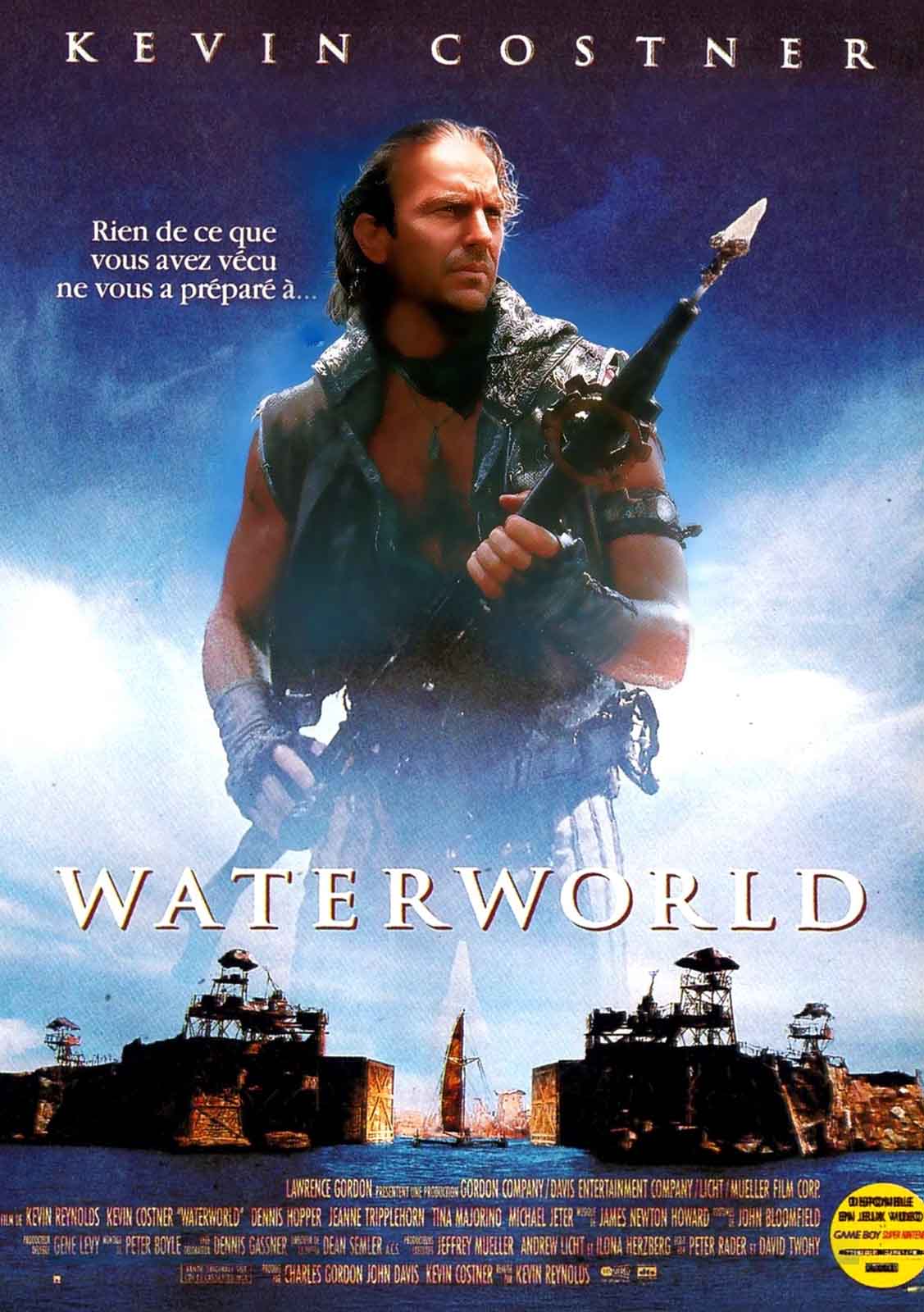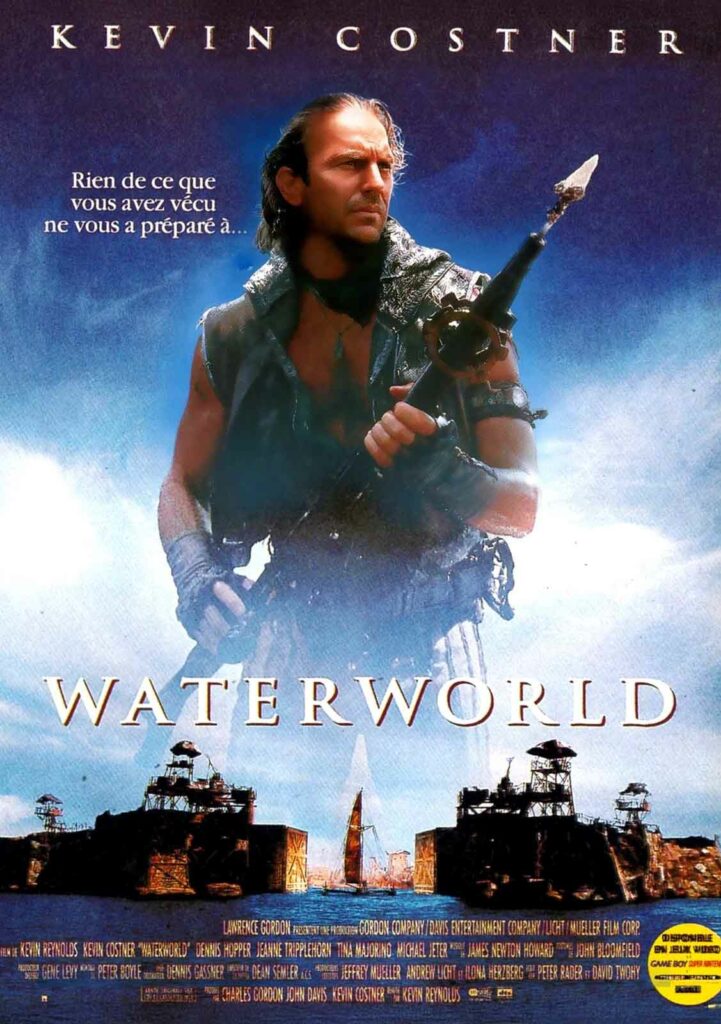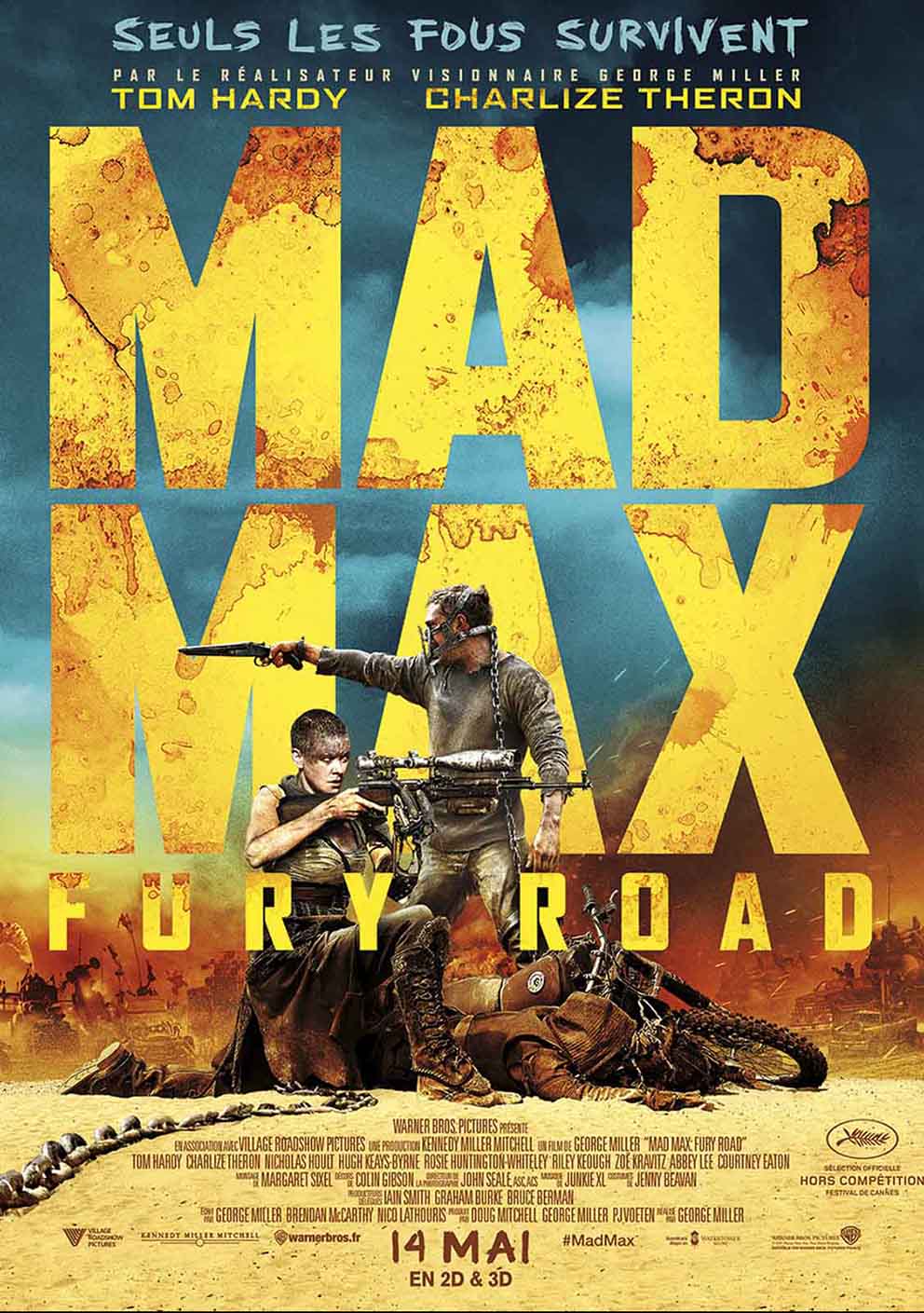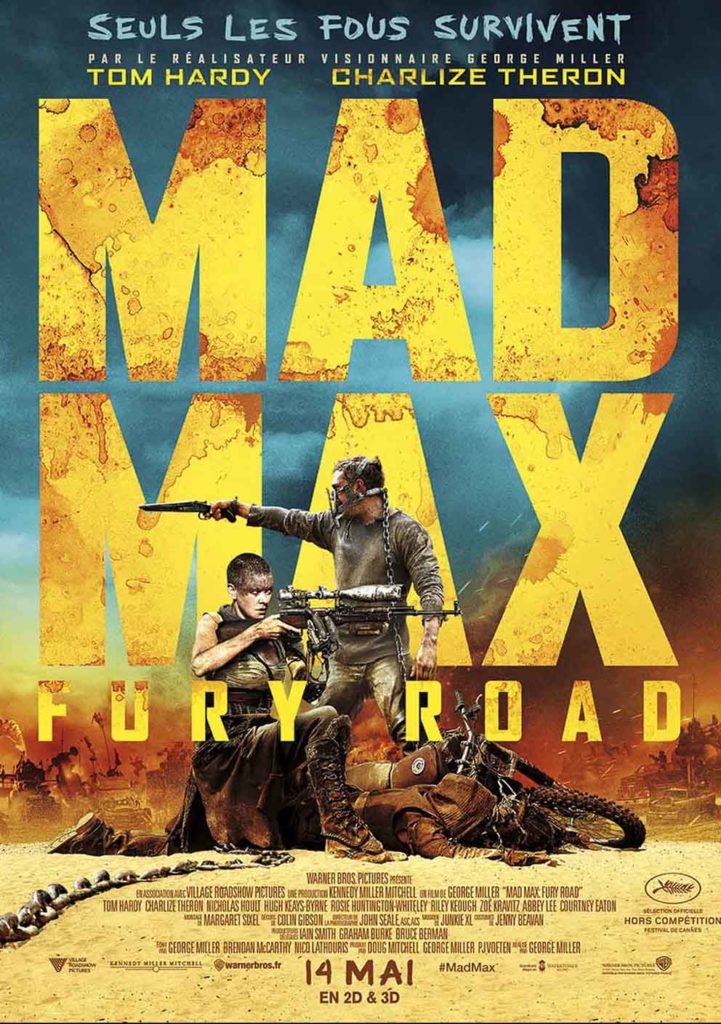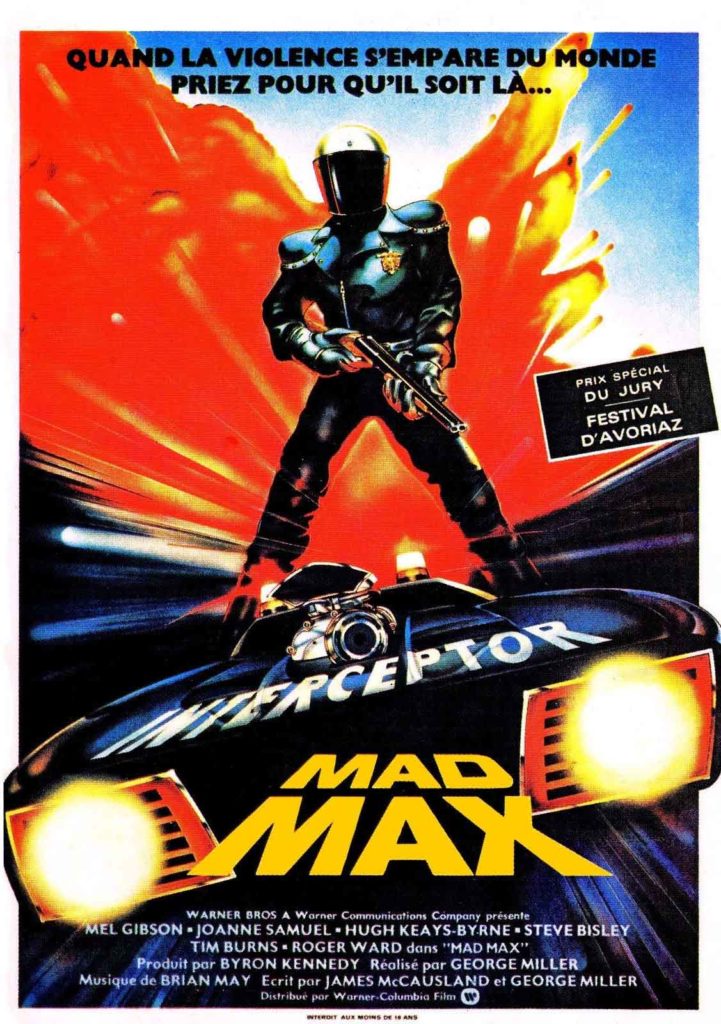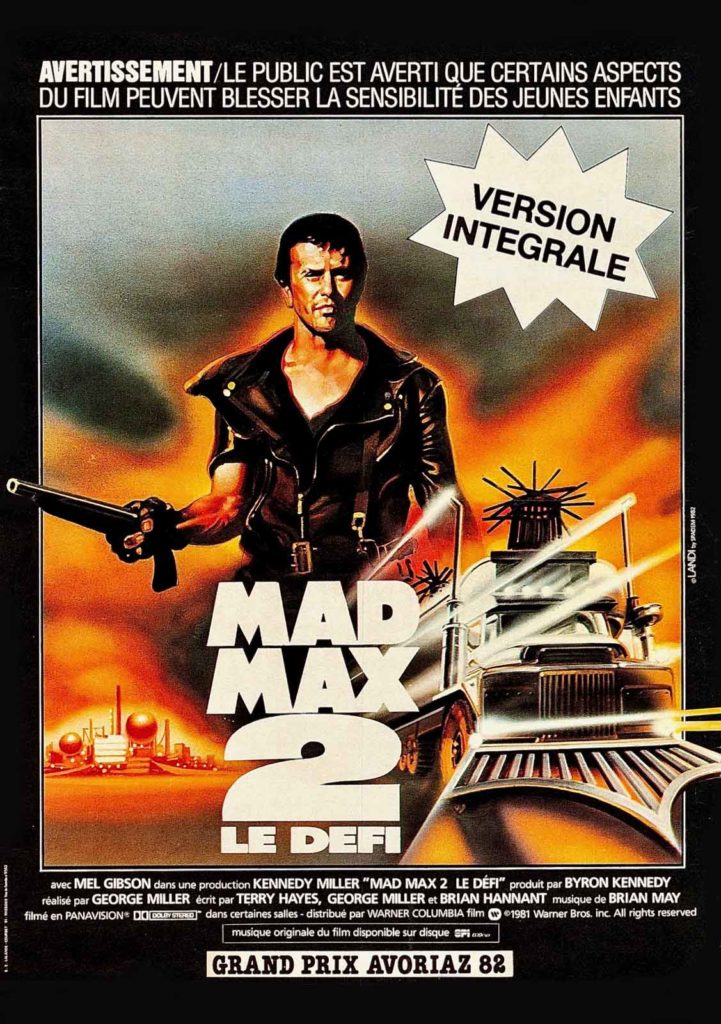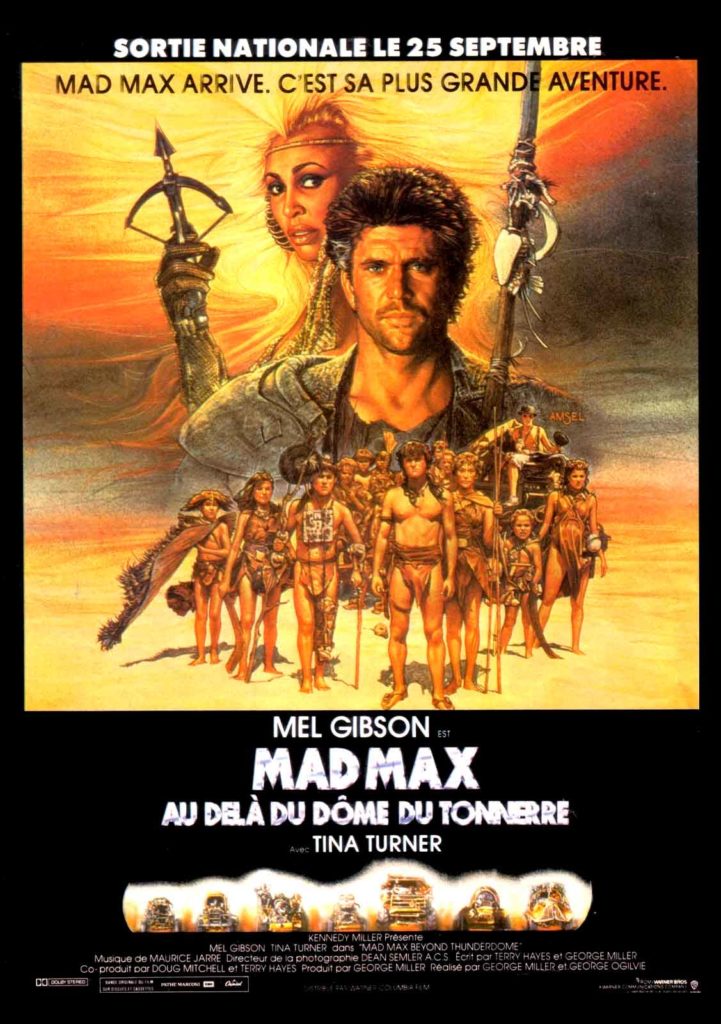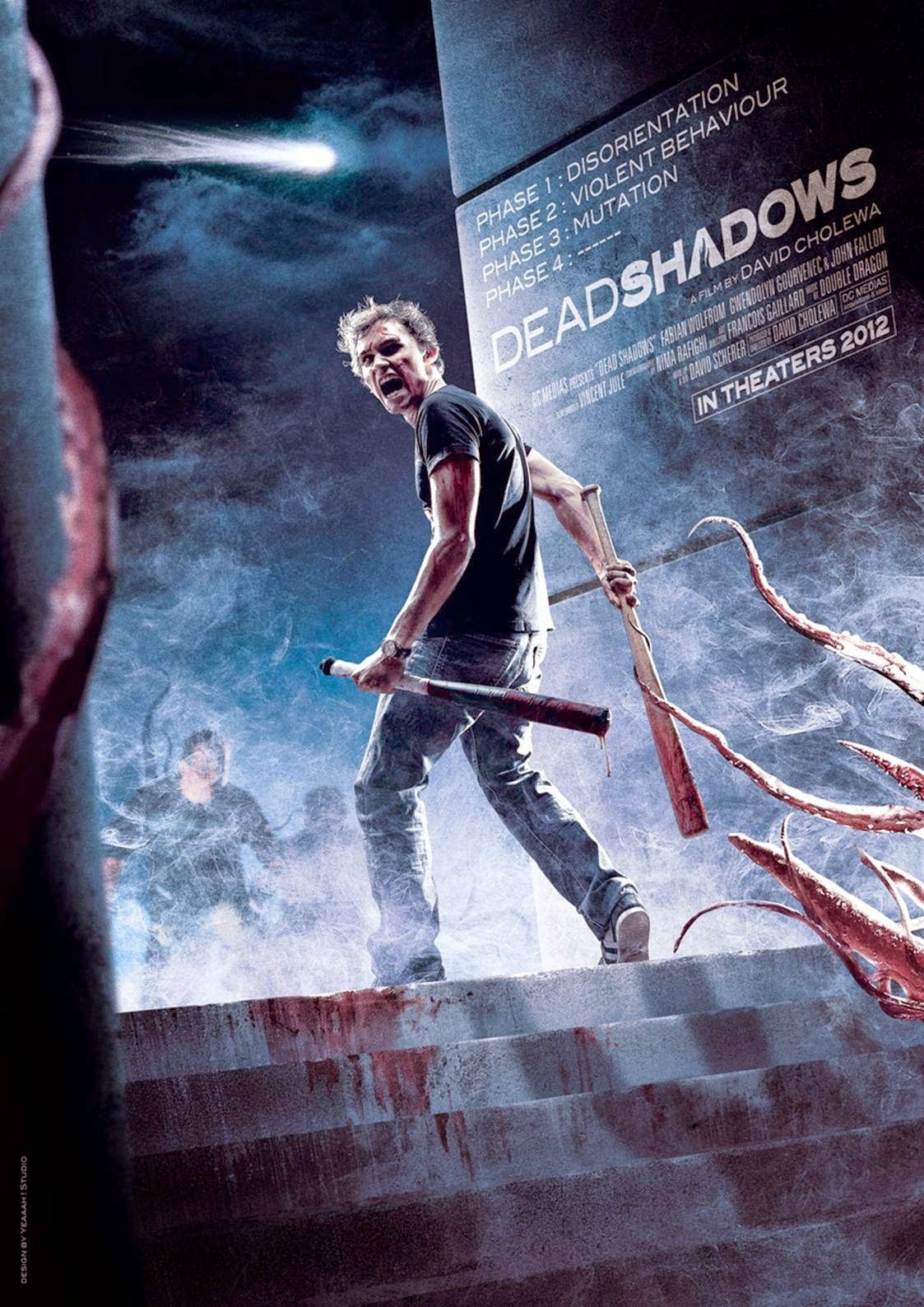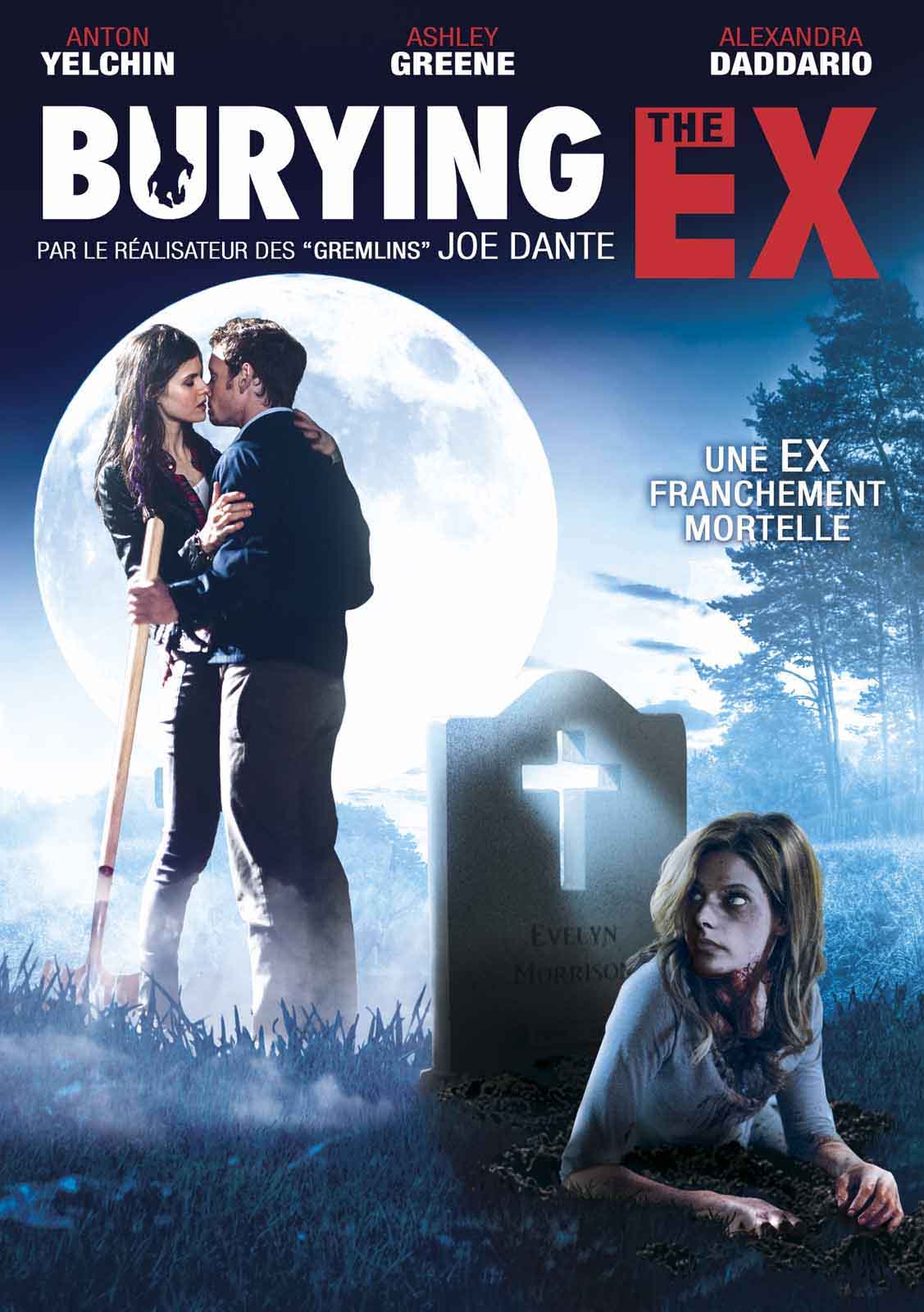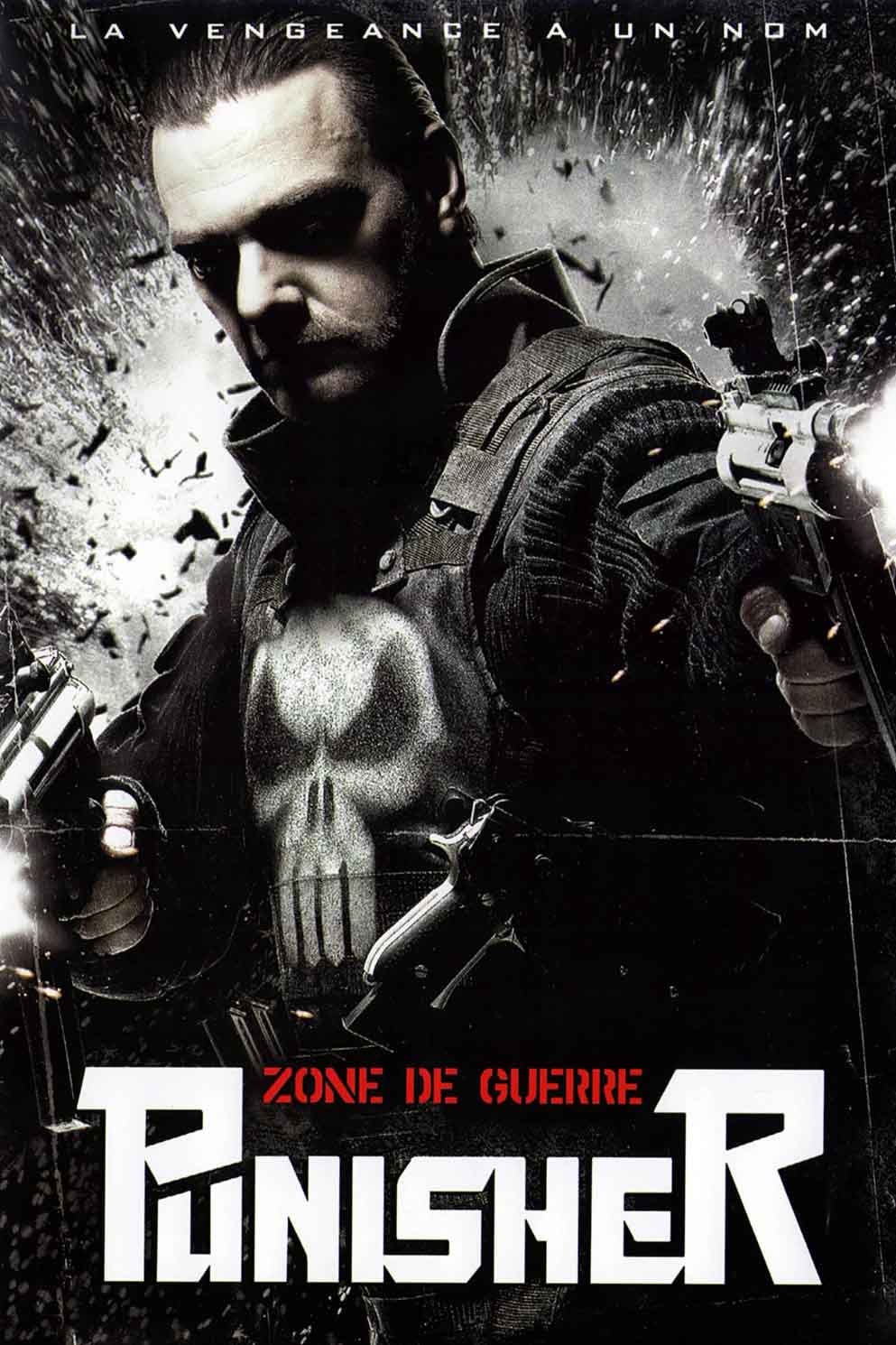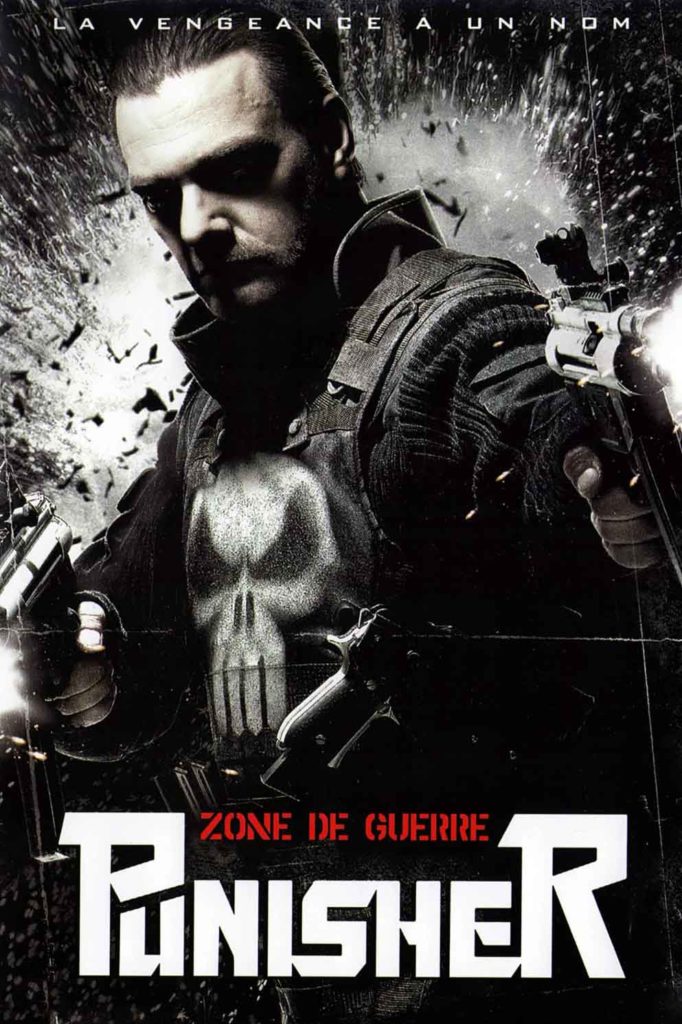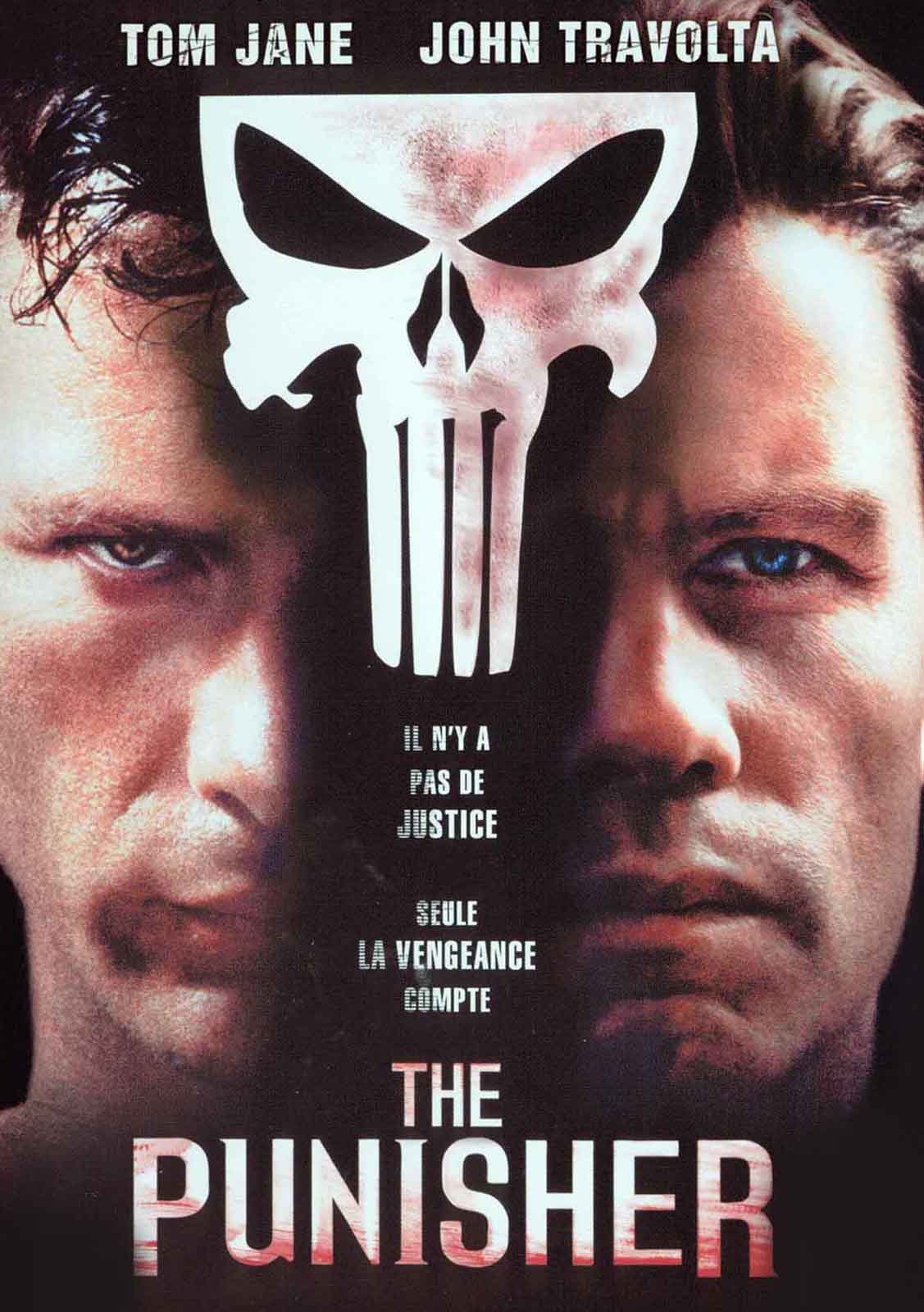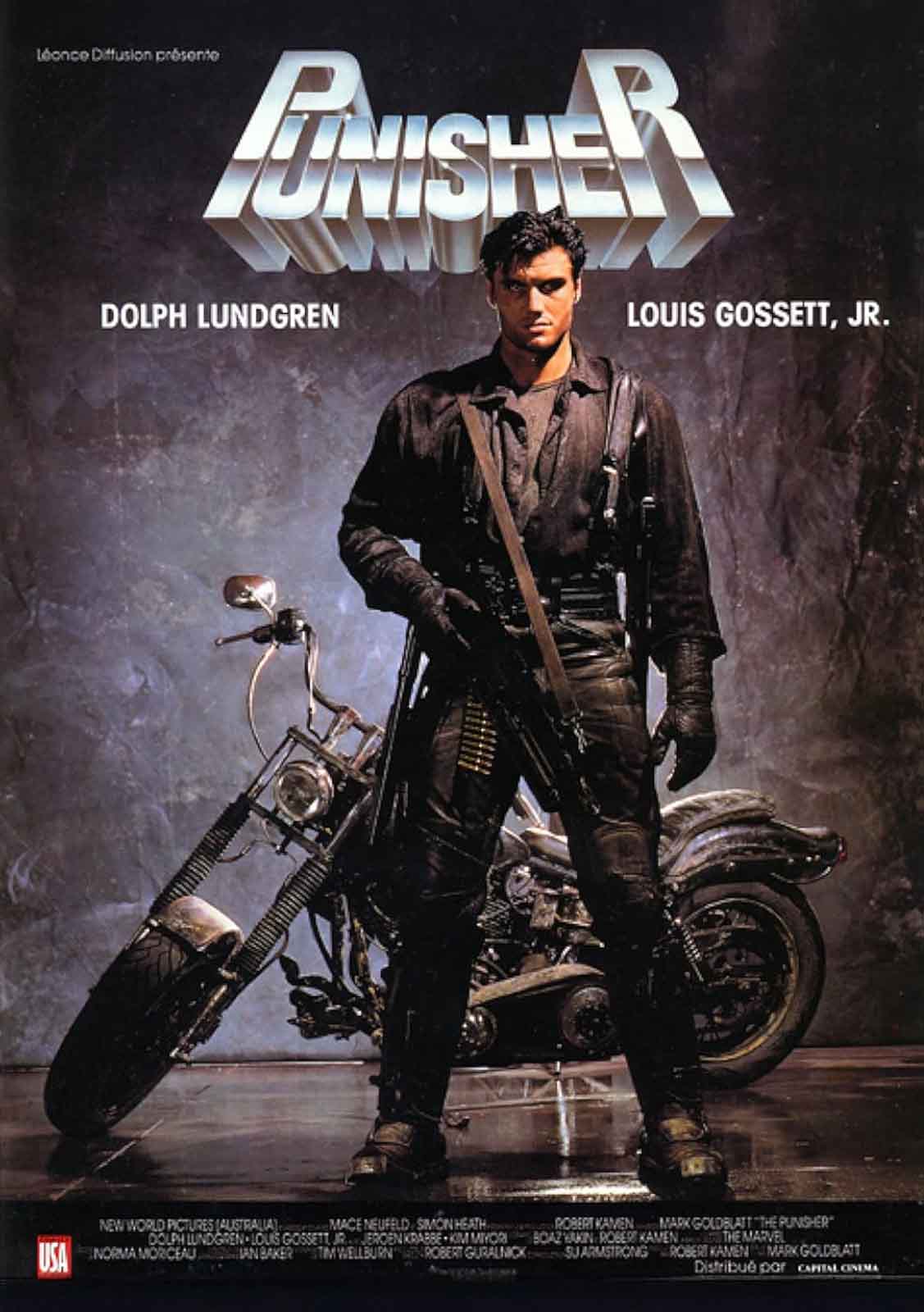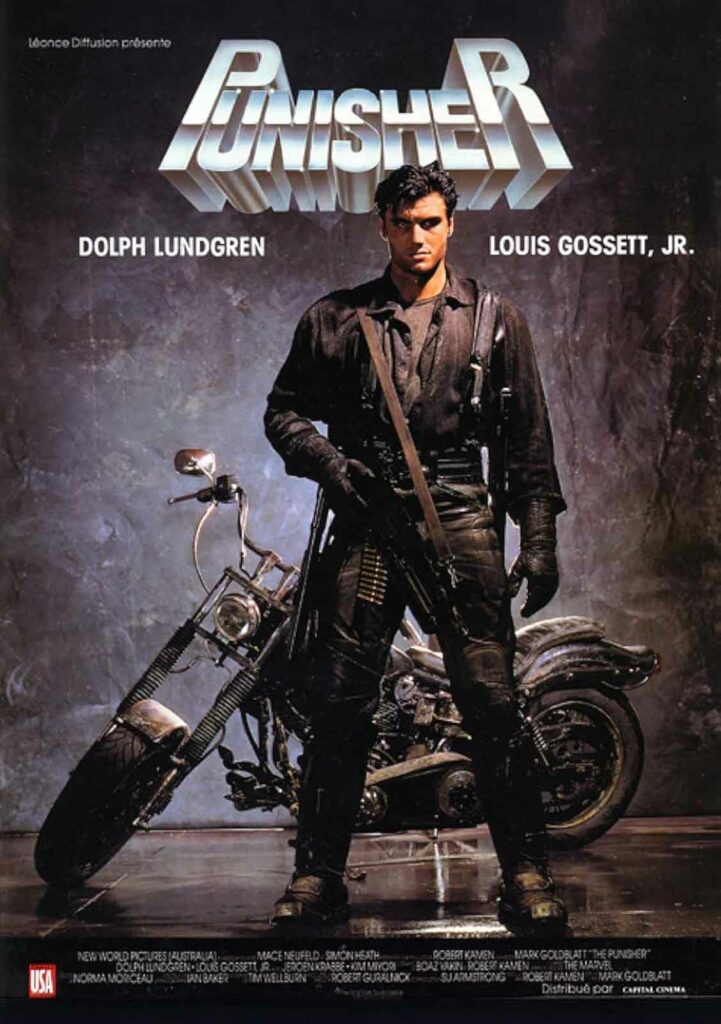Brad Bird, réalisateur de quelques-uns des films d'animation les plus marquants des années 90/2000, s'attaque à un ambitieux récit de science-fiction live
TOMORROWLAND
2015 – USA
Réalisé par Brad Bird
Avec Brittany Robertson, George Clooney, Raffey Cassidy, Hugh Laurie, Judy Greer, Kathryn Hahn, Thomas Robinson
THEMA FUTUR
Peu de cinéastes peuvent se targuer d’avoir amorcé leur carrière par un parcours sans faute. Brad Bird est de cette trempe. Après ses premières armes sur les séries Histoires fantastiques et les Simpsons, Bird a réalisé l’un des plus beaux films d’animation de tous les temps (Le Géant de fer), deux chefs d’œuvres pour les studios Pixar (Les Indestructibles et Ratatouille) et l’un des meilleurs – le meilleur ? – opus de la saga Mission Impossible : Protocole Fantôme. Hélas, avec A la poursuite de demain, le niveau baisse drastiquement, la quasi-perfection cède le pas à l’approximation, la grâce fait place à la confusion. Entendons-nous bien : A la poursuite de demain est loin d’être un échec artistique, mais son ambition démesurée et sa quête désespérée d’originalité jouent paradoxalement en sa défaveur. Le célèbre adage d’Alfred Hitchcock « mieux vaut partir du cliché qu’y arriver » s’applique malheureusement au scénario co-écrit par Bird, Jen Jensen et Damon Lindelof.


Certes, le film sait titiller notre intérêt dès son entame. Deux parcours parallèles s’offrent à nous simultanément. D’un côté, nous faisons connaissance dans les années 50 avec le tout jeune Frank Walker (Thomas Robinson), inventeur en herbe venu présenter son projet de jet-pack à un jury dirigé par l’austère David Nix (Hugh Laurie), et pénétrant soudain dans un univers parallèle futuriste hérissé de buildings vitrés, empli de robots multifonctions et traversé par toutes sortes de vaisseaux volants. De l’autre, nous suivons les pas d’une adolescente du 21ème siècle, Casey Newton (Brittany Robertson), qui se retrouve en possession d’un pin’s aux pouvoirs surprenants : dès qu’elle le touche, elle a des visions du même monde futuriste que celui découvert par Frank soixante ans plus tôt. Tandis que le mystère s’épaissit, une seule personne semble pouvoir apporter des réponses : Athena (Raffey Cassidy), une fillette qui n’a pas pris une ride depuis les années 50 et qui s’apprête à organiser une rencontre entre Casey et Frank devenu adulte (George Clooney)… Visiblement, A la poursuite de demain ne sait pas trop sur quel pied danser, cherchant à séduire autant le jeune public que les amateurs de science-fiction pure et dure sans trop parvenir à se décider.
Un fil narratif sans doute trop distendu
En cherchant à complexifier coûte que coûte sa narration – de peur que le nœud de l’intrigue ne paraisse finalement trop simpliste ? – le film se cherche en permanence, alternant les morceaux de bravoure (la séquence de la découverte du pin’s est extraordinaire) et les séquences frisant le ridicule (le voyage à Paris). Bien sûr, Brad Bird n’a rien perdu de sa virtuosité et sait nous époustoufler par sa mise en scène inspirée, soutenu par l’orchestre emphatique du fidèle Michael Giacchino, tout en dirigeant avec beaucoup de finesse un casting impeccable (George Clooney est parfait, tout comme les deux jeunes comédiennes qui lui donnent la réplique). Mais le fil narratif est décidément trop distendu pour captiver, d’autant que la tendance du film à abuser d’auto-citations de l’univers Disney (le prologue situé à Disneyland, les allusions aux animatroniques du parc, les références pataudes à Star Wars) et de placements produits (ah, la scène du Coca Cola !) finit par agacer.
© Gilles Penso
Partagez cet article