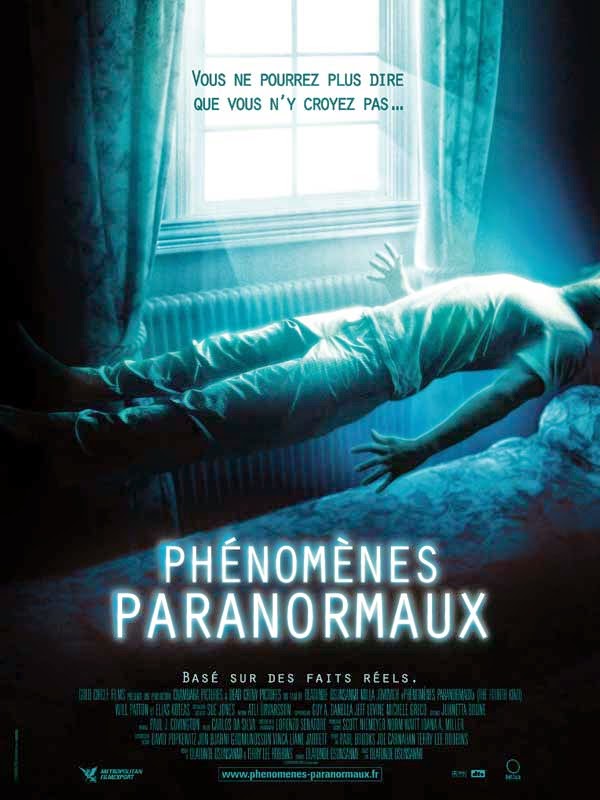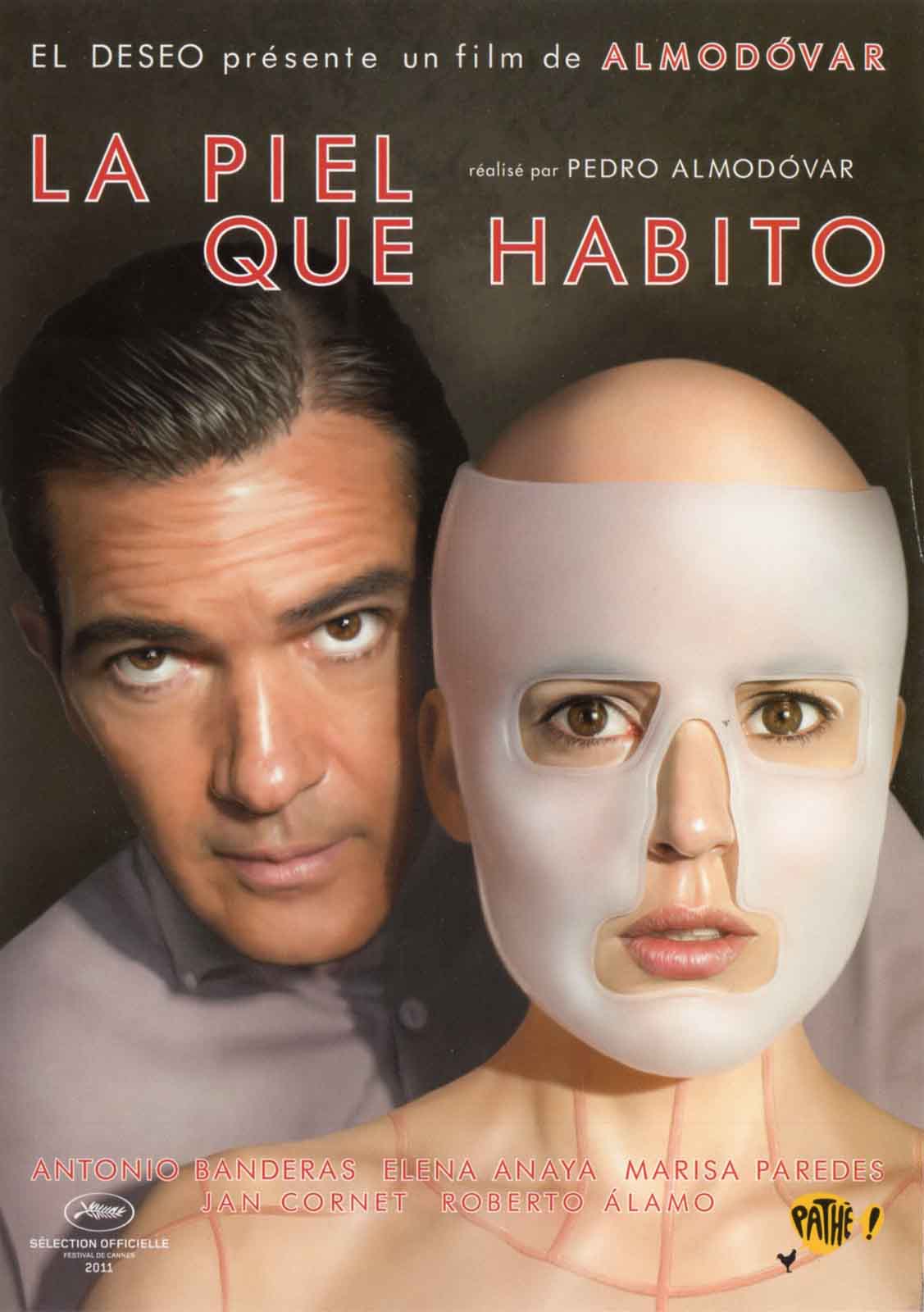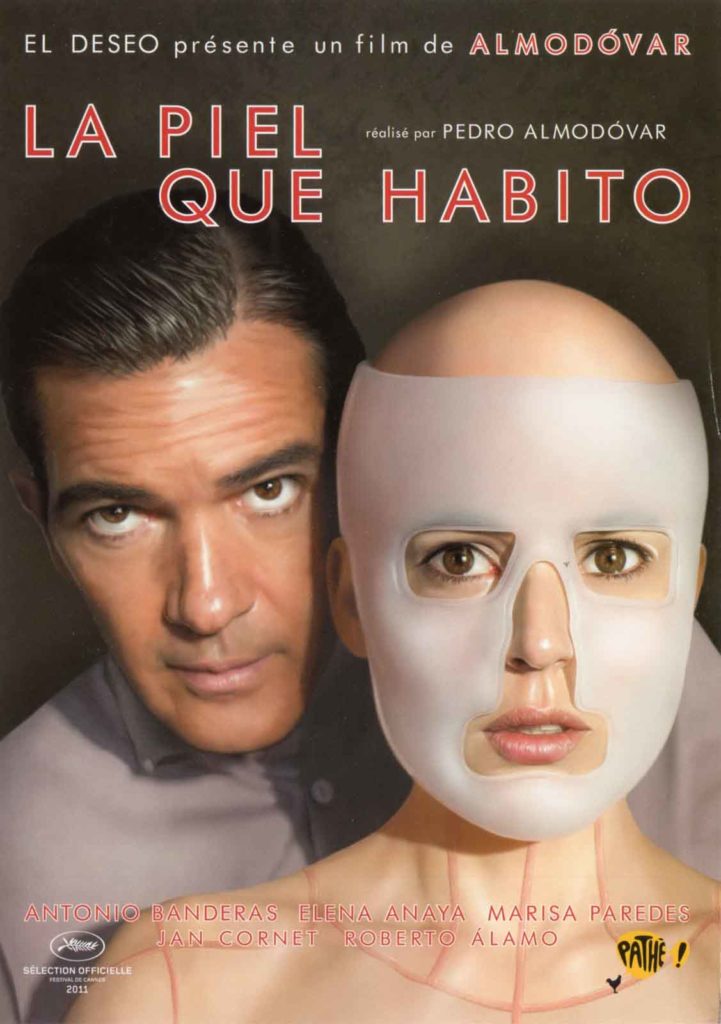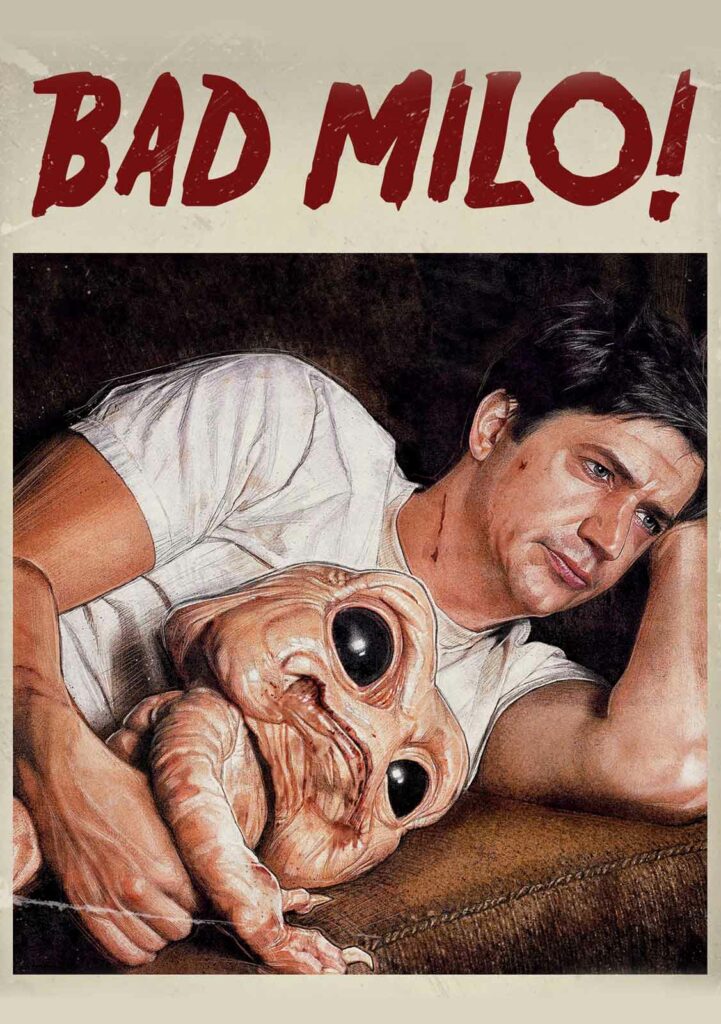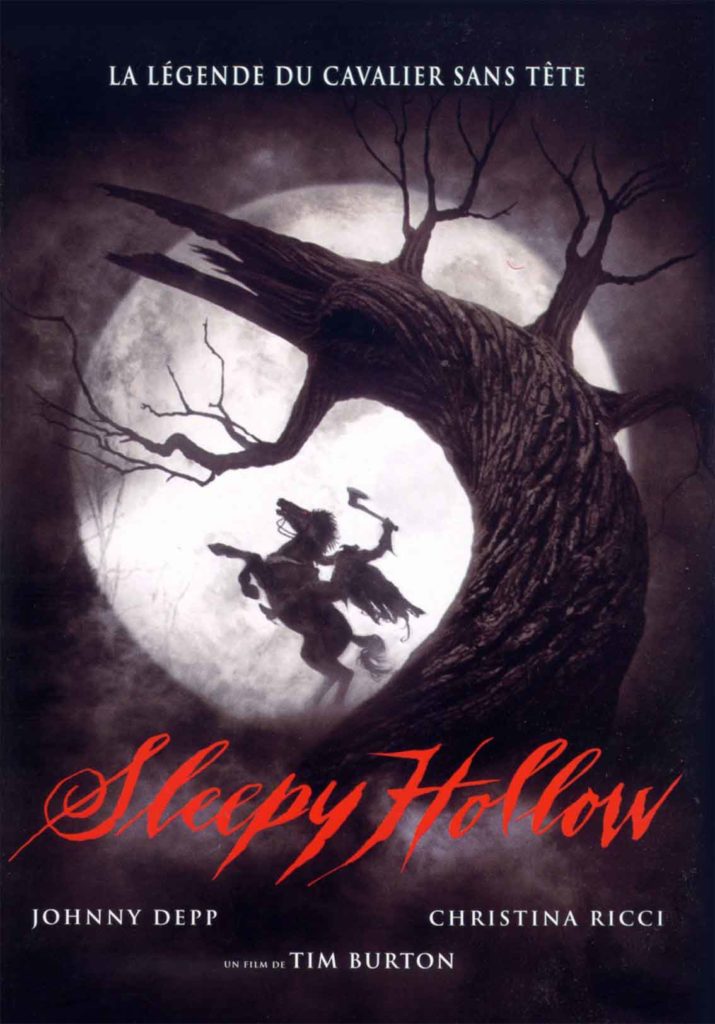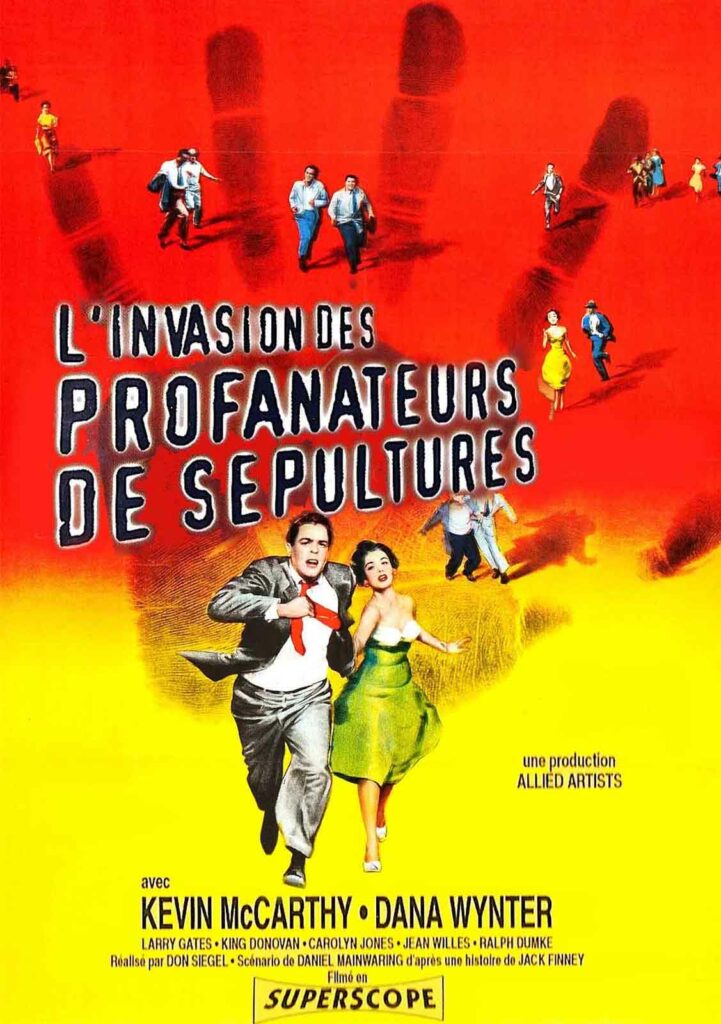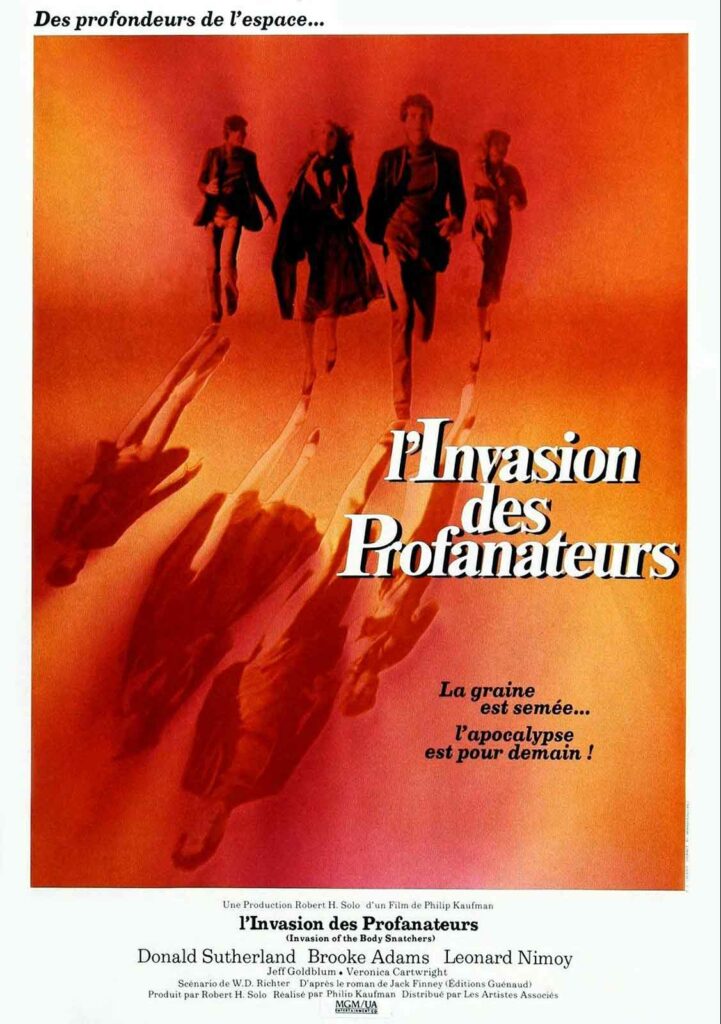Le chasseur de démons imaginé par Robert Howard prend corps à l'écran sous les traits charismatiques de James Purefoy
SOLOMON KANE
2009 – GB / FRANCE / REPUBLIQUE TCHEQUE
Réalisé par Michael J. Bassett
Avec James Purefoy, Max Von Sydow, Pete Postlethwaite, Rachel Hurd-Wood, Alice Krige, Mackenzie Crook, Ben Steel
THEMA HEROIC FANTASY I DIABLE ET DEMONS
Moins connu que Conan le barbare, Solomon Kane est pourtant une autre création inspirée de l’écrivain Robert Howard, un pourfendeur de démons du 17ème siècle aussi peu dénué de scrupules et d’états d’âmes que son petit frère cimmérien. Apparu pour la première fois en août 1928 dans le magazine Weird Tales, Solomon Kane (dont le nom mixe deux influences bibliques, le fougueux roi Salomon et le fratricide Caïn) fut le héros de plusieurs récits et se vit adapter en bande dessinée. Mais il aura fallu attendre la passion du scénariste/réalisateur Michael J. Bassett, grand admirateur d’Howard, pour qu’un Solomon Kane sur grand écran voie enfin le jour. Et le spectacle est à la hauteur des espérances, ne reculant devant aucune brutalité (les combats sont particulièrement sanglants), bénéficiant de magnifiques décors naturels captés en République Tchèque ou reconstitués en studio façon Hammer Films (ah, ce magnifique cimetière nocturne !), et mettant en scène quelques somptueuses créatures démoniaques conçues par Patrick Tatopoulos et visiblement sous l’influence de Guillermo del Toro.


A ce titre, les spectres grimaçants qui hantent les miroirs et happent les guerriers passant à leur portée ou le colossal Troll surgissant au moment du climax s’affirment comme de superbes visions de pure fantasy. Le casting lui-même est d’une grande finesse, offrant à quelques vétérans tels que Max Von Sydow ou Pete Postlethwaite des rôles mémorables tout en proposant à un quasi-inconnu (l’excellent James Purefoy) de tenir le haut de l’affiche. Aussi crédible en combattant farouche qu’en puritain tourmenté, Purefoy, avec ses faux airs d’Hugh Jackman et de Robert Carlyle, porte une bonne partie de l’impact du film sur ses solides épaules.
Sanglante croisade
N’adaptant aucune aventure précise écrite par Robert Howard, le film de Bassett se situe dans une Angleterre ravagée par les guerres. Le capitaine Solomon Kane, guidé par une foi inébranlable, occis à tour de bras tous les « infidèles » qu’il croise, persuadé d’agir pour le bien de l’humanité. Mais après une de ses sanglantes croisades, il croise un émissaire du Diable qui lui annonce le prix qu’il devra payer pour tout ce sang versé : son âme. Terrifié, Kane décide de renoncer à la violence en s’enfermant dans un cloître. Mais le mal continue de croitre autour de lui, et lorsque les démoniaques émissaires du redoutable Malachi se mettent à battre la campagne, ses nouvelles résolutions sont mises à rude épreuve… Élégante, stylisée, toute en retenue (sauf évidemment lorsque l’acier et la chair entrent en collision au cours des nombreuses échauffourées scandant le métrage), la mise en scène de Bassett dote Solomon Kane d’un souffle et d’une personnalité en parfait accord avec ses sources d’inspiration littéraires. La seule véritable ombre au tableau, en la matière, est sans doute la partition paresseuse d’un Klaus Badelt en sérieux manque d’inspiration. On regrette aussi – et surtout – un final un peu escamoté qui fait l’effet d’un pétard mouillé et laisse imaginer quelques coupes budgétaires inopinées. Ces réserves mises à part, Solomon Kane est une initiative réjouissante qui mériterait plusieurs séquelles. Hélas, le succès très mitigé du film ne laisse guère augurer de prolifique descendance…
© Gilles Penso
Partagez cet article