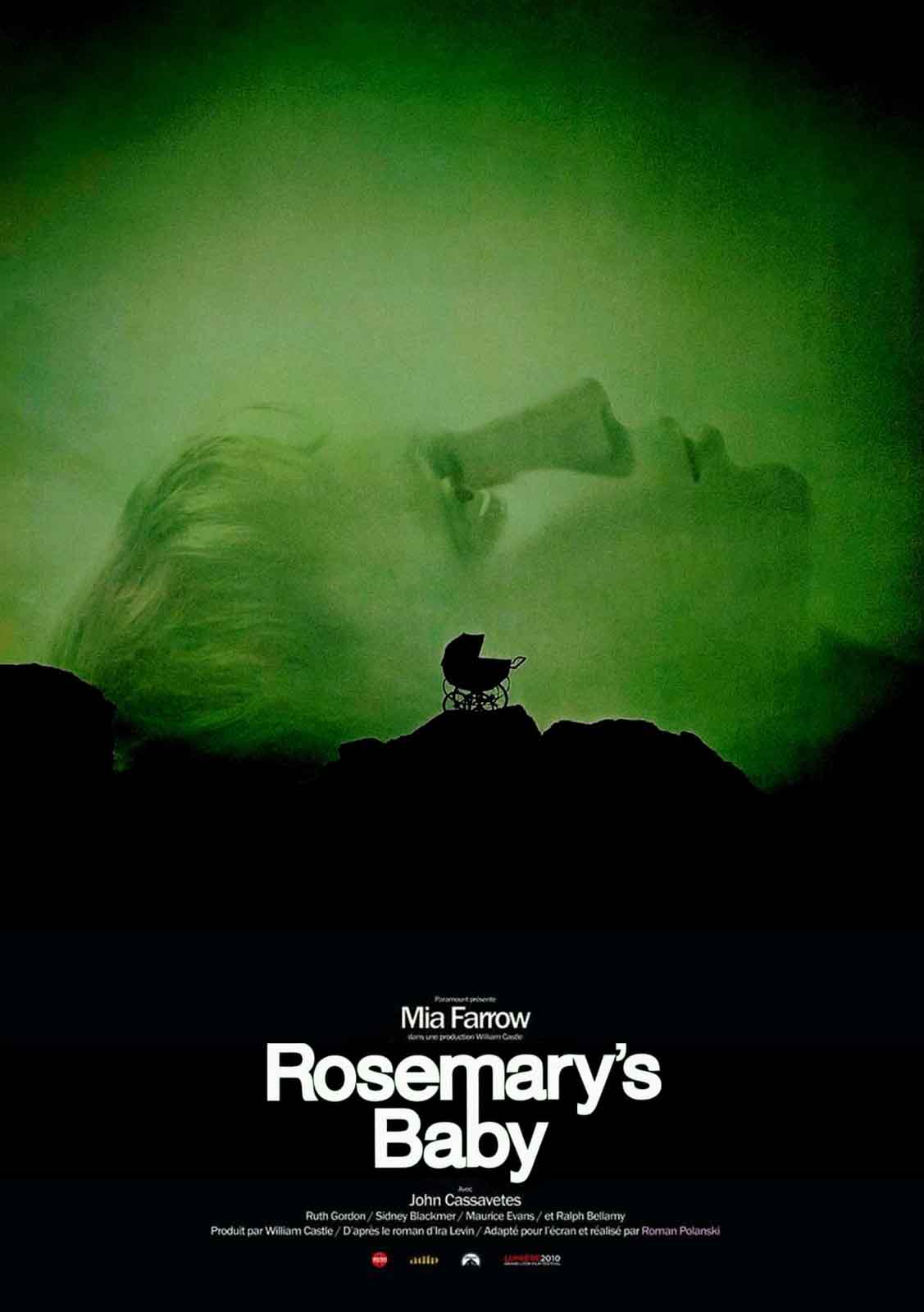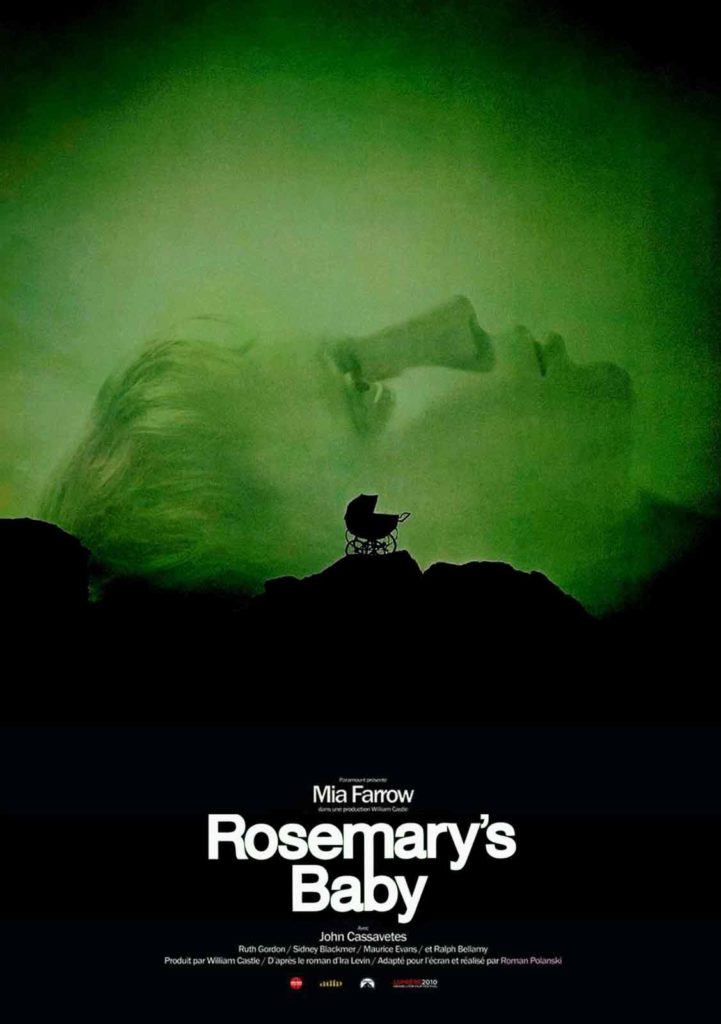Surréalisme, cynisme et mysticisme se bousculent dans cette œuvre à l'image de son réalisateur : inclassable…
THE HOLY MOUNTAIN
1973 – MEXIQUE / USA
Réalisé par Alejandro Jodorowsky
Avec Alejandro Jodorowsky, Horacio Salinas, Ramona Saunders, Juan Ferrara, Adriana Page, Burt Kleiner, Valerie Jodorowsky
Dire qu’Alejandro Jodorowsky est un cinéaste atypique est le plus doux des euphémismes. En s’attaquant à La Montagne Sacrée, il décida de lui donner l’ampleur d’un évangile et, pour trouver l’inspiration, fit un périple de quarante jours à travers les villages du Mexique, chaque halte lui permettant d’écrire une scène de son scénario. La première partie du film est une collection d’images surréalistes parfois drôles, parfois horribles, souvent absurdes et grotesques. Pêle-mêle, un homme au visage couvert d’insectes, un vieillard qui ôte un œil de verre de son orbite pour l’offrir à une petite fille, des caméléons costumés en conquistadors qui escaladent une maquette de cité aztèque, une colombe qui s’envole du corps d’un fusillé s’enchaînent à l’écran. On se croirait dans un mixage entre Un Chien Andalou et Salo ou les 120 Journées de Sodome.


Le héros est un voleur aux allures de Jésus qui erre au milieu de centaines de statues grandeur nature à son effigie puis escalade un tour immense avant de se retrouver nez à nez avec un étrange alchimiste incarné par Jodorowsky lui-même, friand de dialogues abscons (« la force dont a besoin le vautour pour s’agripper au bœuf est vitale au bœuf pour supporter le vautour »). Le délire surréaliste continue, de l’hippopotame qui prend son bain dans une fontaine aux excréments qui se transforment en or. Au bout d’une heure de métrage, le propos du cinéaste s’éclaircit enfin, à la faveur de la présentation de sept extra-terrestres. A travers leurs propos caricaturaux, la satire sociale prend corps. Le Vénusien est un chef d’entreprise qui entretient le culte de l’apparence en fabriquant des masques pour les humains ; la Martienne vend des armes à la mode (fusils psychédéliques, colliers de grenades, armes adaptées à toutes les religions) ; le Jupitérien tient une galerie d’art et a inventé une machine à orgasme ; la Saturnienne fabrique des jouets guerriers pour conditionner les enfants dès la naissance à haïr leurs ennemis futurs ; l’Uranien est conseiller du président et lui propose de tuer quatre millions de personnes pour sauver l’économie du pays ; le Neptunien est un chef de police qui, dans une tenue SM pré-Mad Max, émascule sur la place publique les condamnés ; le Plutonien est architecte et propose des cercueils monoplaces pour tous… Au cours de la dernière partie du film, le surréalisme et le cynisme s’évaporent au profit du mysticisme, tout ce beau monde partant en quête de l’immortalité au sommet d’une montagne sacrée.
Des producteurs nommés John Lennon et Yoko Ono
Partagez cet article