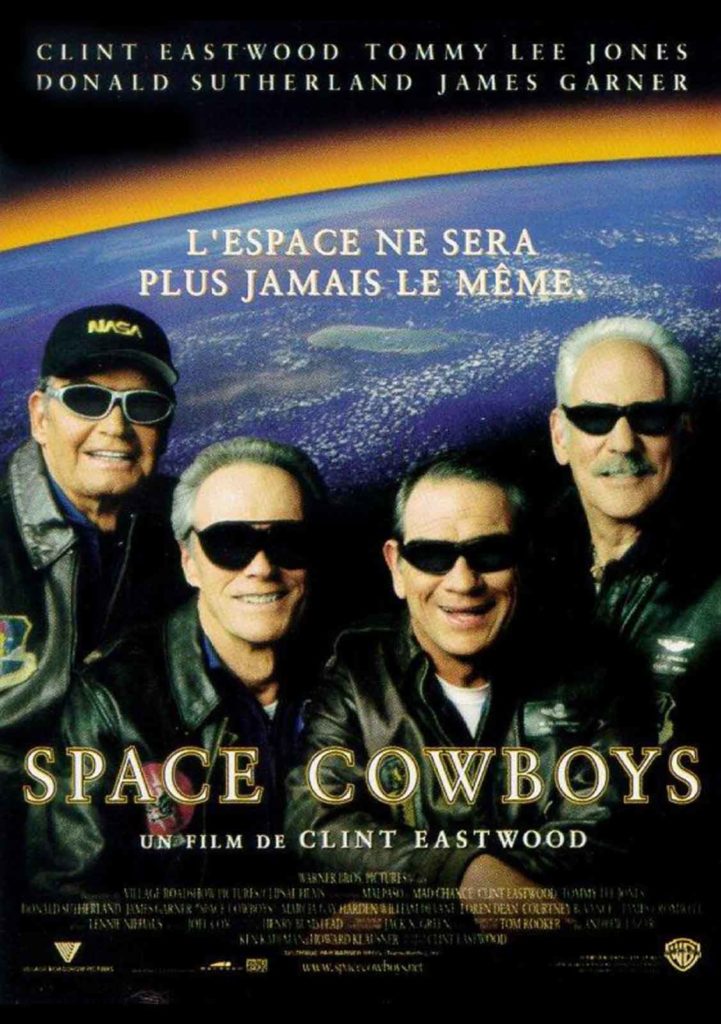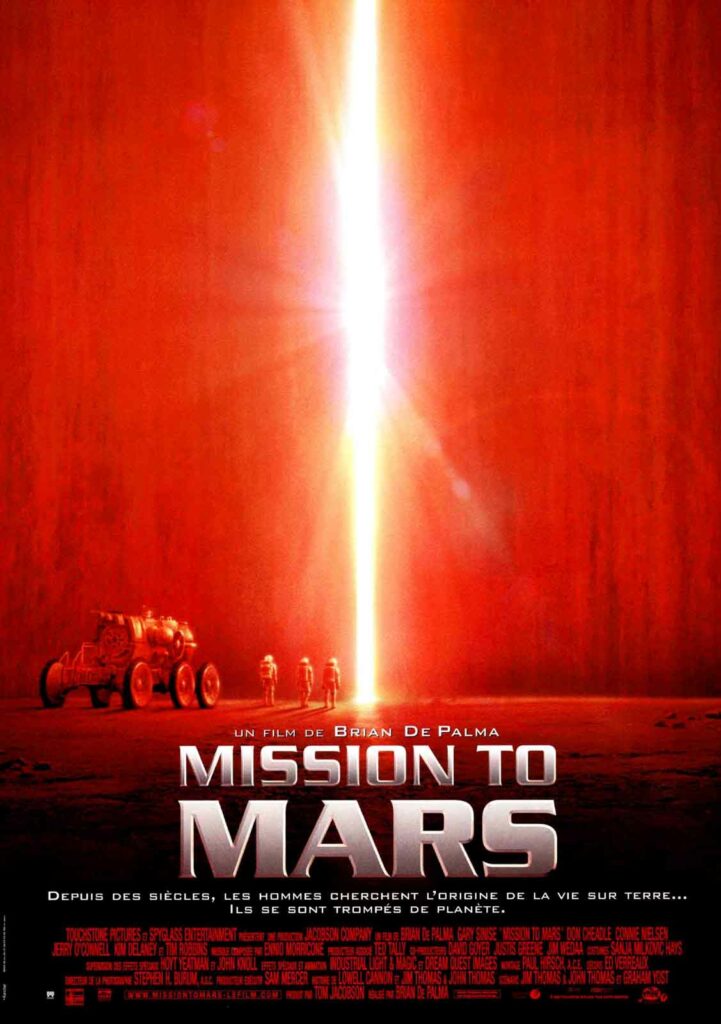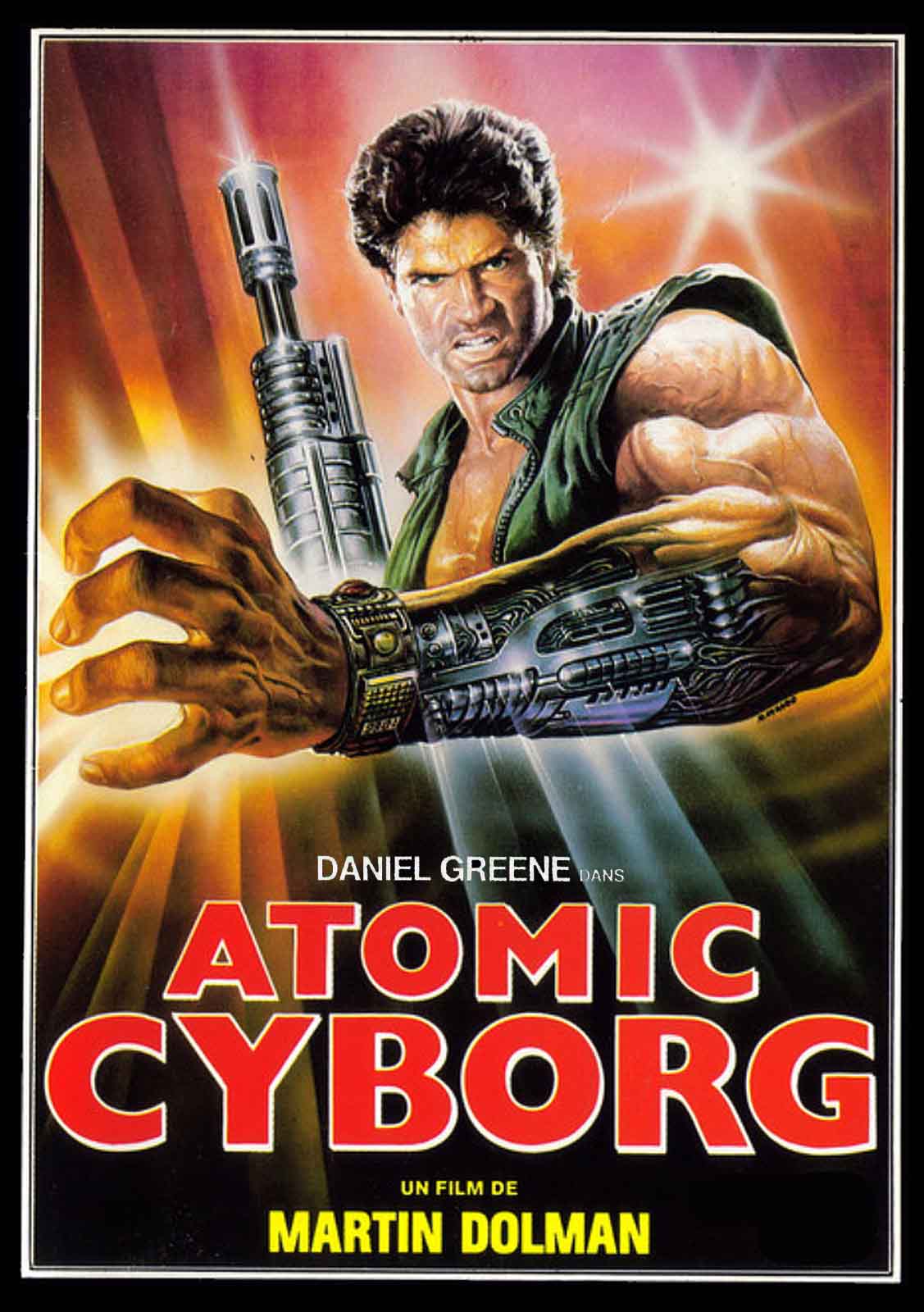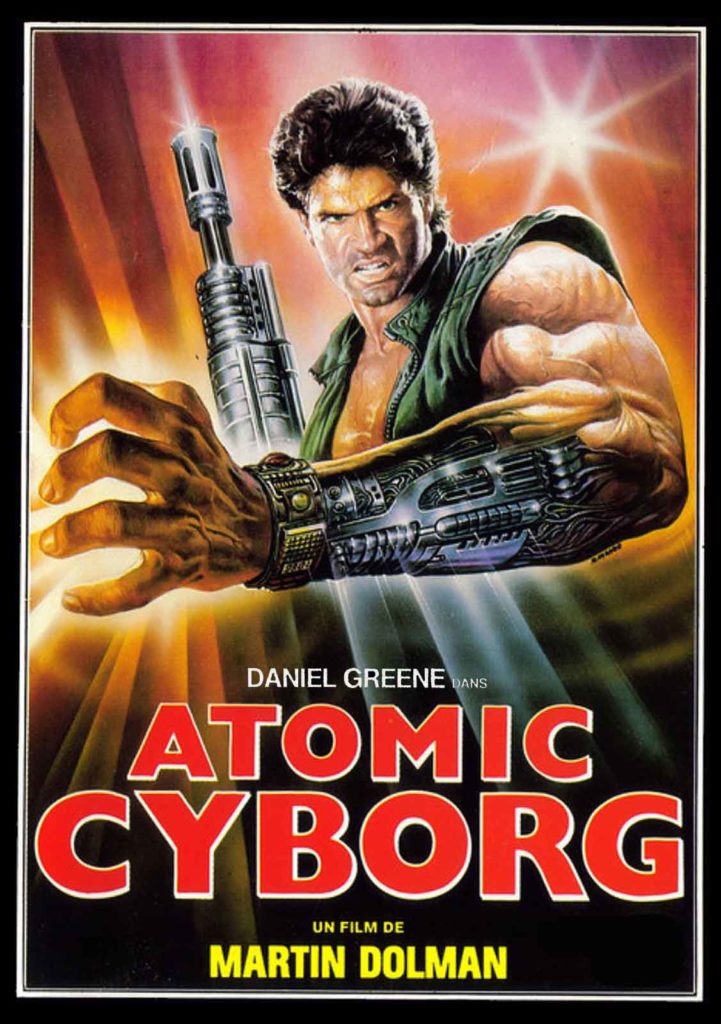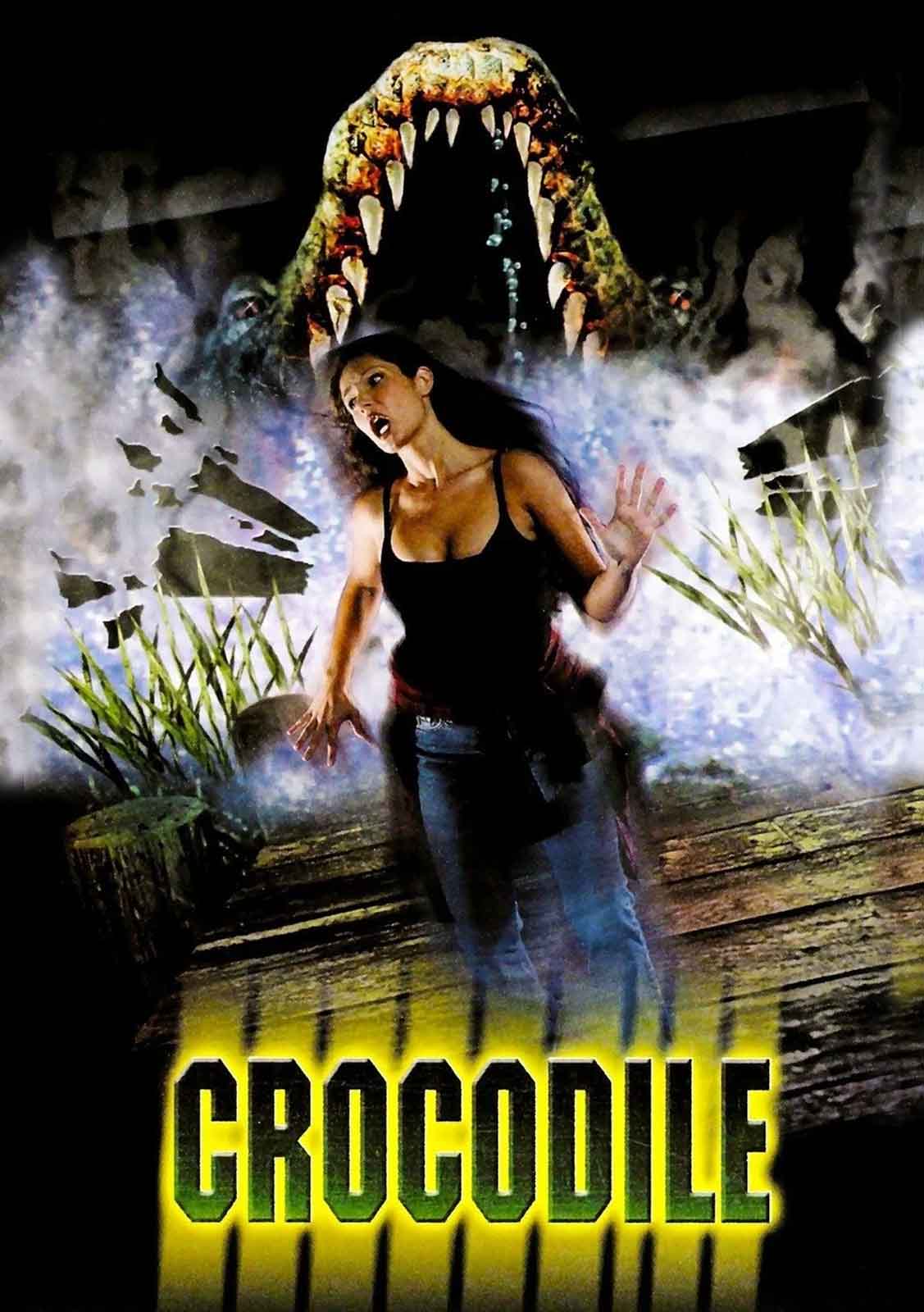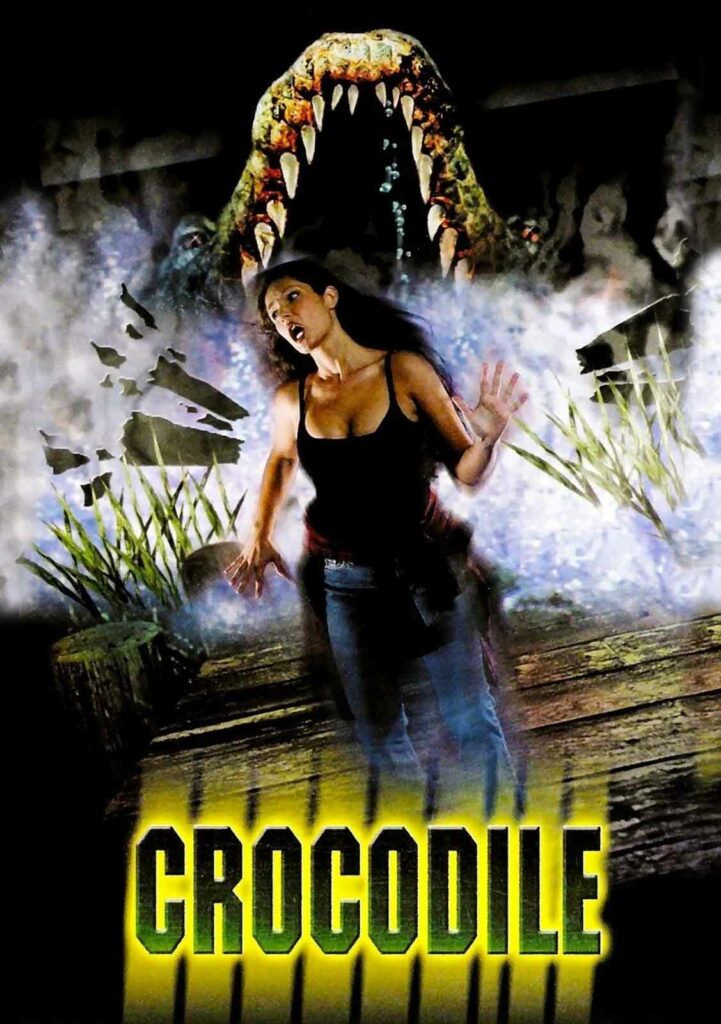Un slasher semi-parodique conçu directement pour Netflix et dirigé par un McG qu'on a connu plus inspiré
THE BABYSITTER
2017 – USA
Réalisé par McG
Avec Bella Thorne, Samara Weaving, Robbie Amell, Judah Lewis, King Bach
THEMA TUEURS
Mais qu’est-il arrivé à McG ? L’ancien clippeur devenu cinéaste avait su transposer avec panache la série Charlie Angels sur le grand écran, et même réaliser le meilleur épisode de la saga Terminator non dirigé par James Cameron. Comment s’est-il donc retrouvé à la tête d’un téléfilm aussi anecdotique ? Visiblement persuadé qu’une fille sexy, un héros adolescent et des litres de sang étaient des ingrédients suffisants pour garantir un succès immédiat auprès du public teenager, McG s’est lancé dans une sorte de mixage improbable entre Scream et Maman j’ai raté l’avion destiné directement à une diffusion sur Netflix.


Le personnage central de The Babysitter est Cole Johnson, un garçon de douze ans qui subit de manière récurrente le harcèlement de plusieurs de ses voisins. Intelligent mais sans doute trop naïf, il échappe à ce quotidien morose grâce à la présence de Bee, sa baby-sitter. Cette jolie jeune femme déborde de charisme et semble la seule personne de son entourage à ne pas l’infantiliser. Le lien très fort qu’ils ont noué leur permet de se considérer comme des amis. Mais Cole est persuadé que Bee attend qu’il s’endorme pour inviter des garçons dans la maison. Un soir, alors qu’il l’espionne, il la surprend avec un groupe de jeunes gens bizarres qui assassinent l’un des leurs et récupèrent son sang. Car Bee est à la tête d’une secte dont le but est d’invoquer un démon maléfique. Quand le groupe découvre que Cole les espionnait, ce dernier va devoir se battre pour survivre.
D'une désespérante vacuité…
Partagez cet article