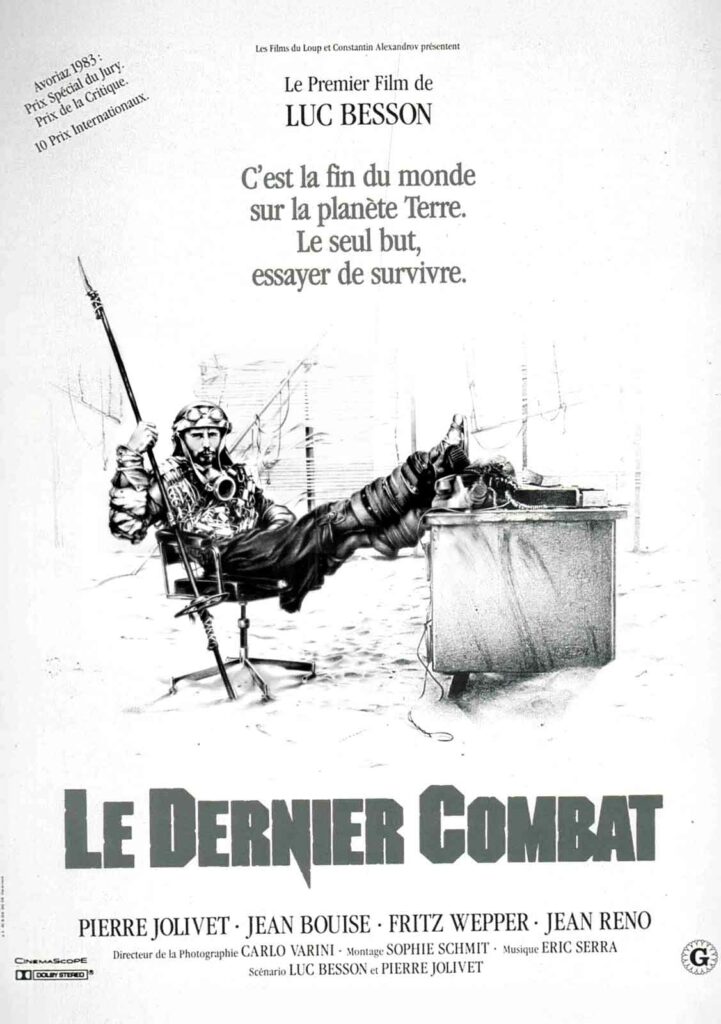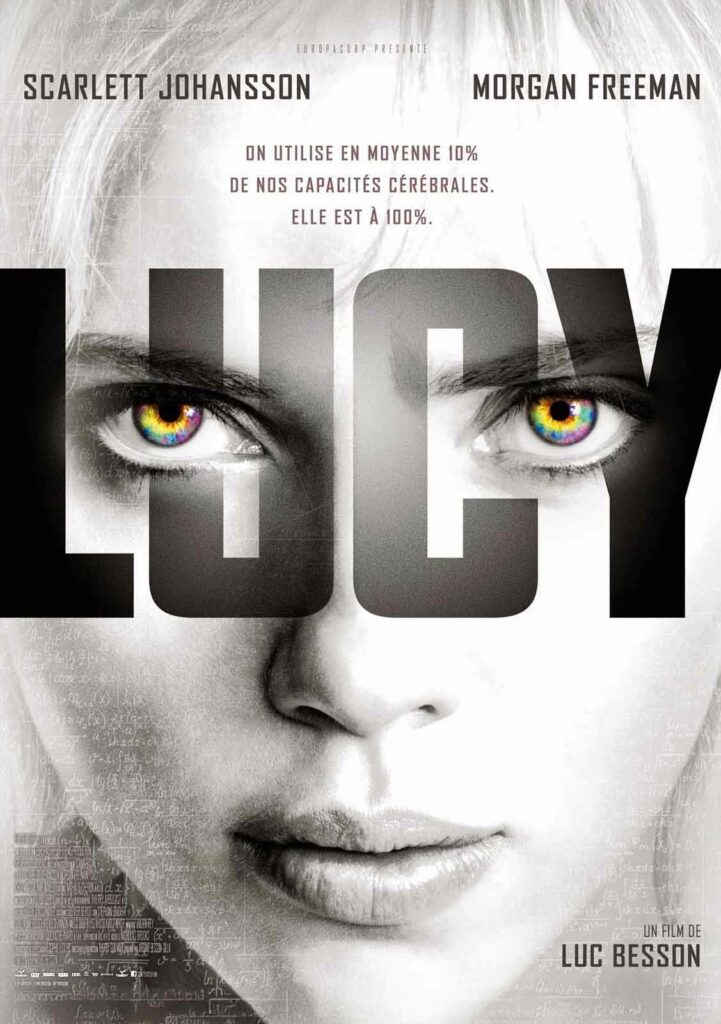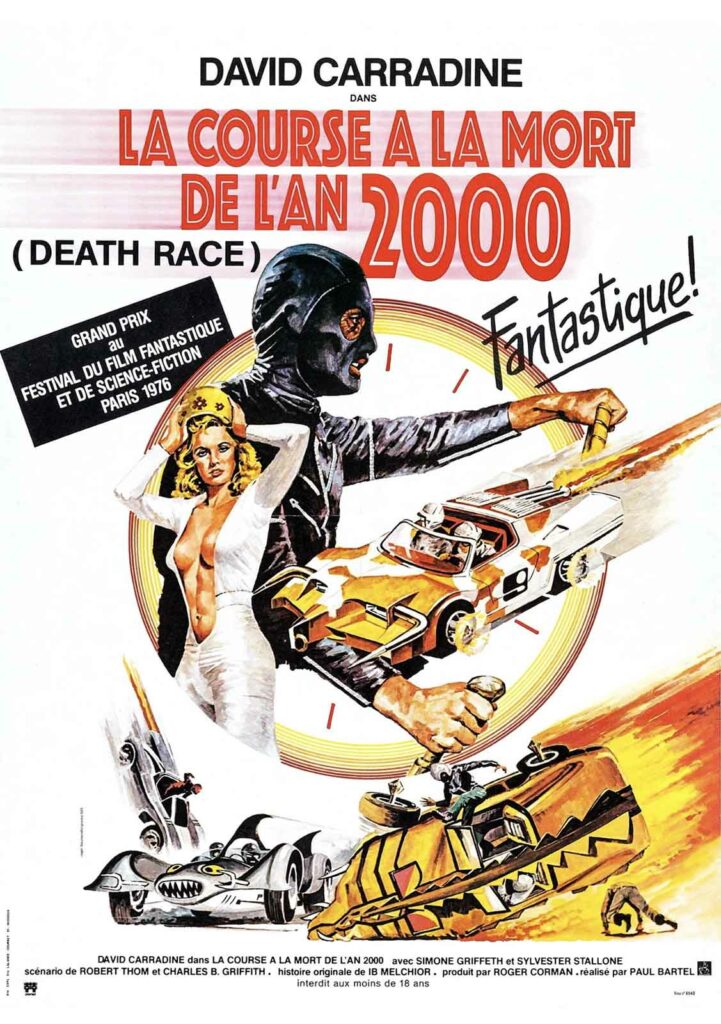Les frères Wachowski adaptent un classique de l'animation japonaise et réalisent leur film le plus acidulé… et sans doute aussi le plus creux
SPEED RACER
2008 – USA
Réalisé par Andy et Larry Wachowski
Avec Emile Hirsch, Christina Ricci, John Goodman, Susan Sarandon, Matthew Fox, Scott Porter
THEMA FUTUR
Dissipons tout de suite un malentendu : Speed Racer ne s’adresse pas aux amateurs de science-fiction férus de la trilogie Matrix mais plutôt aux spectateurs en bas âge biberonnés aux longs-métrages Disney. En effectuant un tel grand écart entre le cyberpunk désenchanté et le manga live acidulé, les frères Wachowski ont d’ailleurs désarçonné le public américain qui a réservé au film un accueil glacial. Il faut dire que les partis pris graphiques des duettistes sont un peu déroutants. Si l’extrême saturation des couleurs et le look sixties sautent agréablement aux yeux, que dire de ces environnements numériques qui clament ouvertement leur artificialité, de cette mise en scène empruntant la plupart de ses effets de style aux jeux vidéo et de ces incrustations de comédiens figurant probablement parmi les plus hideuses de l’histoire du cinéma ? On peut légitimement se demander pourquoi Andy et Larry Wachowki n’ont pas opté pour un film d’animation pur et dur, dans la mesure où ici la technique mixte rend les images numériques factices et les acteurs réels fadasses. Rarement Christina Ricci fut moins sexy, Matthew Fox autant insipide, John Goodman si avachi et Susan Sarandon aussi peu pétillante.


Il faut avouer que le scénario lui-même, inspiré d’un classique de l’animation japonaise, laisse peu de place au développement des personnages. Speed Racer (Emile Hirsch) est un pilote de course de très haut niveau, digne successeur de son frère aîné Rex (Scott Porter) qui trouva la mort pendant le rallye Casa Cristo. Fidèle à la firme automobile de son père Pops (John Goodman), il refuse la proposition alléchante de la toute-puissante multinationale Royalton Industries et s’attire dès lors les pires ennuis. Pour sauver l’entreprise familiale et sa propre carrière, Speed, soutenu par sa fidèle compagne Trixie (Christina Ricci), s’associe au mystérieux pilote Racer X (Matthew Fox) afin de remporter le redoutable rallye qui coûta la vie à son frère… Répétitif en diable, le film enchaîne les séquences de courses automobiles futuristes sans vraiment chercher à créer un effet crescendo qui permettrait de créer une progression du double point de vue de la dramaturgie et de l’effet spectaculaire.
Cascades impensables et répétitives
Dès la première compétition, on apprécie les cascades impensables de Speed Racer, capable de faire voler sa voiture, de la faire rebondir contre celles de ses adversaires comme s’il s’agissait d’une balle de flipper, de négocier les virages avec une souplesse étourdissante et d’éviter de justesse les collisions. Mais le film se contente par la suite de reproduire ces figures de style, variant simplement les décors comme si le héros progressait à l’intérieur des différents niveaux d’un jeu de plateformes. Reste à sauver de l’entreprise une excellente partition der Michael Giacchino (Alias, Lost, Les Indestructibles) aux accents délicieusement sixties, c’est à peu près tout. D’ordinaire, les cinéastes affirment un peu plus leur maturité au fil de leurs œuvres cinématographiques. Pour les frères Wachowski, c’est le contraire qui semble se produire. Bound était une perle noire très adulte, la saga Matrix visait prioritairement un public adolescent. Speed Racer, pour sa part, se situe quelque part entre Spy Kids 3 et La Coccinelle revient. A ce rythme-là, Andy et Larry ne devraient pas tarder à réaliser un épisode des Télétubbies !
© Gilles Penso
Partagez cet article