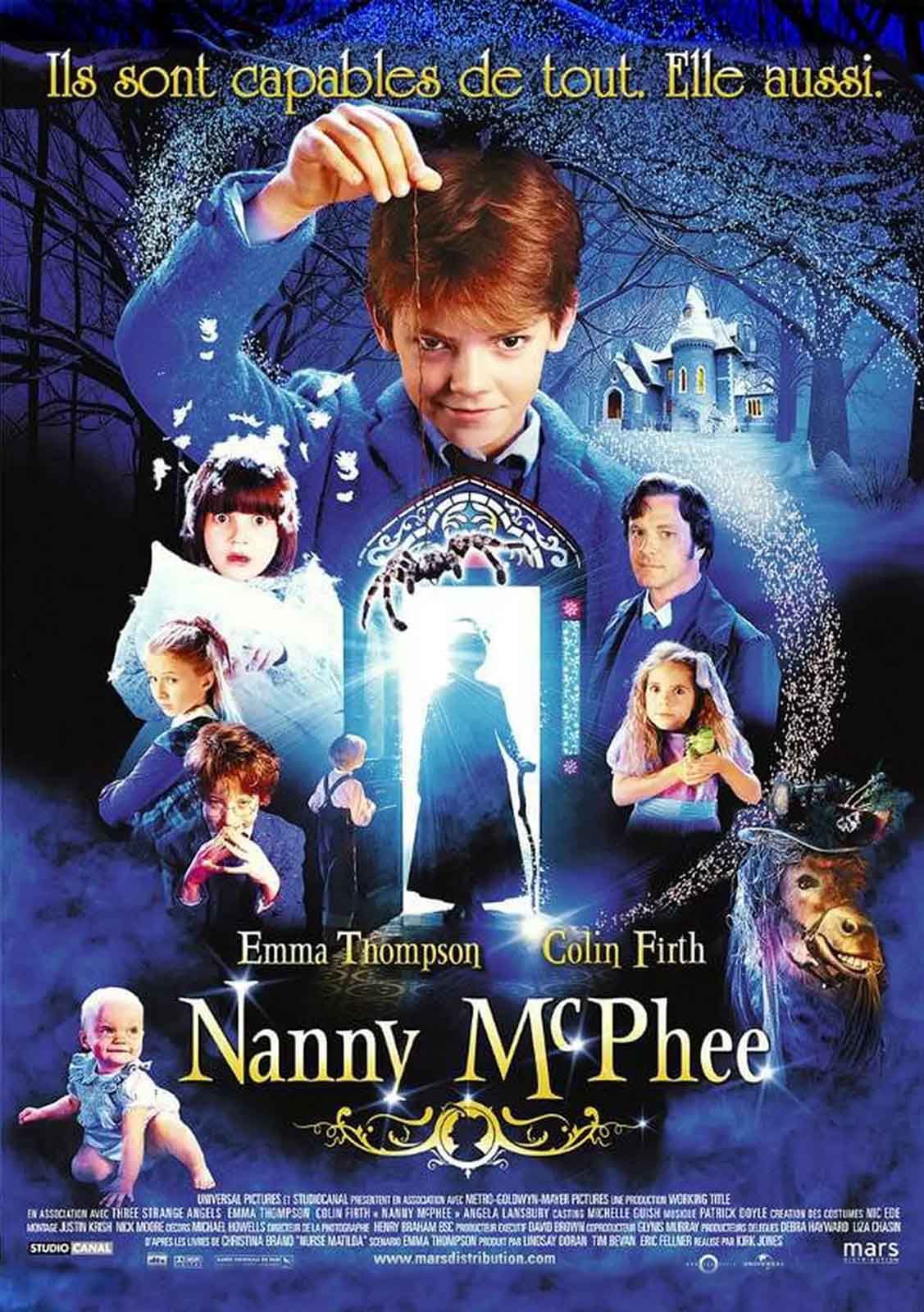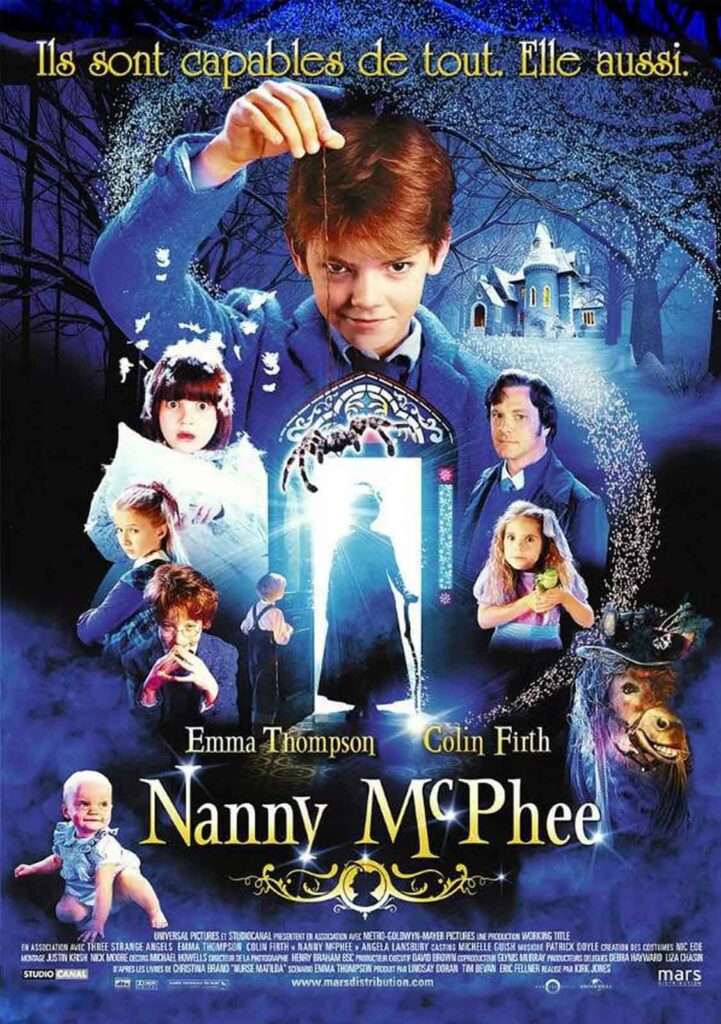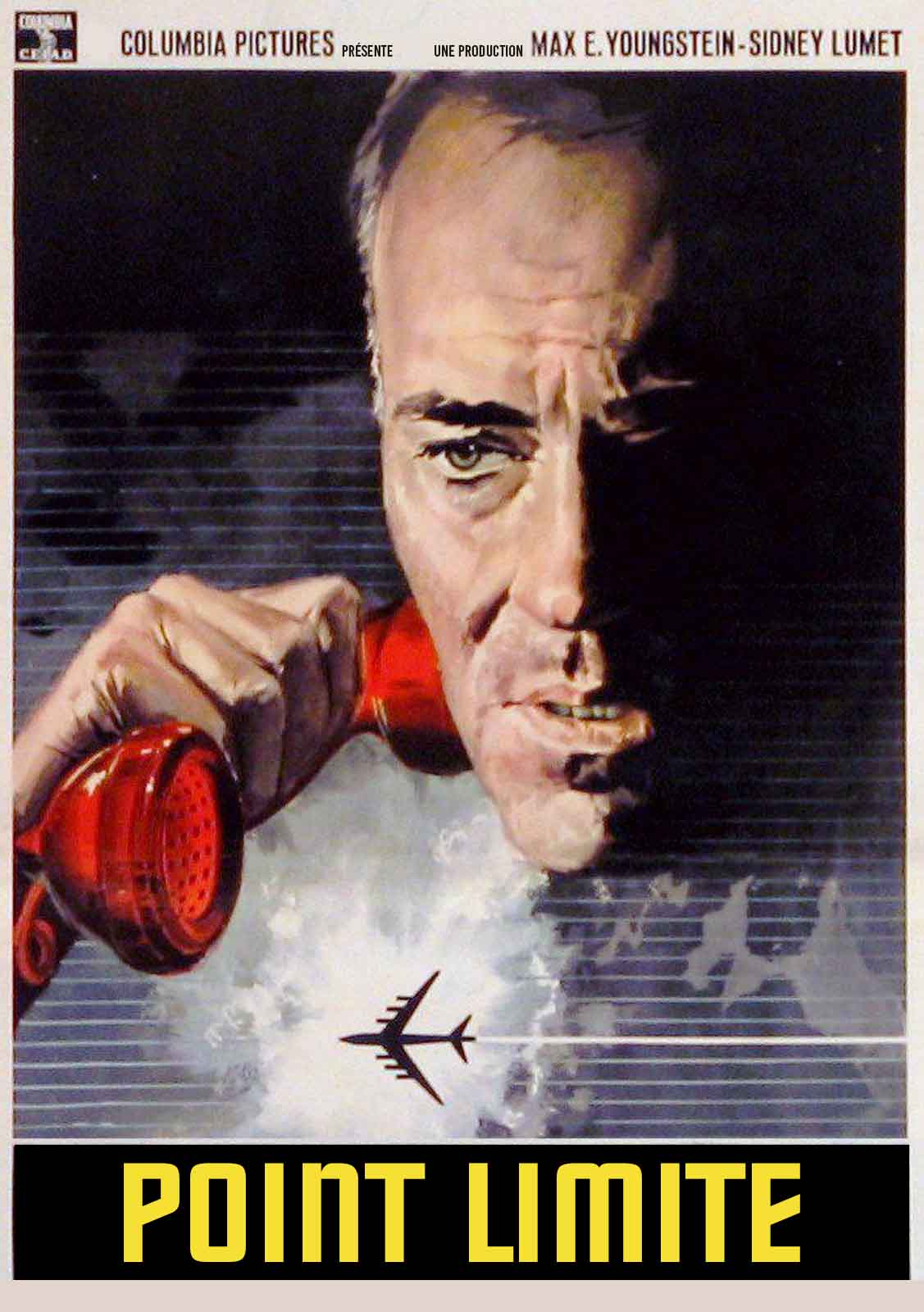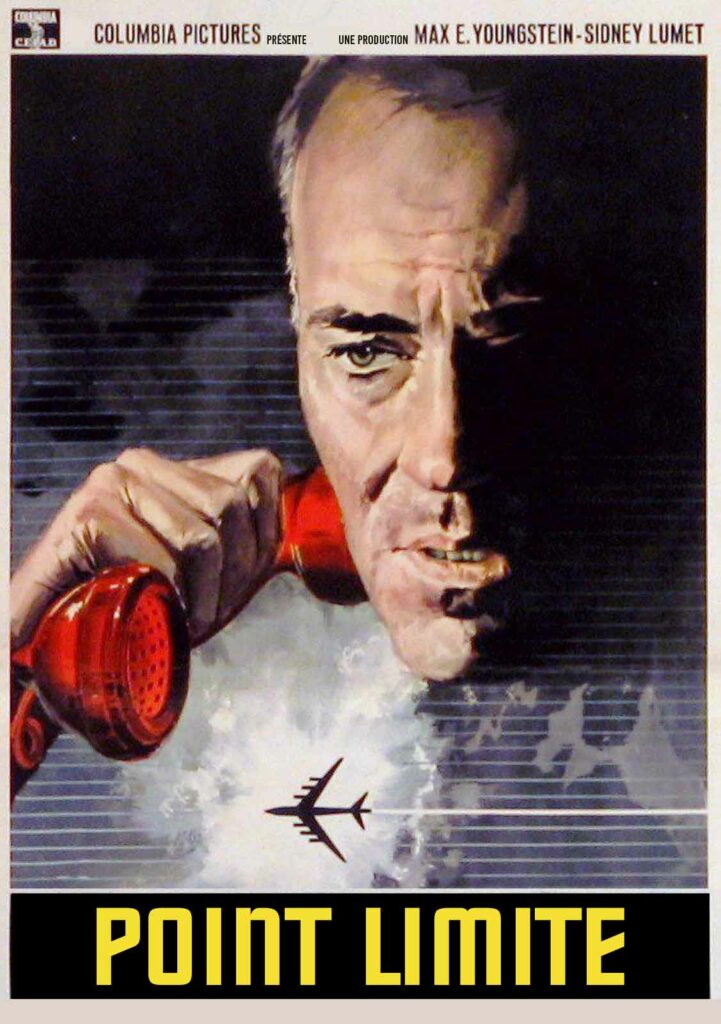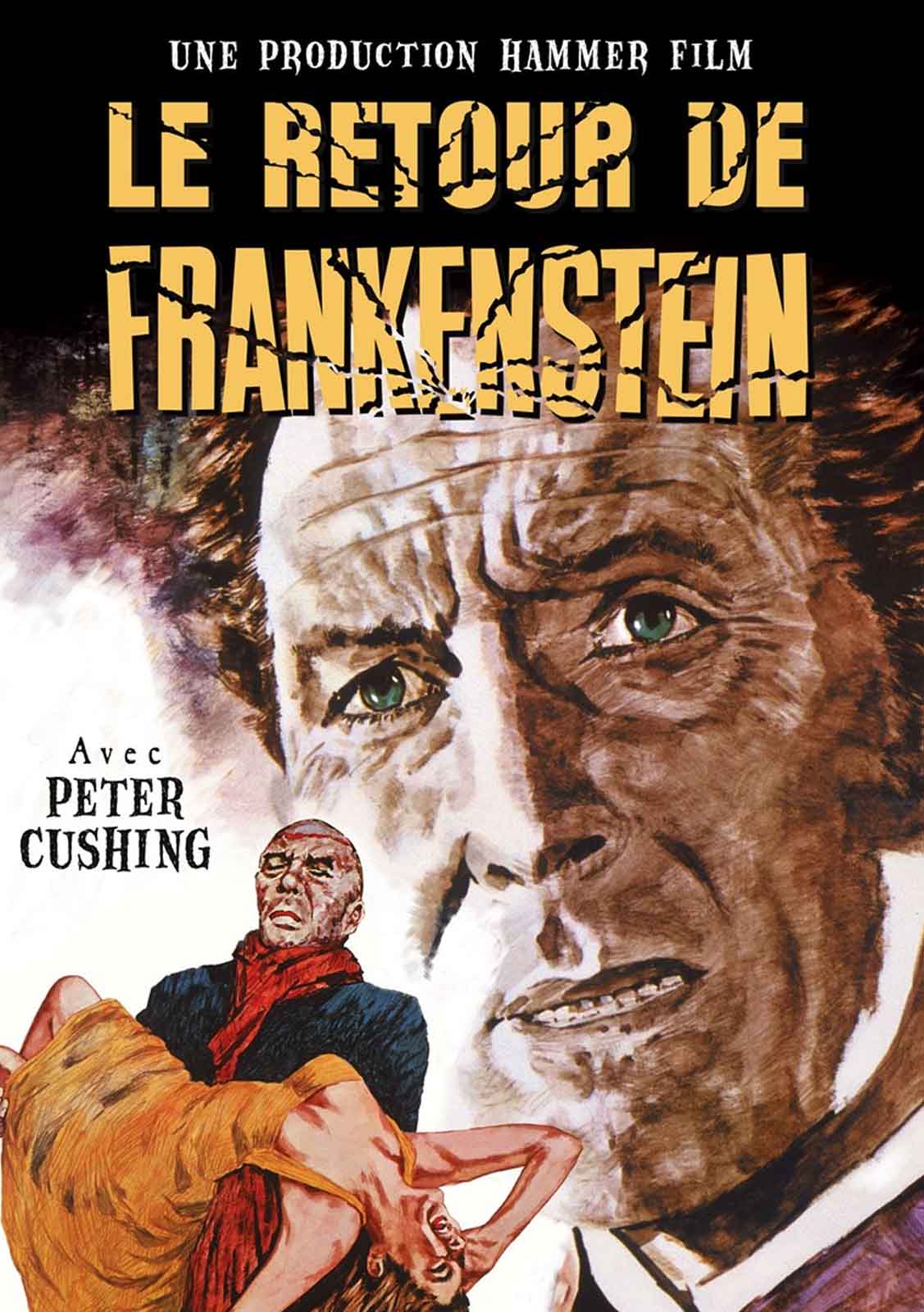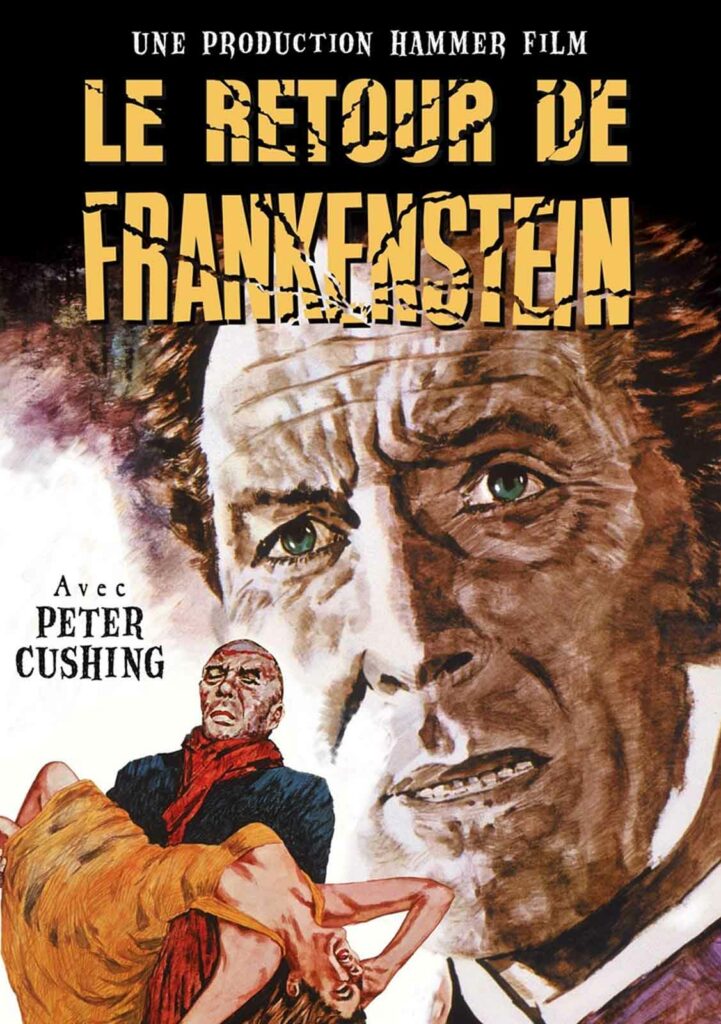Un directeur de zoo psychopathe se sert de ses animaux sauvages pour éliminer tous ceux qui l’importunent…
BLACK ZOO
1963 – USA
Réalisé par Robert Gordon
Avec Michael Gough, Jeanne Cooper, Rod Lauren, Virginia Grey, Jerome Cowan, Elisha Cook Jr, Marianna Hill
THEMA MAMMIFÈRES I SINGES
Les Fauves meurtriers s’ouvre sur une visite de zoo qu’orchestre le facétieux propriétaire des lieux, Michael Conrad, incarné avec une délectation certaine par Michael Gough. Le clou de cette visite est le spectacle de singes savants que dirige son épouse Edna (Jeanne Cooper). Excentrique, Conrad convoque ses fauves dans son salon chaque soir pour leur offrir un concert d’orgue. Mais sous ses airs affables, cet homme est un psychopathe caractériel qui traite son employé muet Carl (Rod Lauren) comme un esclave et se sert de ses animaux comme instruments de vengeance. Ainsi assiste-t-on dès les prémices du film à l’agression d’une jeune fille par un tigre. Plus tard, lorsqu’un promoteur immobilier menace Conrad de le chasser, il ne tarde pas à finir entre les crocs de King, un lion qui obéit au doigt et à l’œil à la voix de son maître. Le sujet des Fauves meurtriers n’est donc pas très éloigné de celui de Konga, dans lequel Michael Gough se débarrassait déjà des importuns à l’aide d’un gorille agressif.


D’ailleurs, parmi les animaux à son service, Conrad garde derrière une cage un grand singe velu (autrement dit un acteur sous une peu convaincante défroque simiesque), lequel sera chargé de tuer sa propre femme après que celle-ci ait été débauchée par un agent artistique pour produire son spectacle de singes dans un grand cirque. Un jour, l’un des gardiens du zoo est agressé par un tigre et se défend en l’abattant in extremis. Furieux, Conrad n’y va pas par quatre chemins et transforme l’imprudent en apéritif pour son lion. S’ensuit une très photogénique séquence d’enterrement dans un cimetière brumeux. On pourrait croire une seconde que c’est l’homme qu’on enterre, mais en fait c’est le tigre. Au cours de ces funérailles surréalistes, Conrad prononce un discours plein d’emphase au beau milieu de ses autres fauves. Autant dire que dans ce type d’exercice, Michael Gough excelle.
Les « vrais croyants »
Mais ce n’est rien à côté de la séquence suivante, au cours de laquelle une congrégation d’adorateurs du règne animal, qui s’autoproclament les « vrais croyants », jouent du tam-tam, psalmodient, se recouvrent d’une défroque de fauve et orchestrent le transfert de l’âme du félin mort dans le corps d’un bébé tigre ! L’indiscutable pouvoir distractif de telles scènes est hélas noyé dans l’indigence d’un scénario filiforme incapable de soutenir bien longtemps l’attention de son spectateur. A tel point que, pour pouvoir s’étirer sur une heure et demie, le récit s’encombre de longueurs tout à fait inutiles, comme les disputes du couple Conrad en plein dîner (il faut dire que la montreuse de singe est quelque peu portée sur la bouteille, ce qui irrite fortement son époux) ou les discussions interminables des policiers s’efforçant sans grande conviction d’élucider cette étrange affaire. Robert Gordon lui-même, dont le seul titre de gloire, Le Monstre vient de la mer, devait beaucoup aux effets spéciaux de Ray Harryhausen et bien peu à l’éclat de sa mise en scène, assure le service minimum, jusqu’à un climax peu palpitant prenant la forme d’un ultime combat sous la pluie entre Conrad et Carl.
© Gilles Penso
Partagez cet article