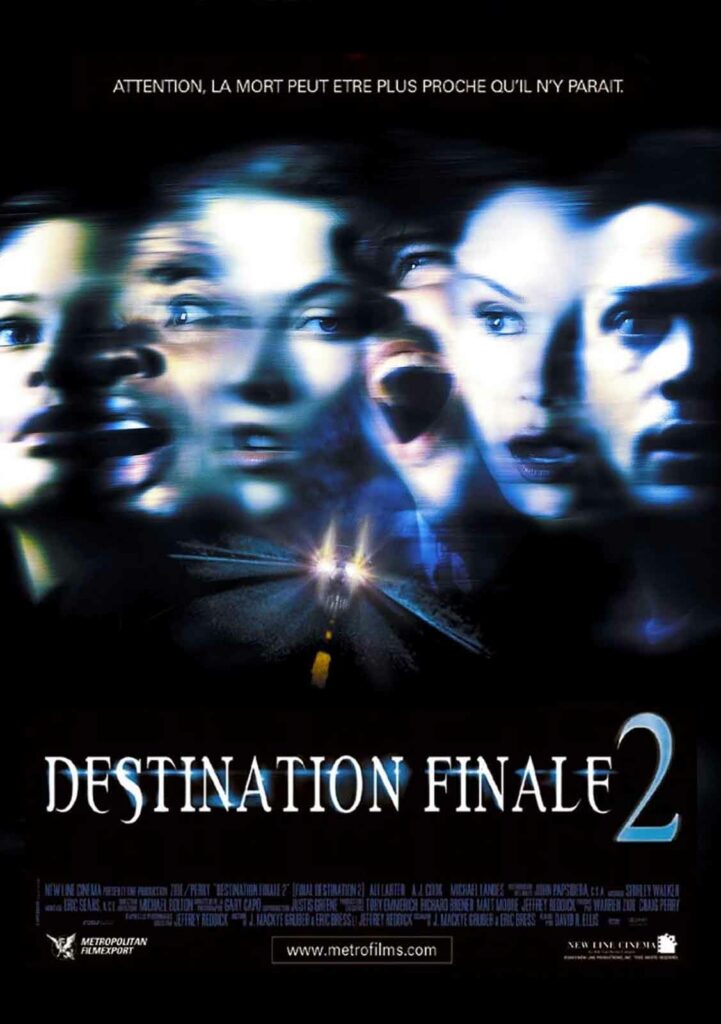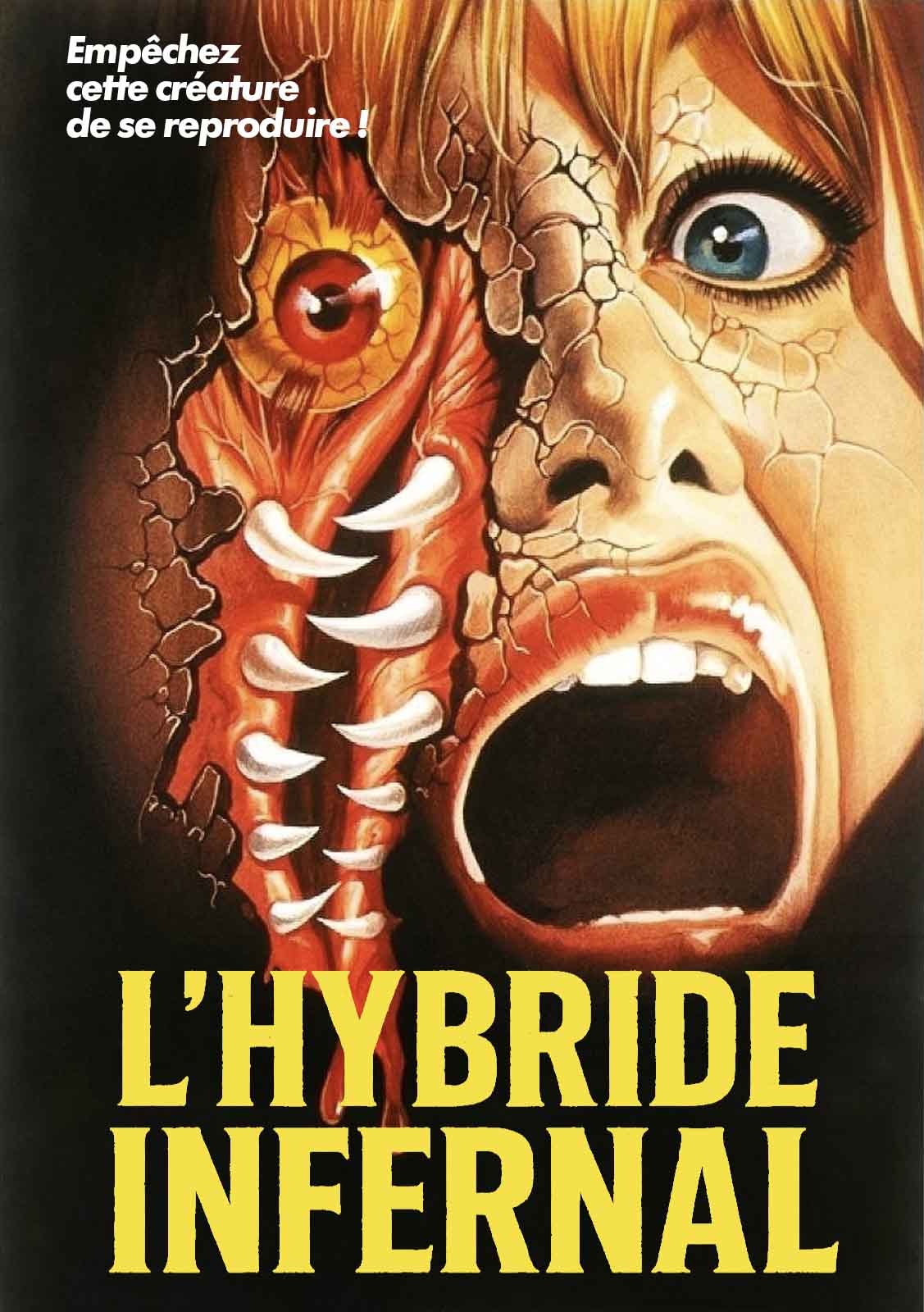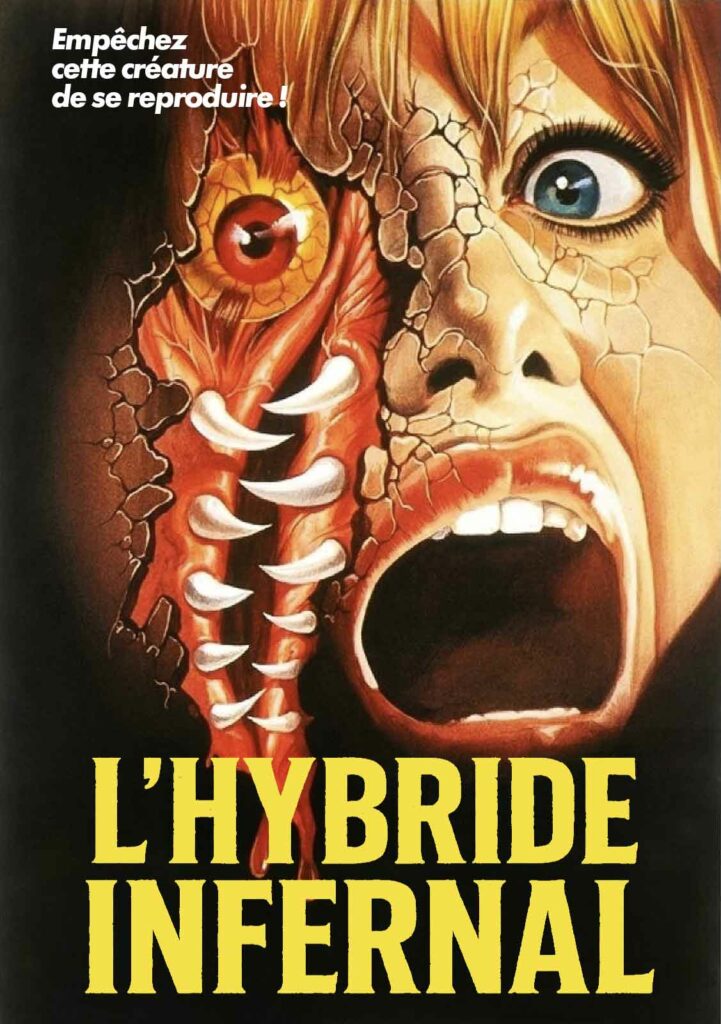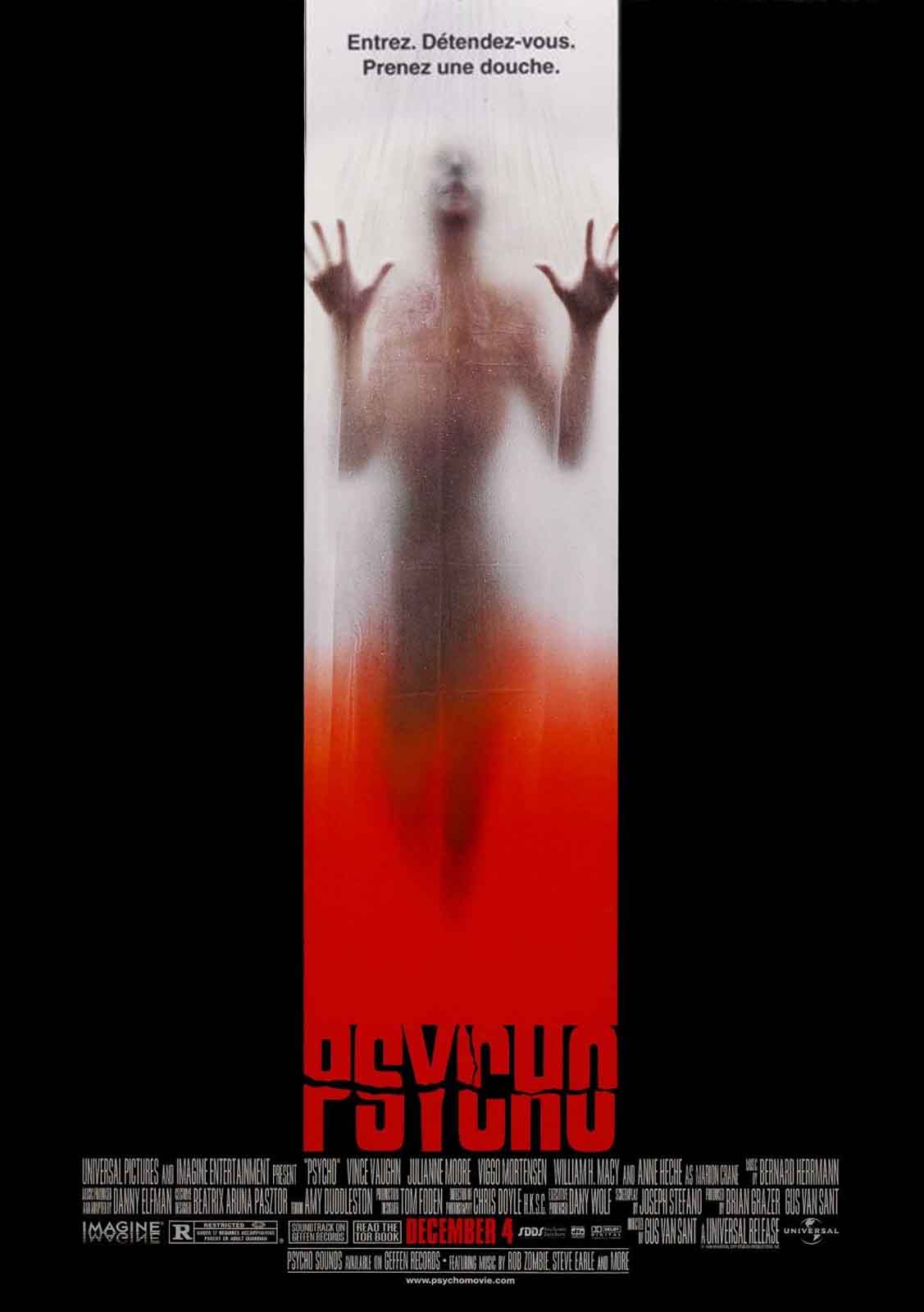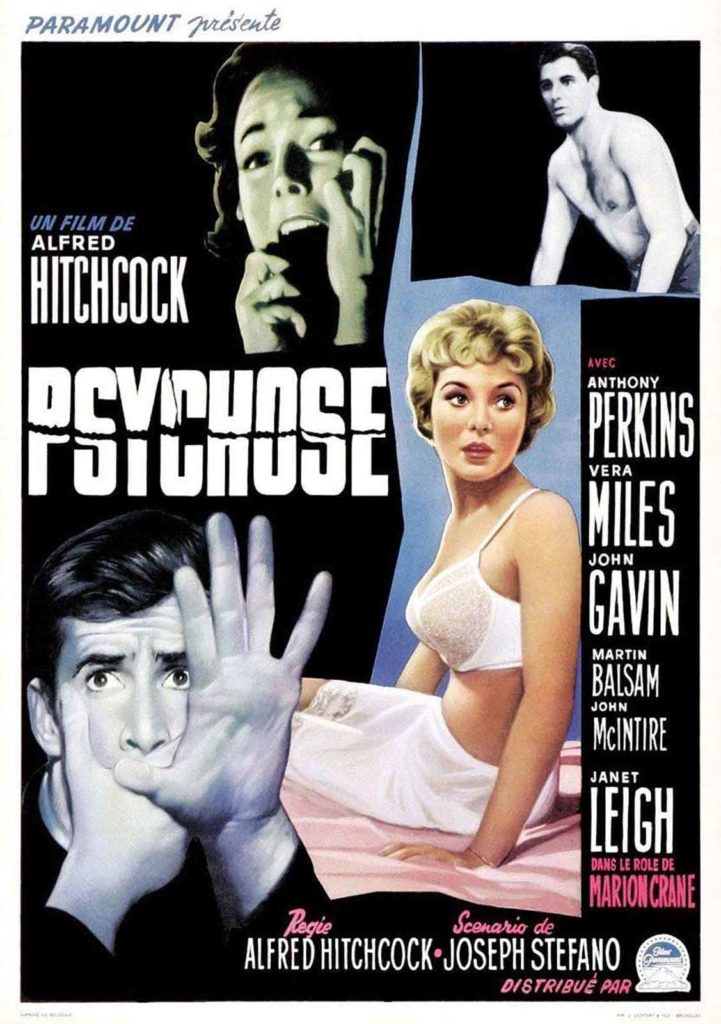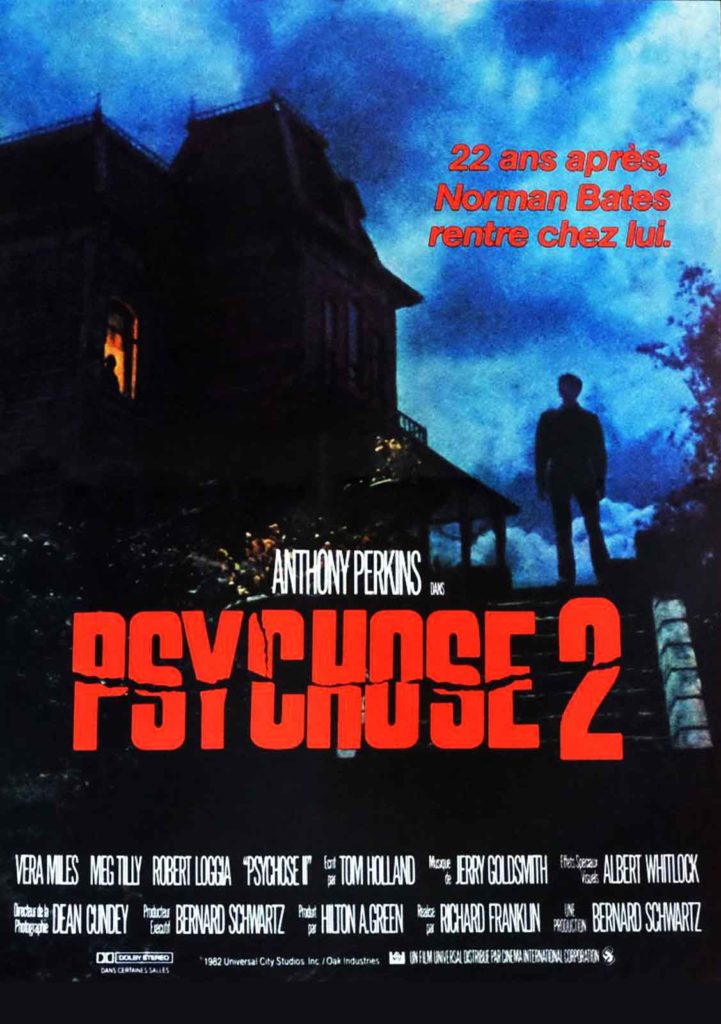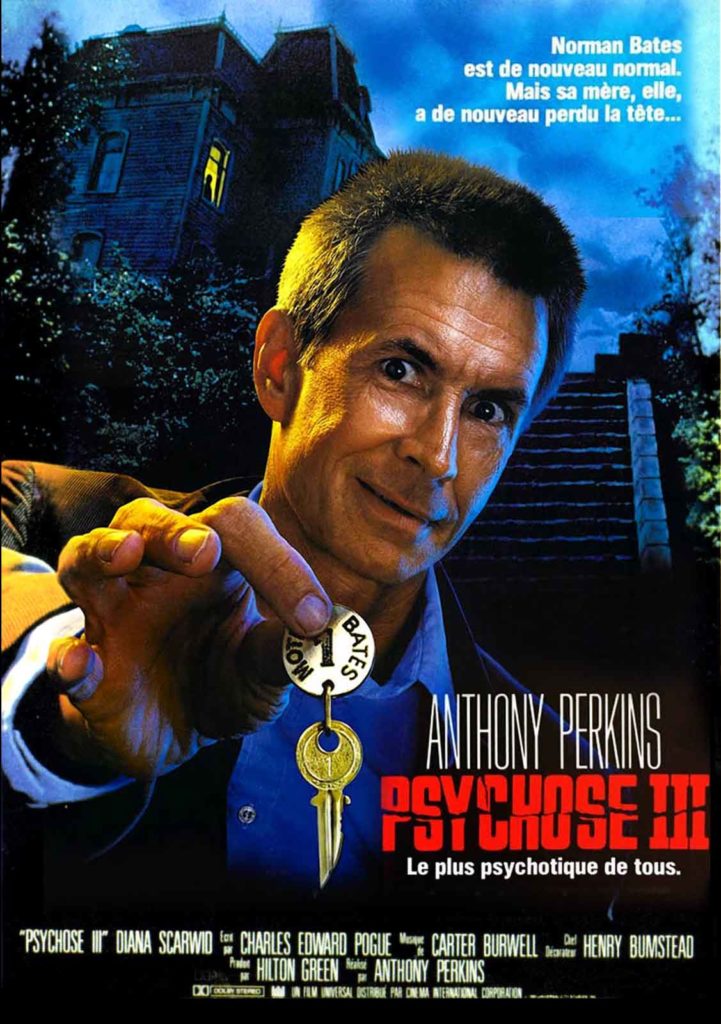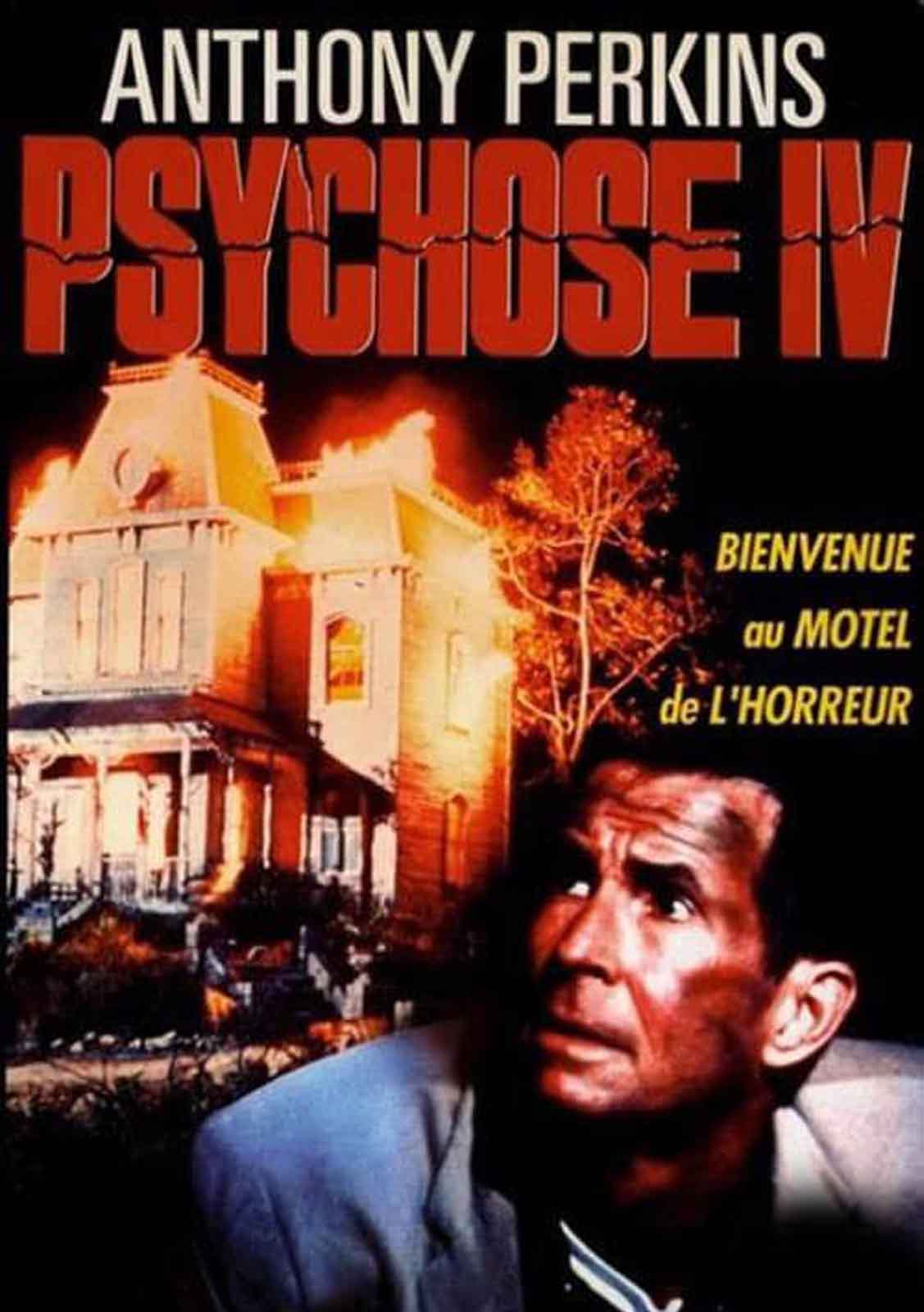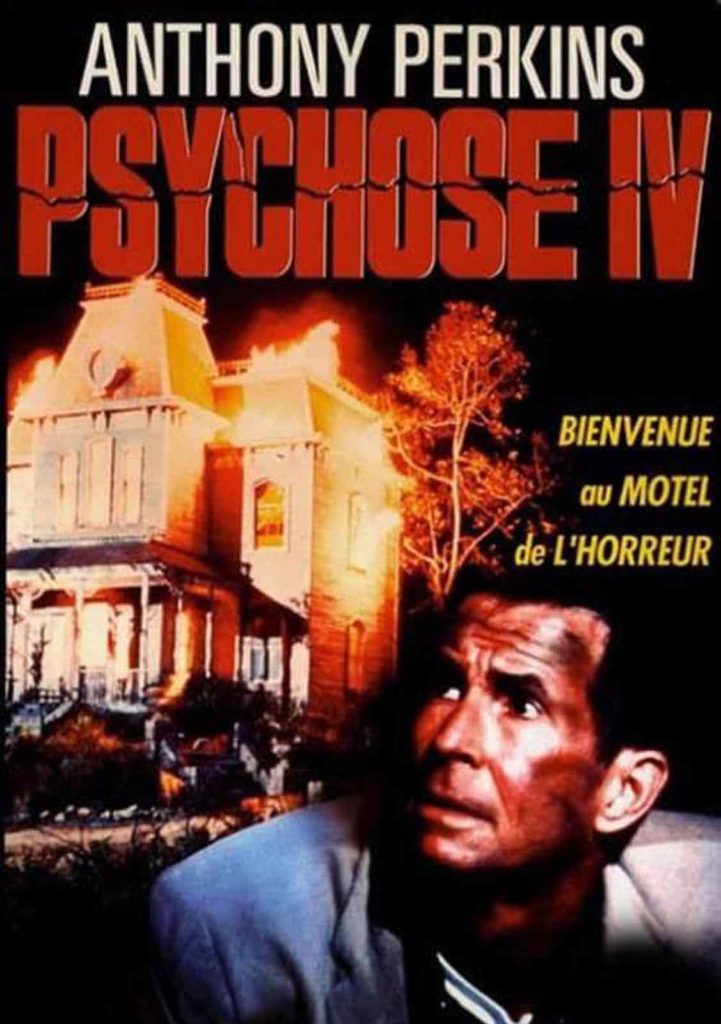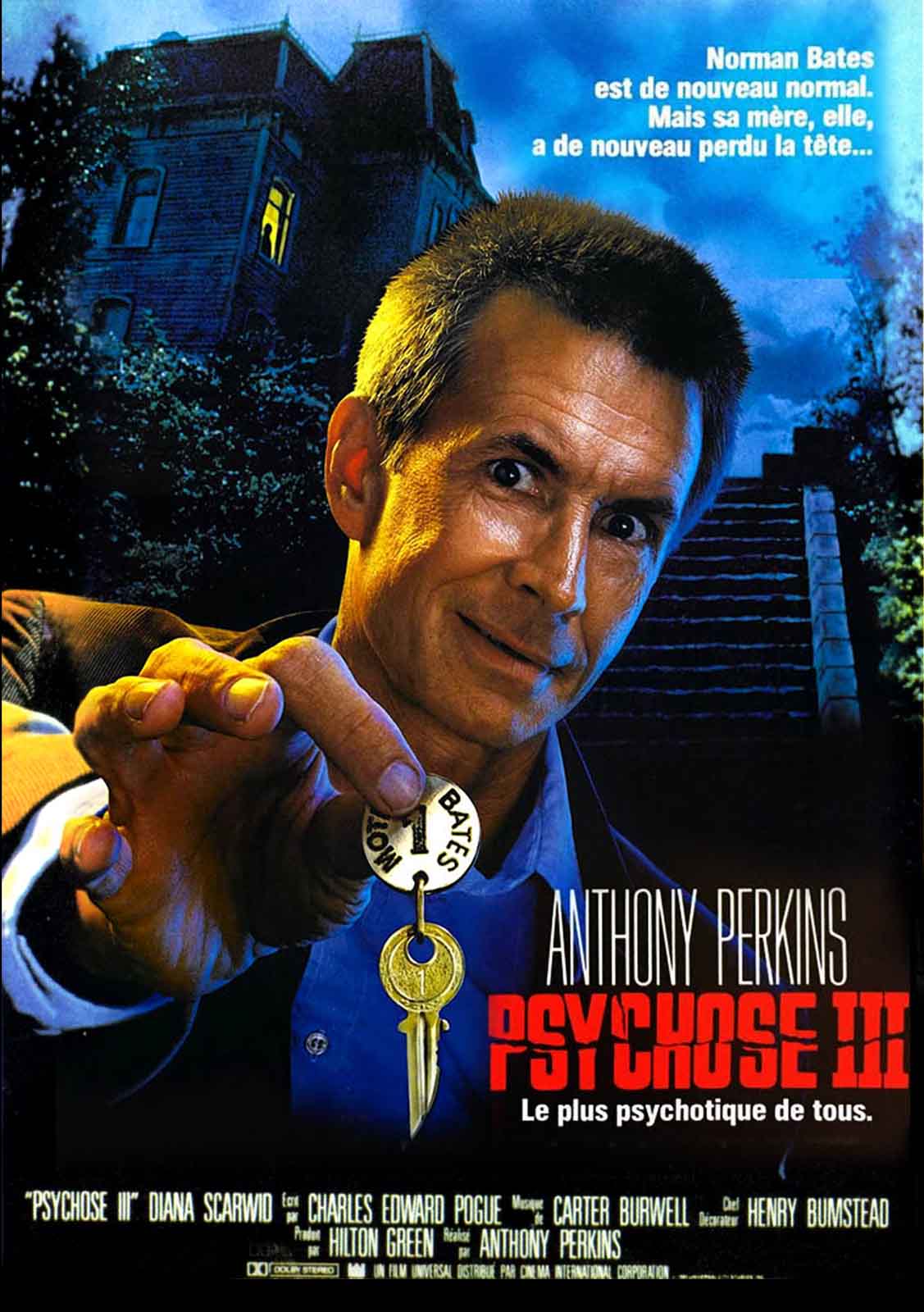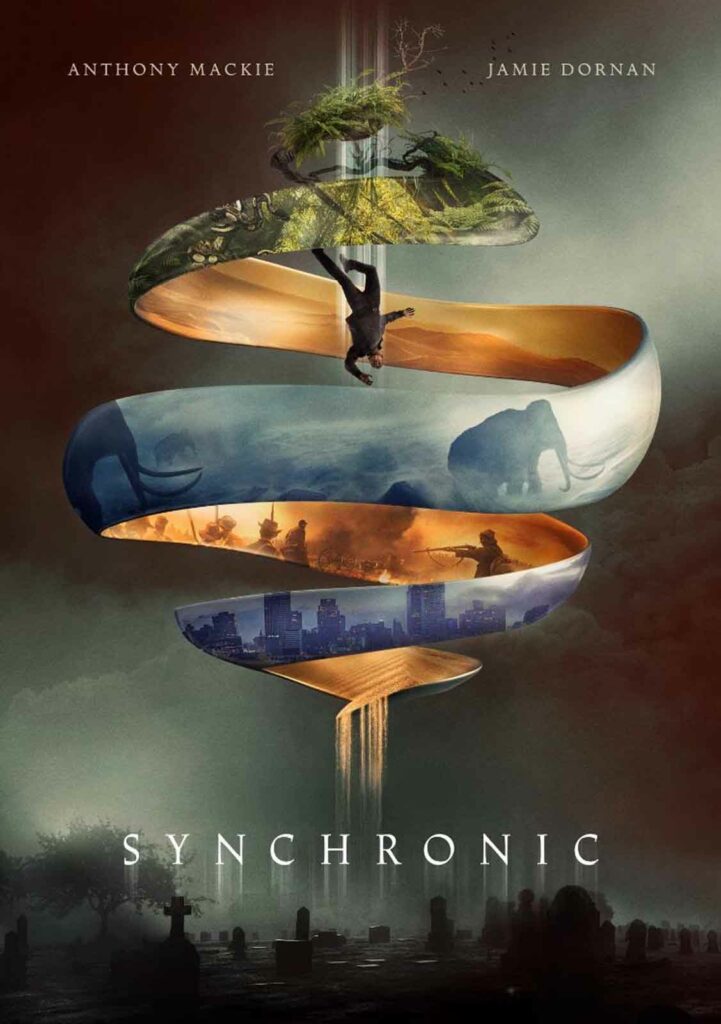La version « live » du célèbre dessin animé produit par les studios Disney prend la forme d’une superproduction à grand spectacle
MULAN
2020 – USA
Réalisé par Niki Caro
Avec Liu Yifei, Yoson An, Gong Li, Donnie Yen, Jason Scott Lee, Jimmy Wong, Doua Moua, Utkarsh Ambudkar, Chum Ehelepola, Jet Li
THEMA SORCELLERIE ET MAGIE
L’adaptation « live » de l’excellent long-métrage d’animation de Tony Bancroft et Barry Cook s’est concrétisée dans des circonstances compliquées, liées à une situation socio-politique en pleine tourmente. Les relations tumultueuse qu’entretient la Chine avec le monde occidental se sont logiquement envenimées avec la levée du voile sur l’internement forcé de la minorité musulmane Ouïgoure dans la province du Xinjiang, province qui aurait apporté son aide à la production de ce nouveau Mulan. Autant dire que les levées de bouclier n’ont pas tardé, certains allant jusqu’à taxer les studios Disney de complicité de crime contre l’humanité. D’autre part, la distribution du film – qui aurait pu requinquer les salles de cinéma sérieusement mises à mal par la crise du Covid 19 – a été annulée un peu partout au profit d’une diffusion sur la plateforme Disney +, la maison de Mickey préférant assurer ses arrières financièrement plutôt que subir la défaite au box-office d’une superproduction chiffrée à 200 millions de dollars. La colère des exploitants et des spectateurs a provoqué une nouvelle polémique autour du film. Le fait que la pandémie mondiale trouve ses origines en Chine ne fait bien sûr que compliquer les choses. Même s’il est difficile de séparer l’œuvre de son contexte, il nous faut tout de même tenter d’analyser Mulan sous un angle purement cinématographique.


L’idée d’un Mulan en prises de vues réelles date de 2010, époque à laquelle Disney envisage de confier le premier rôle à Zhang Ziyi (Tigre et Dragon) et la mise en scène à Chuck Russell (The Mask). Sans cesse repoussé, le projet patine jusqu’à prendre corps une décennie plus tard. Ang Lee est contacté pour la mise en scène, mais son planning l’empêche d’accepter, et c’est finalement la réalisatrice néo-zélandaise Niki Caro qui hérite du bébé. Au casting, on retrouve du beau monde comme l’impressionnant Jason Scott Lee (Bruce Lee dans le Dragon de Rob Cohen) en chef des barbares, la sublime Gong Li (qui servit d’ailleurs de modèle pour l’héroïne du Mulan de 1998) en sorcière métamorphe ou l’incontournable Jet Li en empereur de Chine. Pour le rôle de Mulan, on sollicite en revanche un visage moins connu. Si ce n’est pas une débutante (elle croisait déjà la route de Jet Li mais aussi de Jackie Chan dans Le Royaume interdit), Yifei Liu n’a été sélectionnée qu’après l’audition d’un millier de candidates. Il faut dire que le cahier des charges nécessité par le rôle s’avérait conséquent : le physique de l’emploi bien sûr, mais aussi la pratique des arts martiaux, le maniement des armes, l’expérience de l’équitation et une maîtrise totale de la langue anglaise. La jeune comédienne coche allègrement toutes les cases, allant jusqu’à exécuter elle-même la grande majorité des cascades du film. Dans une Chine impériale reconstituée en grande partie en Nouvelle-Zélande, le récit de Mulan reprend fidèlement celui de son modèle dessiné, la jeune fille partant gonfler les rangs de l’armée en se faisant passer pour un garçon afin d’éviter à son père de risquer sa vie sur le front. Les analogies avec le Yentl de Barbra Streisand sont toujours présentes (avec cette idée similaire d’une société ayant relégué chaque sexe à une fonction spécifique, obligeant les femmes à se travestir en homme pour accéder à un rôle qui leur est interdit) et une grande partie des séquences épiques du premier film sont revisitées, notamment la titanesque avalanche ou le climax vertigineux.
Le côté obscur du Ch’i
Pour autant, ce Mulan n’est pas une copie carbone de son modèle, s’éloignant de fait de la démarche vaine de La Belle et la Bête de Bill Condon ou du Aladdin de Guy Ritchie. Le film possède son propre style, sa propre personnalité, évacuant les parties chantées (l’action ne s’interrompt plus pour laisser les personnages faire des vocalises) et les animaux parlants. Si le dragon Mushu et le criquet porte-bonheur ont disparu, le caractère fantastique du récit se renforce pourtant à travers cette sorcière capable d’imiter les traits de ses semblables ou de se muer en volatile, ces guerriers défiant les lois de la gravité ou ce Phoenix mythologique qui traverse régulièrement les cieux pour guider notre héroïne. Quant à Mulan, elle possède le Ch’i, un don qui la dote d’une force, d’une agilité et d’une rapidité quasi-surnaturelles. Ces capacités hors-normes la muent quasiment en chevalier Jedi (le principe du Ch’i ayant inspiré à George Lucas celui de la Force, la boucle est bouclée). Le scénario lui offre même la tentation de « suivre le côté obscur », le temps d’une séquence qu’il est difficile d’appréhender autrement que comme un clin d’œil à Star Wars. Visuellement, le film est splendide (décors, costumes et photographie rivalisent de beauté) et la musique de Harry Gregson-Williams parvient habilement à se soustraire à l’influence de Jerry Goldsmith tout en rendant plusieurs hommages discrets à la bande originale du film original. Le bilan de ce Mulan « live » est donc globalement positif. Car si les séquences de comédie (l’enfance malicieuse de Mulan, la scène de la marieuse) s’avèrent pataudes et si certains raccourcis scénaristiques cèdent à la facilité, Niki Caro fait des merveilles lorsqu’elle se laisse porter par le souffle de l’aventure.
© Gilles Penso
Partagez cet article