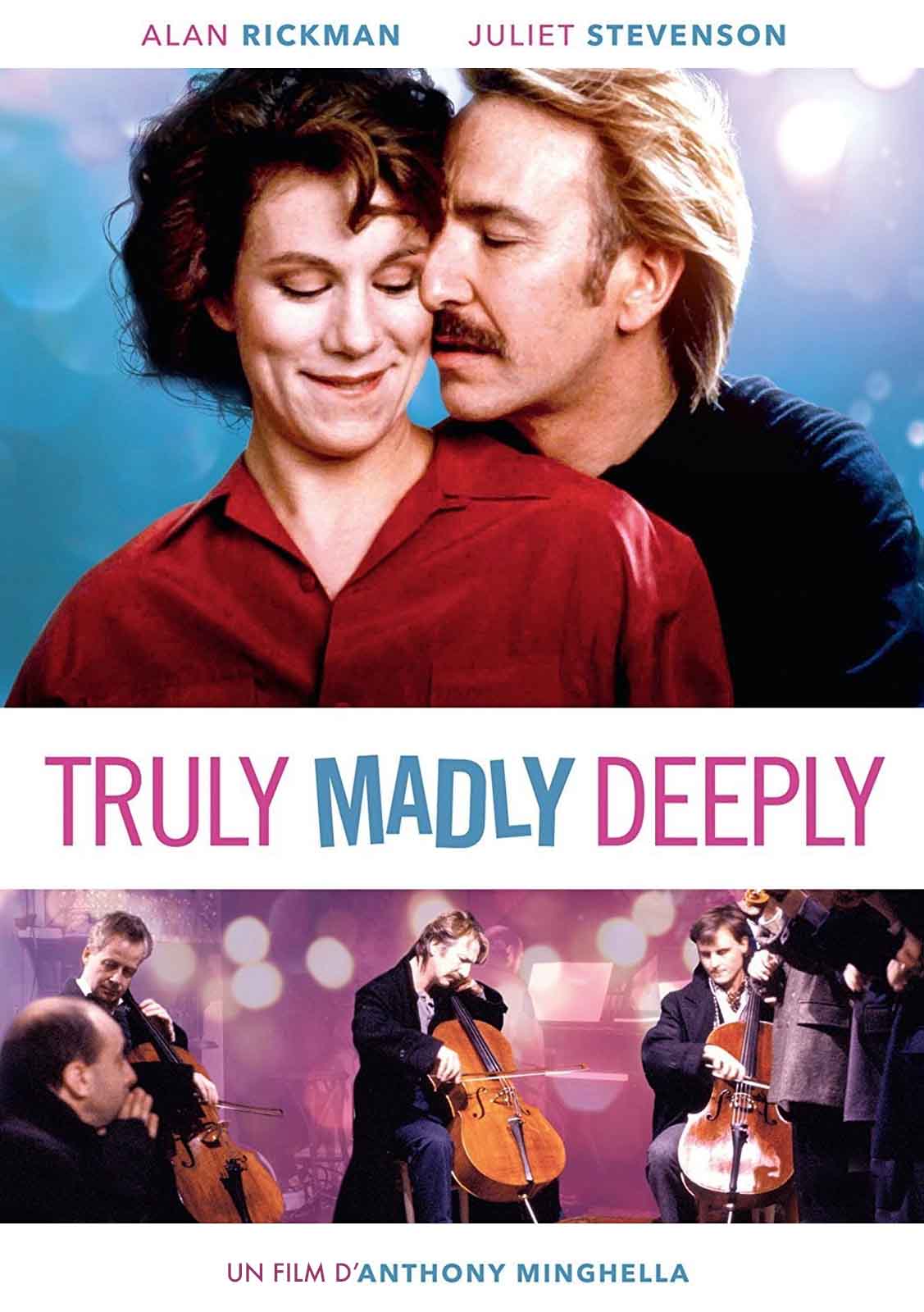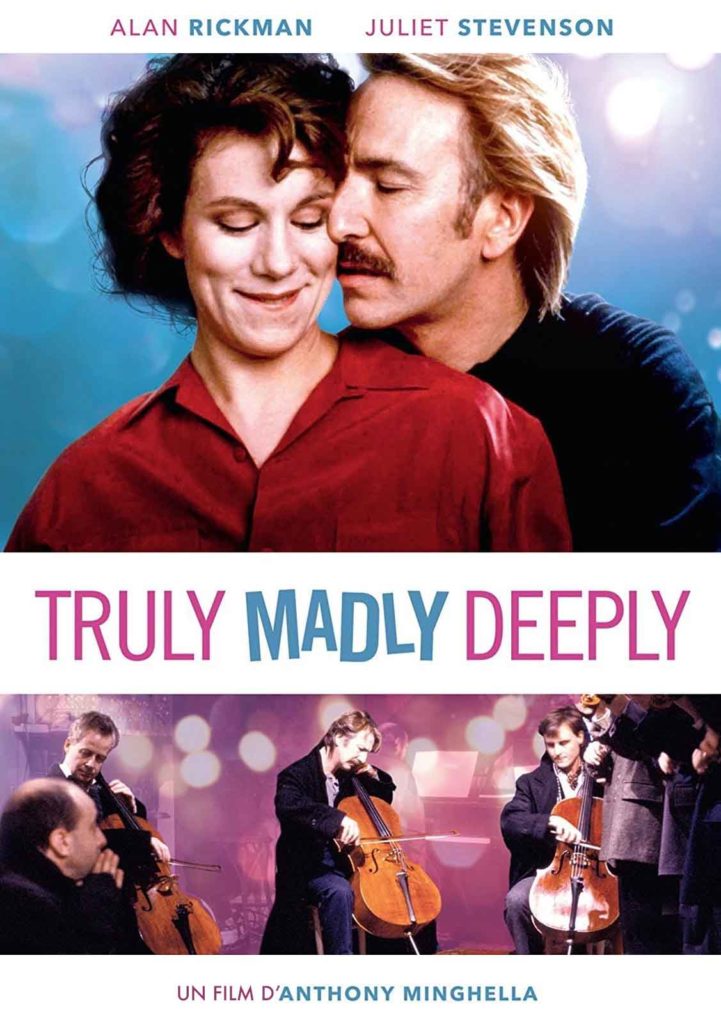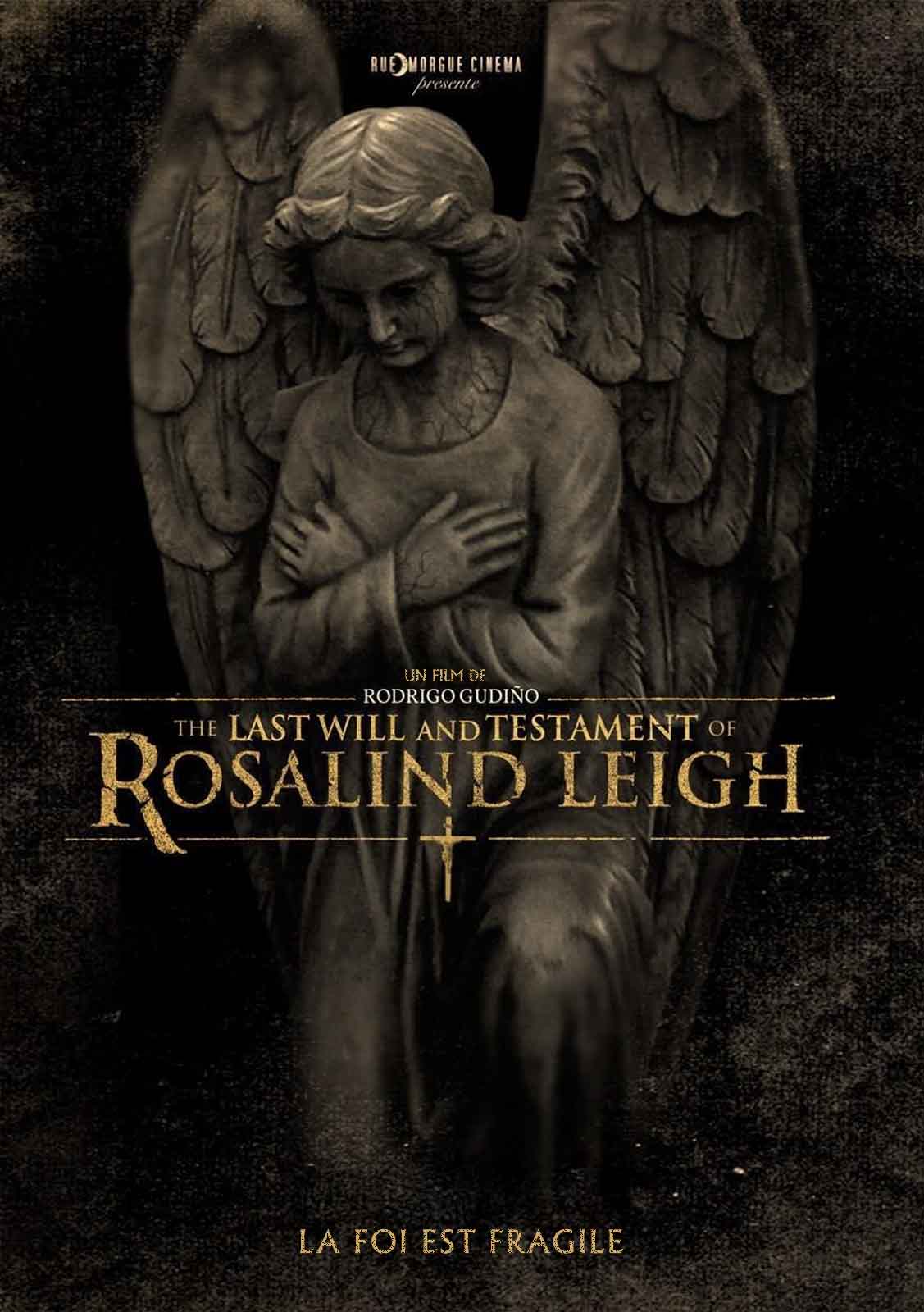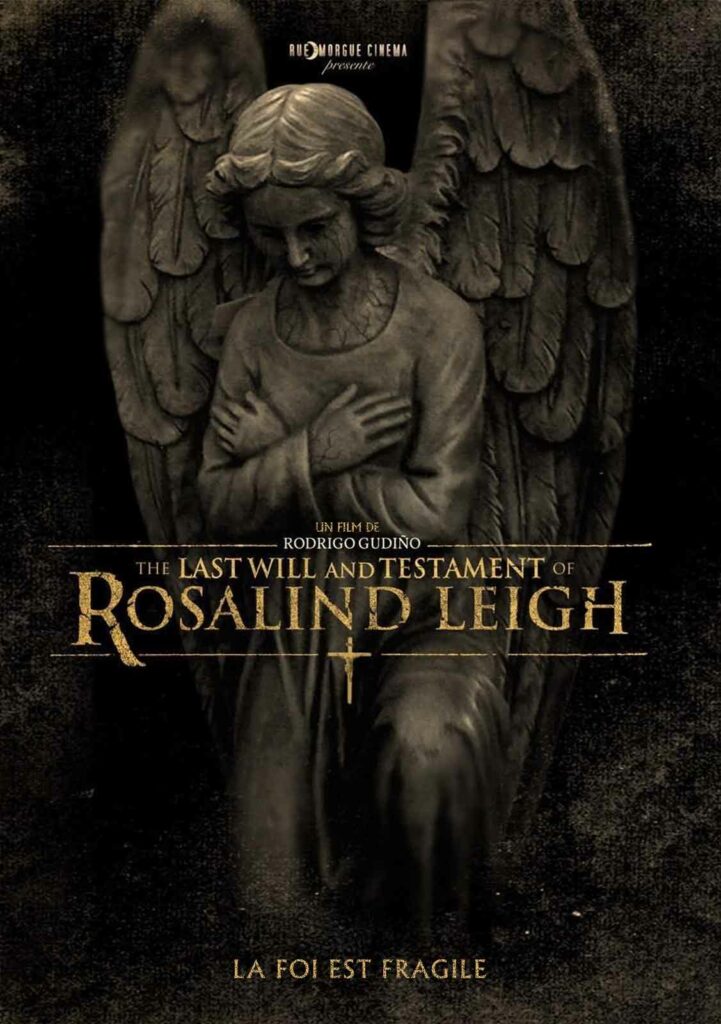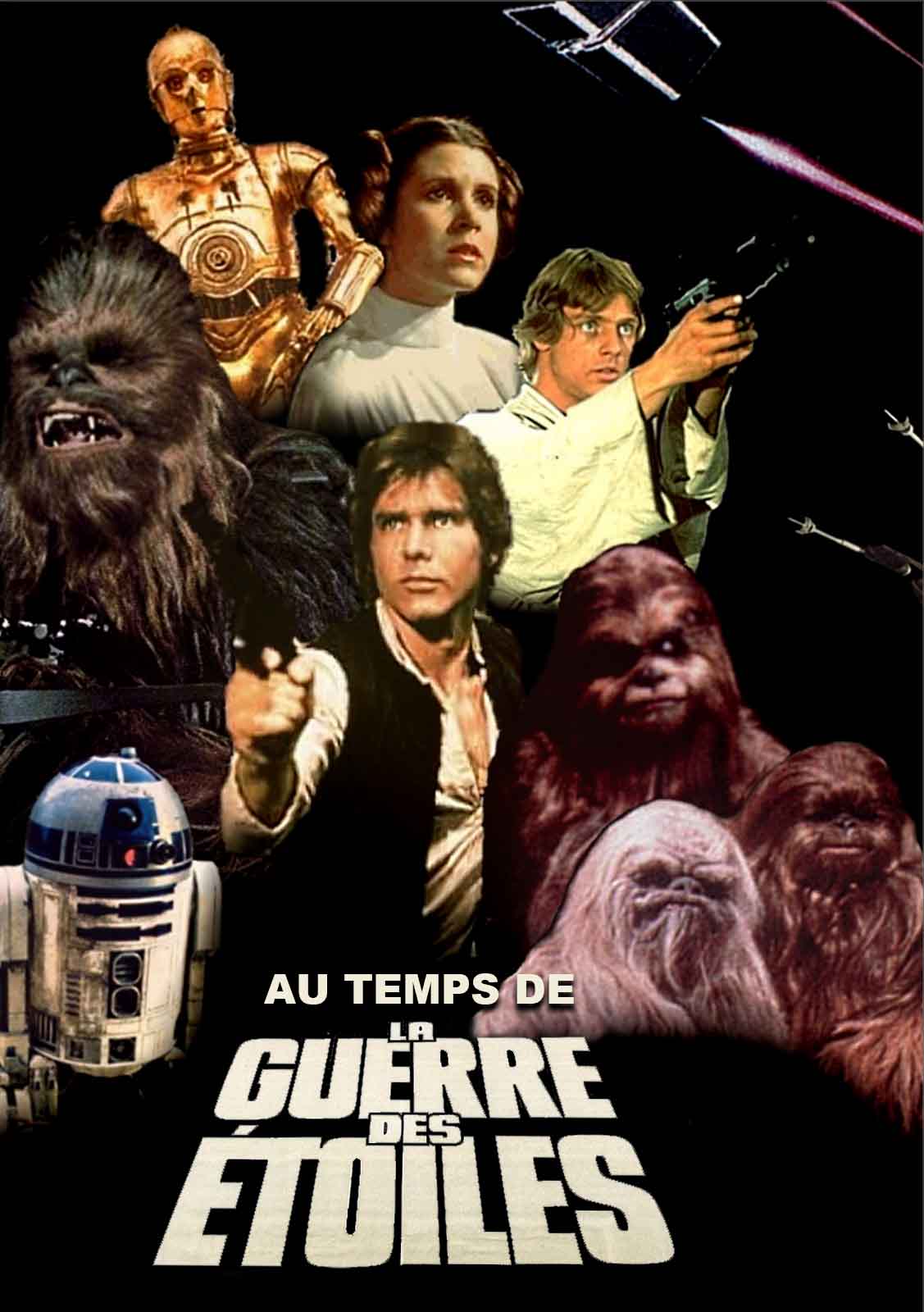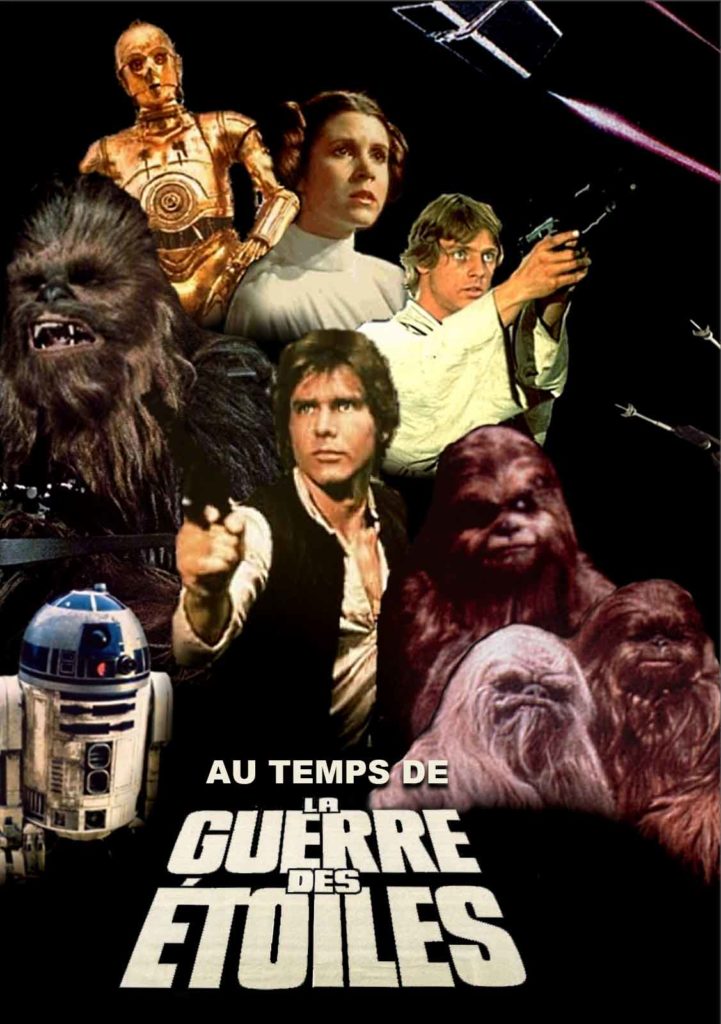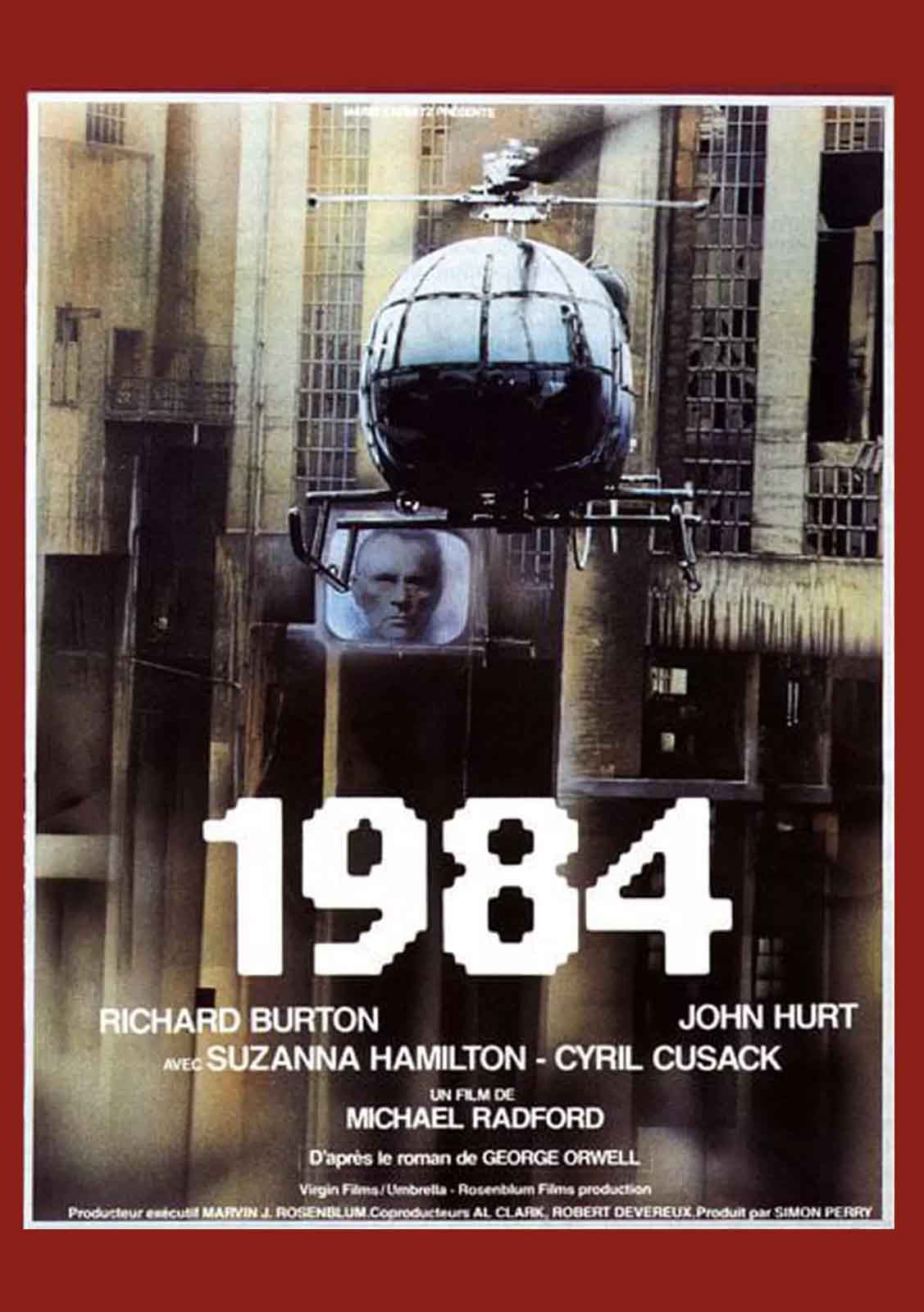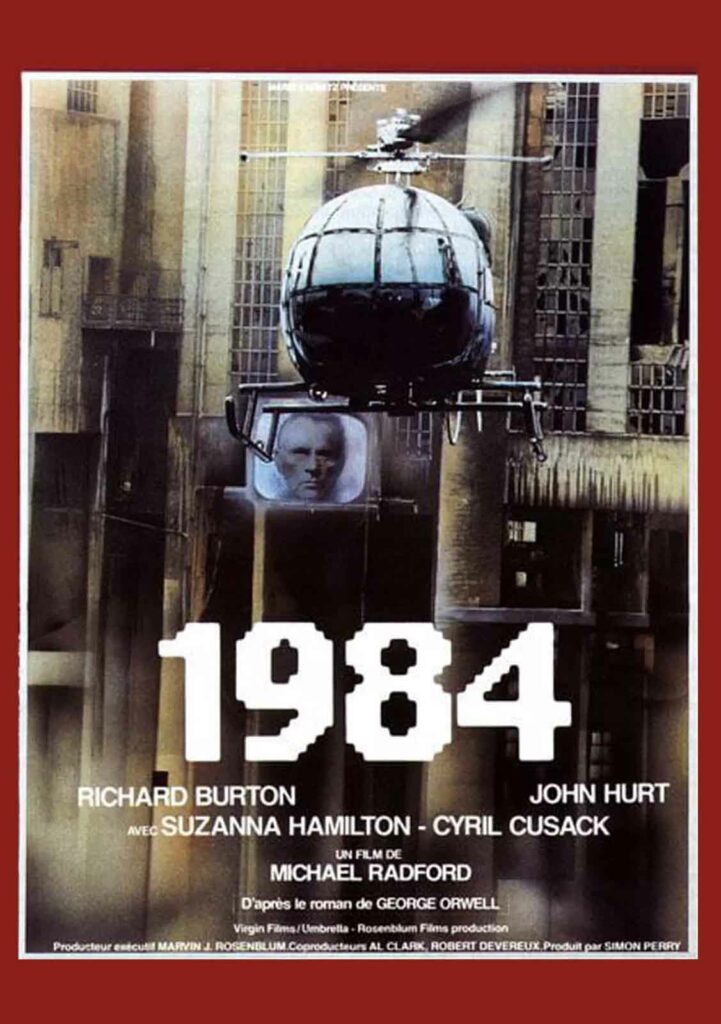Des expériences atomiques réveillent un monstre géant, mi-escargot mi-mille pattes, qui s'en va semer la panique autour d'un lac
THE MONSTER THAT CHALLENGED THE WORLD
1957 – USA
Réalisé par Arnold Laven
Avec Tim Holt, Audrey Dalton, Hans Conried, Barbara Darrow, Max Showalter, Harlan Wade, Gordon Jones, Mimi Gibson
THEMA INSECTES ET INVERTEBRES
Sous son titre français anonyme et fadasse, Le Secret du Lac Salé abrite l’un de ces monstres improbables dont raffolait la science-fiction des années 50. Ici, il s’agit d’un gigantesque invertébré à mi-chemin entre l’escargot et le mille-pattes, que des scientifiques lyriques surnomment « Kraken », en hommage aux monstres marins des légendes nordiques. D’habitude rompu au petit écran, le réalisateur Arnold Laven s’en sort plutôt bien, exploitant jusqu’au dernier centime les quelque 250 000 dollars qui lui sont alloués pour le film. L’intrigue se situe aux abords du lac Salton, au beau milieu d’un désert du Sud de la Californie, où le gouvernement américain a installé une base de recherche navale. Une série d’expériences atomiques ultra-secrètes et un tremblement de terre : il n’en faut pas plus pour réveiller ce fameux monstre d’origine préhistorique, affamé et très vindicatif, comme Godzilla et Le Monstre des Temps Perdus.


Les morts mystérieuses s’accumulent donc autour du lac, chaque victime étant retrouvée dans un affreux état : livide, figée, les yeux écarquillés et la peau séchée. Les premières attaques évoquent avec vingt ans d’avance celles des Dents de la Mer, notamment cette séquence nocturne où une jeune fille, nageant à la suite de son petit ami, est soudain happée sous les flots par la bête qui demeure invisible. Le périmètre est bientôt bouclé, et militaires et scientifiques se serrent les coudes pour enrayer la menace. D’autant que le monstre semble ne pas être seul. En effet, toute une horde de ces horribles bestioles carnivores et amphibies s’apprête à gagner la terre ferme pour défier le monde, comme le dit si bien le titre original. Le docteur Jess Rogers (Hans Conried) délivre alors un avis scientifique sans appel : « depuis qu’ils sont nés, ils ont faim ! » Entre deux scènes de monstre, le scénario s’attache comme il peut aux humains, donnant dans la romance gentillette, et s’amusant à brosser des personnages secondaires pittoresques. Notamment un archiviste particulièrement déjanté et une standardiste qui ne cesse de téléphoner à sa mère.
« Vous allez pouvoir nager à nouveau ! »
La bête, quant à elle, est plutôt réussie. Œuvre d’Augie Lohman, elle bénéficie d’un design des plus intéressants et est animée sous forme d’une marionnette grandeur nature habilement sculptée et mécanisée, ce qui permet des séquences d’interaction directes avec les comédiens. La plus efficace d’entre elles est l’affrontement final, au cours duquel le commandant de l’US Navy John Twillinger (Tim Holt, échappé du Trésor de la Sierra Madre) tente de repousser le dernier monstre vivant à l’aide d’un extincteur, avant que des soldats ne viennent lui prêter main-forte et abattent la créature sous une rafale de balles. Le dialogue final, précédant le « The End » fatidique, ne fait pas tout à fait dans la dentelle : « devinez quoi, Sandy », déclare jovialement Twillinger à la jolie secrétaire du savant incarnée par Mimi Gibson, « vous allez pouvoir nager à nouveau ! », ce à quoi elle rétorque en gloussant : « je peux ? » Bref, rien de bien transcendant, ni de très mémorable, mais un bon vieux film de monstre géant comme on les aime : naïf, excessif, et esquivant le ridicule avec une belle témérité.
© Gilles Penso
Partagez cet article