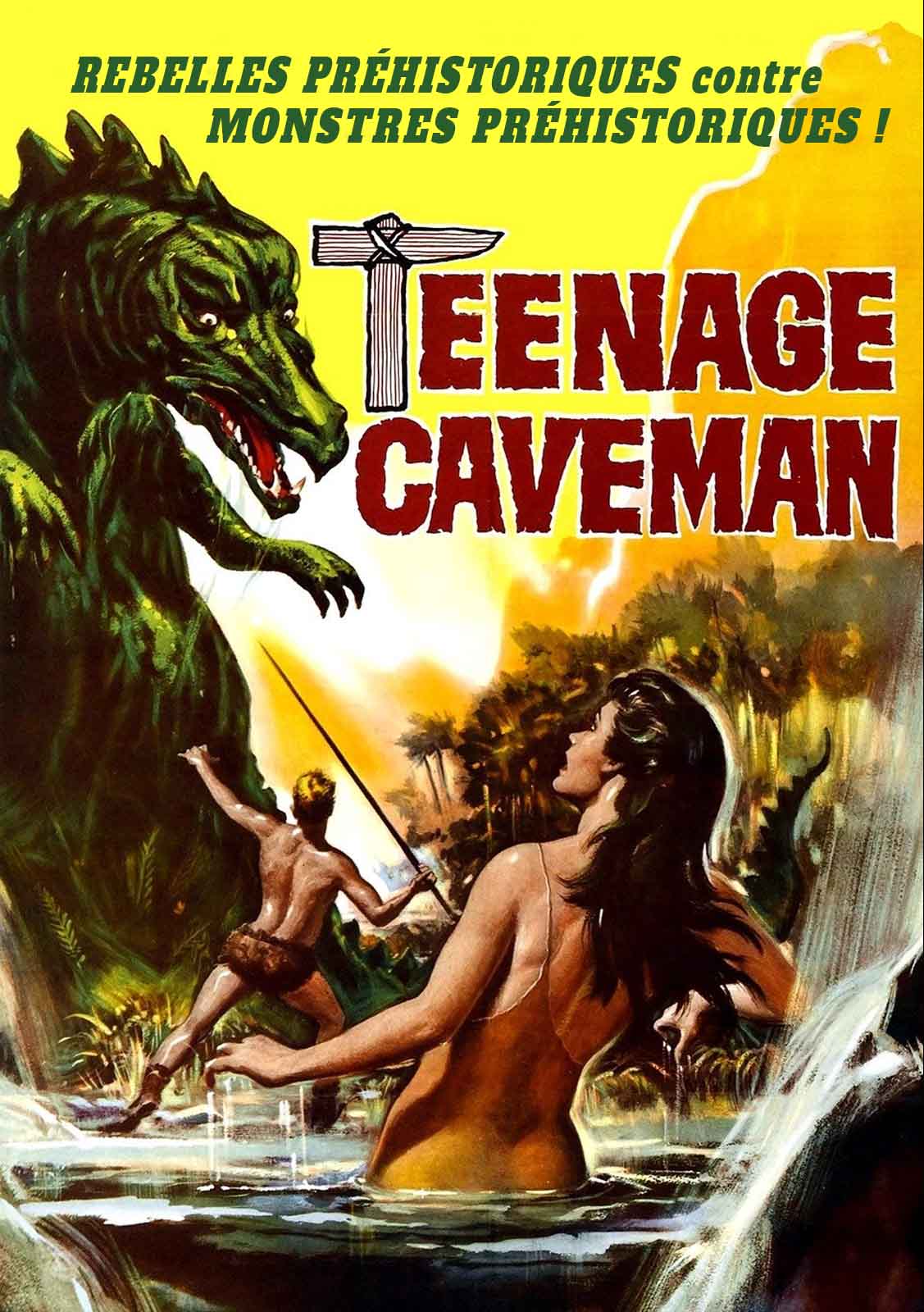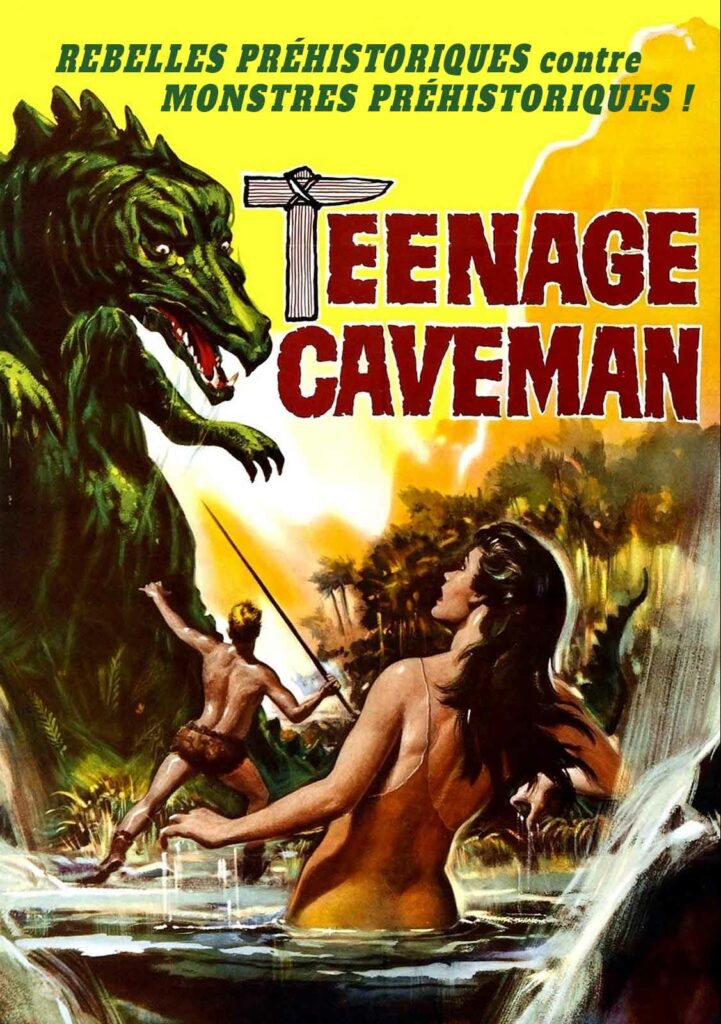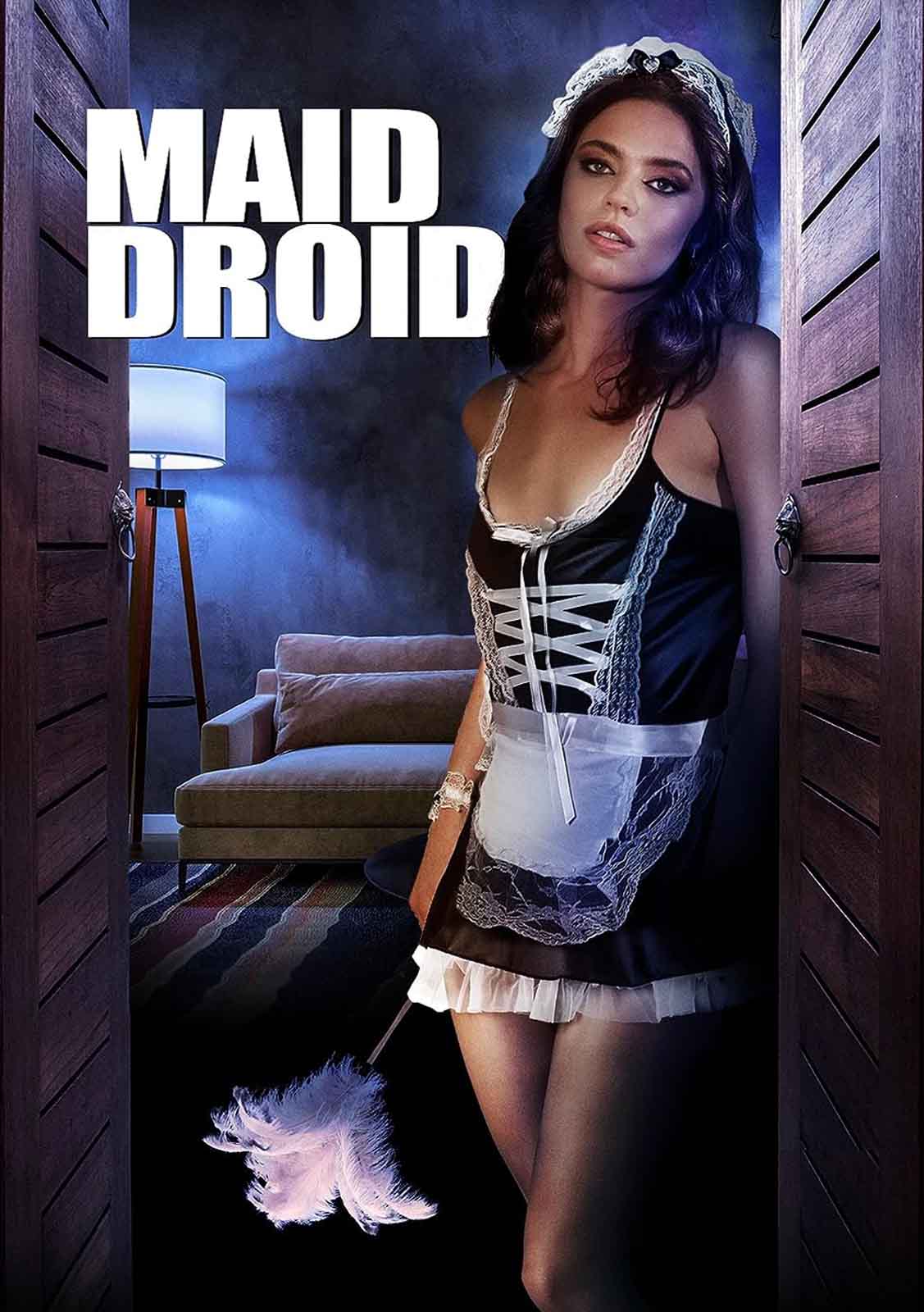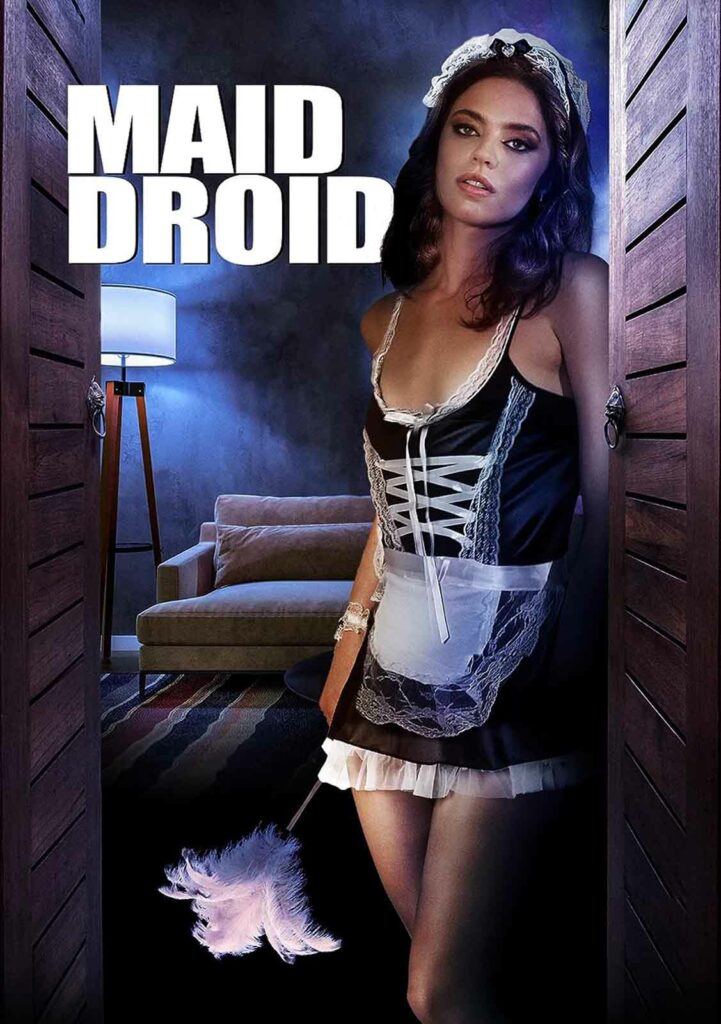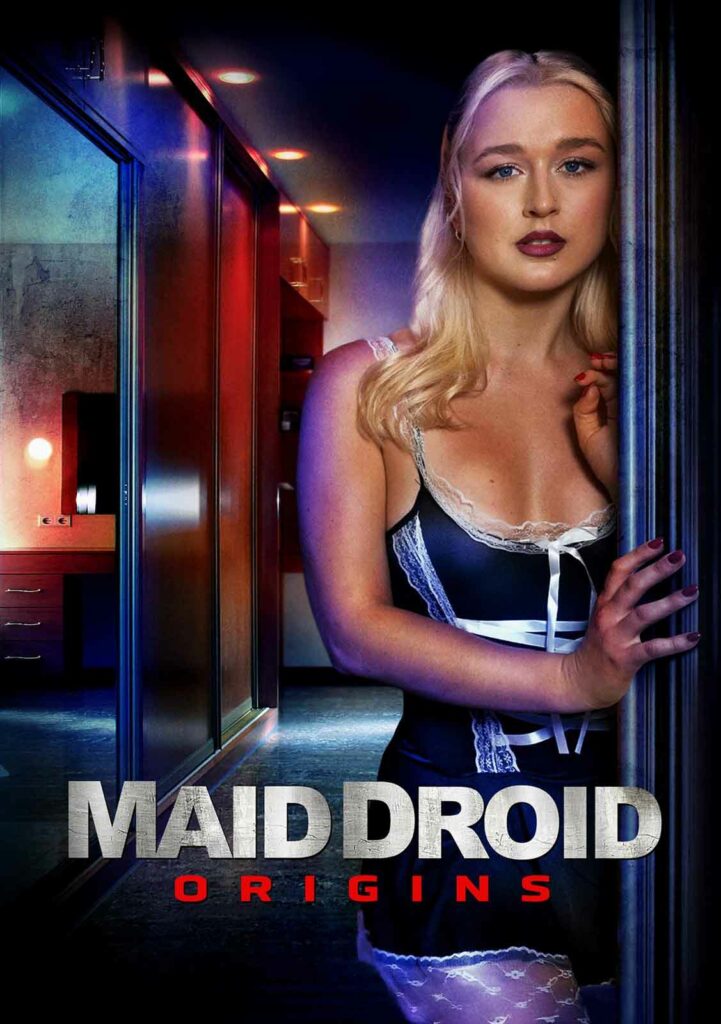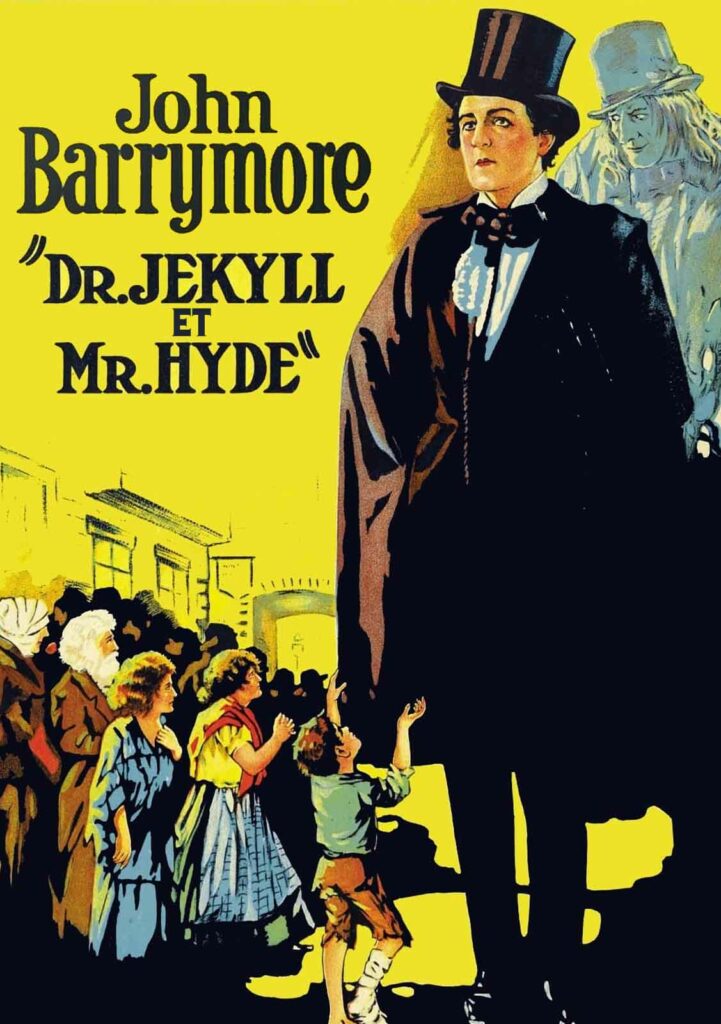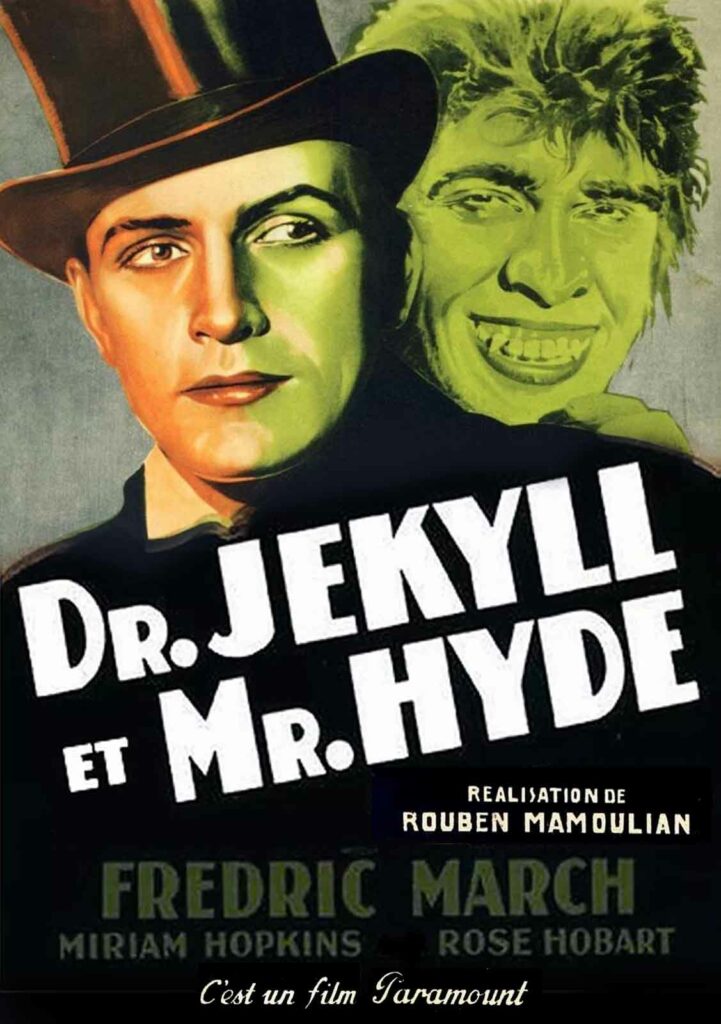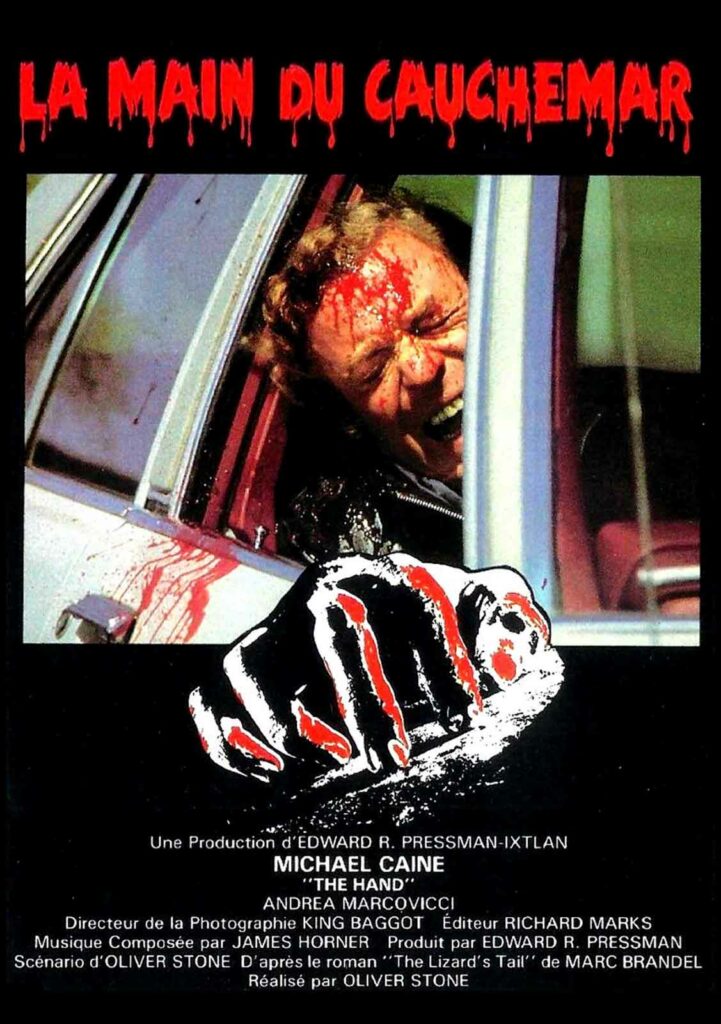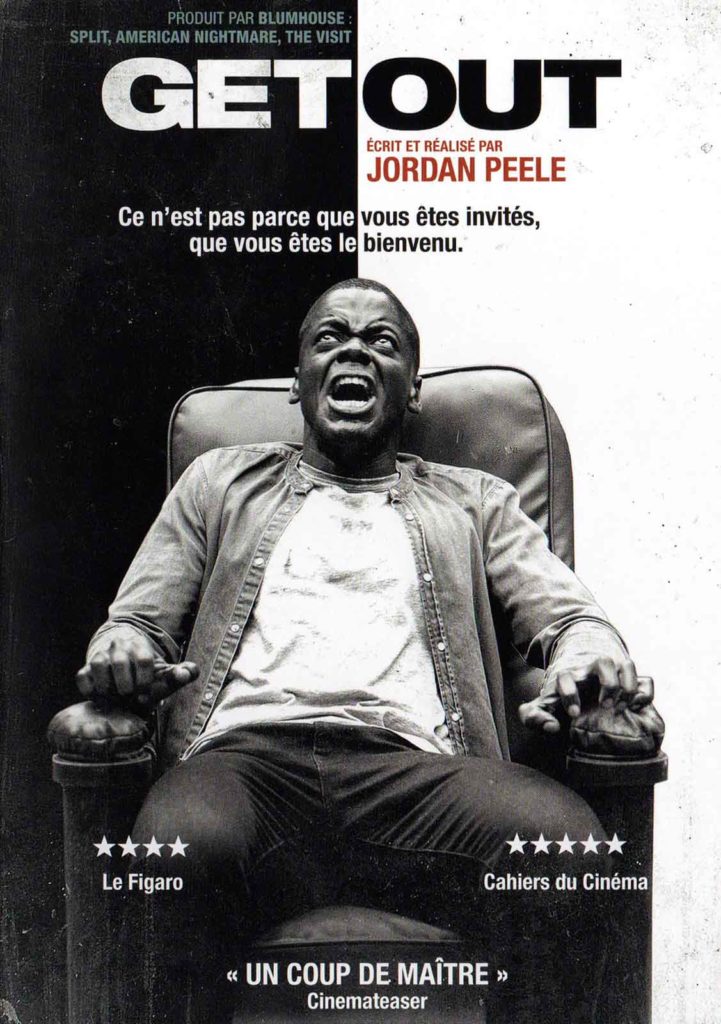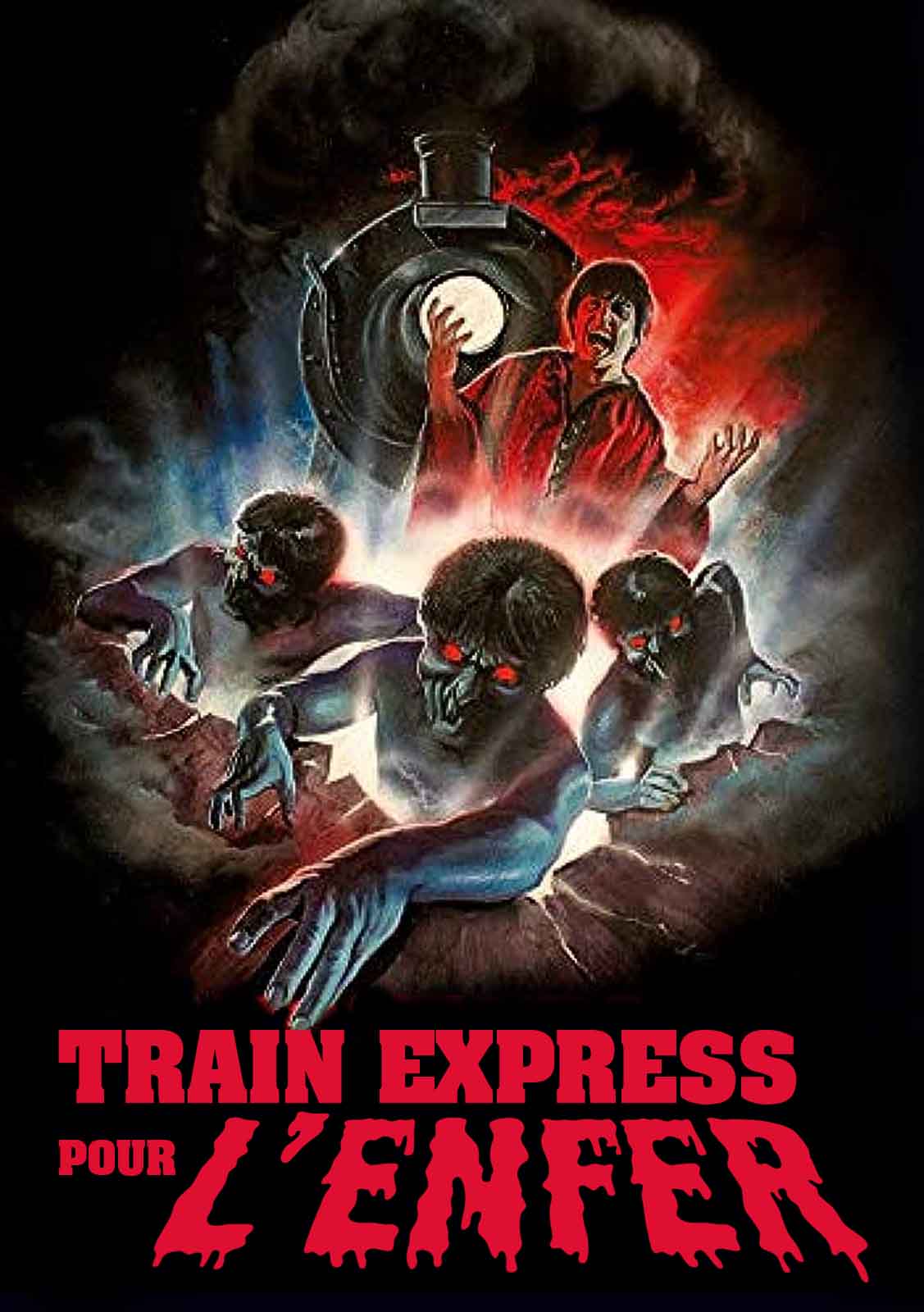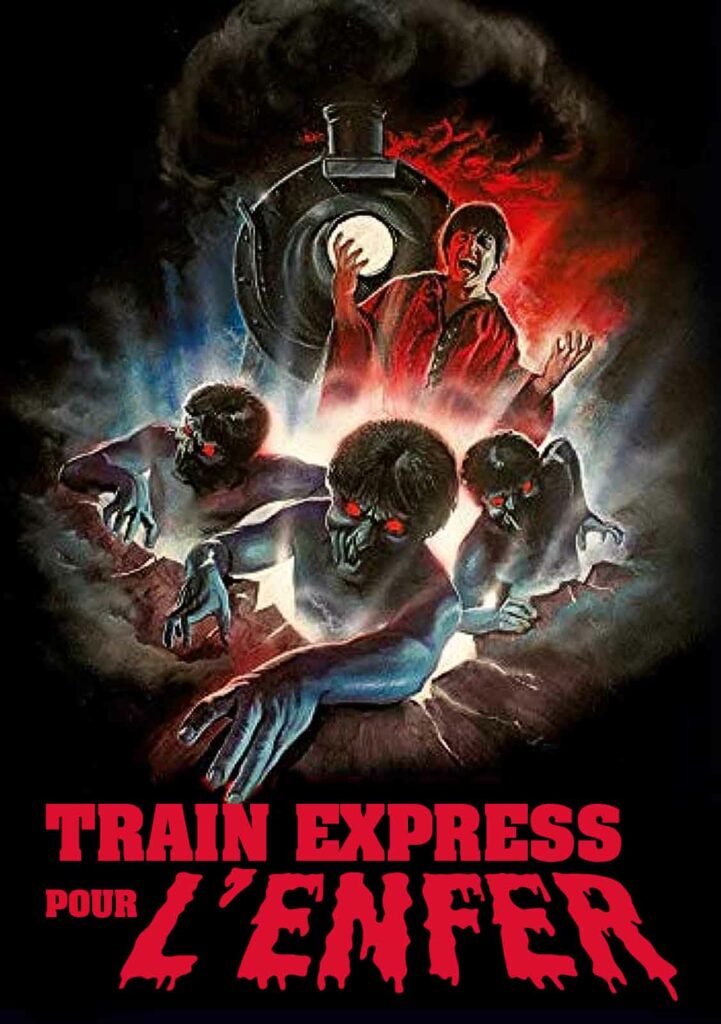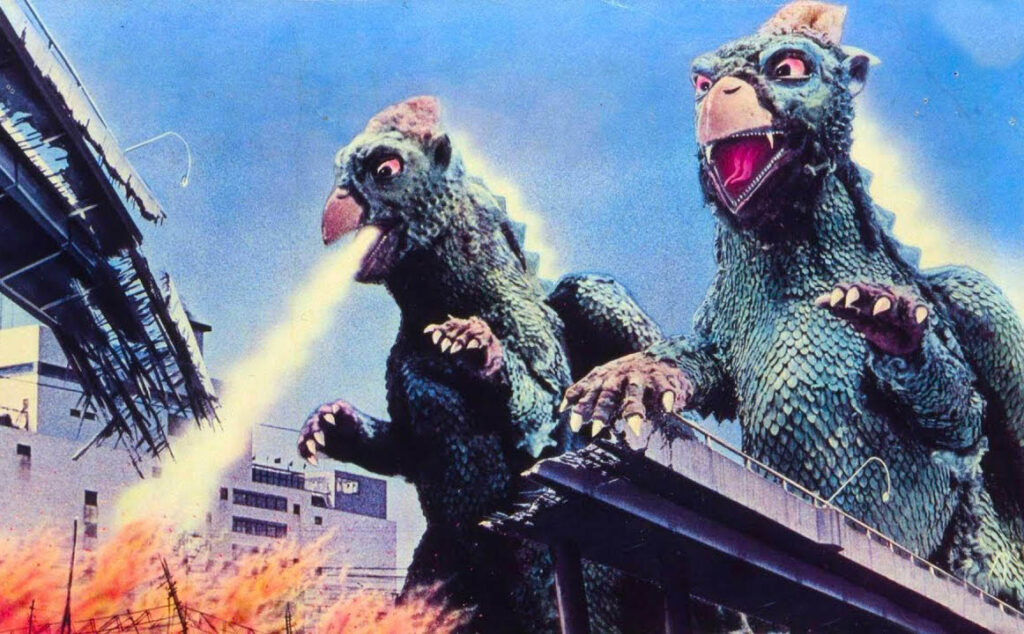Trois enfants nés la même nuit, pendant une éclipse du soleil, révèlent à l’âge de dix ans de dangereuses tendances psychopathes…
BLOODY BIRTHDAY
1981 – USA
Réalisé par Ed Hunt
Avec Lori Lethin, K.C. Martel, Elizabeth Hoy, Billy Jane, Andy Freeman, Bert Kramer, Melinda Cordell, Susan Strasberg, Jose Ferrer, Julie Brown
THEMA ENFANTS
Ed Hunt ayant réalisé le peu mémorable L’Invasion des soucoupes volantes en 1977, on n’espérait pas grand-chose de sa part en le voyant s’aventurer sur le terrain du slasher. Pourtant, Les Tueurs de l’éclipse ménage son lot de surprises et d’audaces, malgré d’indiscutables maladresses. Le projet est né après la lecture d’un article consacré à l’astrologie. Hunt y apprend que, selon l’auteur, la position de la lune dans le ciel influerait sur les grands événements de notre société et sur les agissements des humains. Dans ce cas, pourquoi ne pas imaginer qu’une éclipse totale du soleil détermine le comportement déviant de trois enfants nés exactement en même temps ? Hunt se met à l’écriture et réunit sa petite équipe de tournage, avec un budget réduit à sa plus simple expression qui l’empêche de s’entourer de certains collaborateurs. James Horner, par exemple (Les Monstres de la mer, Les Mercenaires de l’espace, Wolfen), aurait pu composer la musique du film si les moyens mis à sa disposition n’étaient pas aussi étriqués. Il est finalement remplacé par le moins exigeant Arlon Ober (Le Monstre qui vient de l’espace, Paranoïd). Ce dernier s’en sort sans éclat mais avec efficacité, quitte à plagier un peu les violons de Psychose et les cuivres des Dents de la mer. Le malaise s’installe d’ailleurs dès le générique des Tueurs de l’éclipse, avec une espèce de ritournelle enfantine au piano dont certaines harmonies dissonantes annoncent déjà le climat anxiogène du film.


Nous sommes dans la petite ville de Meadowvale, en Californie, le 9 juin 1970. Trois femmes donnent simultanément naissance à leur enfant pendant une éclipse du soleil. Le réalisateur prend le parti de laisser sa caméra braquée sur le phénomène céleste, tandis que la bande son nous annonce la venue au monde des trois bambins : une fille et deux garçons. Nous voilà déjà intrigués. Le jour de leur dixième anniversaire, Debbie (Elizabeth Hoy), Steven (Andrew Freeman) et Curtis (Billy Jayne) se révèlent tels qu’ils sont : des assassins psychopathes. Un jeune couple est bientôt retrouvé étranglé avec une corde à sauter dans un cimetière où il flirtait. Lorsque le père de Debbie, le shérif Brody (aucun lien avec celui des Dents de la mer, à moins qu’il ne s’agisse d’un hommage ?), est chargé de l’enquête, la petite fille place son skateboard sur un escalier de façon à provoquer sa chute. Le pauvre homme est ensuite achevé à coups de gourdin par Steven et Curtis ! Ce n’est que le début d’une sanglante croisade. Personne ne peut bien sûr soupçonner ces trois sympathiques têtes blondes. Personne sauf le jeune Timmy (K.C. Martel), qui commence à émettre de sérieux doutes sur leur santé mentale, et sa sœur aînée Joyce (Lori Lethin), qui finit par se ranger à son avis. Tous deux vont donc devenir la cible du trio infernal…
Mauvaise graine
Ce qui effraie le plus, chez ces tueurs en culottes courtes, c’est le fait que leur esprit machiavélique ne semble obéir à aucune logique. Ils tuent sans distinguer le bien du mal, sans état d’âme, sans émotion, parce que c’est dans leur nature. Joyce étant férue d’astrologie, elle avance une théorie. « Le soleil et la lune cachaient Saturne quand ils sont nés », dit-elle. « Or c’est Saturne qui contrôle les émotions. » Voilà une explication qui en vaut bien une autre. Toutes les armes qui passent à leur portée sont les bienvenues : corde à sauter, batte de base-ball, pistolet, arc et flèche, fil de téléphone… Si Debbie et Curtis rivalisent de perfidité et de fourberie, leur troisième comparse reste très en retrait, ne se pliant que mollement aux exactions orchestrées par les deux autres. Rien n’explique cette implication restreinte du petit Steven, si ce n’est peut-être l’incapacité d’Ed Hunt à lui réserver une place satisfaisante dans son scénario. Si le film sait ménager d’efficaces séquences de suspense (l’attaque de la voiture dans la décharge publique, l’assaut final dans la maison), la finesse n’est pas toujours au rendez-vous. Plusieurs scènes de seins nus ponctuent par ailleurs le métrage, sans doute pour sacrifier sagement aux codes du genre. Les jeunes couples s’accouplent donc sans pudeur avant de finir les pieds devant et la grande sœur de Debbie se livre à de longs strip-teases devant son miroir en se trémoussant. Malgré sa fin ouverte, Les Tueurs de l’éclipse restera sans suite, faute d’un score satisfaisant au box-office.
© Gilles Penso
Partagez cet article