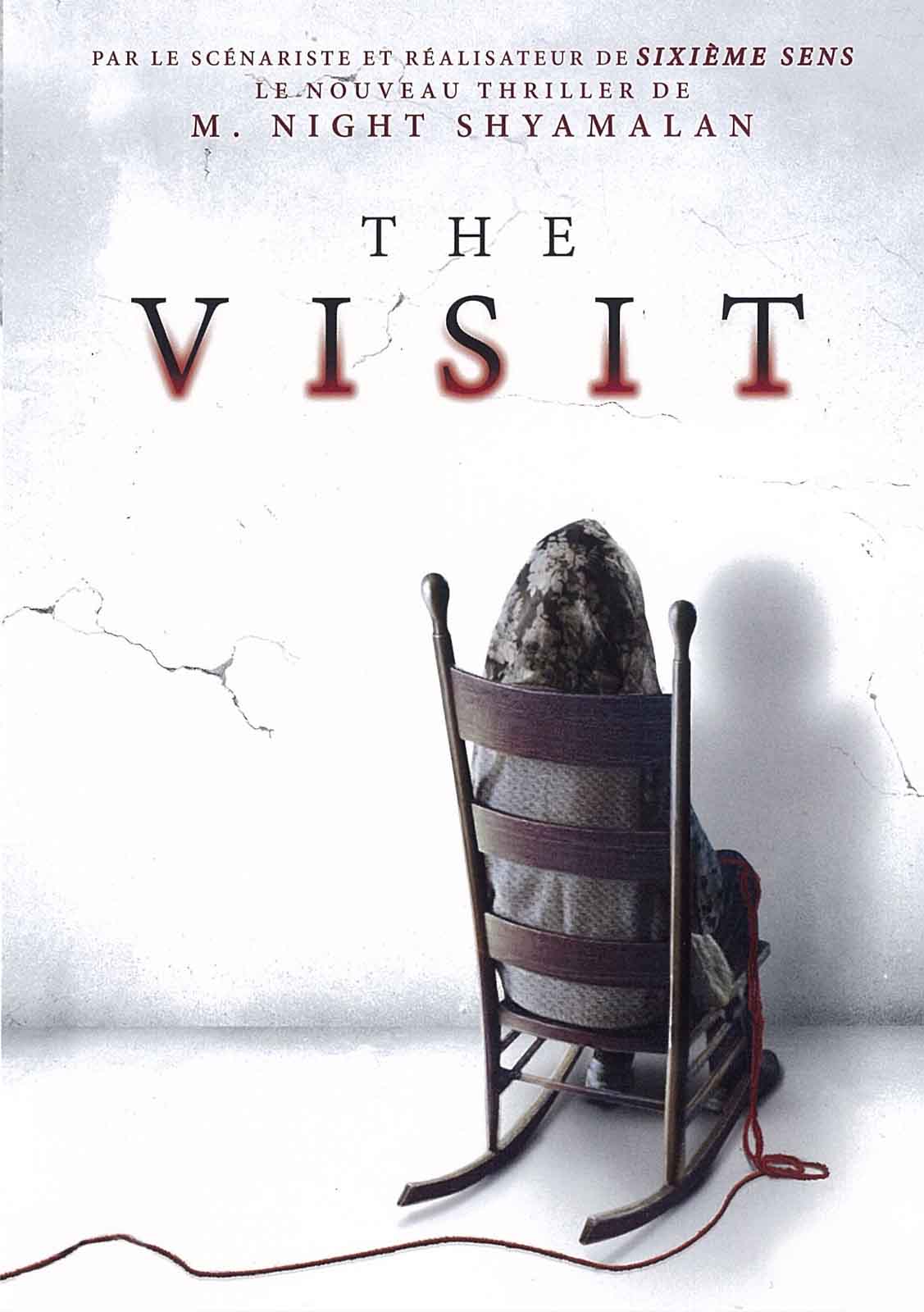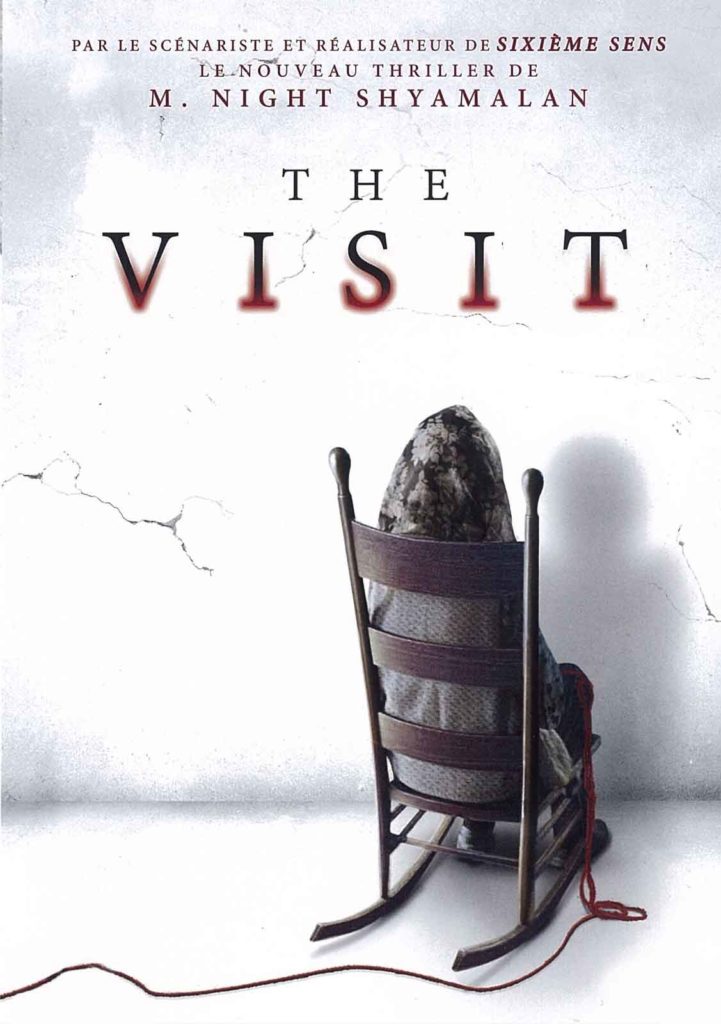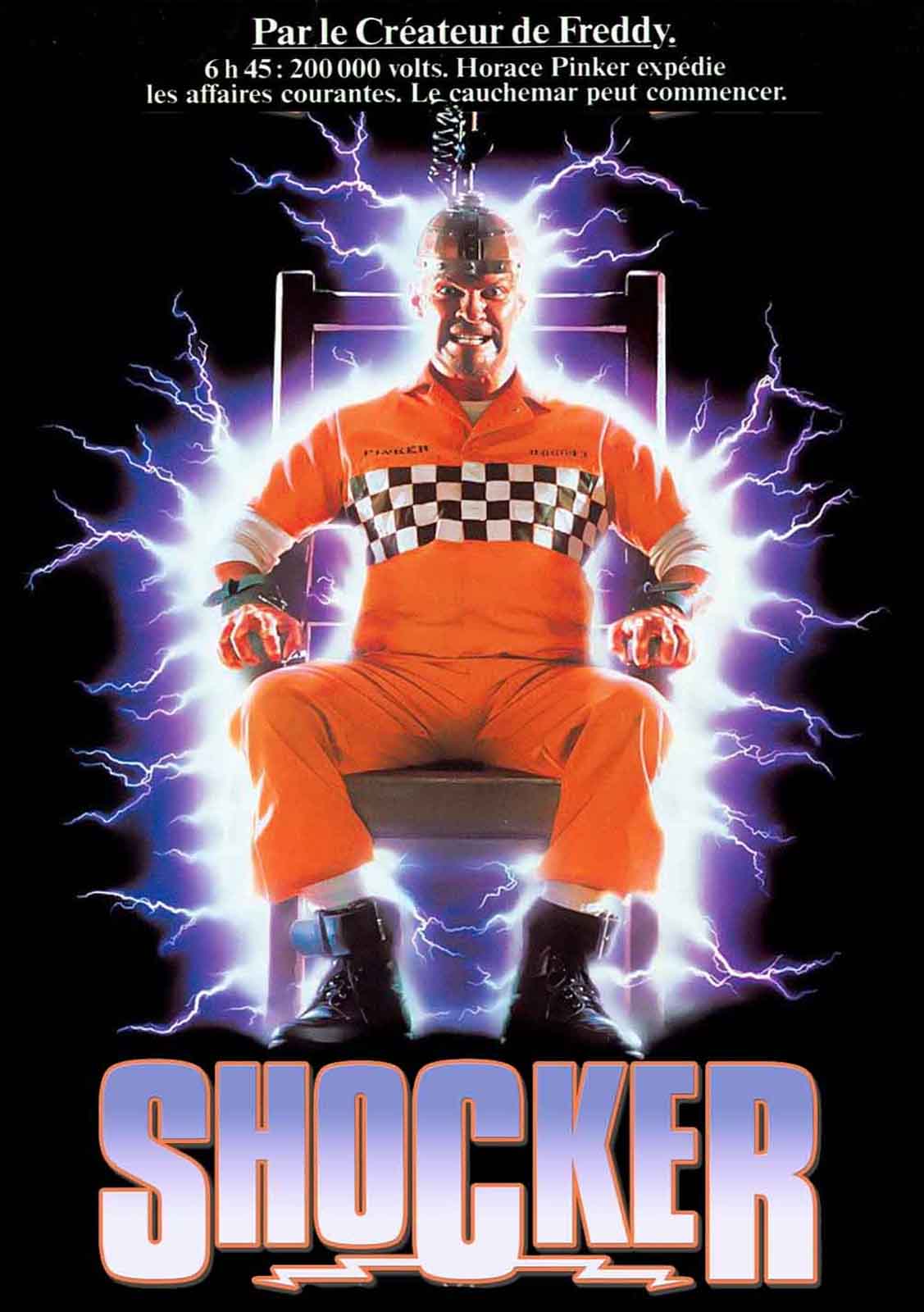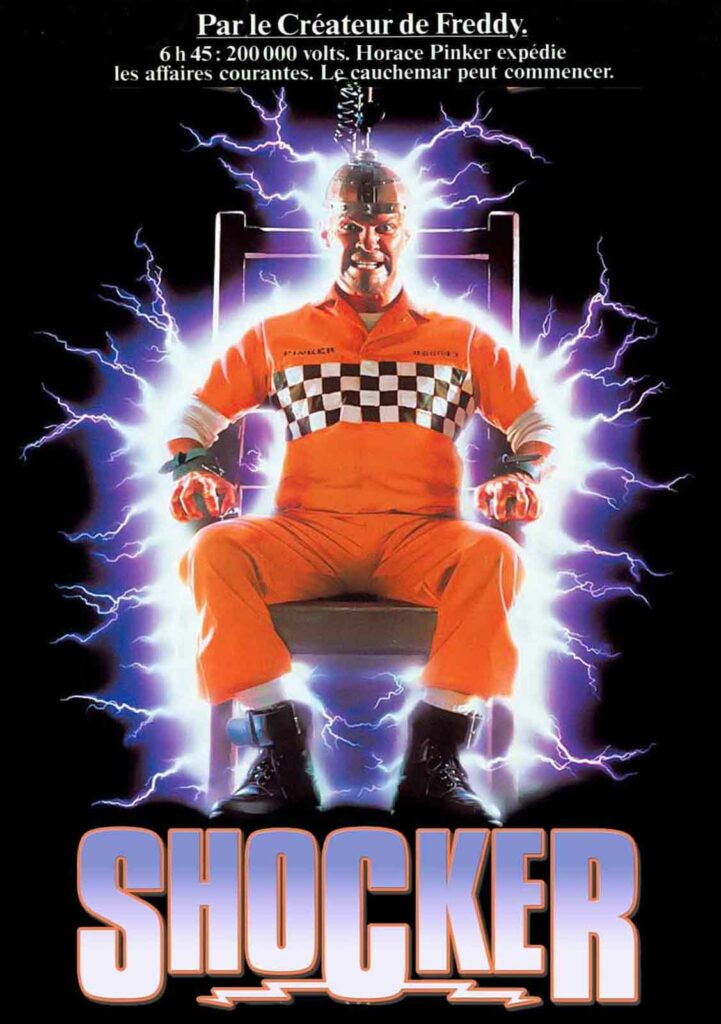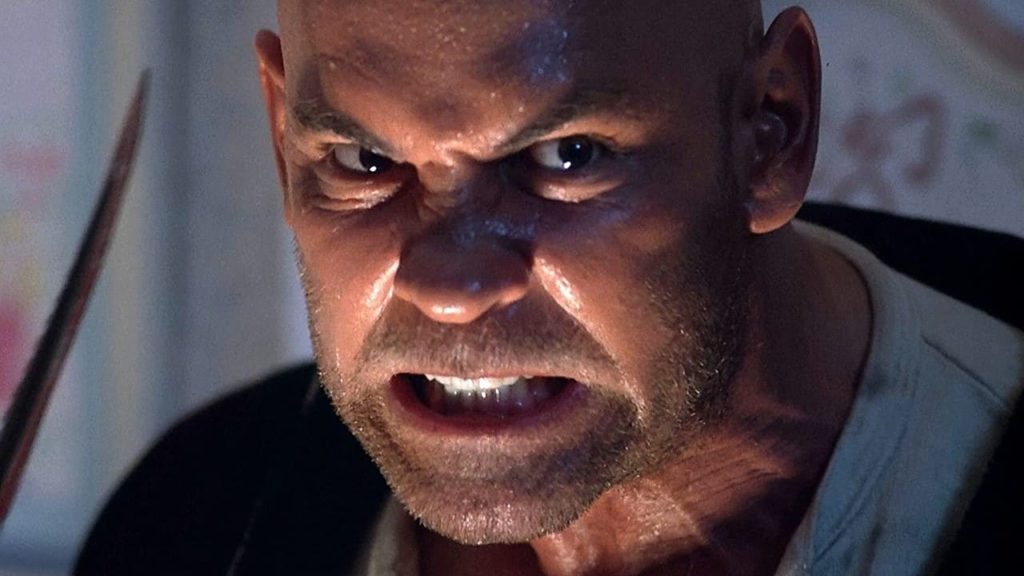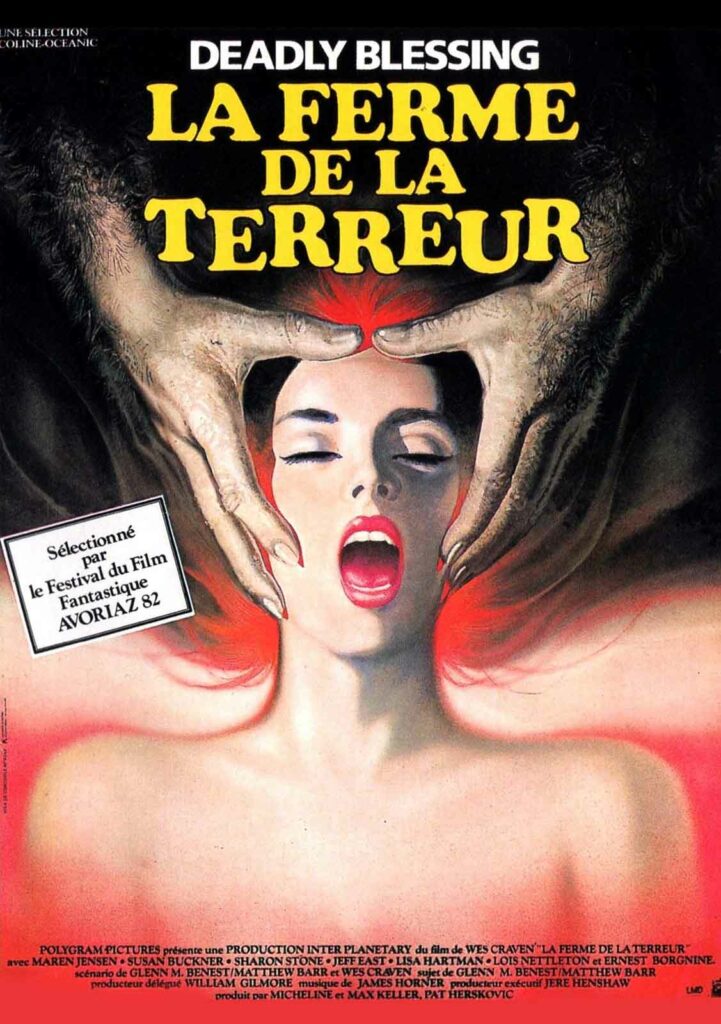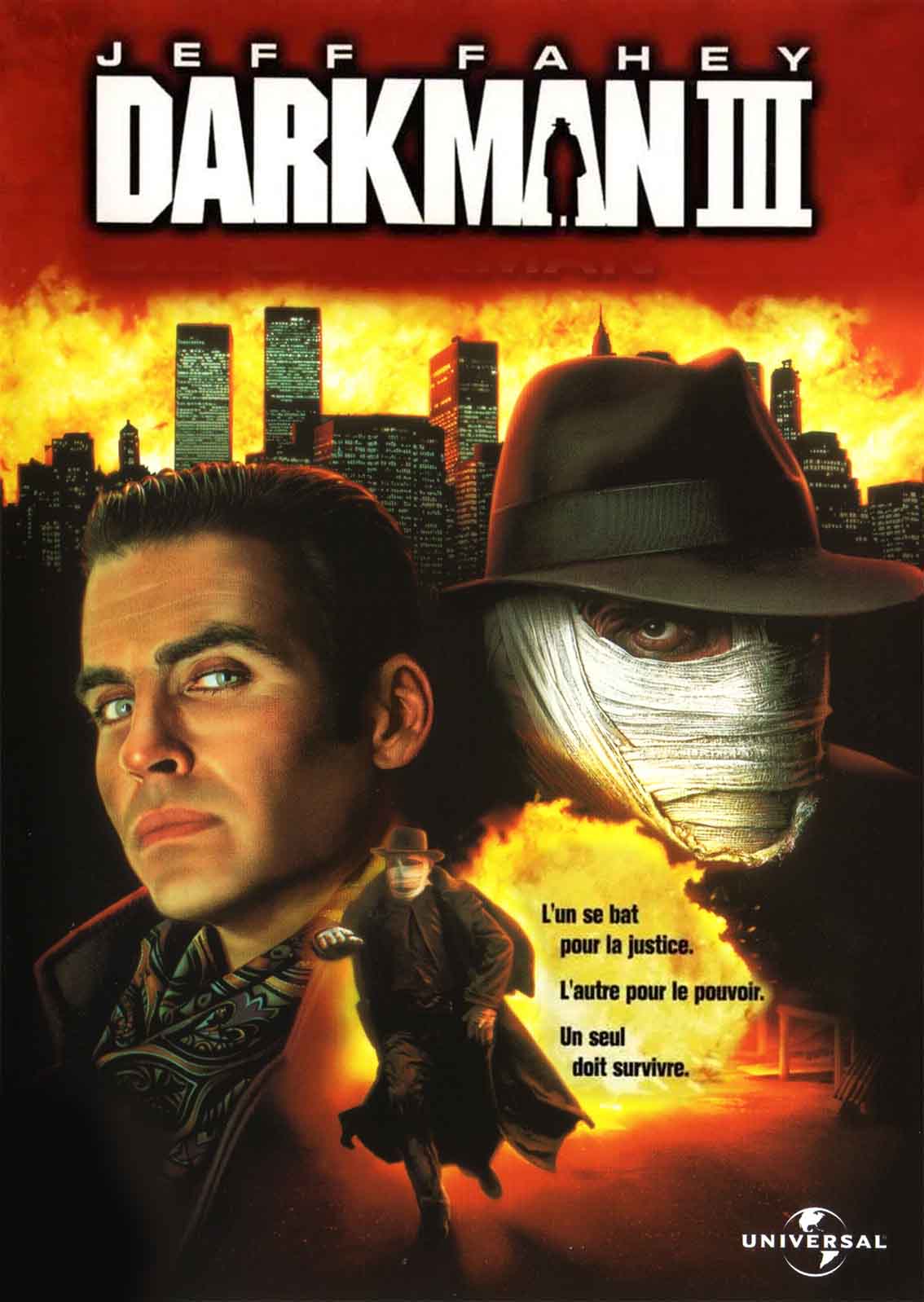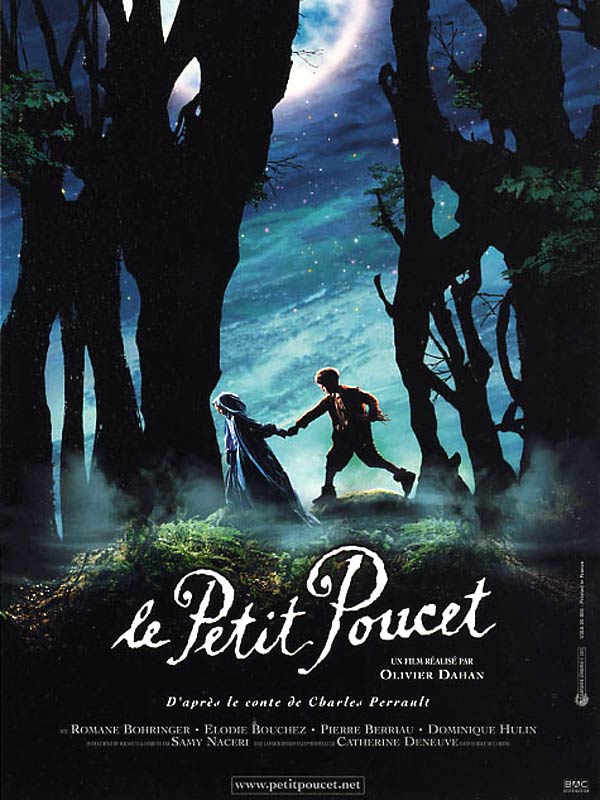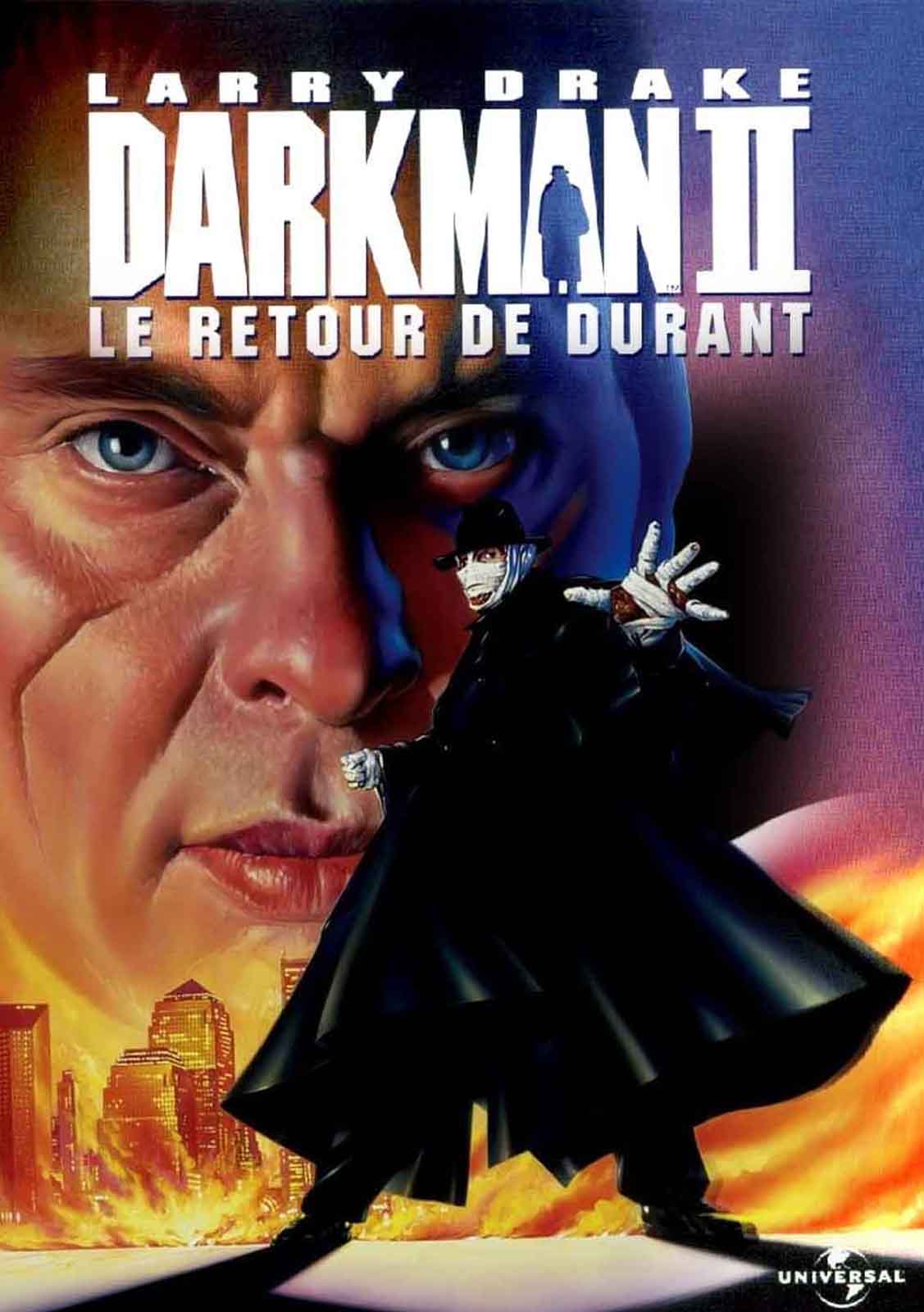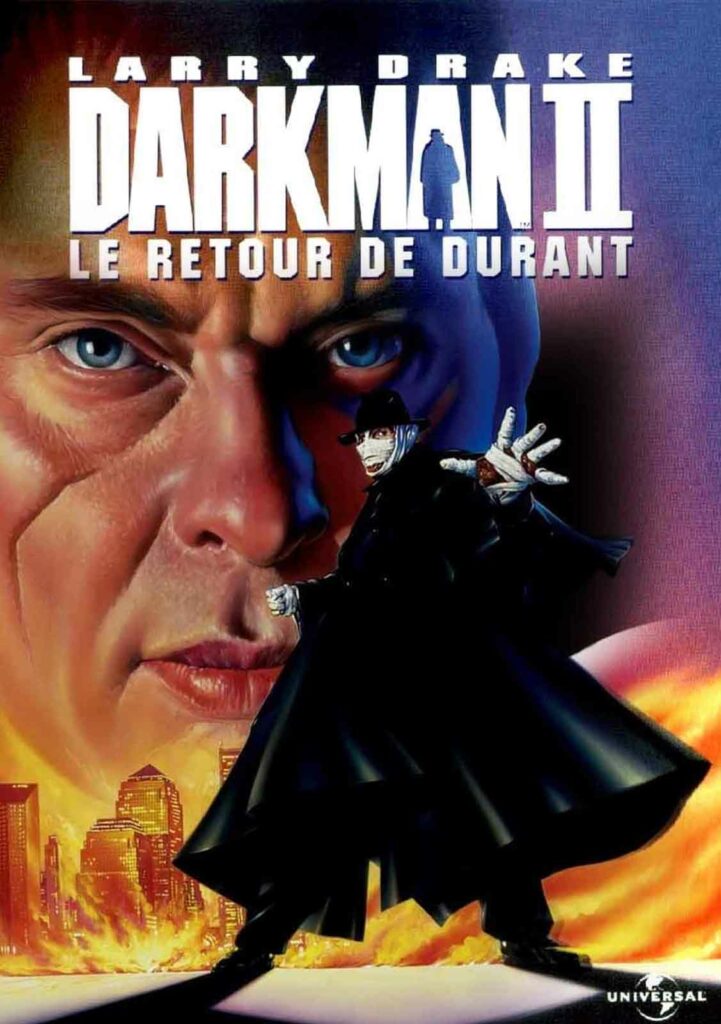Ridley Scott transporte Matt Damon sur la planète rouge et le transforme en naufragé spatial
THE MARTIAN
2015 – USA
Réalisé par Ridley Scott
Avec Matt Damon, Jessica Chastain, Kristen Wiig, Jeff Daniels, Sebastian Stan, Naomi Scott, Chiwetel Ejiofor, Sean Bean
THEMA SPACE OPERA I FUTUR
Adaptation fidèle d’un roman signé Andy Weir, ancien programmateur informatique ayant pris la plume avec succès, Seul sur Mars marque le retour de Ridley Scott vers l’espace et le futur, trois ans après Prometheus. Mais ici, le maître mot est le réalisme. Pas d’extraterrestres ni d’androïdes à l’horizon, mais une série de péripéties scientifiquement crédibles qui inscrivent le film dans le courant de la « hard science » emprunté quelques années avant lui par Alfonso Cuaron (Gravity) et Christopher Nolan (Interstellar). Sans remonter jusqu’à Robinson Crusoé sur Mars de Byron Haskin ou Les Naufragés de l’espace de John Sturges, Seul sur Mars évoque tour à tour trois œuvres majeures de la fin des années 90 et du début des années 2000 : Seul au Monde, Apollo 13 et Il faut sauver le Soldat Ryan. Le parallèle avec la fresque guerrière de Steven Spielberg est bien sûr accru par la présence de Matt Damon dans le rôle de l’âme à sauver.


Hélas, le film de Ridley Scott ne retrouve jamais l’intensité de ces trois films mémorables, à cause d’une série de parti pris discutables. L’adaptation du roman de Weir posait d’emblée un problème. La majeure partie du récit y est en effet racontée à la première personne, via un journal de bord que tient l’astronaute Mark Watney, laissé pour mort sur la planète Mars après une tempête de sable ayant obligé ses coéquipiers à quitter les lieux précipitamment. En muant les messages écrits du roman en une série de témoignages vidéo, le scénariste Drew Goddard se heurte à un problème de taille : la bande son du film se retrouve saturée de voix off, étiolant le sentiment de solitude et d’isolement que devrait générer un tel postulat.
Perdu dans l'espace
Là où l’on était en droit d’attendre de longs silences pensants, des regards perdus dans le vide d’un horizon lointain, des angoisses existentielles voire métaphysiques, un verbe trivial s’invite partout et coupe court à toute introspection. Seul être humain perdu sur une planète inhospitalière et aride, oublié et abandonné par les siens, promis à une mort certaine, Watney devrait logiquement passer par un certain nombre de phases de détresse psychologique, voire de déséquilibres mentaux, une notion qu’avait par exemple fort bien restitué le Moon de Duncan Jones. Or ici, notre naufragé se montre confiant et sûr de lui, ne cessant de s’amuser de la situation et de multiplier les blagues à l’attention des spectateurs. Ce travers est amplifié par le choix d’une bande originale ponctuée de tubes disco des années 70. Certes, cet humour désenchanté était déjà présent dans le roman initial, et le film pèche sans doute par excès de fidélité au matériau littéraire original. Fort heureusement, la tension redevient optimale le temps d’une poignée de séquences de suspense magistrales et étourdissantes. En la matière, Ridley Scott prouve qu’il n’a pas perdu la main, tout comme dans le domaine de la direction artistique et de la direction d’acteurs, impeccables. Si le Ridley Scott raffiné et surdoué de l’époque d’Alien et Blade Runner s’était emparé d’un tel sujet, il l’aurait sans doute mué en chef d’œuvre du genre. Aujourd’hui, il n’en a tiré qu’un film d’aventure sympathique et distrayant. C’est déjà ça…
© Gilles Penso
Partagez cet article