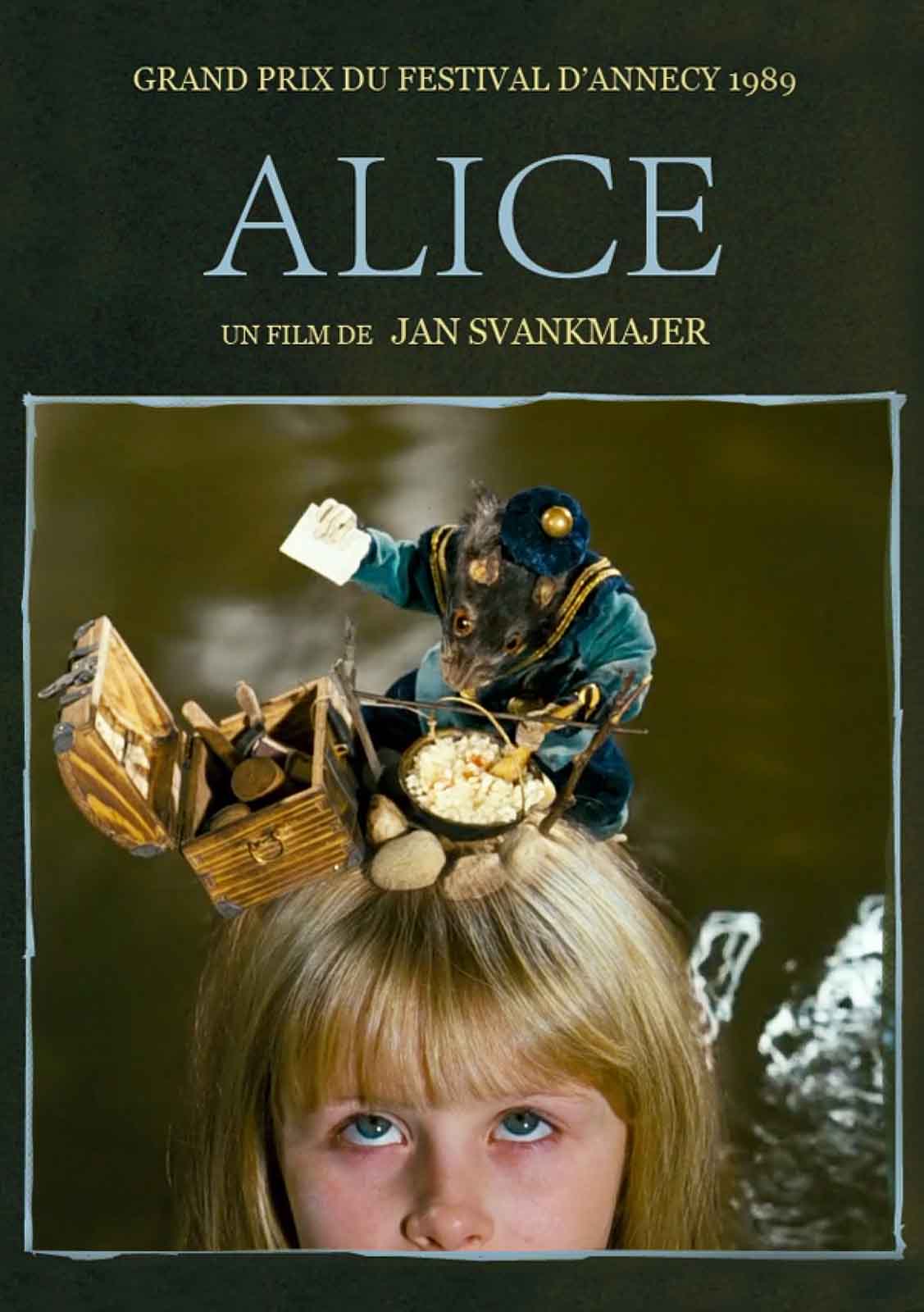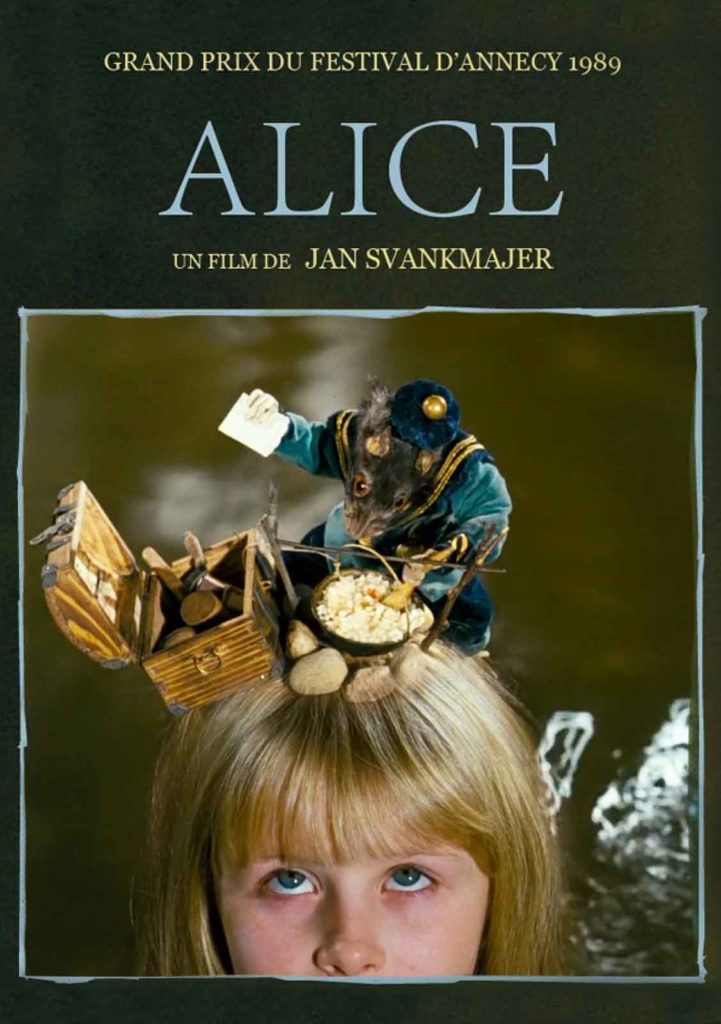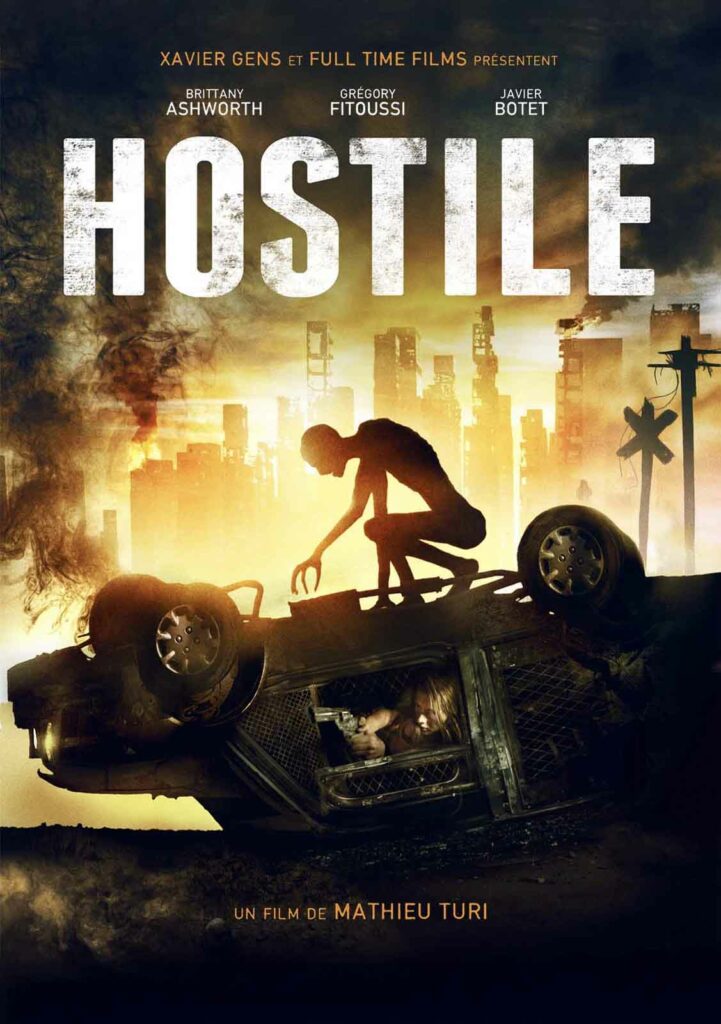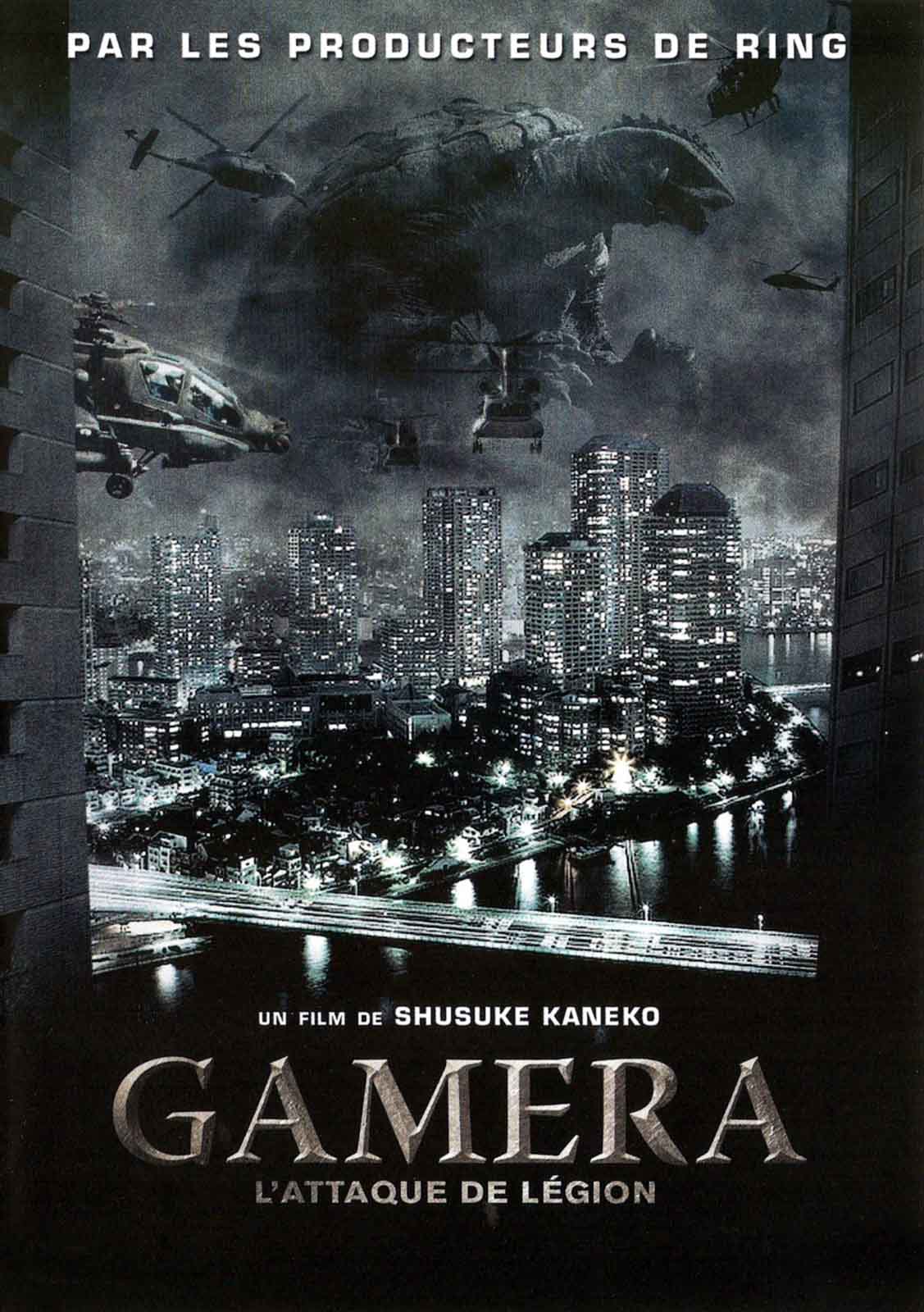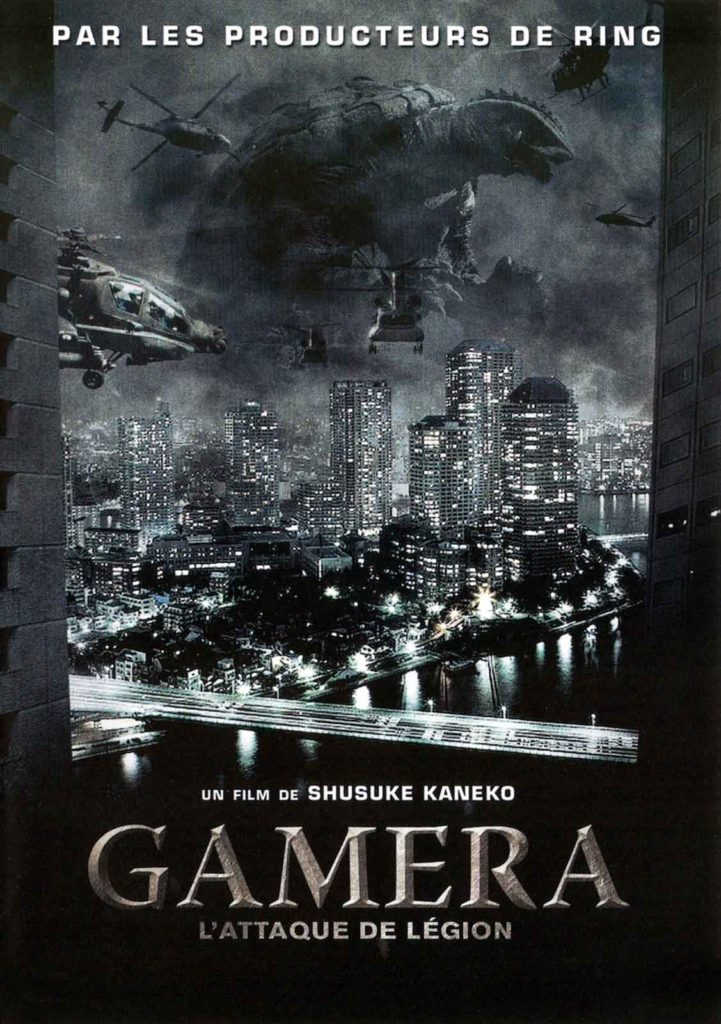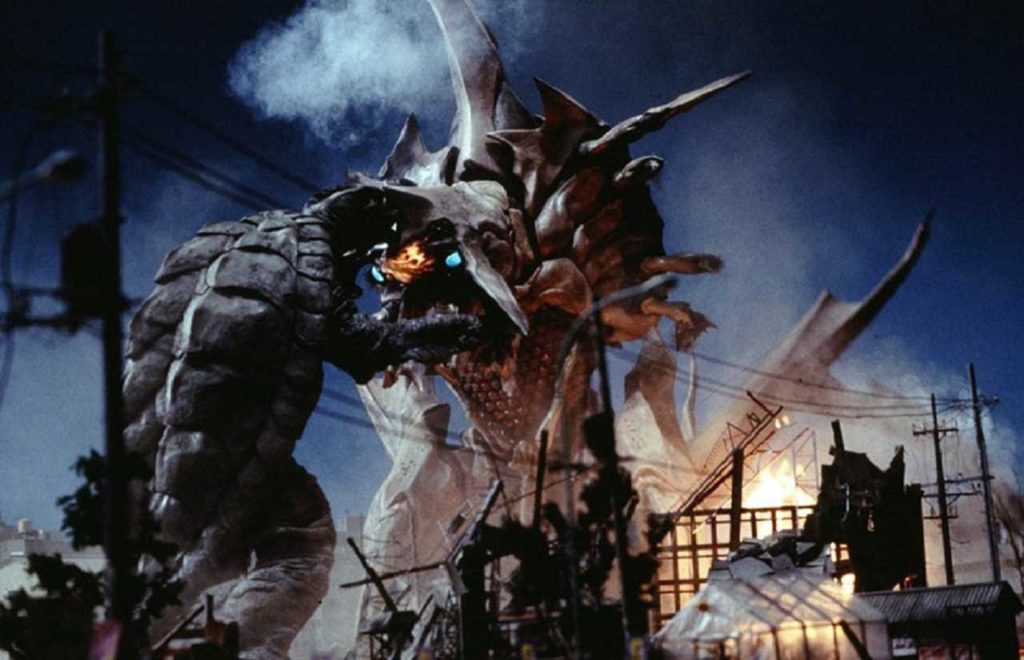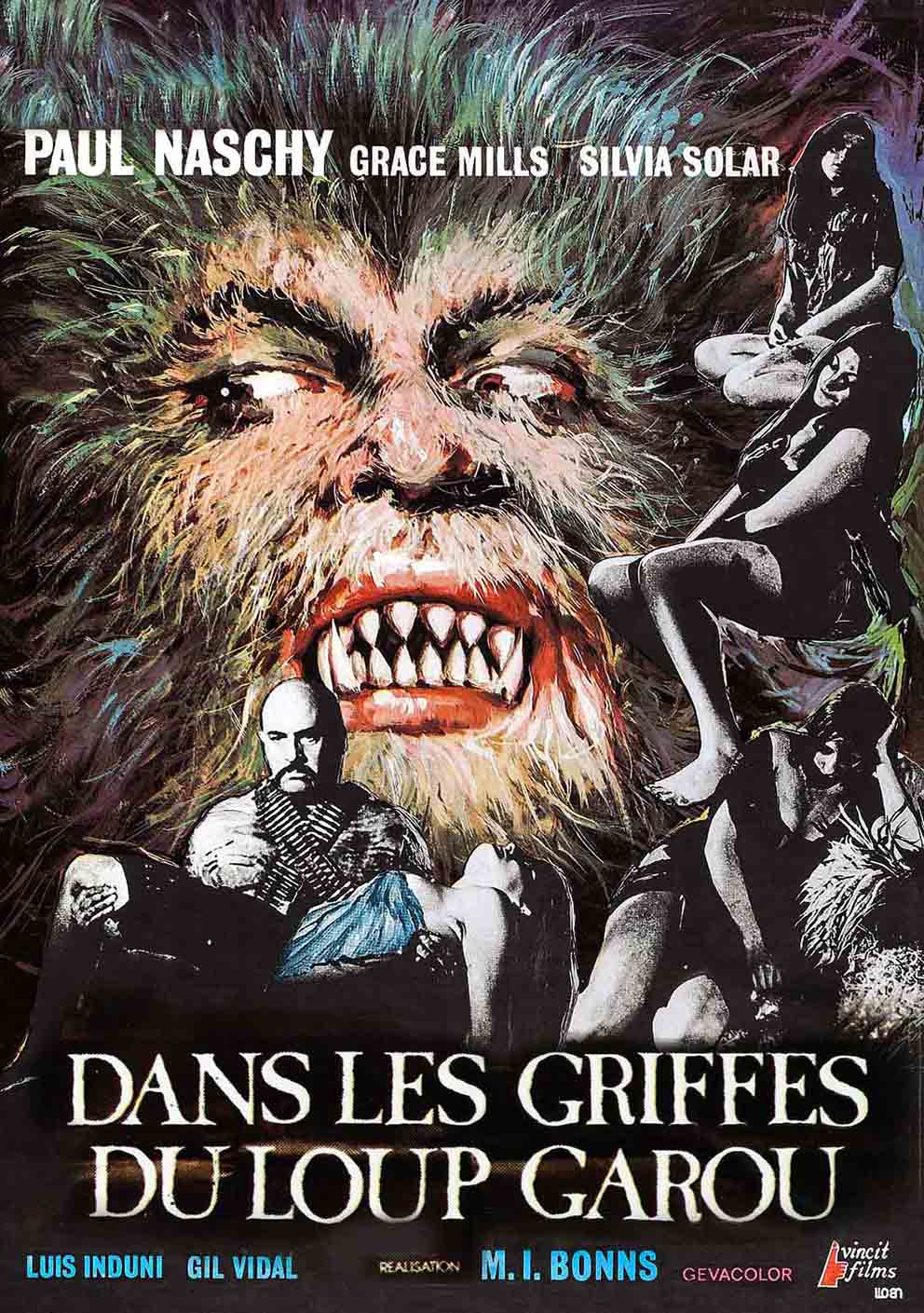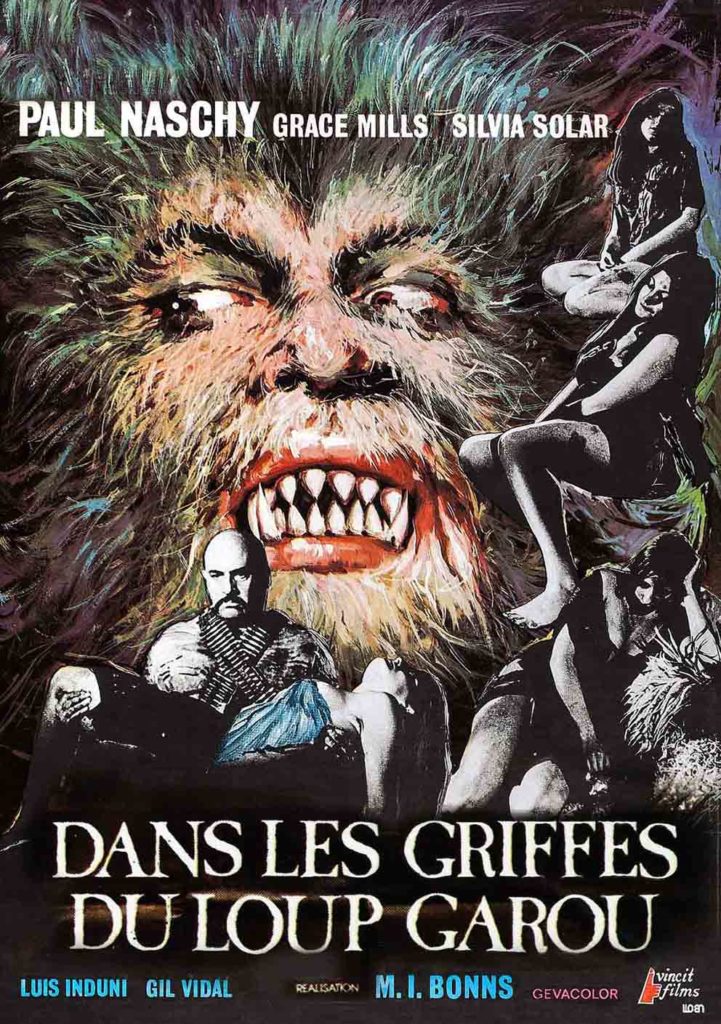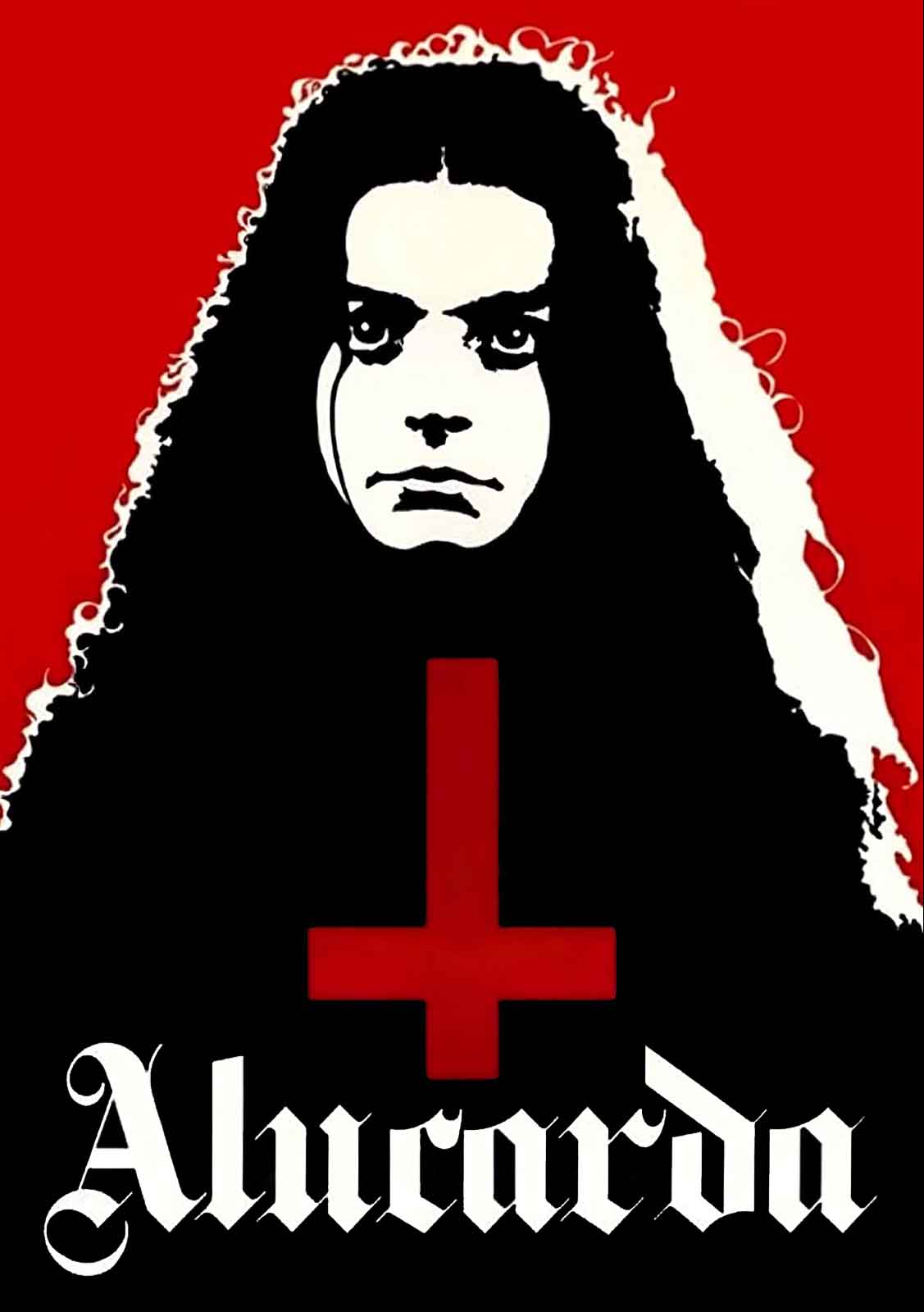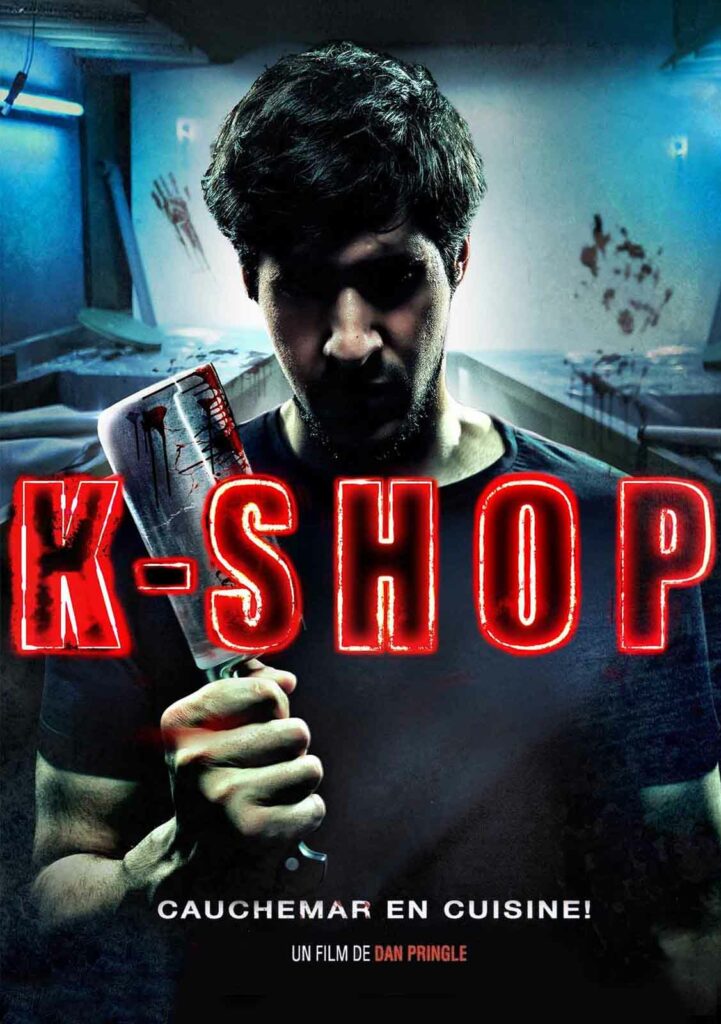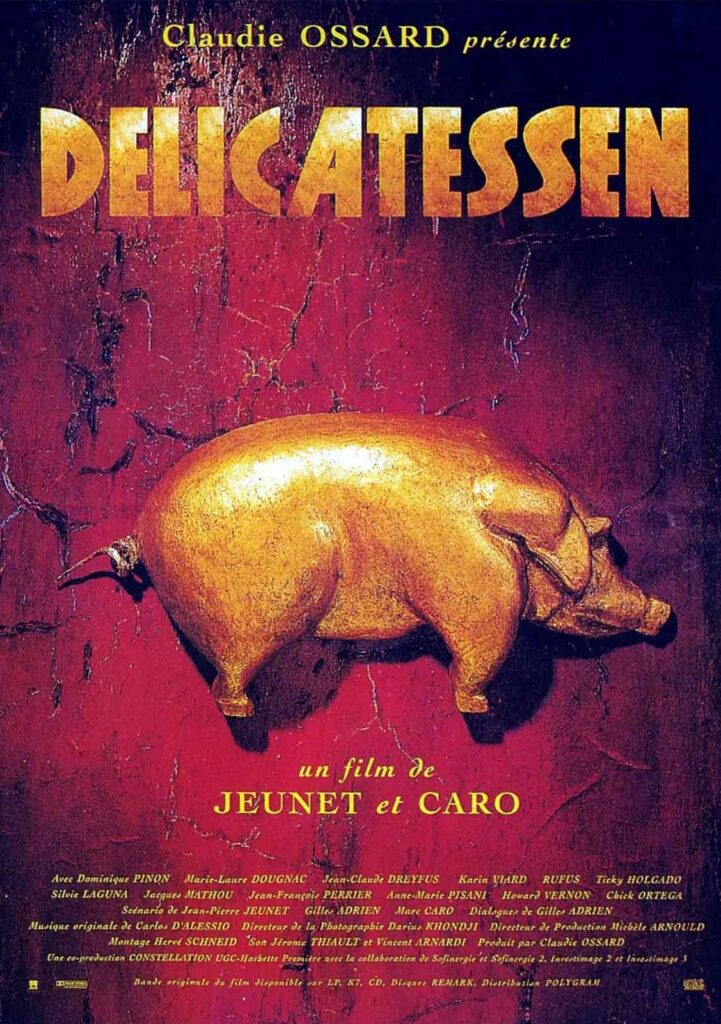M. Night Shyamalan adapte la série animée Avatar et se heurte aux difficultés d’une épopée à grand spectacle dont il maîtrise mal les codes…
THE LAST AIRBENDER
2010 – USA
Réalisé par M. Night Shyamalan
Avec Noah Ringer, Nicola Peltz, Jackson Rathbone, Dev Patel, Shaun Toub, Aasif Mandvi, Cliff Curtis, Seychelle Gabriel
THEMA POUVOIRS PARANORMAUX I SAGA M. NIGHT SHYAMALAN
Après La Jeune fille de l’eau et Phénomènes, M. Night Shyamalan souhaite élargir son scope et s’aventurer dans d’autres paysages cinématographiques. La série d’animation Avatar, le dernier maître de l’air, créée par Michael Dante DiMartino et Bryan Konietzko, va lui en donner l’occasion. C’est grâce à sa fille que le réalisateur découvre ce show ultra-populaire diffusé sur Nickelodeon. Fasciné par le monde dans lequel se déroule la série, par ses personnages, sa philosophie et son traitement des arts martiaux, Shyamalan décide d’adapter la première saison sous forme d’un long-métrage live à grand spectacle. Confiant, le studio Paramount lui confie un budget de 150 millions de dollars et lui laisse les rênes du projet, dont il assure l’écriture, la réalisation et la production (aux côtés de Frank Marshall et Sam Mercer). Le Dernier maître de l’air se situe un siècle après que la nation du feu ait déclaré la guerre aux nations de l’air, de l’eau et de la terre dans le but de conquérir le monde. C’est là qu’intervient Aang (Noah Ringer), un garçon de douze ans découvert au milieu d’un étrange iceberg par des membres de la tribu de l’eau. Aang est maître de l’Air et réincarnation de l’Avatar, seul être capable d’apprendre à maîtriser les quatre éléments et donc de rétablir l’équilibre dans le monde.


Tous les ingrédients susceptibles de servir les ambitions d’un blockbuster fantasmagorique grand public ont été soigneusement réunis : des enfants aux pouvoirs surnaturels, des héros et des vilains, des créatures surdimensionnées, des retournements de situation multiples, de la romance, des trahisons… Mais la mayonnaise ne prend pas vraiment, dans la mesure où Le Dernier maître de l’air manque de souffle, de style et finalement de prise de risque artistique. Certes, Shyamalan semble se faire plaisir et sa démarche est probablement sincère (c’est l’une des qualités majeures de son cinéma, tous genres confondus), mais on ne le sent pas très à l’aise dans le registre de la fantasy à grand spectacle. Son terrain de jeu est d’ordinaire plus confiné et plus intimiste. Par ailleurs, prendre le parti d’adapter toute une saison de la série animée en un seul film l’oblige à des raccourcis pas toujours heureux, notamment une voix off qui résume les faits qu’on n’a pas le temps de raconter, des enjeux pas toujours bien définis, un recours artificiel à l’humour et un gros problème de rythme global.
La folie des grandeurs
Même d’un point de vue strictement visuel, Le Dernier maître de l’air loupe le coche. Le design de certaines créatures (notamment le bison géant qui accompagne Aang) est étrange, comme échappé de Max et les Maximonstres. Les effets 3D jouent dans la catégorie gadget (un maximum de projectiles sont envoyées à la figure des spectateurs) et les chorégraphies des combats pas toujours très folichonnes. La bataille finale aurait dû être grandiose, spectaculaire et épique. Mais elle fait pâle figure après le raz de marée des Seigneurs des Anneaux. Les stratégies n’étant pas claires et la topographie confuse, il s’avère bien difficile de s’impliquer dans cet affrontement massif et d’en retirer une quelconque émotion. Certes, Le Dernier maître de l’air reste un film distrayant et agréable, mais il ne laisse guère de souvenirs après son visionnage. C’est d’autant plus dommage que les jeunes comédiens sont tous très convainquant et que James Newton Howard, partenaire musical habituel de Shyamalan, signe là l’une de ses bandes originales les plus belles et les plus héroïques. « James et moi sommes très proches », avoue le réalisateur. « Notre méthode de travail est sensiblement la même d’un film à l’autre. Généralement, il lit mon scénario, à partir duquel il écrit ses thèmes. Lorsque je lui montre ensuite le montage, il adapte ses thèmes au rythme de chaque séquence. Nous travaillons ensemble les variations et les nuances qu’il peut y apporter. Nous passons par beaucoup d’étapes d’essais, de tentatives, jusqu’à ce que nous obtenions le bon résultat. C’est un processus long et difficile, d’autant que nous sommes tous deux très exigeants et assez perfectionnistes. » (1) De toute évidence, Le Dernier maître de l’air est la consécration de leur travail commun. La fin du film s’ouvre vers une suite possible, mais son échec commercial empêchera la mise en chantier d’autres épisodes.
(1) Propos recueillis par votre serviteur en septembre 2015
© Gilles Penso
Partagez cet article