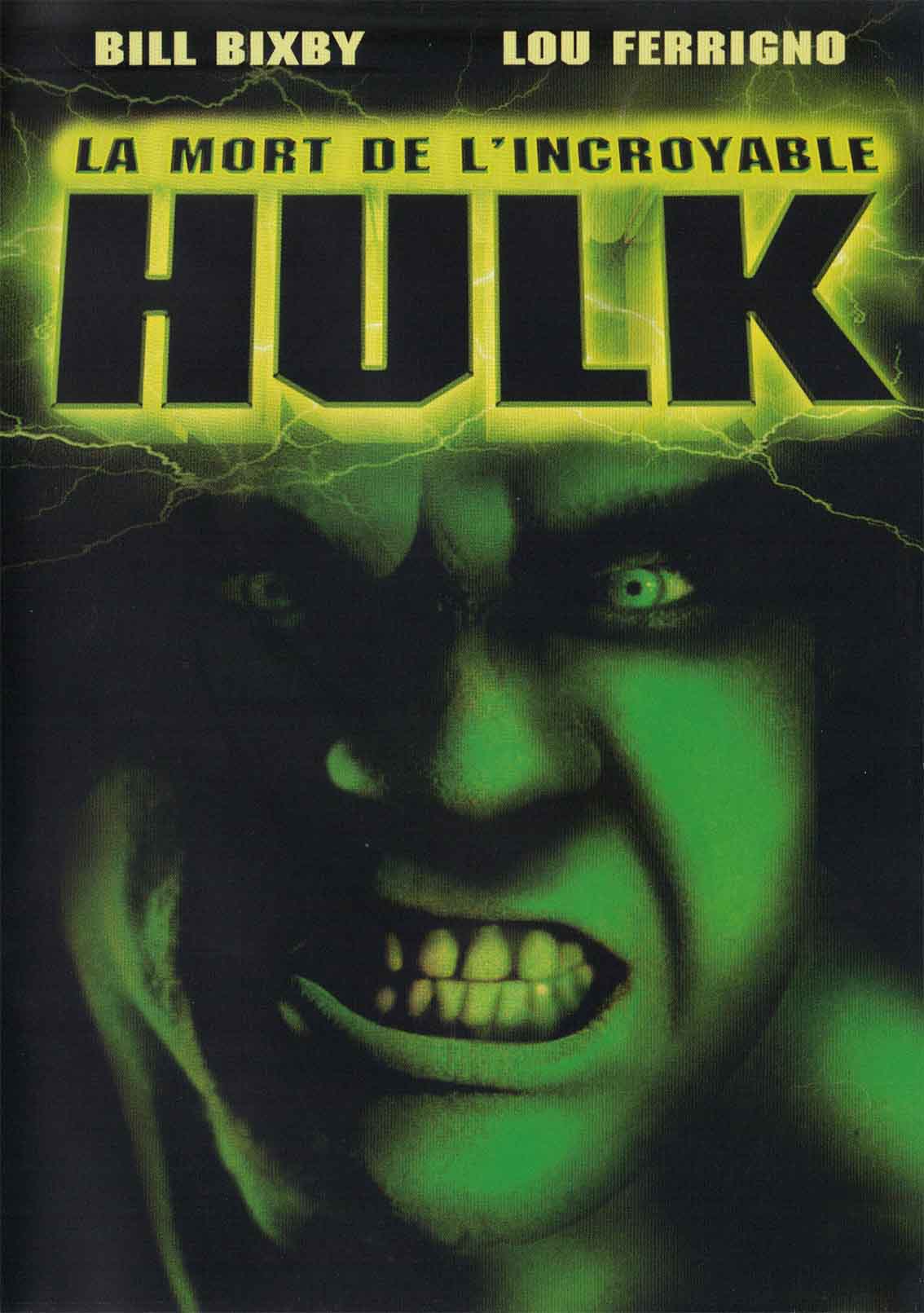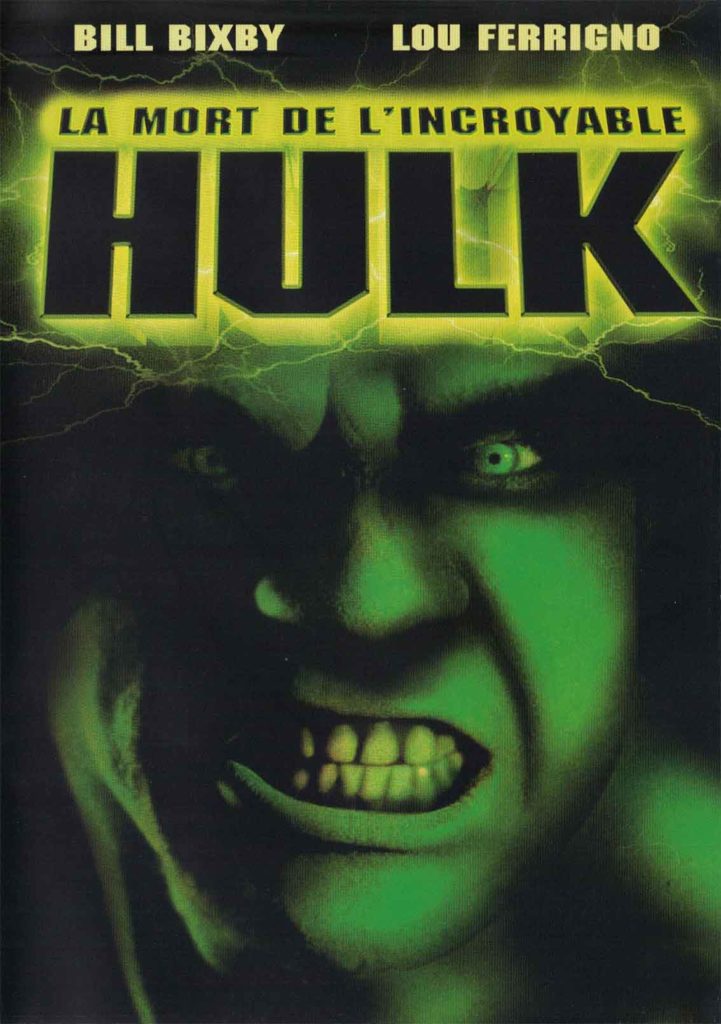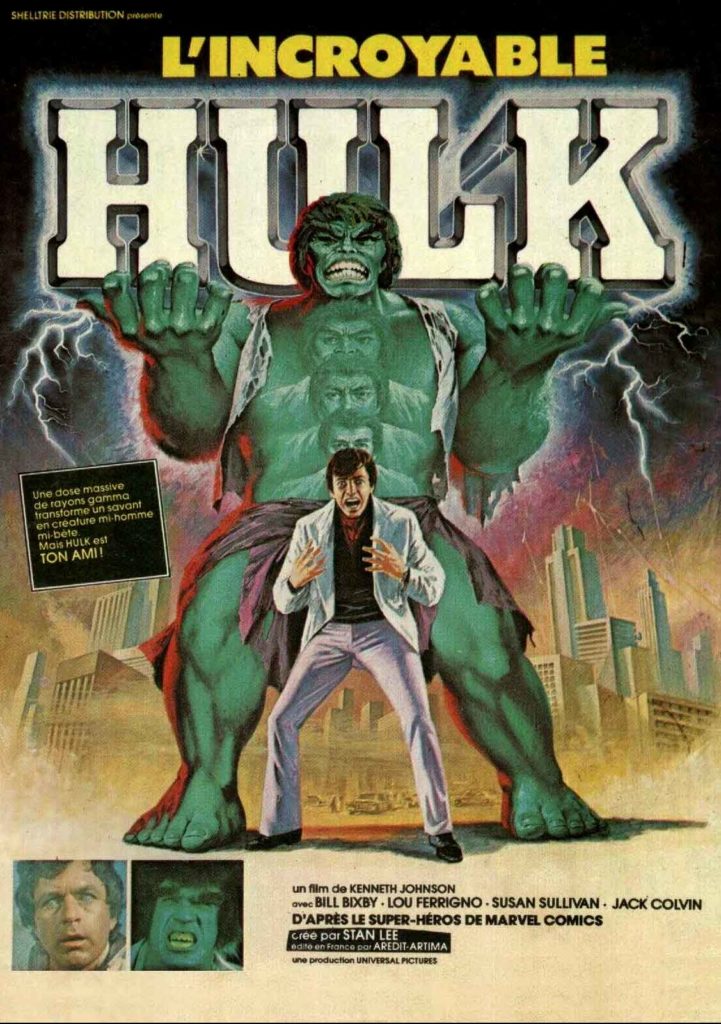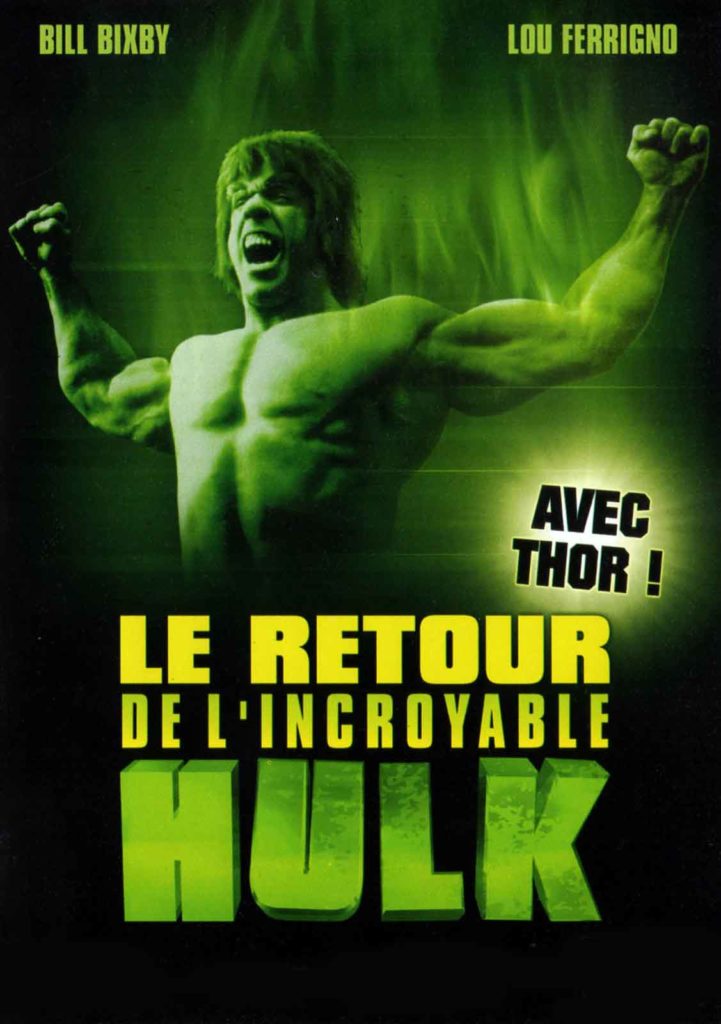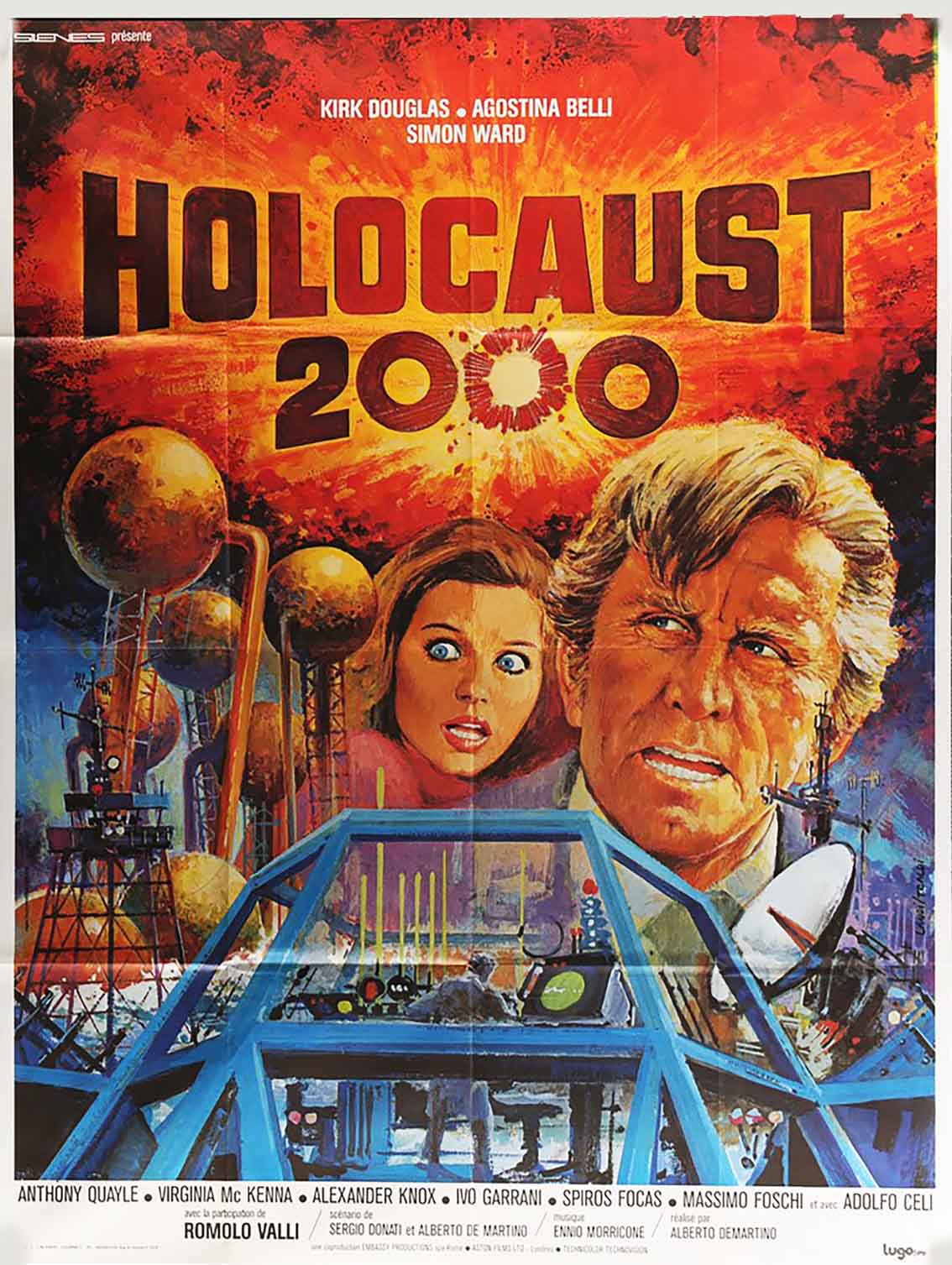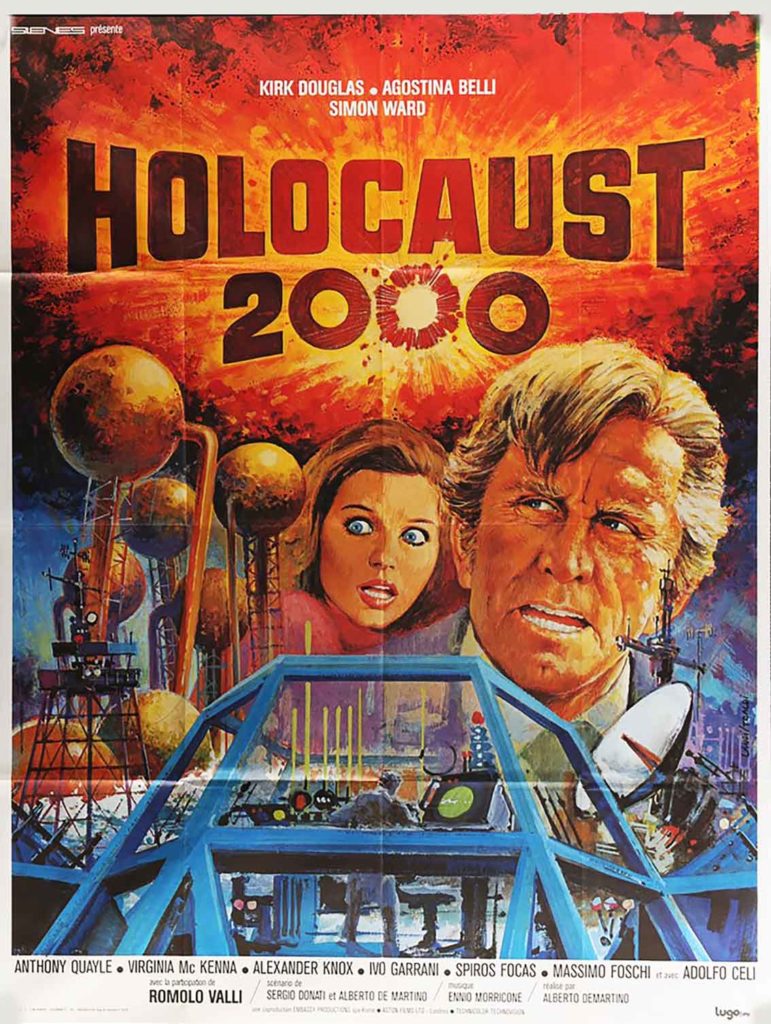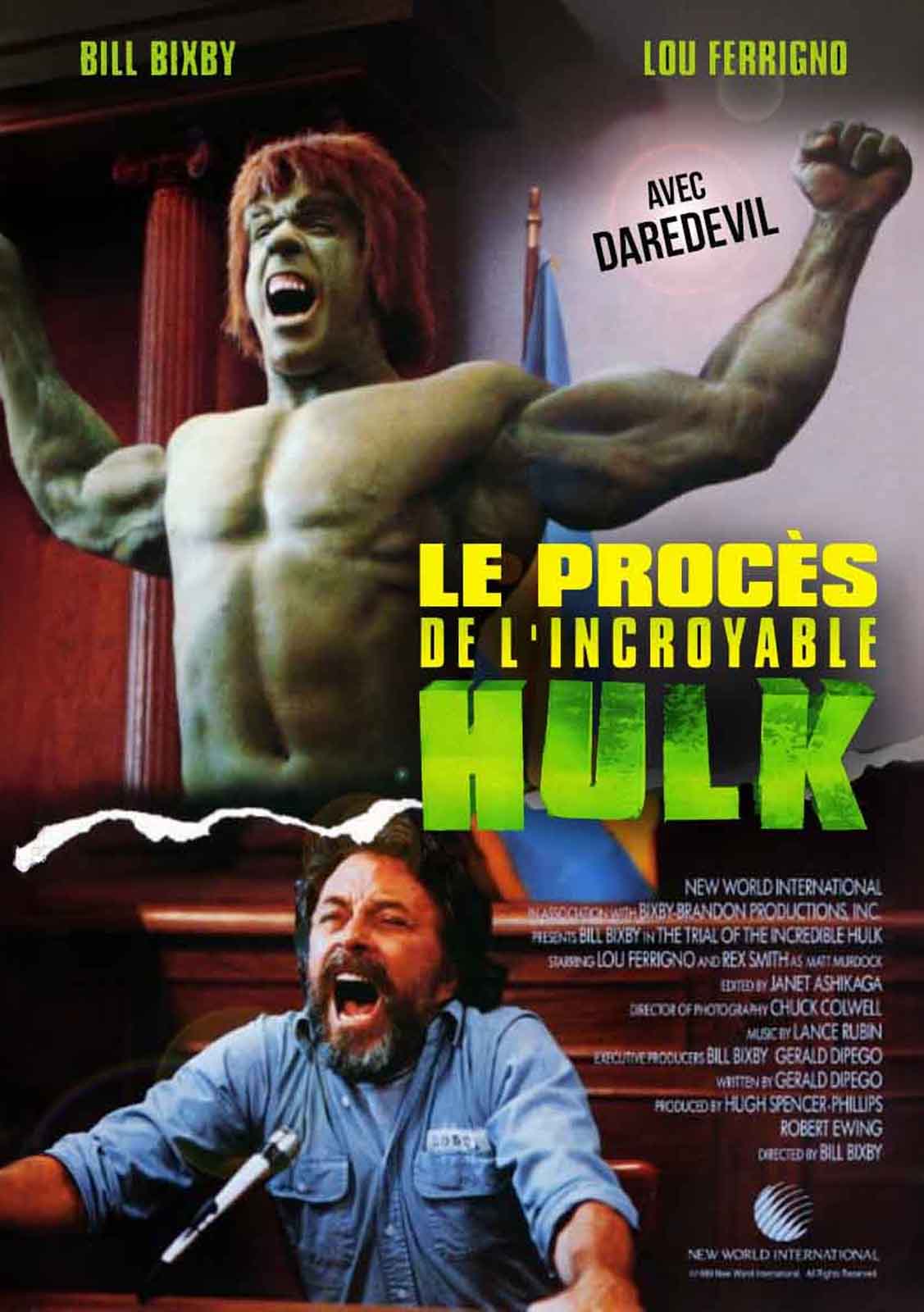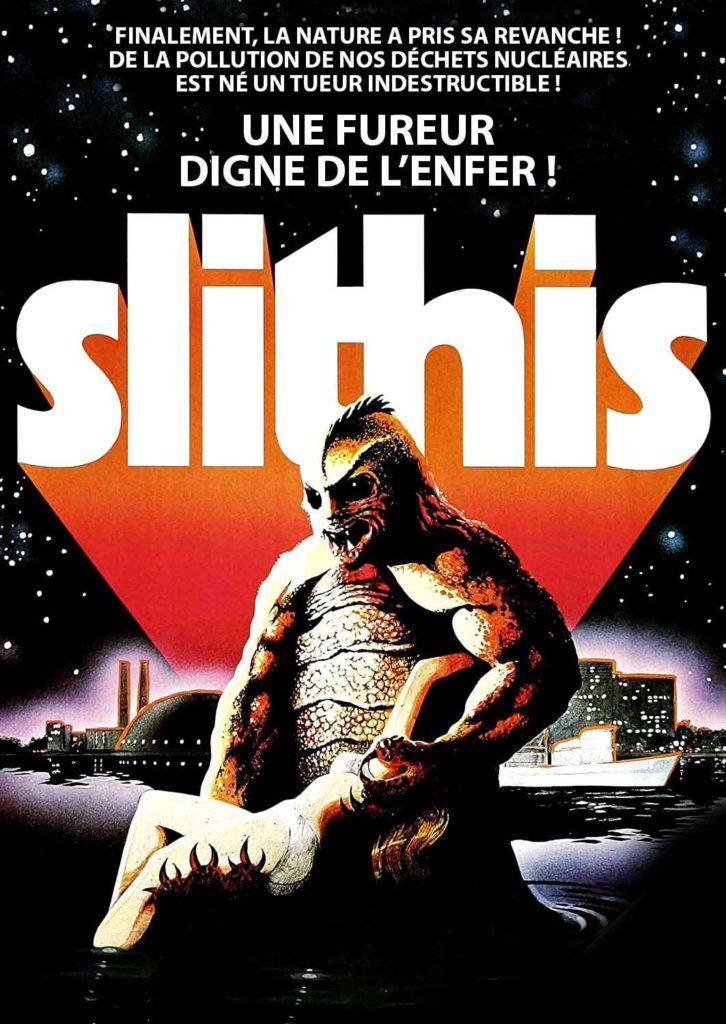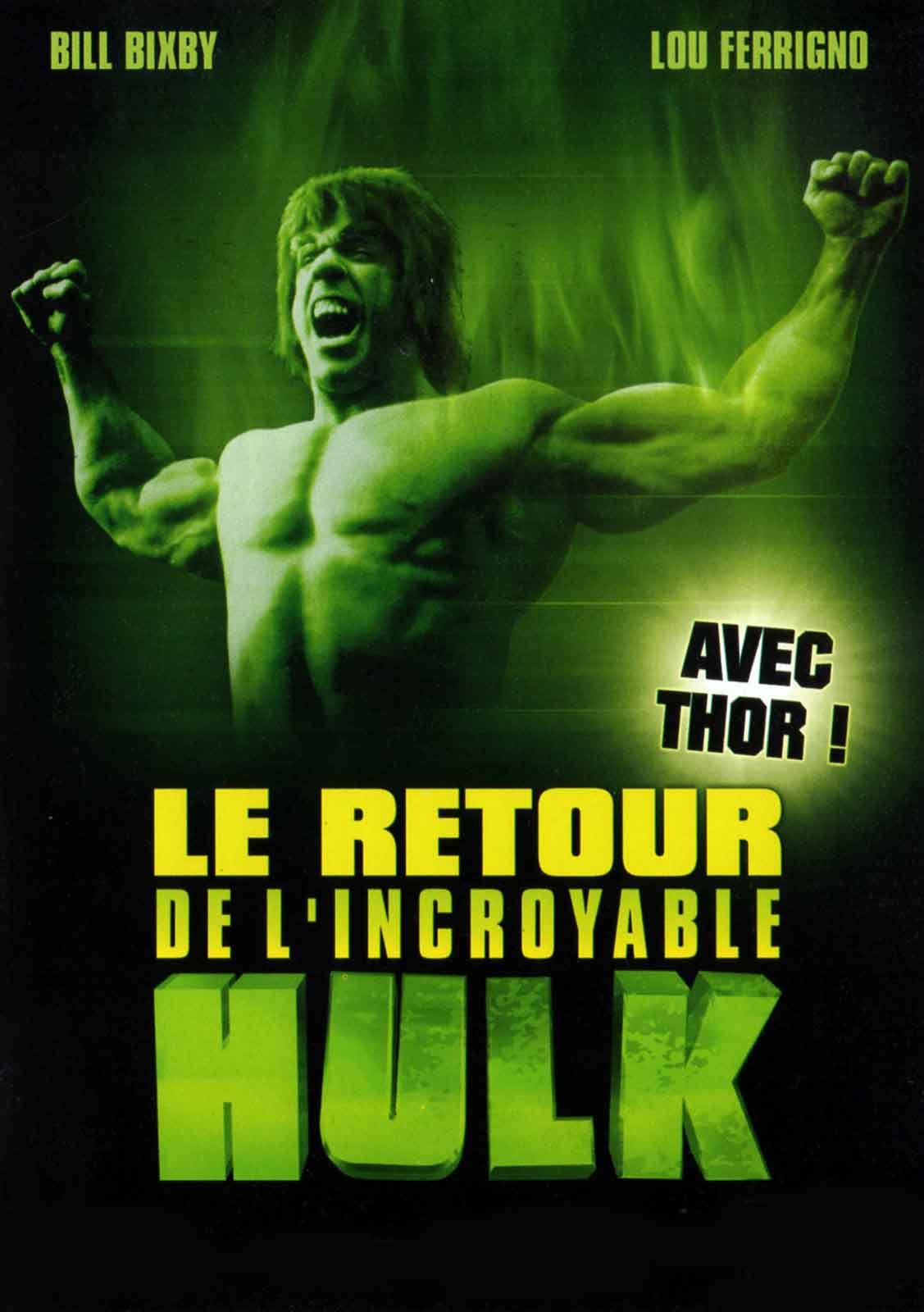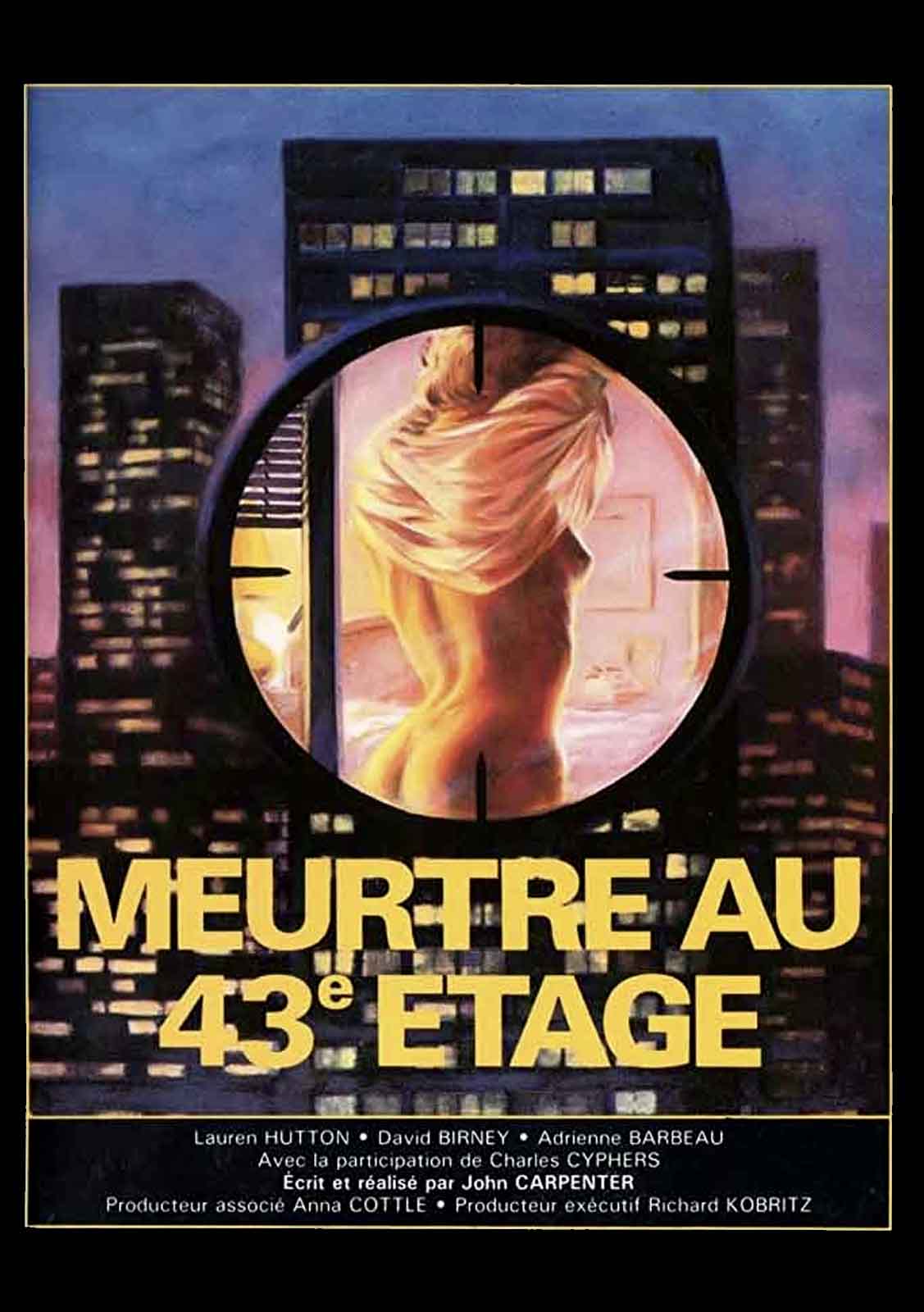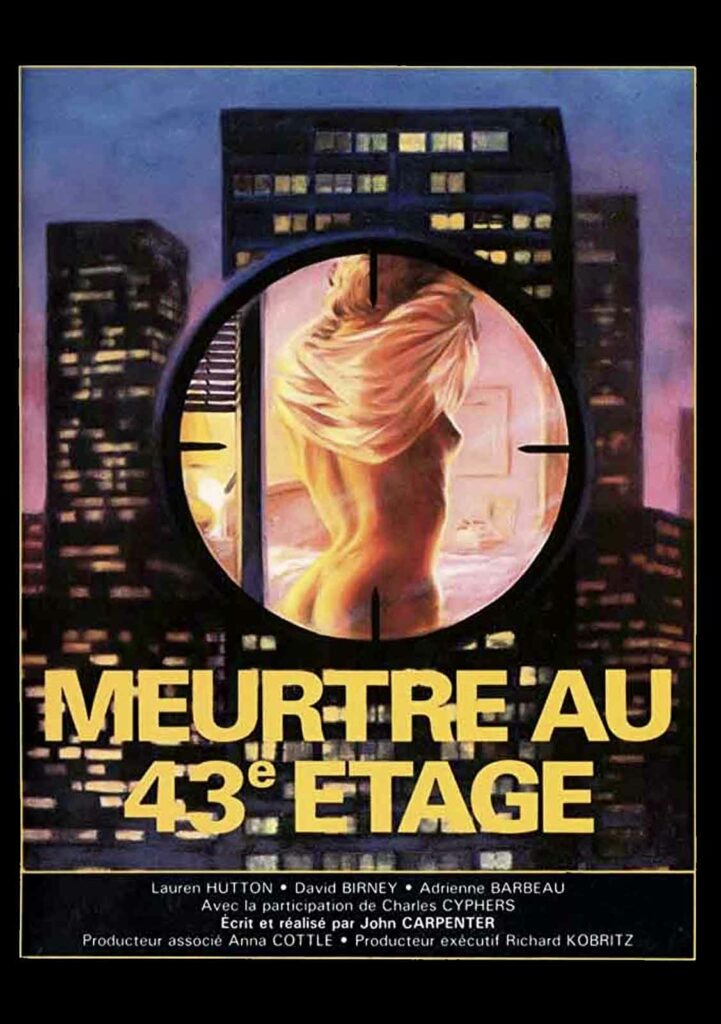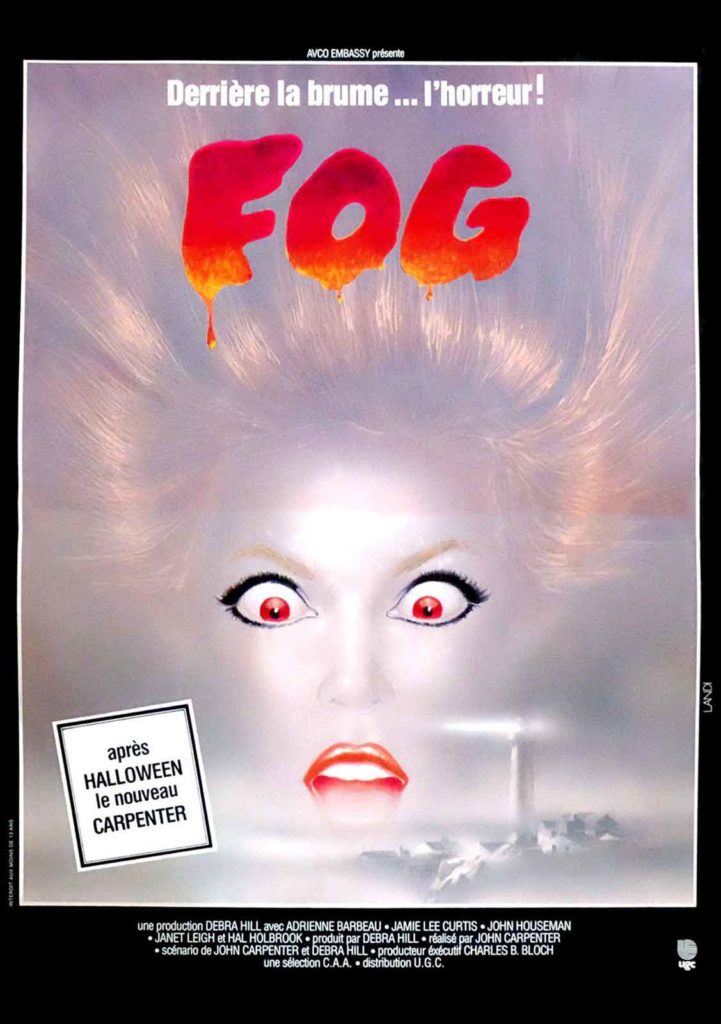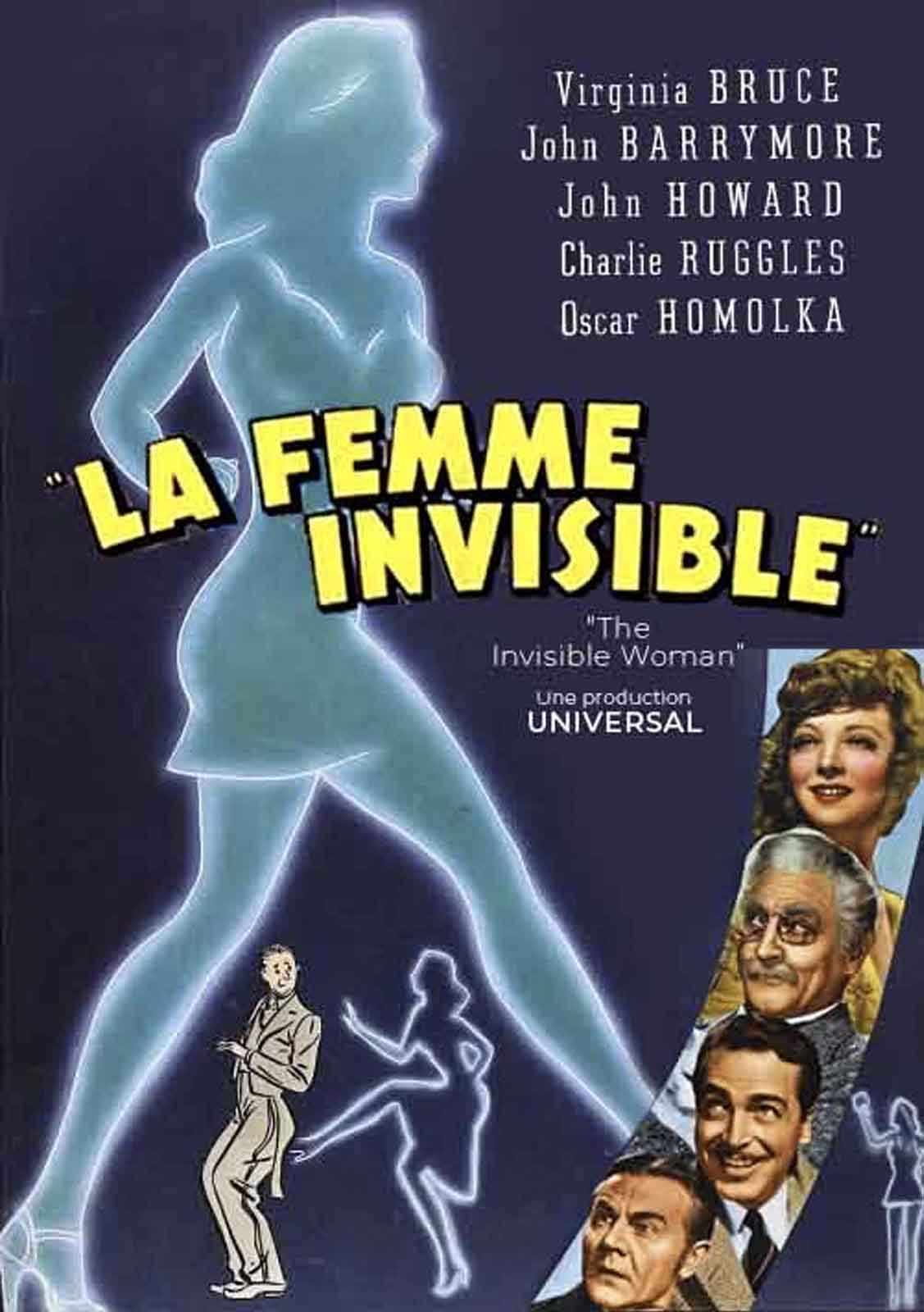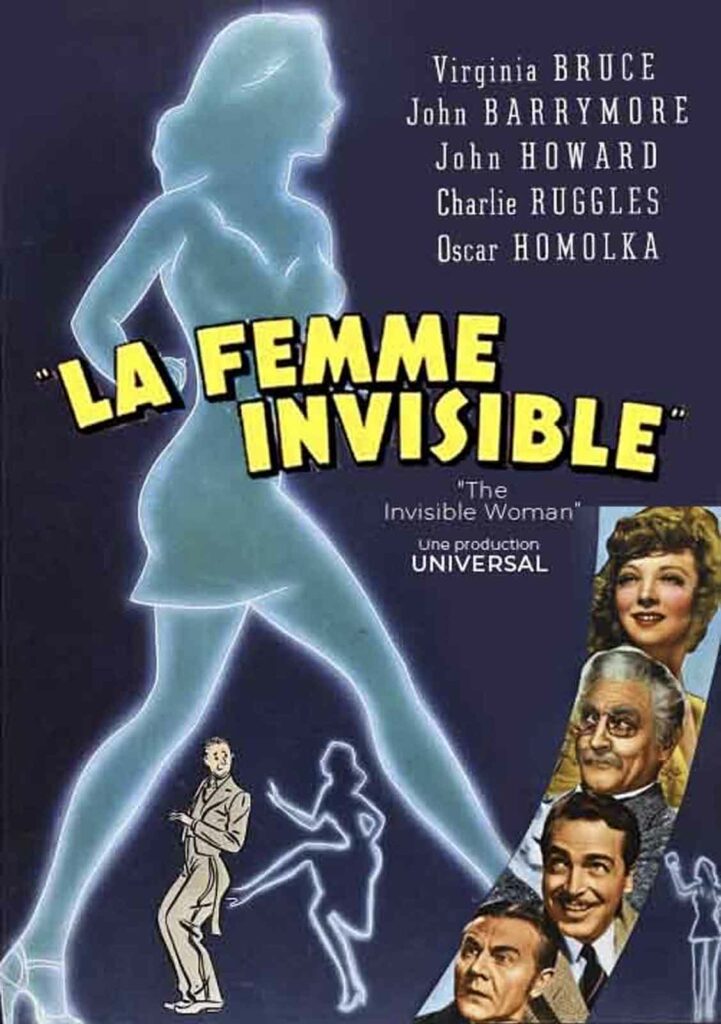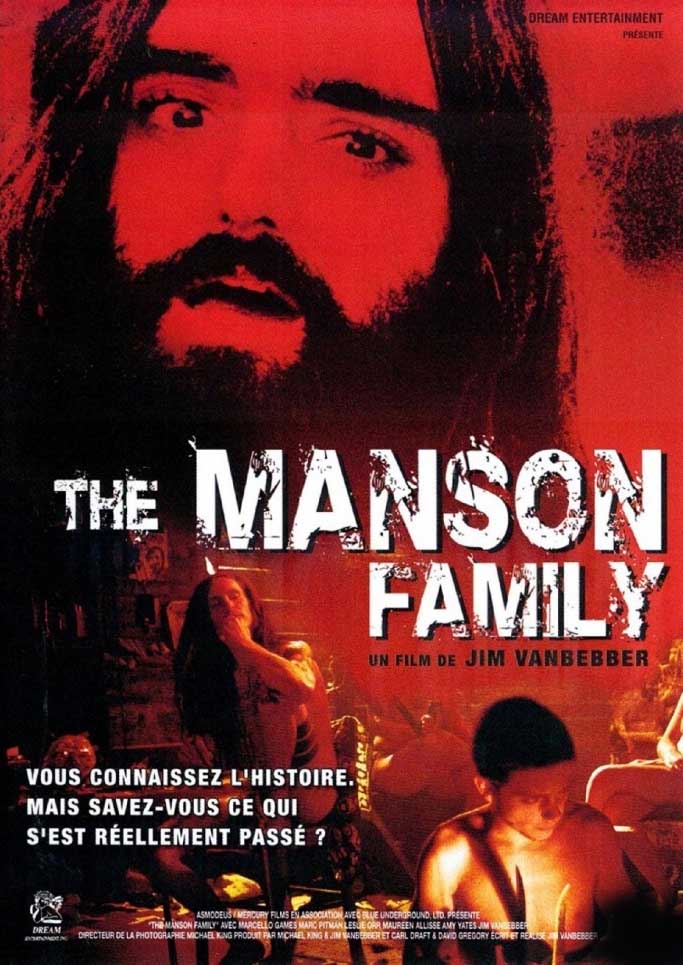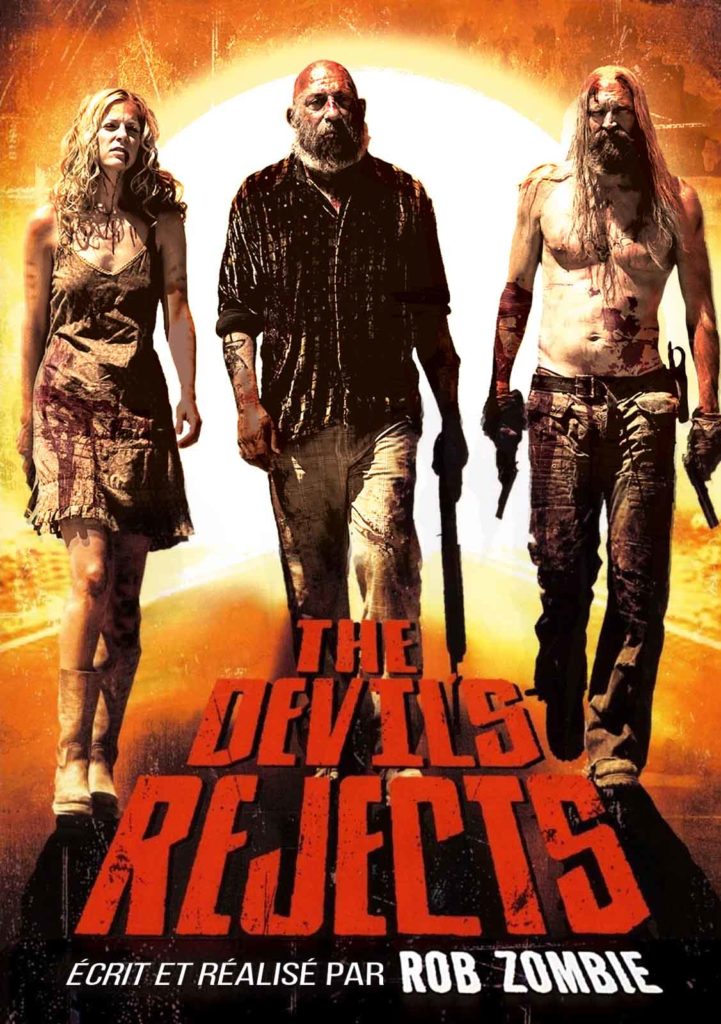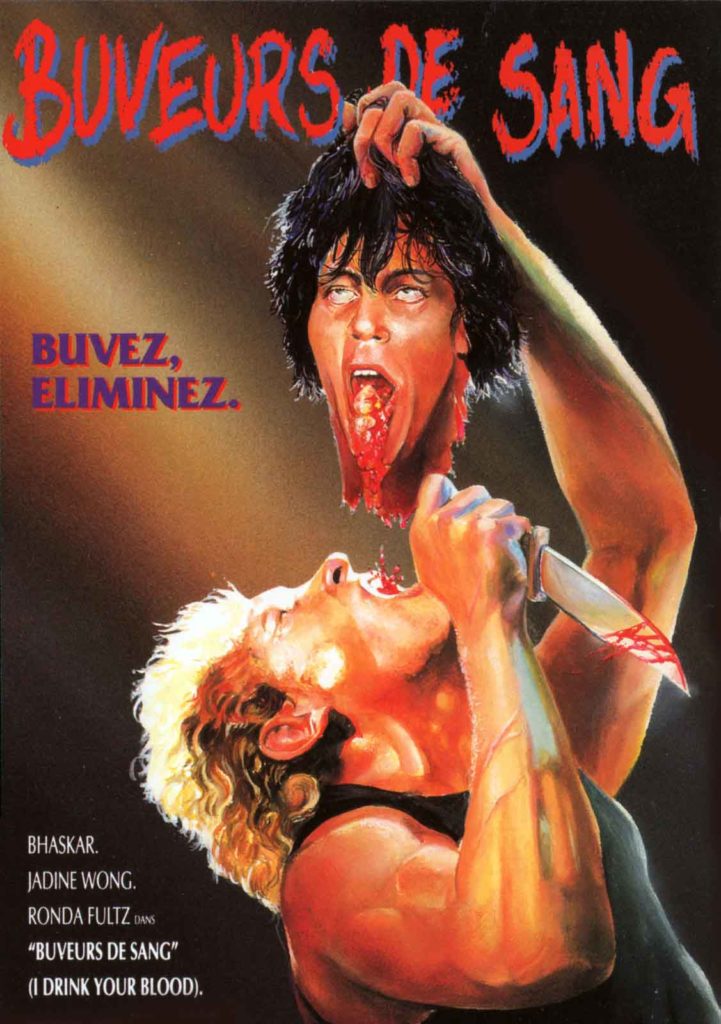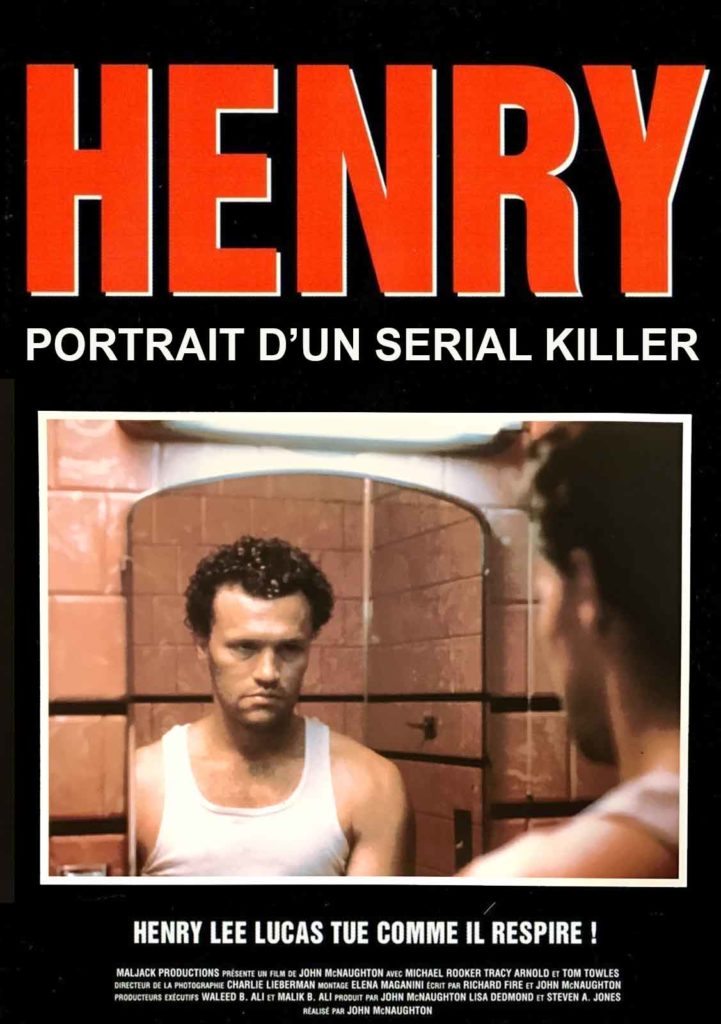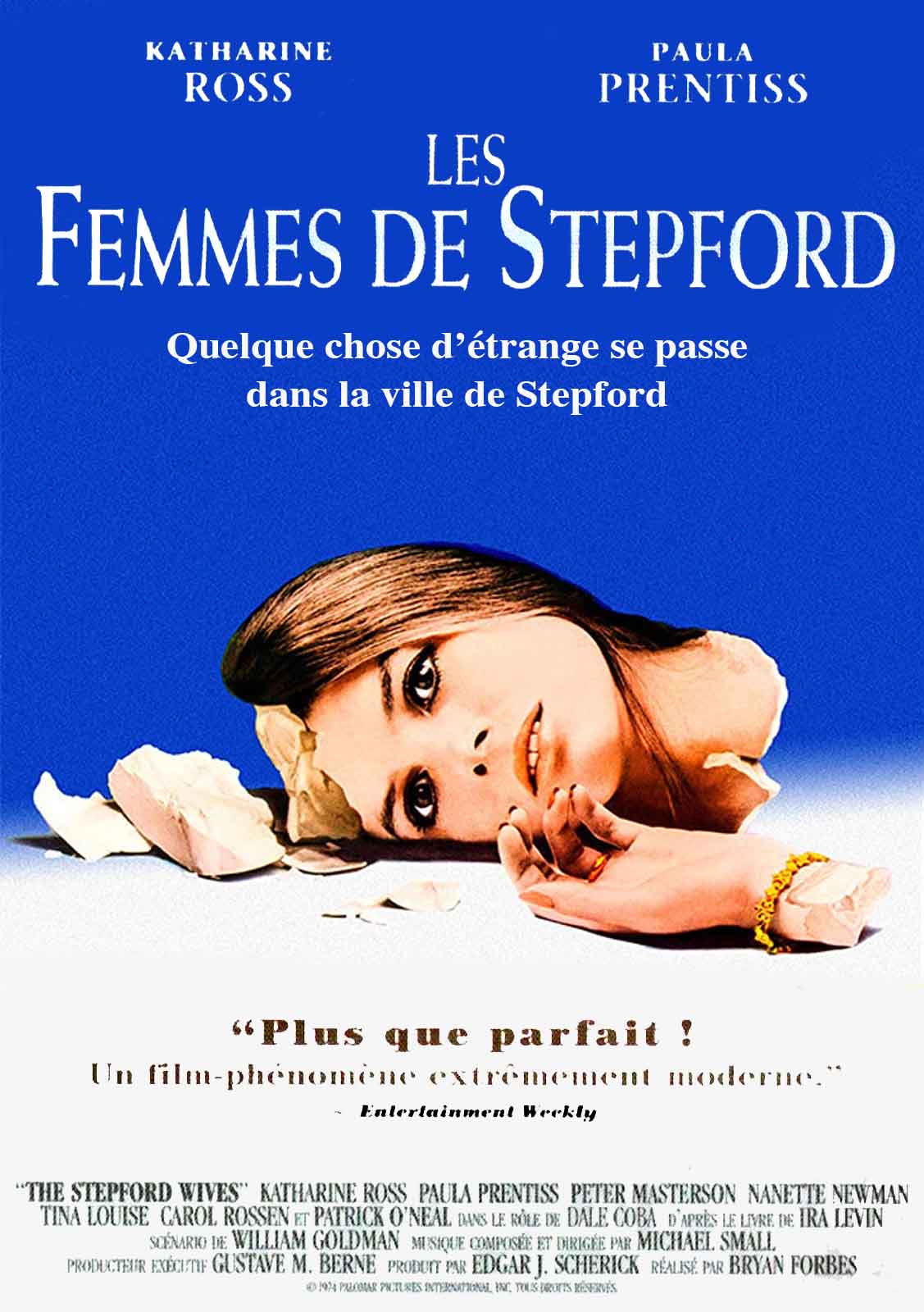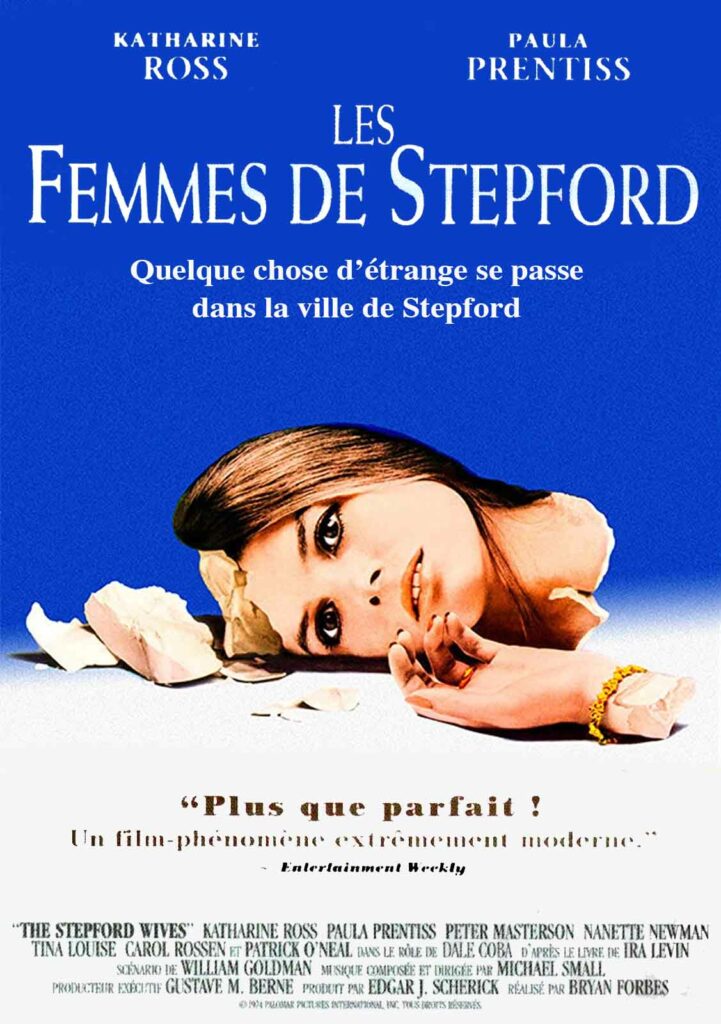Un croisement étrange entre Tarzan et Le Dernier monde cannibale dans lequel Ursula Andress joue de ses charmes en pleine jungle exotique
IL MONTAGNA DI DIO CANNIBALE
1978 – ITALIE
Réalisé par Sergio Martino
Avec Ursula Andress, Stacy Keach, Caludio Cassannelli, Franco Fantasia, Antonio Marsina, Helmut Berger, Dudley Wanaguru
THEMA CANNIBALES
A mi-chemin entre l’aventure exotique à la Tarzan et l’horreur crue façon Le Dernier monde cannibale, cette Montagne du dieu cannibale ne se prive d’aucun des clichés des deux genres qui l’inspirent, autour d’une intrigue empruntant elle aussi des sentiers maintes fois battus. Ursula Andress y incarne Susan, décidée à retrouver par tous les moyens son mari ethnologue, le professeur Henry Stevenson, lequel a disparu corps et biens en Nouvelle-Guinée. En compagnie de son frère Arthur (Antonio Marsina), elle se rend à Port Moresby et y rencontre l’anthropologue Edward Foster (Stacy Keach), ami du professeur Stevenson, pour qu’il les aide dans leurs recherches. Suivi de quelques porteurs commandés par Asaro (Dudley Wanaguru), le trio débarque à Roka Island où il se heurte à des tarentules, des serpents, des crocodiles et des cascades vertigineuses. Très vite, de mystérieux individus maculés de boue et recouverts de masques exterminent tous les porteurs de l’expédition. Il s’agit d’une tribu de cannibales, qui capture les survivants et les emmène dans son village. Là gît le cadavre du professeur Stevenson, vénéré comme un Dieu par les anthropophages, car un compteur Geiger accroché à lui ne cesse de crépiter. La raison de cette activité mécanique est simple : la montagne abrite un important gisement d’uranium, sur la trace duquel s’était lancé Stevenson avant de périr. Bientôt, la tension monte entre les rescapés de l’expédition, chacun s’avérant plus appâté par le gain que concerné par la survie de ses compagnons.


Filmé un peu à la va vite, généreusement truffé d’incohérences et désespérément avare en péripéties palpitantes, La Montagne du dieu cannibale a tout de même deux atouts majeurs : les décors naturels, très photogéniques, et le charme d’Ursula Andress qui, près de quinze ans après James Bond contre docteur No, se dévêt à nouveau pour nous rejouer la scène de Vénus surgie des eaux. Le film se teinte ainsi d’un soupçon d’érotisme, plus glamour et bien moins cru que dans les œuvres voisines de Ruggero Deodato ou Umberto Lenzi. Cette tendance est sans doute due au cinéaste lui-même, a priori plus porté sur le giallo sexy (comme en témoignent certaines de ses œuvres mettant en valeur l’indéniable photogénie d’Edwige Fenech) que sur le gore exotique. Les nombreuses séquences d’horreur conçues par le maquilleur Paolo Ricci dont nous gratifie La Montagne du dieu cannibale (éventrements, décapitations, castrations, écrasements et démembrements en tous genres) seraient même, selon les dires du cinéaste, des ajouts imposés par les producteurs. A ces « passages obligatoires » s’adjoignent les massacres d’animaux qui, hélas, semblent incontournables de la filmographie italienne cannibale. Ici, c’est notamment un iguane qui passe un mauvais quart d’heure, littéralement éviscéré devant la caméra.
Version « trash » et version « soft »
Plus ambitieux, un peu moins gore et largement plus fortuné que la majeure partie des autres films anthropophages transalpins, La Montagne du dieu cannibale a bien sûr subi les foudres de la censure, mais celle-ci facilita à terme sa distribution internationale, le muant en film d’aventure un peu violent (mais pas trop) et gentiment érotique (le strip-tease d’Ursula, toujours très en forme à 42 ans, a été conservé dans son intégralité) agrémenté de têtes d’affiches relativement « bankables » à l’export (Stacy Keach n’avait pas encore incarné Mike Hammer mais son visage était déjà familier du grand public). La Montagne du dieu cannibale existe donc dans une version « soft » qui lui permit de s’inviter en prime time sur nos téléviseurs à plusieurs reprises, et dans un montage plus cru qui le place en émule de Cannibal Holocaust et Cannibal Ferox sans pour autant le doter du statut culte de ces œuvres extrêmes.
© Gilles Penso
À découvrir dans le même genre…
Partagez cet article