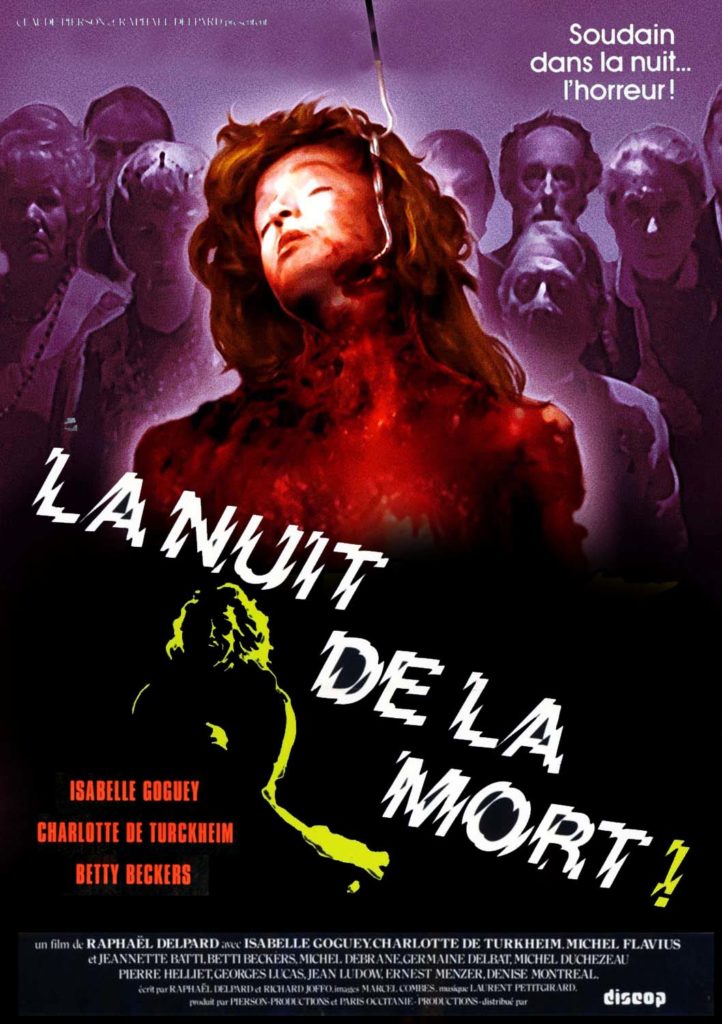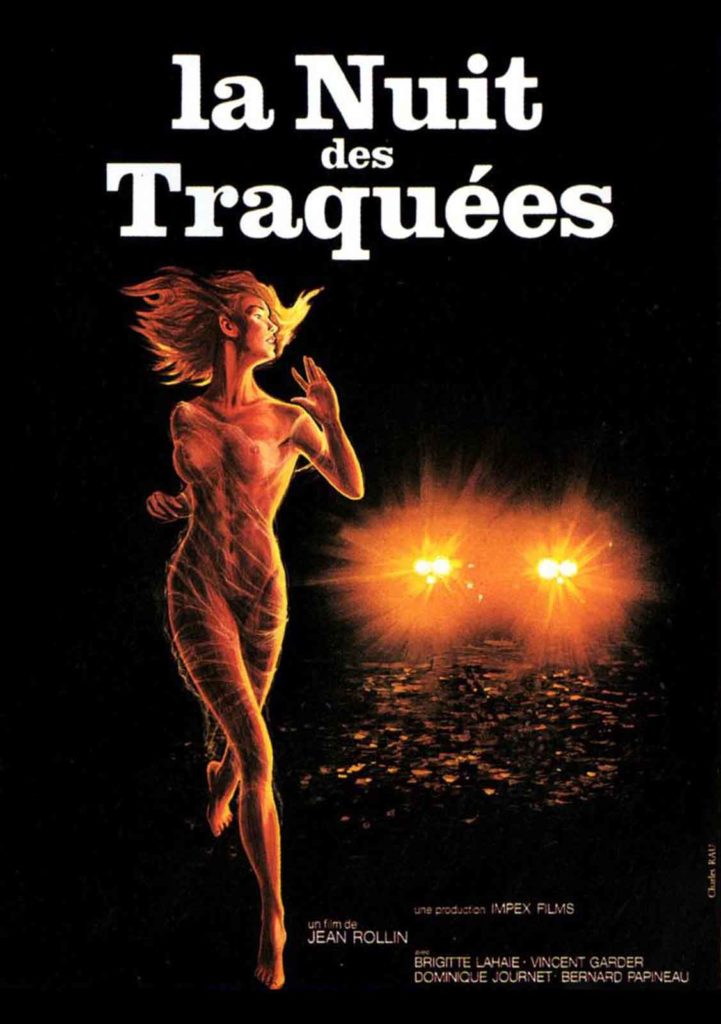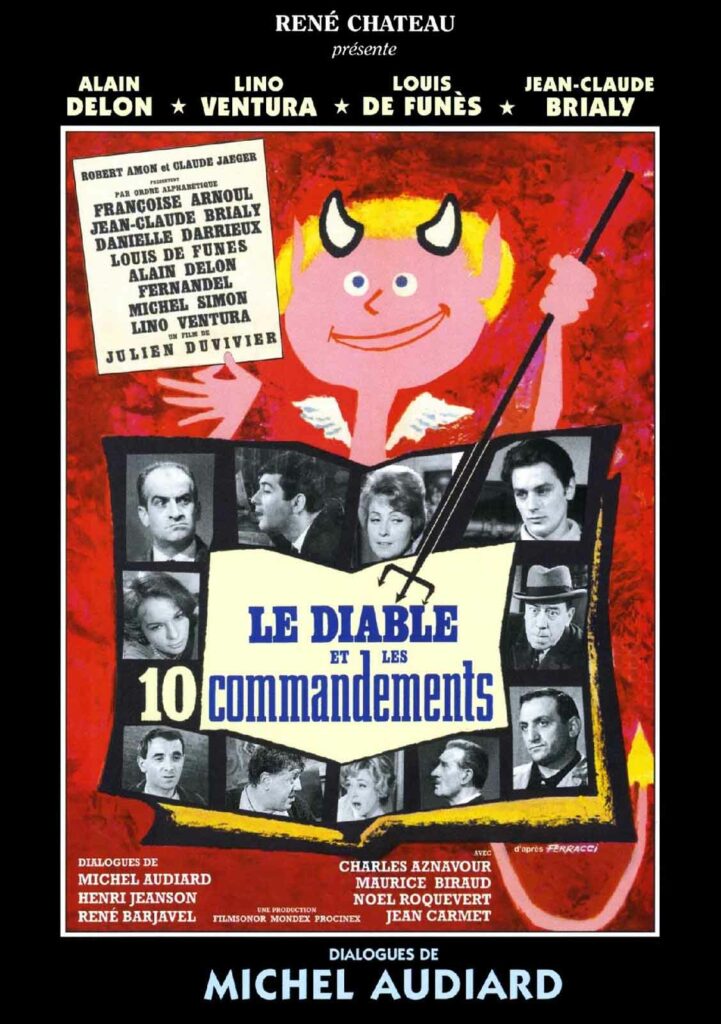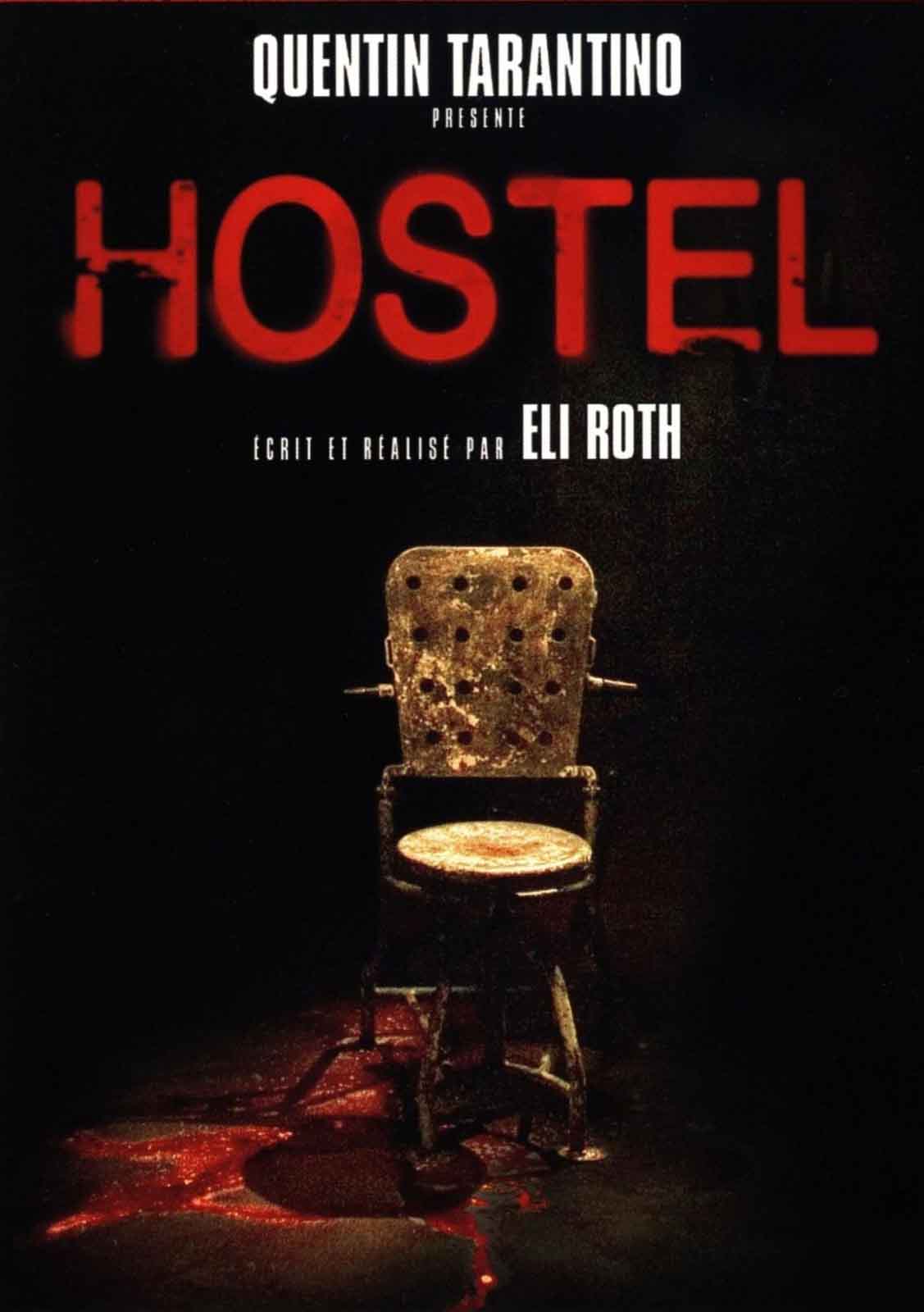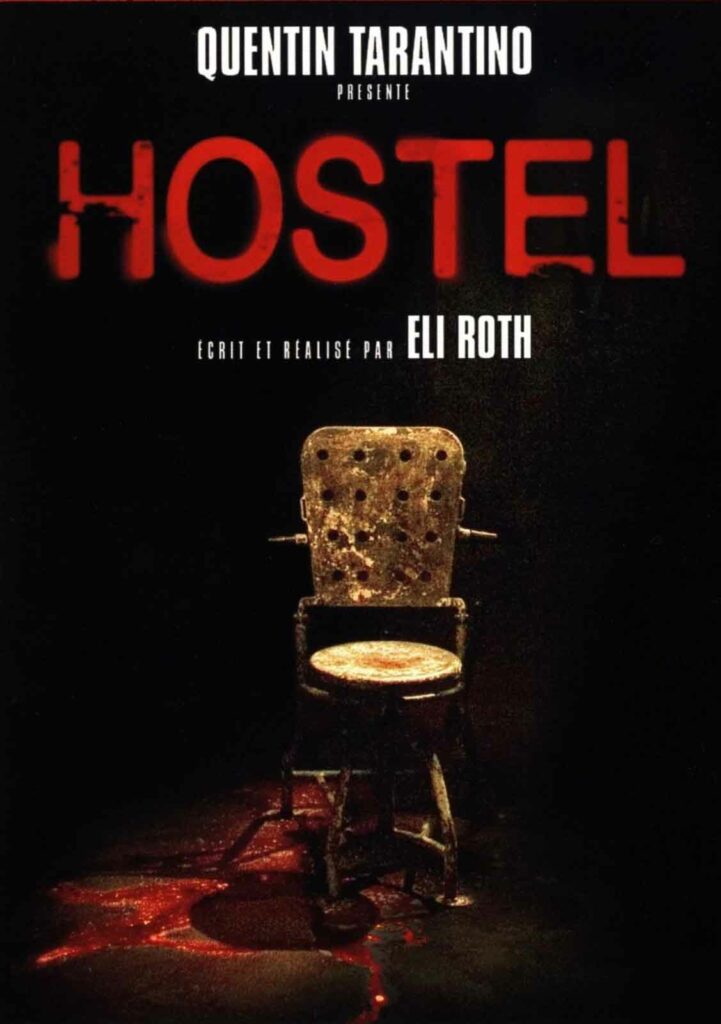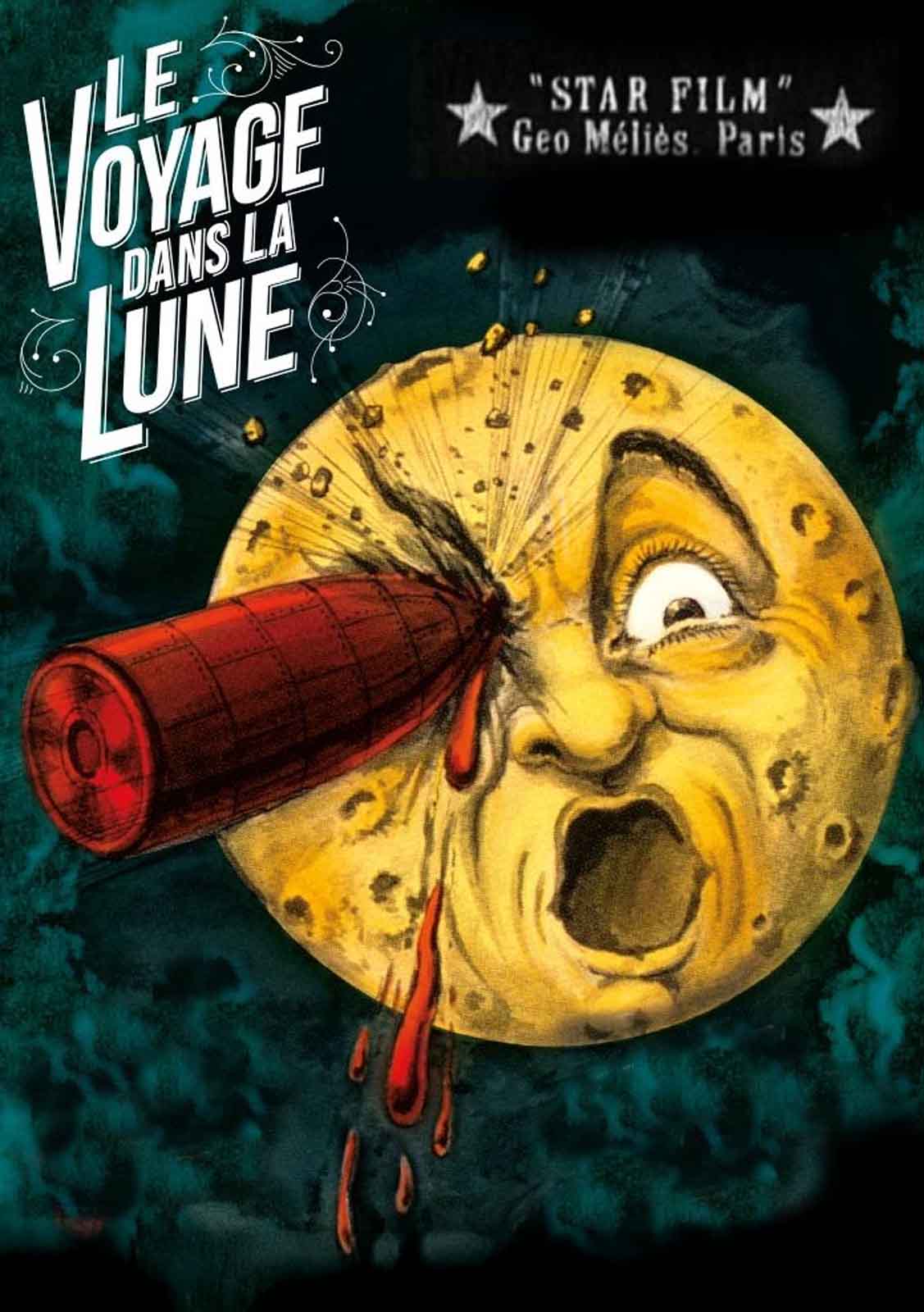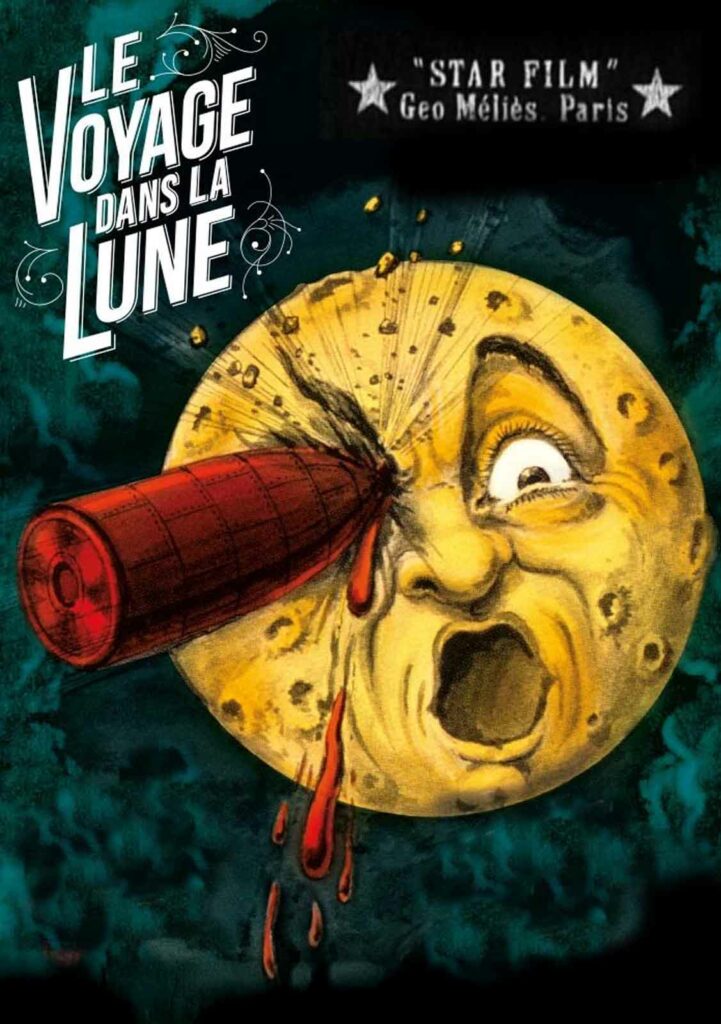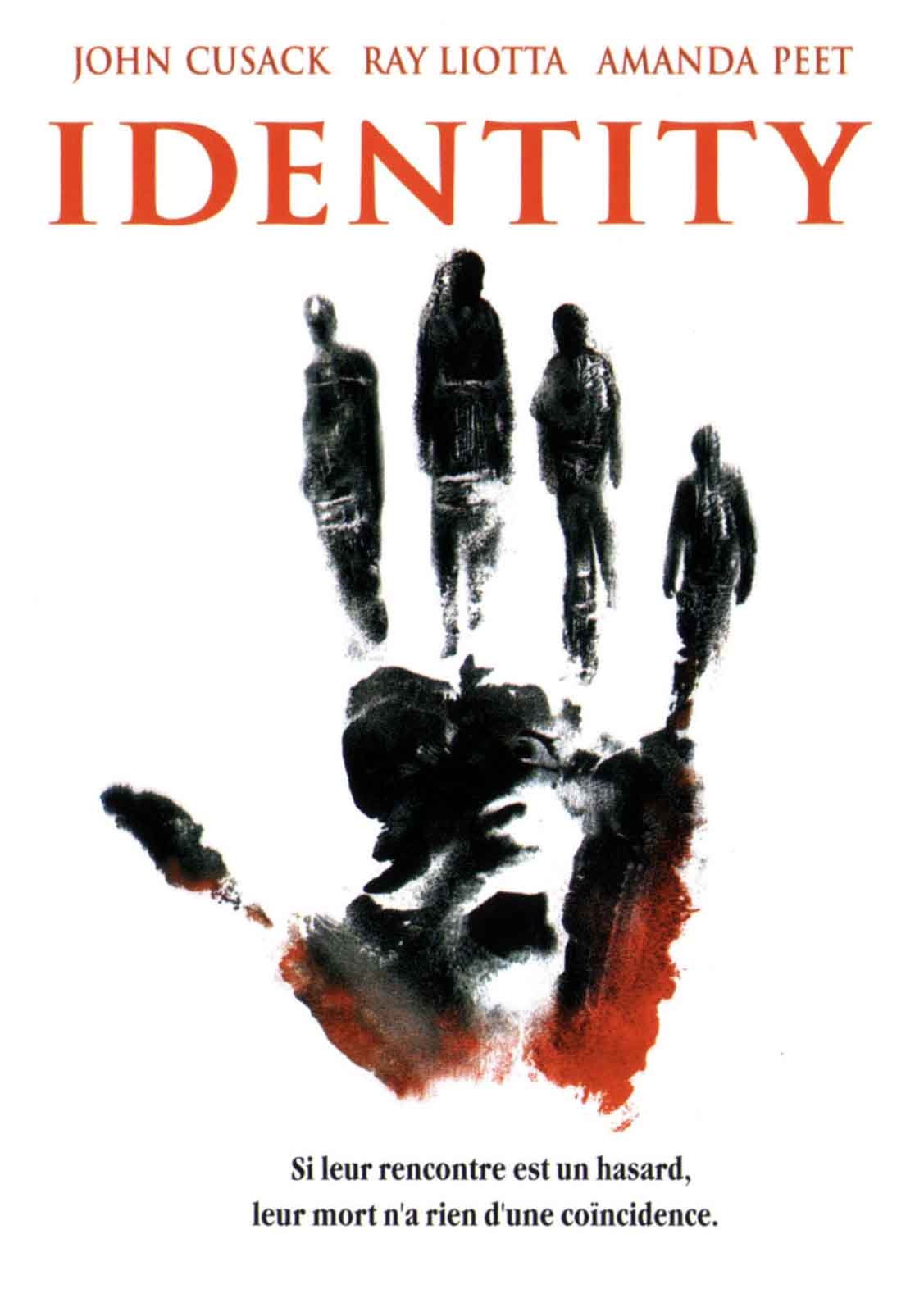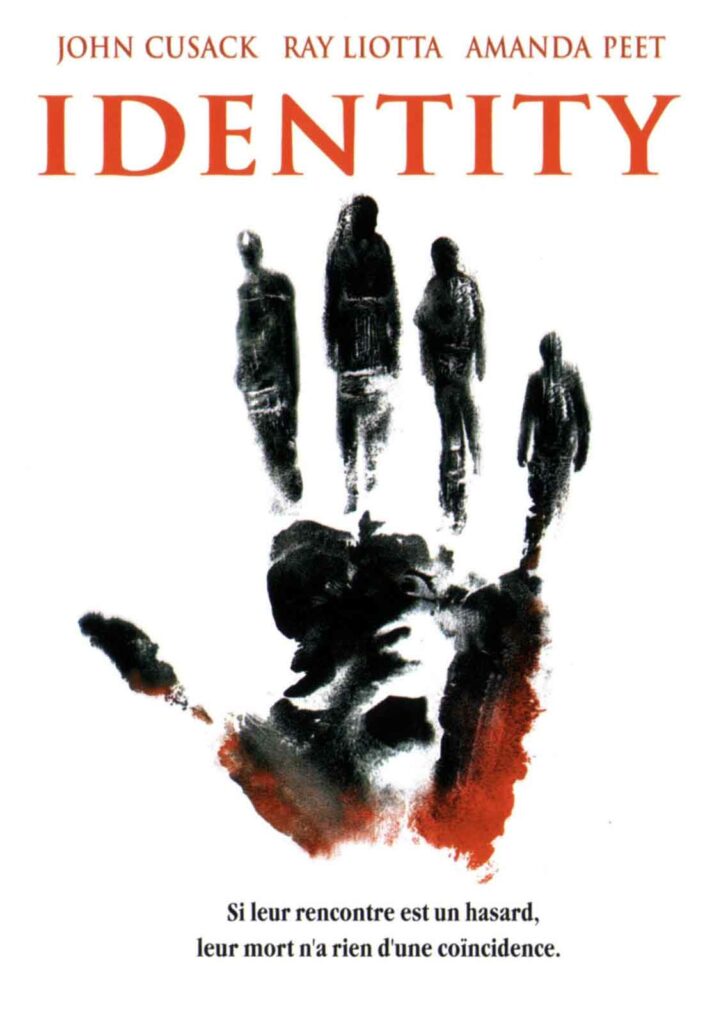Deux femmes assassinent un homme tyrannique qui abuse d’elles. Mais son cadavre disparaît, comme si le mort voulait prendre sa revanche…
Alfred Hitchcock a bien failli mettre en scène Les Diaboliques. Tout se serait joué en quelques heures à peine. En découvrant le roman « Celle qui n’était plus », co-écrit par Pierre Boileau et Thomas Narcejac, le réalisateur de Fenêtre sur cour voit le potentiel d’un grand film à suspense riche en rebondissements. Mais sa déconvenue est grande lorsqu’il cherche à acquérir les droits d’adaptation du livre : Henri-Georges Clouzot vient de le devancer ! Après le coup d’éclat du Salaire de la peur, le cinéaste français désire en effet porter à l’écran ce roman au climat oppressant, dont il compte cependant ravaler la façade en inversant le rôle des personnages principaux et en modifiant leur contexte socio-professionnel. Épaulé par Jérôme Géronimi, René Masson et Frédéric Grendel, Clouzot transforme « Celle qui n’était plus » en « Celui qui n’était plus », en quelque sorte. Le titre Les Diaboliques s’avère être une parfaite trouvaille qui ne trouve tout son sens qu’au moment d’un coup de théâtre final conçu comme une gigantesque surprise. D’où la présence dans le film d’un carton écrit en ces termes à l’attention des spectateurs : « Ne soyez pas diaboliques. Ne détruisez pas l’intérêt que pourraient prendre vos amis à ce film. Ne leur racontez pas ce que vous avez vu. »


Clouzot installe son équipe dans le château de l’Étang-La-Ville, abandonné depuis la guerre, et demande à son chef décorateur Léon Barsacq de le transformer en pensionnat. C’est là que s’inscrit l’intrigue des Diaboliques. Véra Clouzot, la propre femme du réalisateur, incarne Christina, malheureuse auprès d’un époux tyrannique et cruel, Michel Delasalle (Paul Meurisse, délicieusement détestable), qui dirige un strict pensionnat pour garçons. Christina s’est liée avec une des institutrices, Nicole (Simone Signoret), même si elle sait que cette dernière est la maîtresse de son mari. Toutes deux ont fini par se rapprocher, unies dans la haine croissante que Michel suscite chez elles. Le film ne va pas jusqu’à transformer les deux femmes en amantes, comme dans le livre, mais dessine tout de même une relation forte, Nicole étant de toute évidence la dominante et Christina la soumise. Un jour, n’y tenant plus, Nicole demande à Christina de l’aider à tuer leur compagnon. Réservée, pieuse et introvertie, la fidèle épouse refuse catégoriquement. Mais elle finit par se désespérer, face aux nombreux abus que lui fait subir Michel, et se résigne à contrecœur. Le crime est minutieusement préparé. Michel est enivré, noyé dans la baignoire d’un hôtel puis balancé au fond d’une piscine. Mais quelques jours plus tard, le cadavre disparaît mystérieusement. Et le cauchemar commence…
Le mort récalcitrant
Si Les Diaboliques est aussi effrayant, flirtant souvent avec l’épouvante et le fantastique, c’est paradoxalement parce que Clouzot traite cette histoire avec un maximum de réalisme, loin des effets de mise en scène appuyés auxquels s’adonneront ses nombreux imitateurs quelques années plus tard. Car le réalisateur du Corbeau et de Quai des Orfèvres cherche à saisir le réel – ou tout du moins à le reproduire avec le plus de justesse possible. D’où une absence totale de musique, à l’exception du générique, et une crudité qui décuple l’impact des séquences horrifiques. Cette quête permanente de crédibilité entraîne moult complications pendant le tournage. Clouzot ne veut tourner les scènes nocturnes qu’en pleine nuit, demande à un figurant réel de chuter dans la piscine au lieu d’utiliser un mannequin et malmène sans cesse son épouse pour obtenir les prises parfaites. De fait, la fragilité à bout de nerfs du personnage de Christina, telle qu’on la perçoit à l’écran, s’avère souvent bien réelle. Le calendrier des prises de vues s’allonge du coup à vue d’œil, passant de huit à seize semaines, et une tension croissante monte entre le réalisateur et ses deux actrices. C’est non sans ironie que ce triangle conflictuel finit par rappeler celui des trois personnages principaux : Simone Signoret et Vera Clouzot se serrent les coudes face à leur employeur tyrannique, et Paul Meurisse devient le reflet fictionné du cinéaste. En contrepoint de cette atmosphère suffocante, on apprécie la savoureuse interprétation de Charles Vanel dont le personnage de policier sympathique et opiniâtre semble annoncer l’inspecteur Columbo. En arrière-plan apparaissent plusieurs débutants amenés à devenir célèbre : Michel Serrault en enseignant, Jean Lefebvre en soldat ivre et un certain Jean-Philippe Smet (futur Johnny Hallyday) en élève. Les Diaboliques sera l’un des plus gros succès français de l’années 1955. Beau joueur, Hitchcock reconnaîtra les indiscutable qualités du film et demandera illico à Boileau et Barcejac de lui écrire un récit sur mesure. Ce sera Sueurs froides.
© Gilles Penso
Partagez cet article