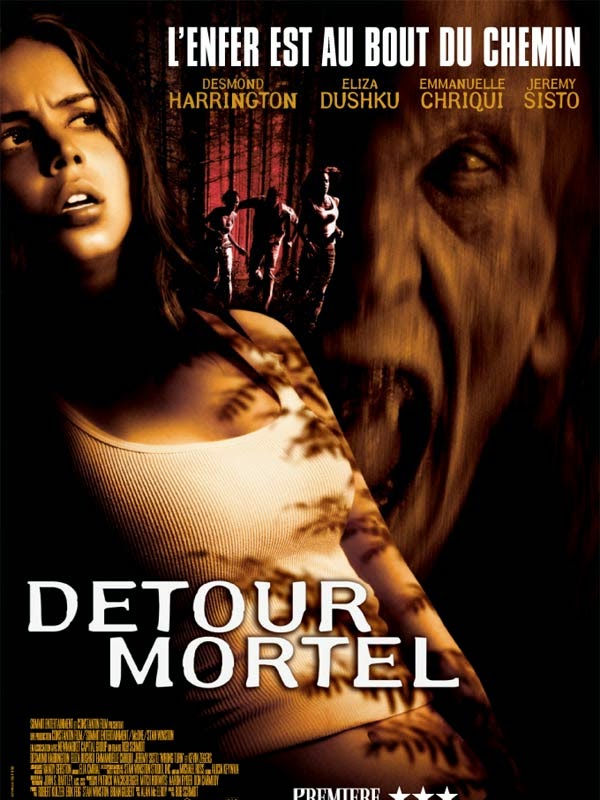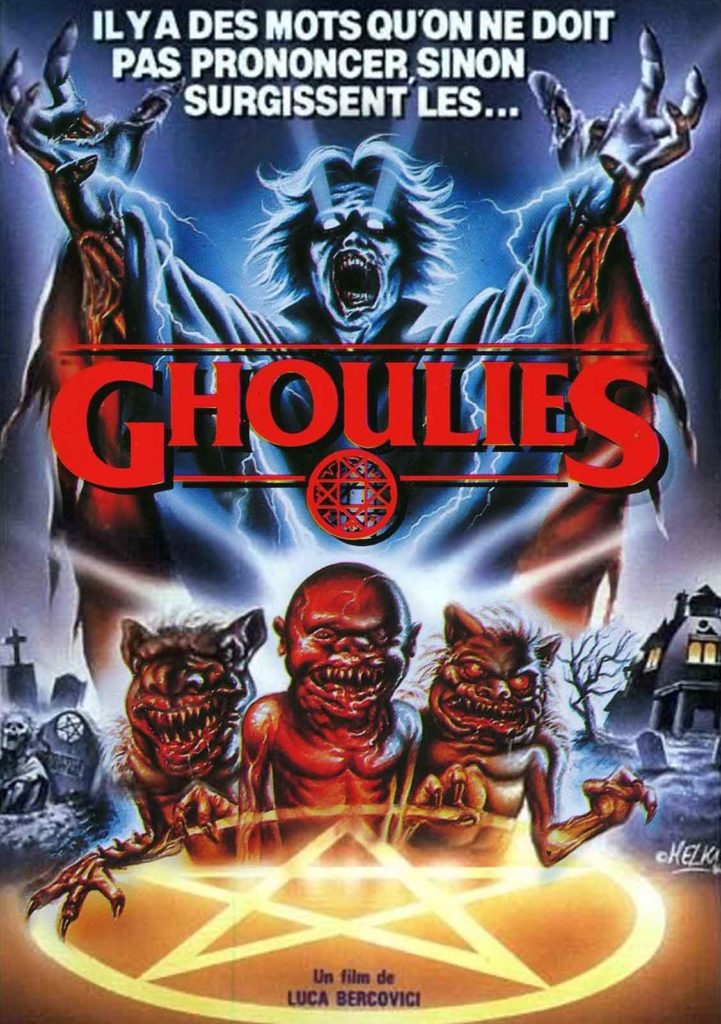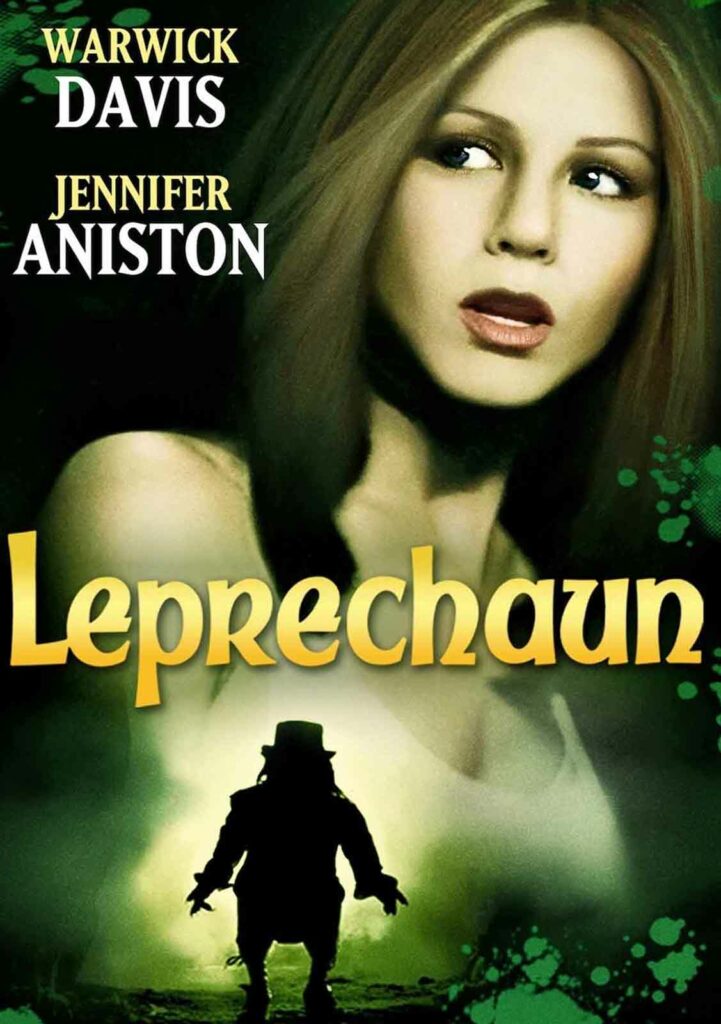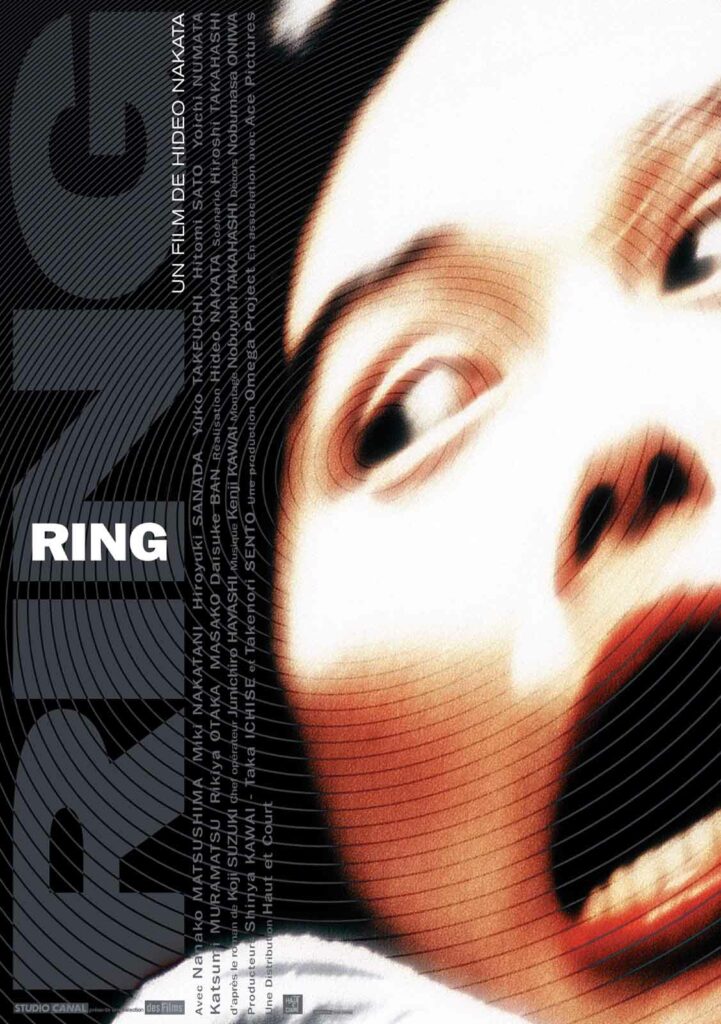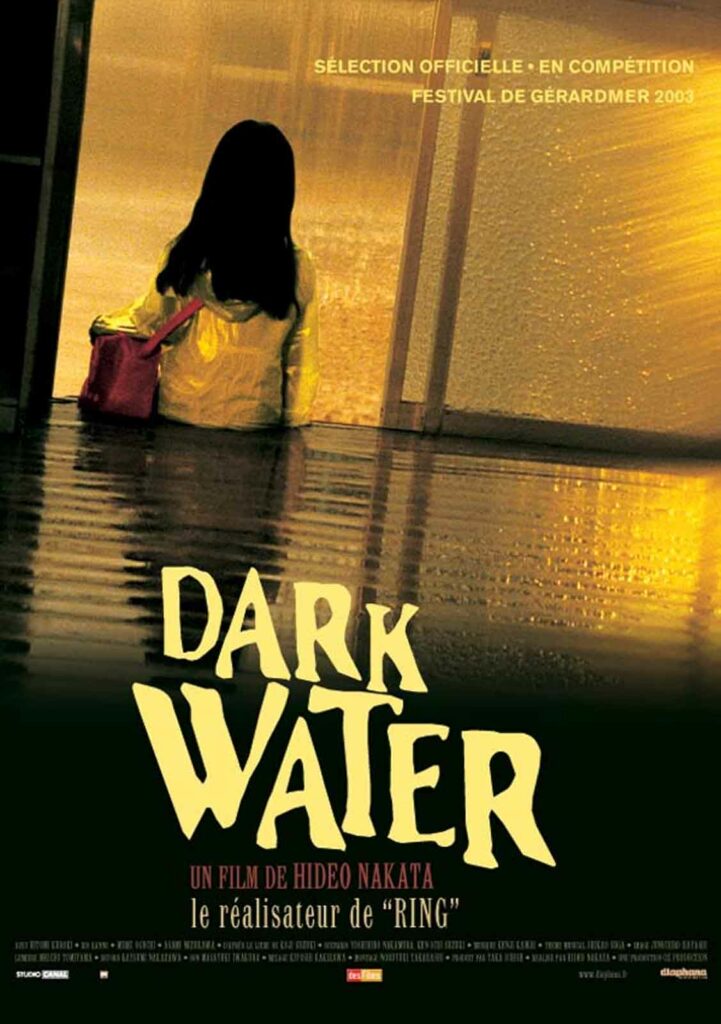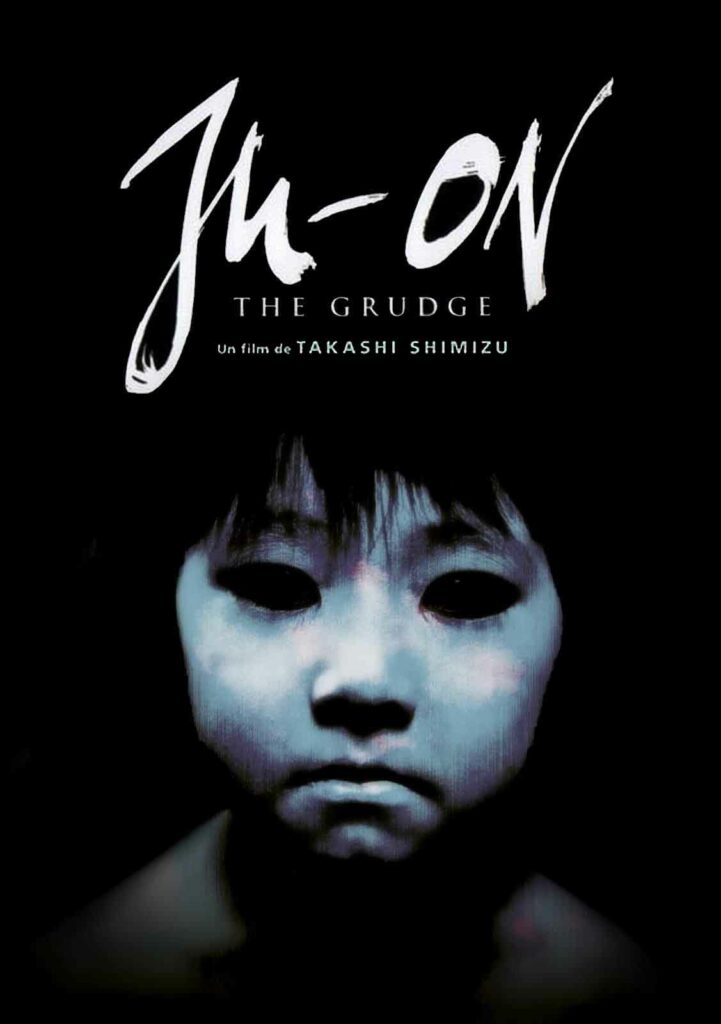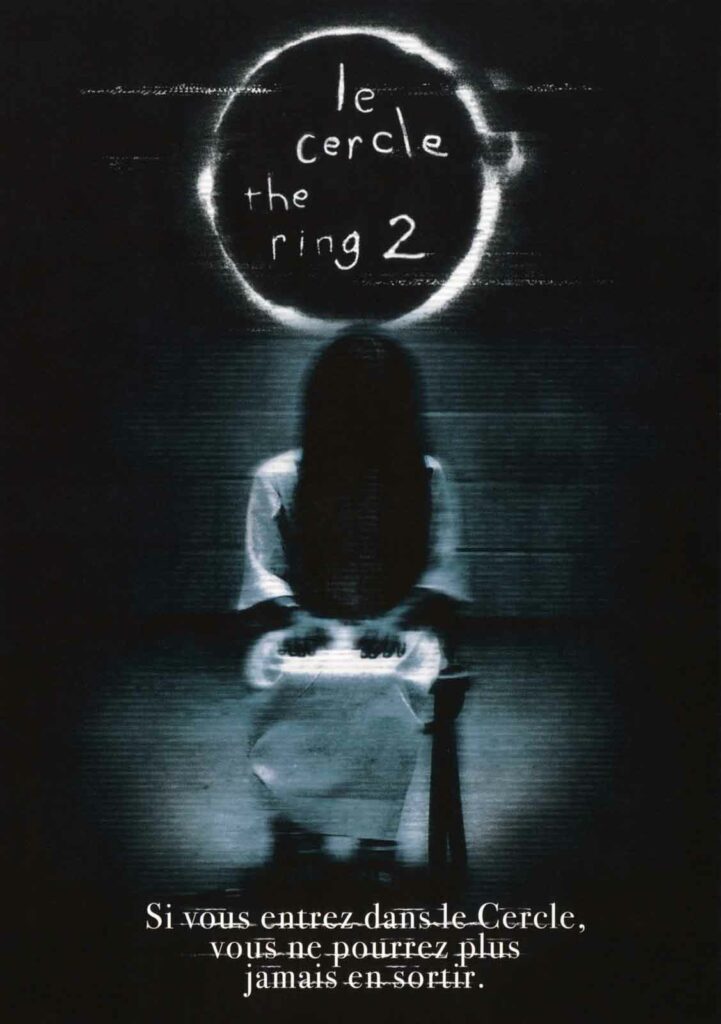Christopher Lee transfigure son corps pour incarner l'un des vilains les plus mémorables de sa longue carrière
RASPUTIN, THE MAD MONK
1966 – GB
Réalisé par Don Sharp
Avec Christopher Lee, Barbara Shelley, Richard Pasco, Francis Matthews, Suzan Farmer, Dinsdale Landen, Renée Asherson
THEMA SUPER-VILAINS
Si le Mal avec un grand M revêt plusieurs formes et arbore toutes sortes de visage, aucun comédien n’aura su mieux que Christopher Lee en incarner autant de facettes, variant à loisir l’exploration des penchants les plus sombres de l’humanité. Mais avec Raspoutine, le Moine Fou, la donne est un peu différente. Contrairement aux vampires transylvaniens ou aux super-criminels asiatiques nés de l’imagination fébrile d’écrivains inventifs, Lee donne ici corps à un personnage réel. Le studio Hammer se lance ainsi dans un exercice qui lui est peu familier, celui de la biographie romancée, sans pour autant évacuer les composantes qui font sa renommée. Car sous l’alibi historique, Raspoutine, le Moine Fou demeure un film d’horreur pur et dur. D’ailleurs, son tournage se déroule simultanément à celui de Dracula, Prince des Ténèbres, les réalisateurs Don Sharp et Terence Fisher bénéficiant ainsi des mêmes comédiens principaux mais aussi des mêmes décors. Le palais des tsars et le château de Dracula ne font donc qu’un, l’histoire et la fantaisie fusionnant en un étrange cocktail.


Le scénario de Raspoutine, le Moine Fou, écrit par John Elder, se situe en Russie au début du 20ème siècle. Doté de pouvoirs proprement surnaturels qui lui permettent de guérir les mourants, de soumettre son entourage à sa volonté ou de prévoir l’avenir, le moine Raspoutine sauve la vie d’une femme dans l’auberge d’un petit village, en échange de litres de vin, de musique, de danse et de ripaille. Sa philosophie est simple : « plus on pèche, mieux on expie ». Ambitieux, il gagne St Petersbourg et complote auprès d’une des dames de compagnie de la Tsarine pour occuper une place influente à la cour. Dès lors, son ascension est fulgurante. Fruste, manipulateur, malfaisant, il devient progressivement l’architecte de sa future perte…
Un véhicule de terreur et de fascination
Bien sûr, les puristes crieront à la trahison, car la réalité historique est un peu malmenée, et les résonnances politiques du récit à peine effleurées. Plusieurs raisons expliquent un tel parti pris. La première, triviale, est liée aux limites budgétaires du film, couplées à sa courte durée de tournage. Avec les moyens à sa disposition, Don Sharp ne pouvait décemment embrasser avec envergure la vie mouvementée de Raspoutine et son impact sur la Russie des Tsars. Il confine donc l’intrigue à un nombre limité de décors et réduit volontairement ses protagonistes. Mais ce n’est pas la seule explication. En centrant la quasi-totalité de l’intrigue sur Raspoutine, ses agissements, ses exubérances et sa folie, le film transcende l’exercice de la biographie pour mettre en scène une figure monstrueuse et quasi inhumaine. La prestation de Christopher Lee est à ce titre hallucinante. Rarement le comédien aura à ce point transfiguré son corps pour le muer en véhicule de terreur et de fascination. Son regard noir, ses mains crispées, sa stature gigantesque irradient l’écran, et Lee s’efface totalement derrière son personnage, dévoilant un registre qu’on ne lui connaissait pas. Au magnétisme de Dracula, à la folie hégémonique de Fu-Manchu, il ajoute ainsi la paillardise, l’exubérance et la luxure. C’est assurément l’un des rôles les plus impressionnants et les plus intenses de sa longue carrière.
© Gilles Penso
Partagez cet article