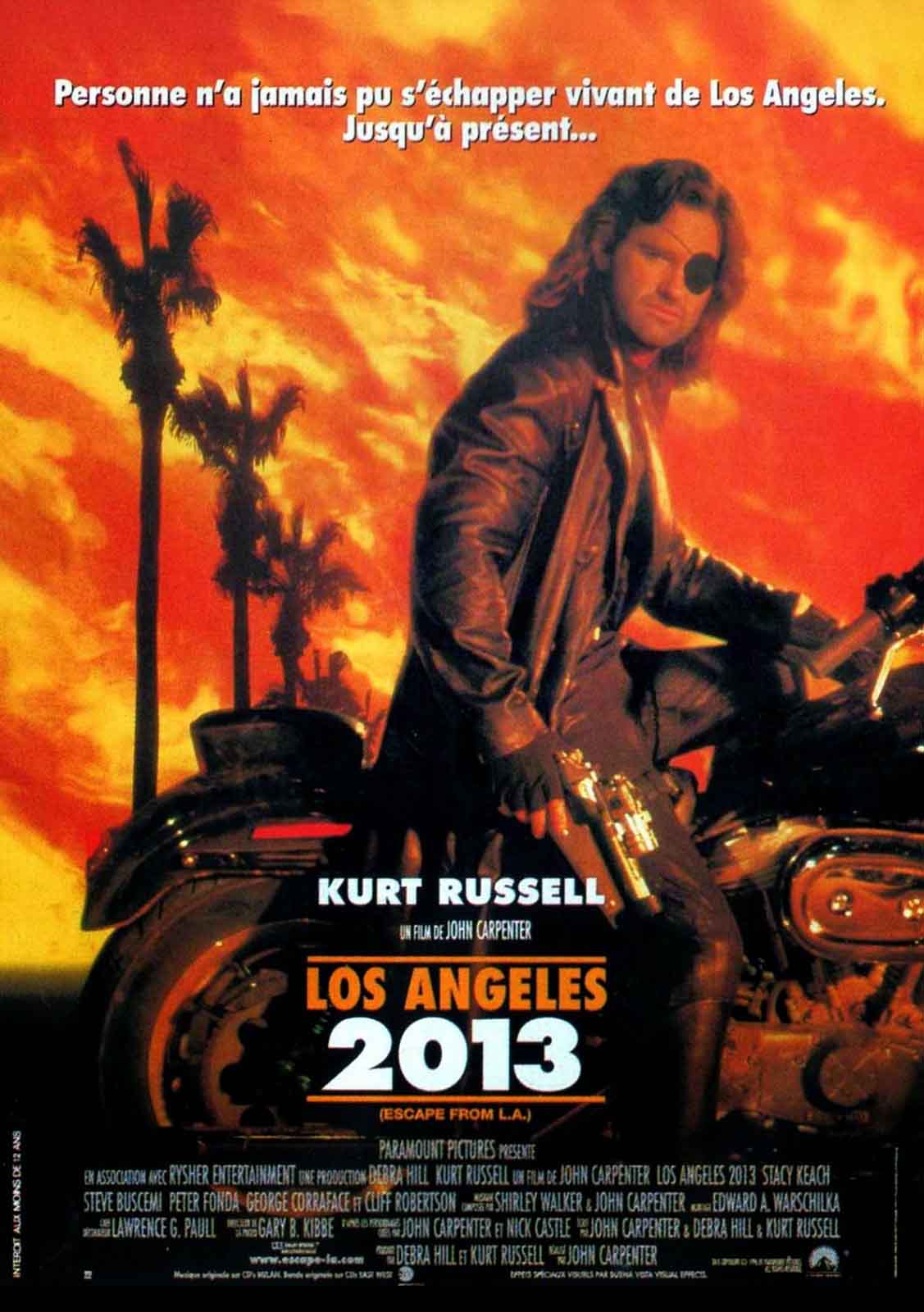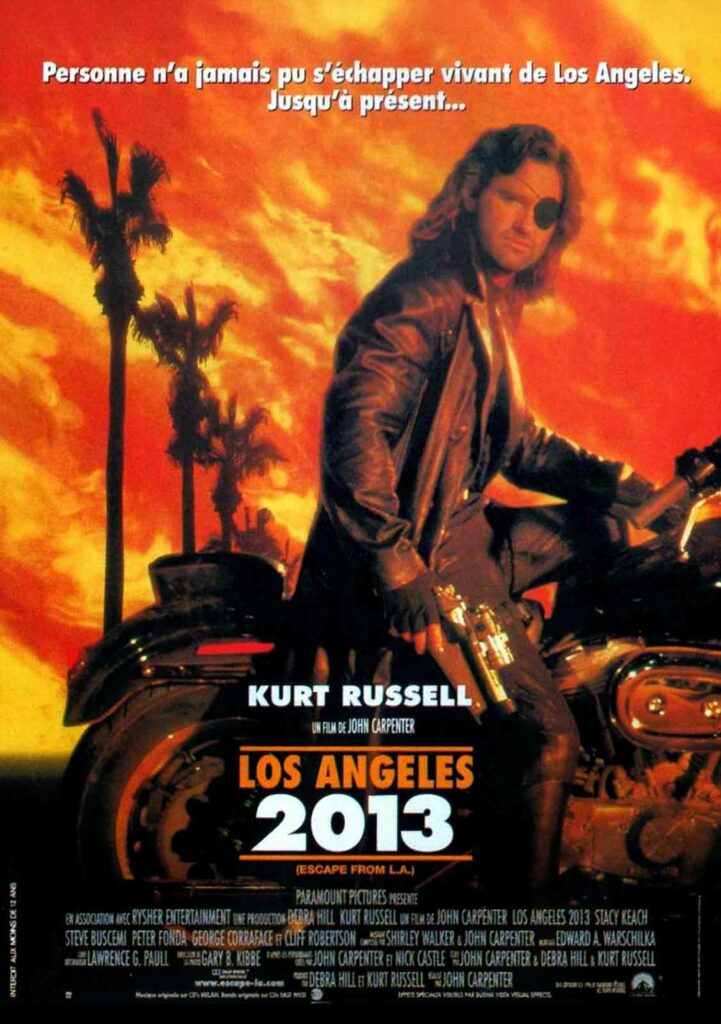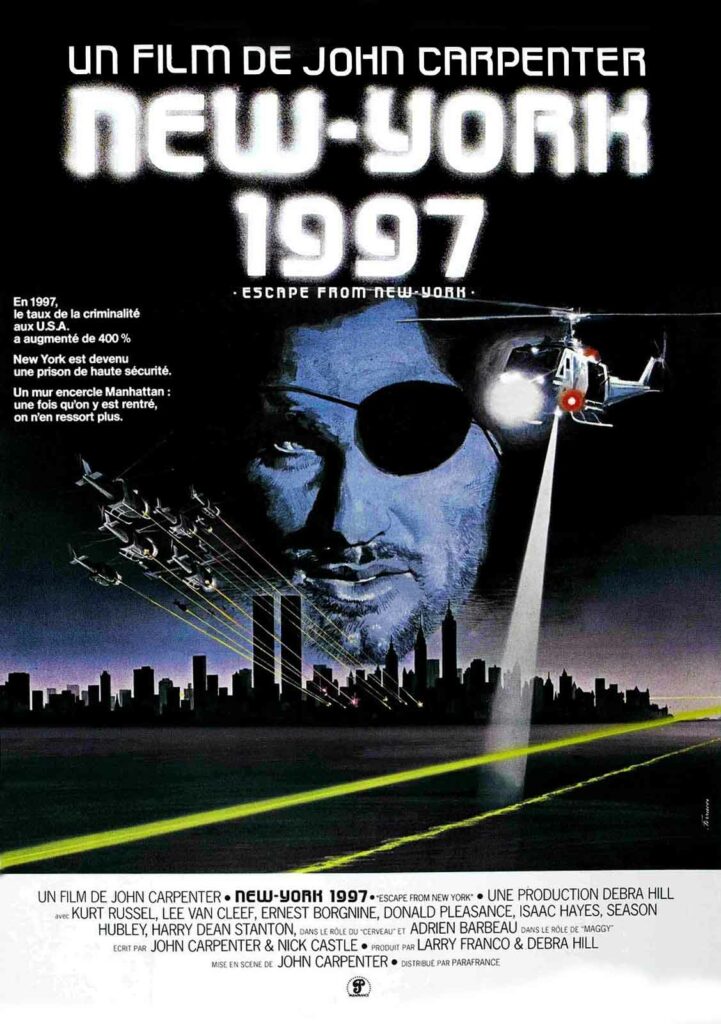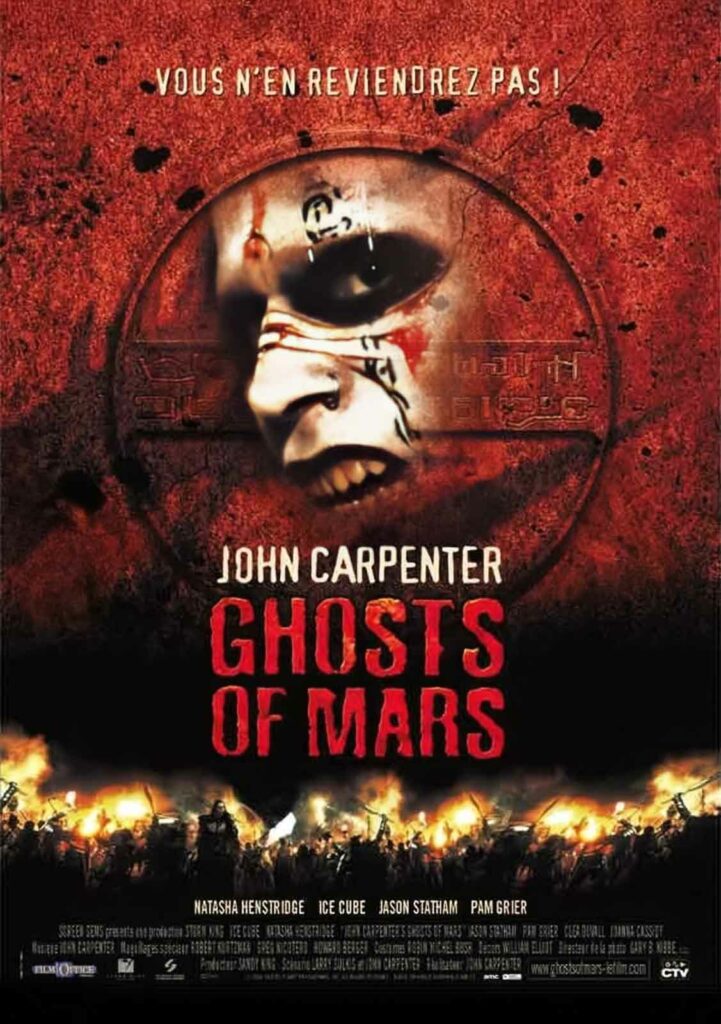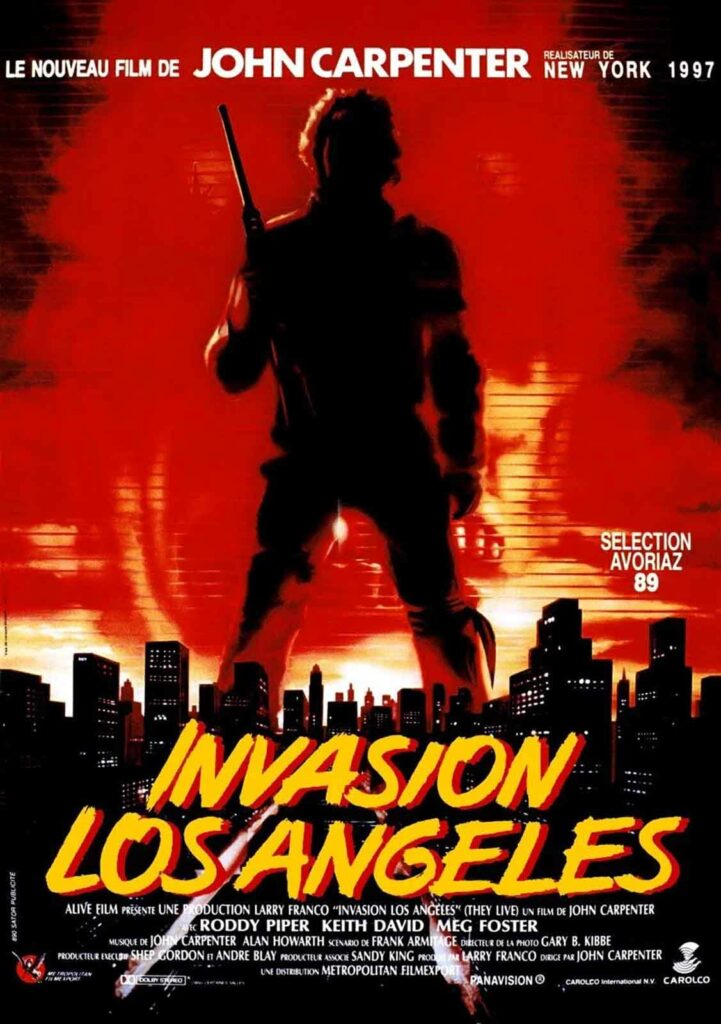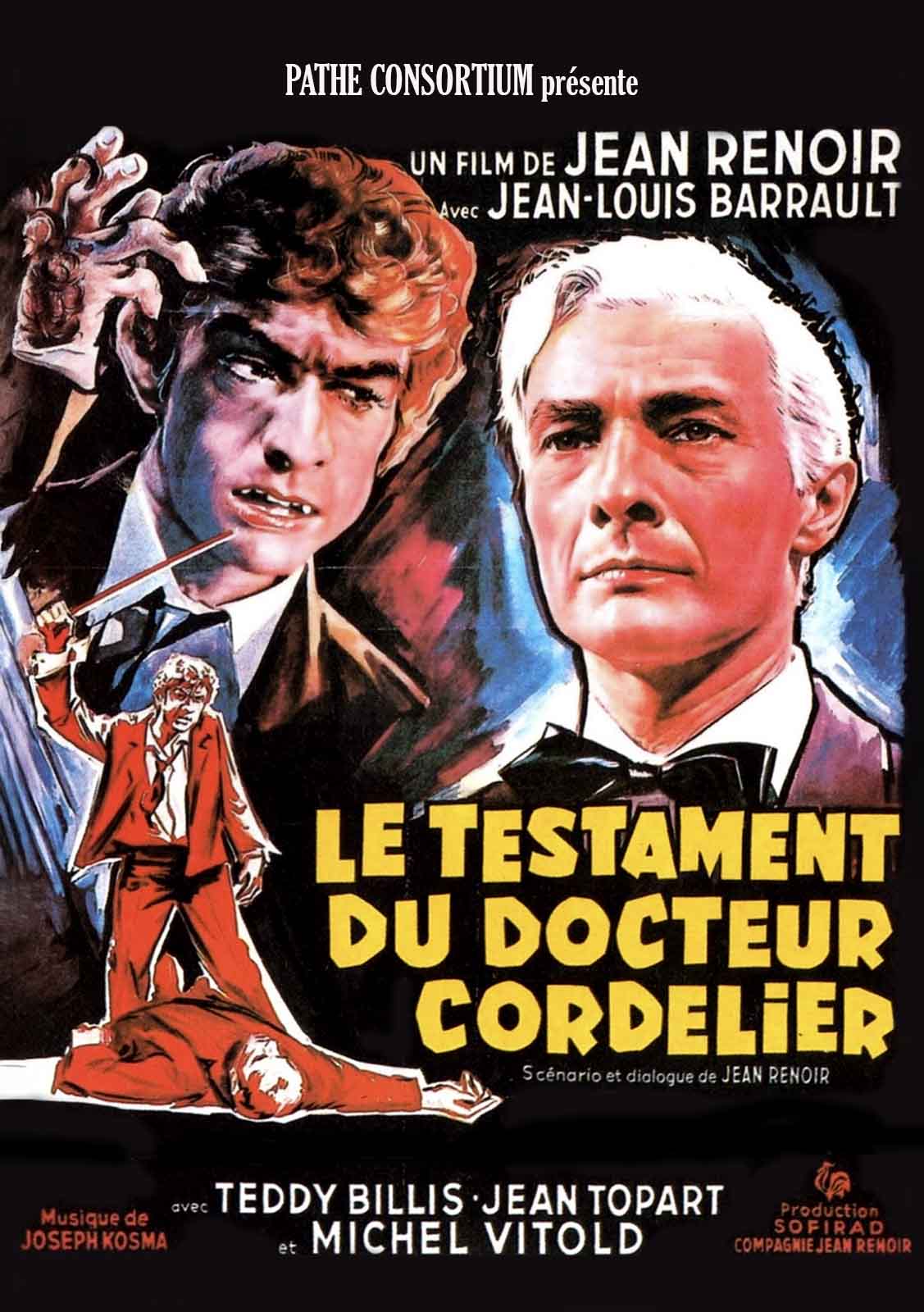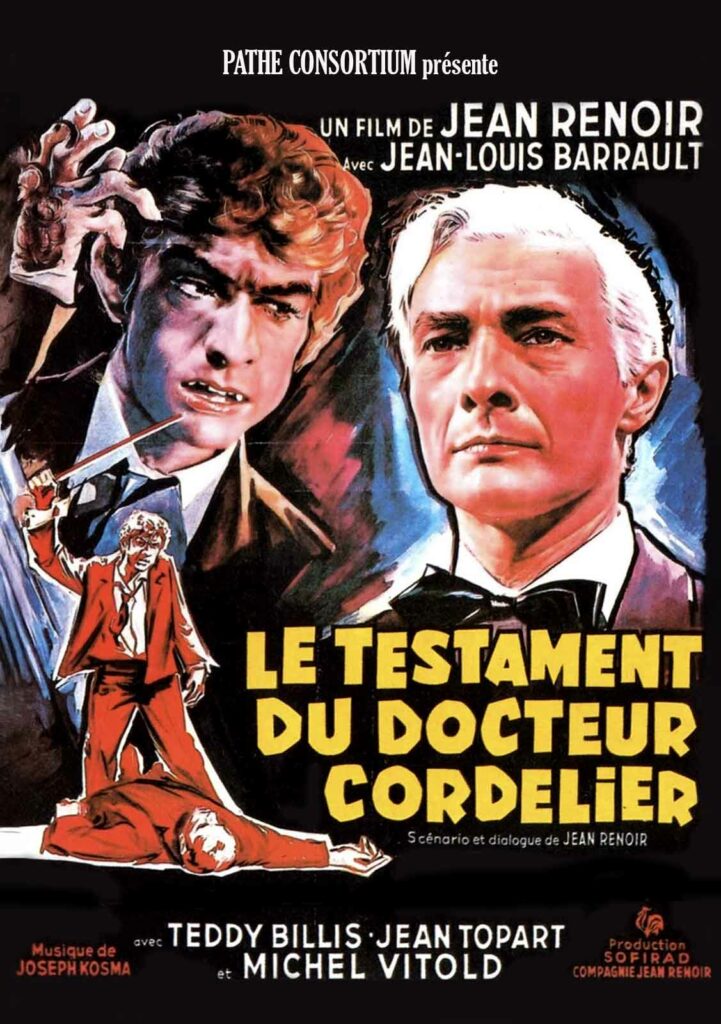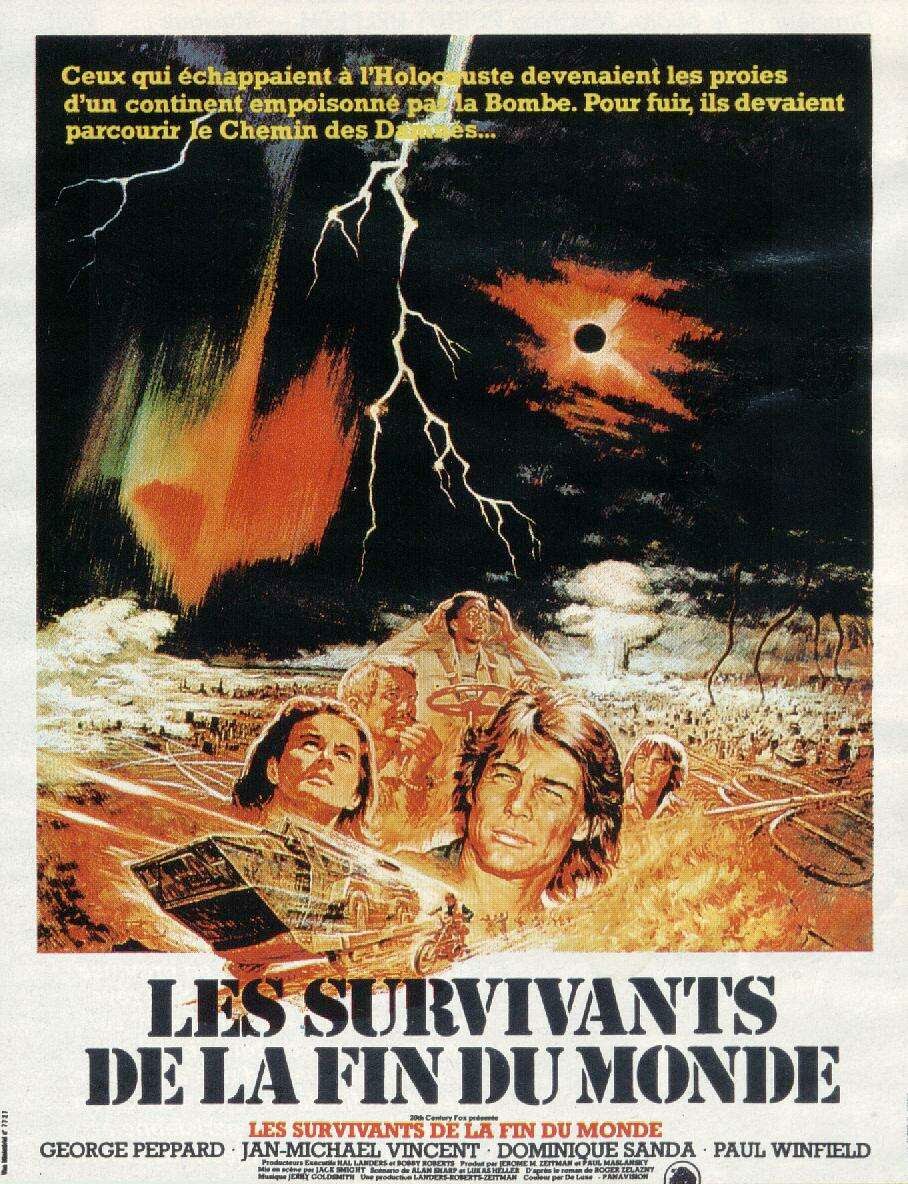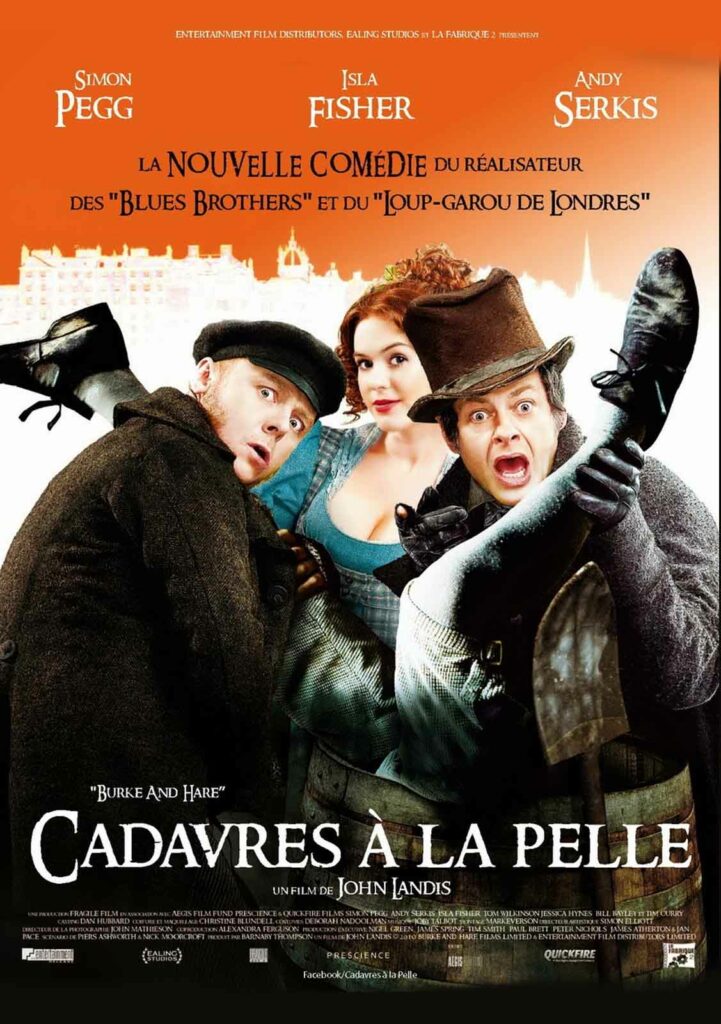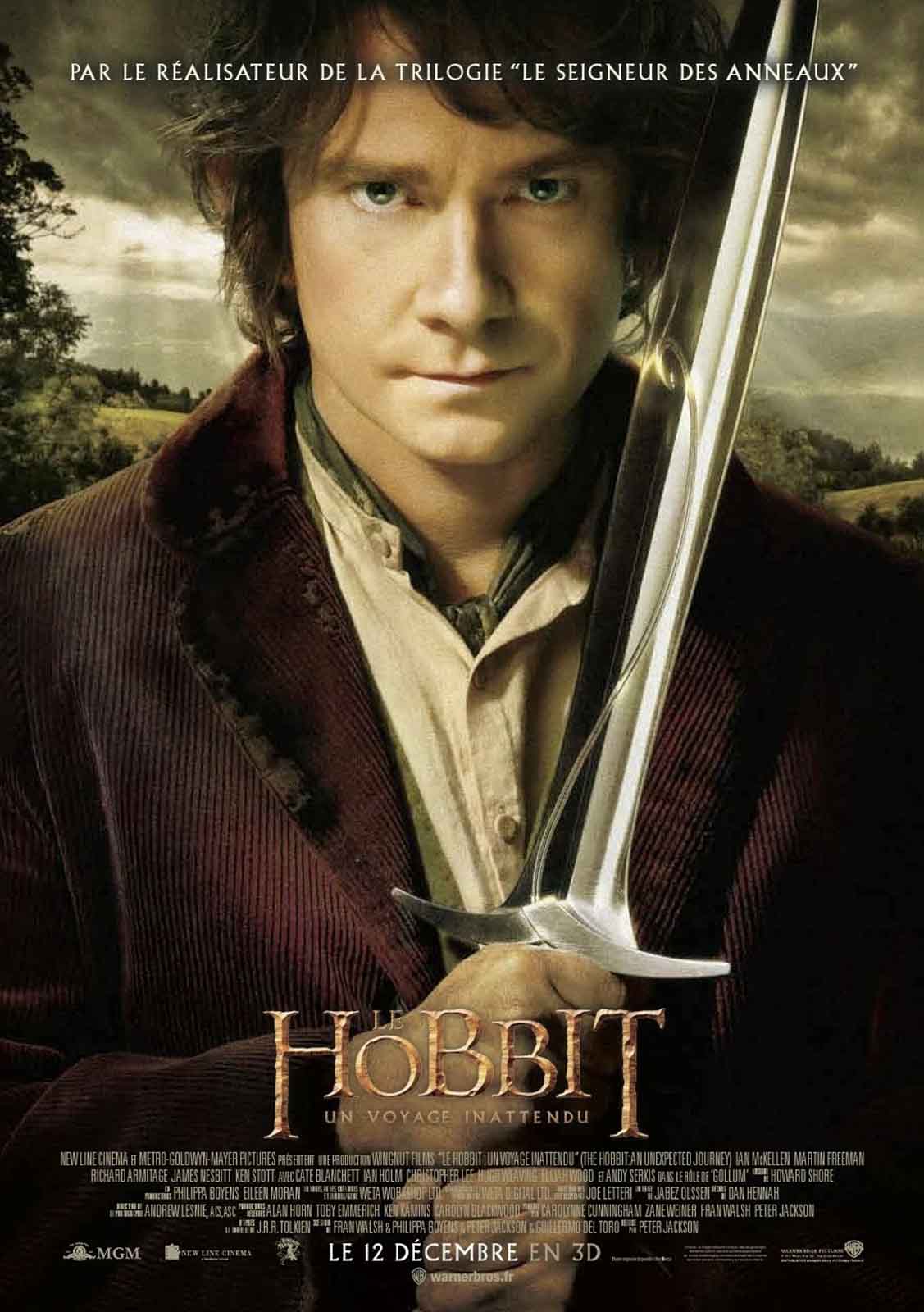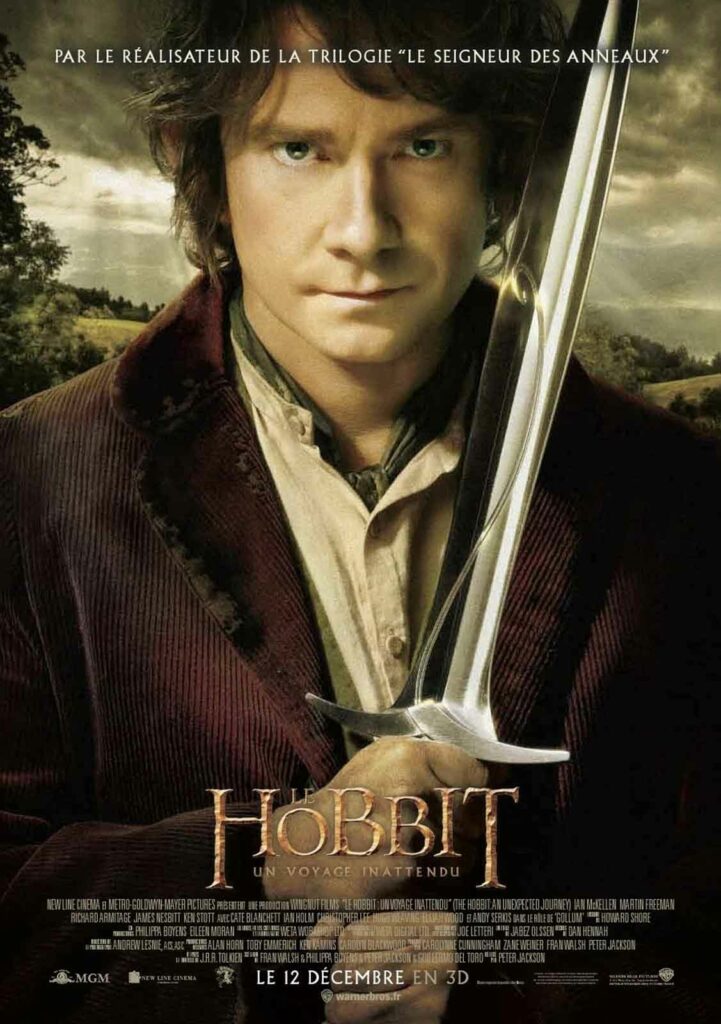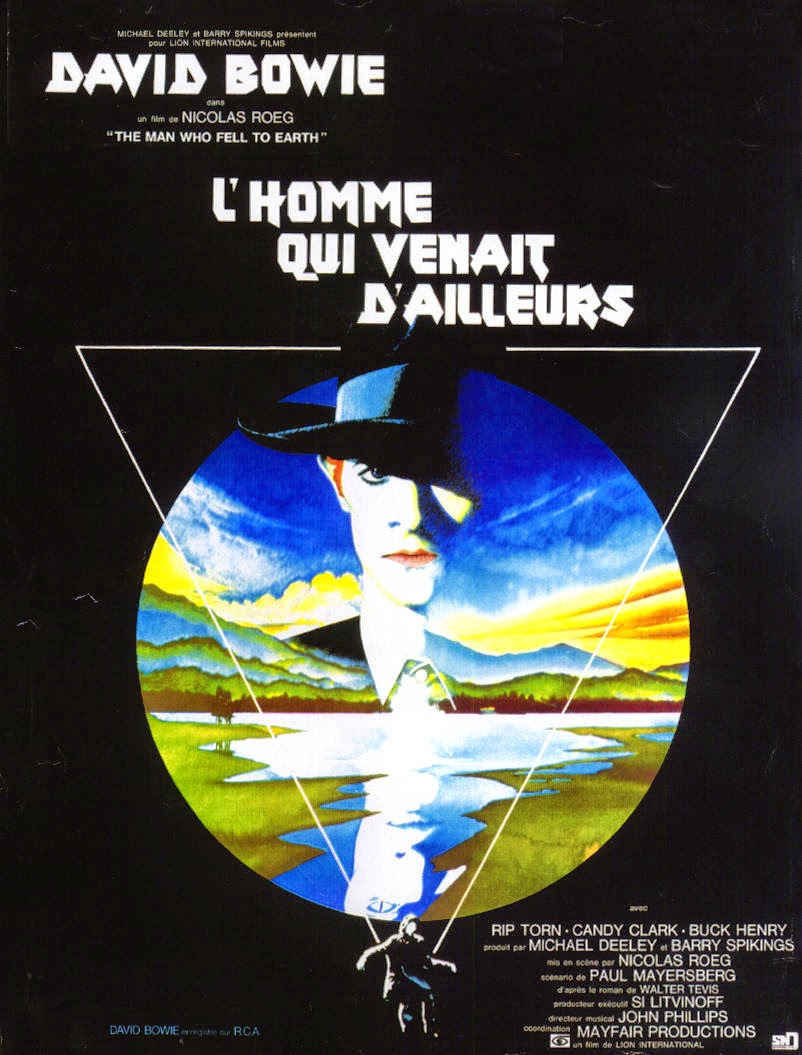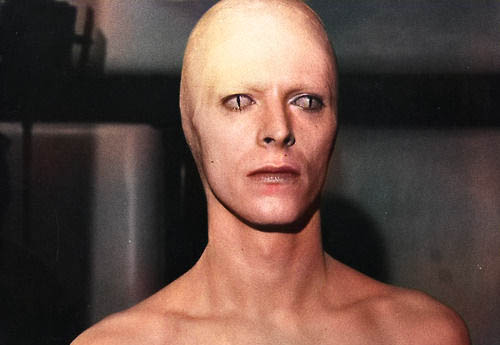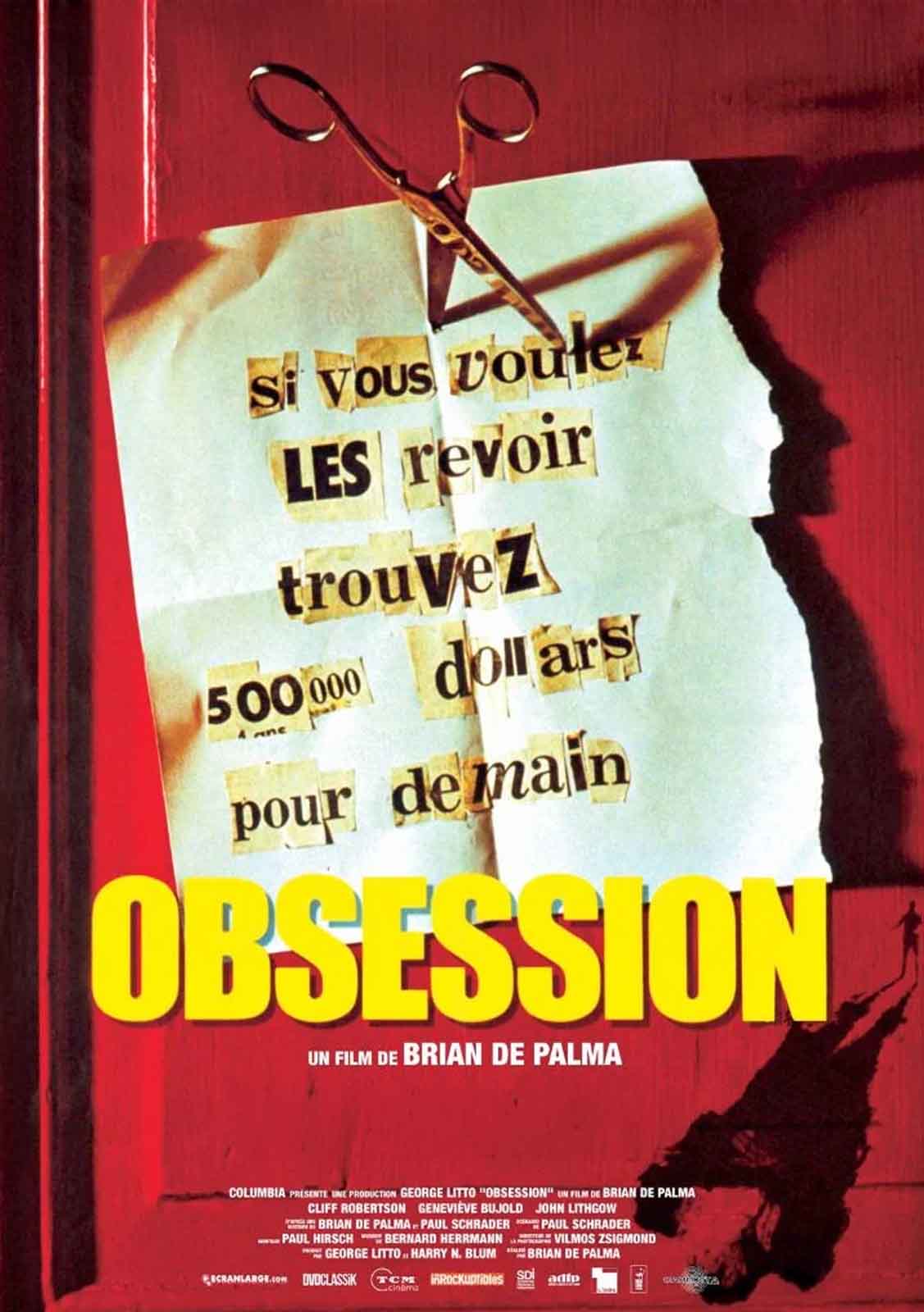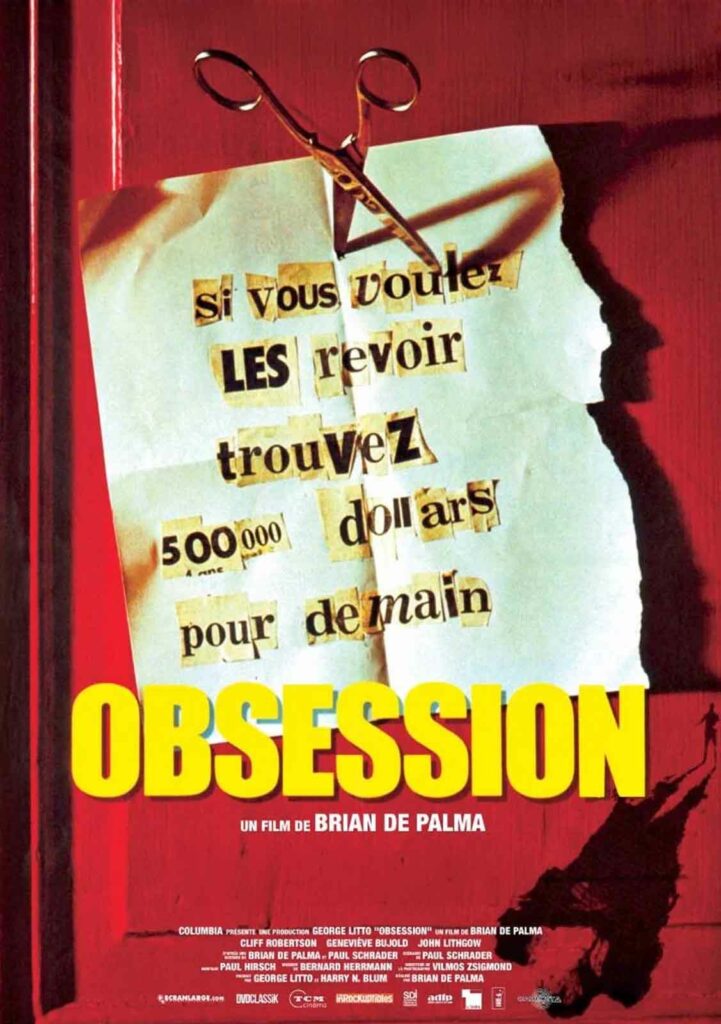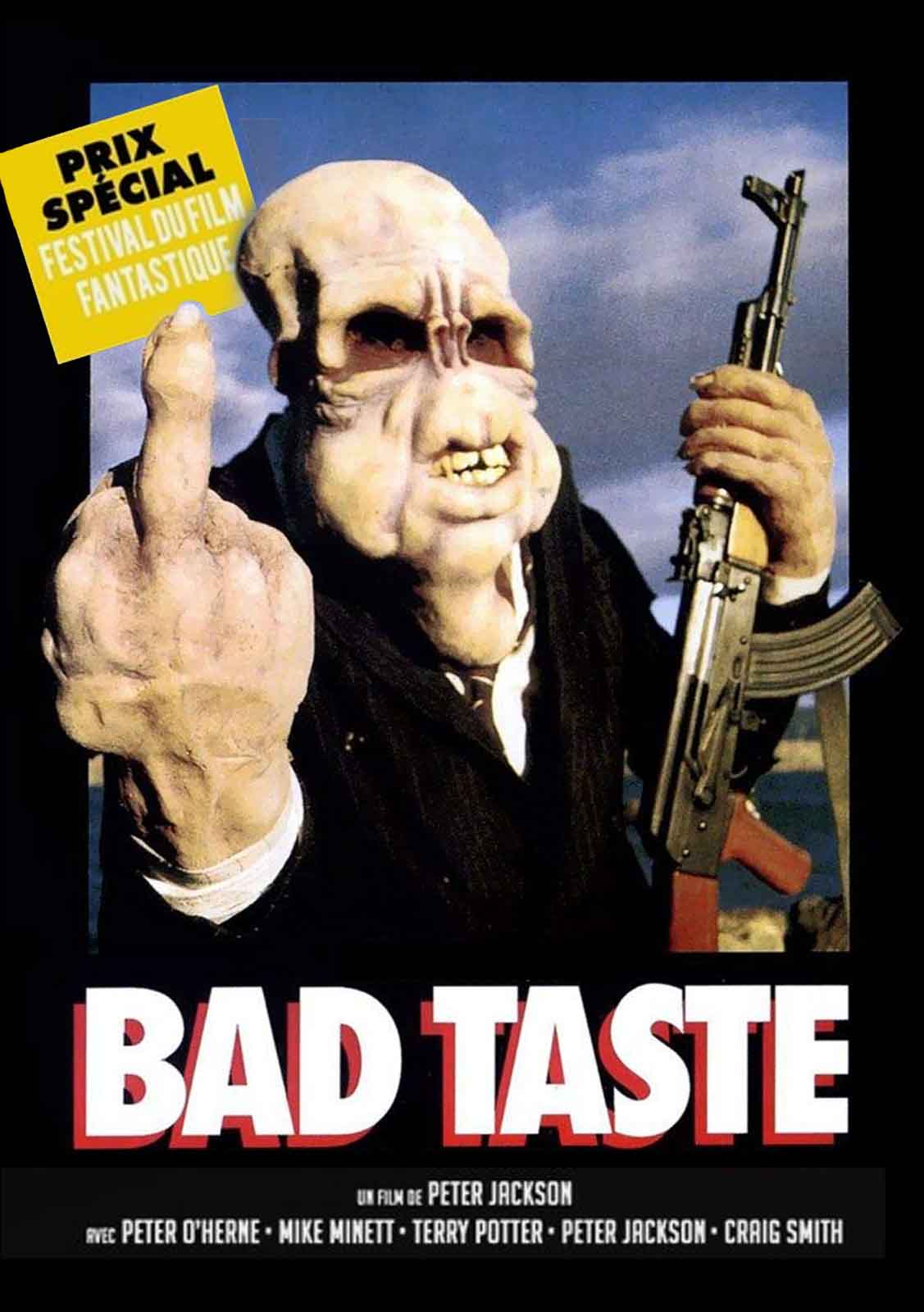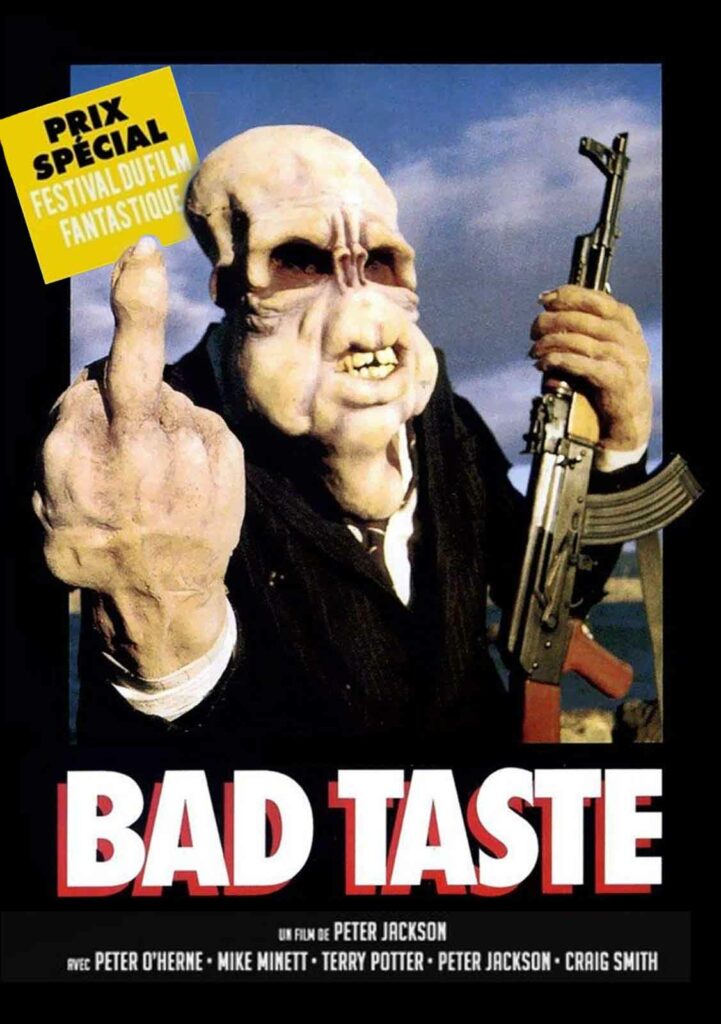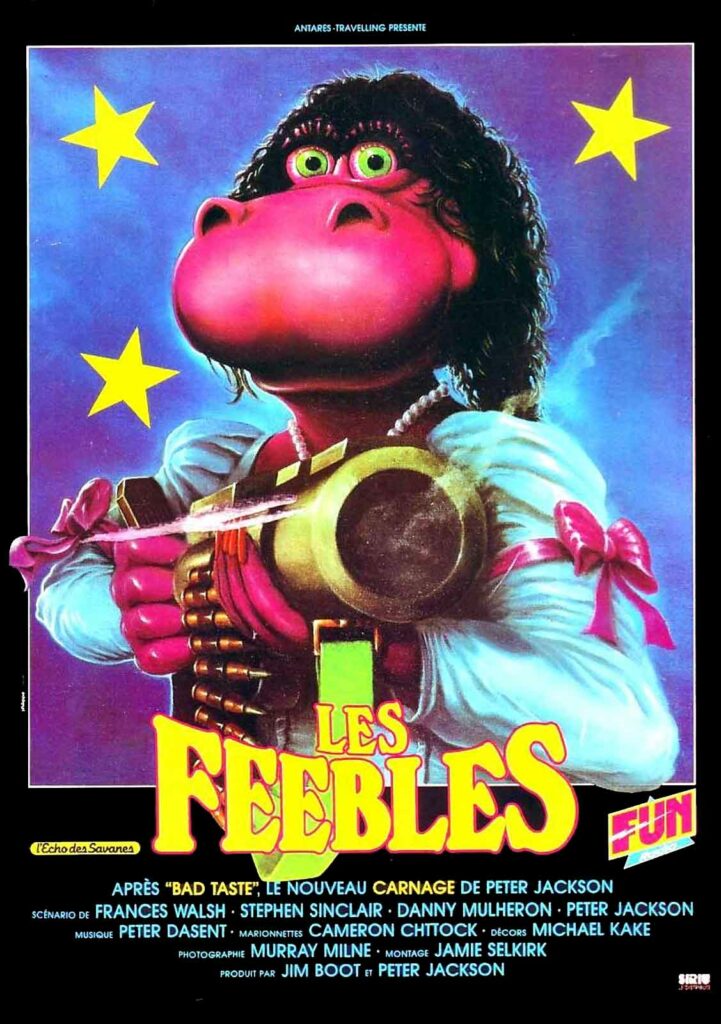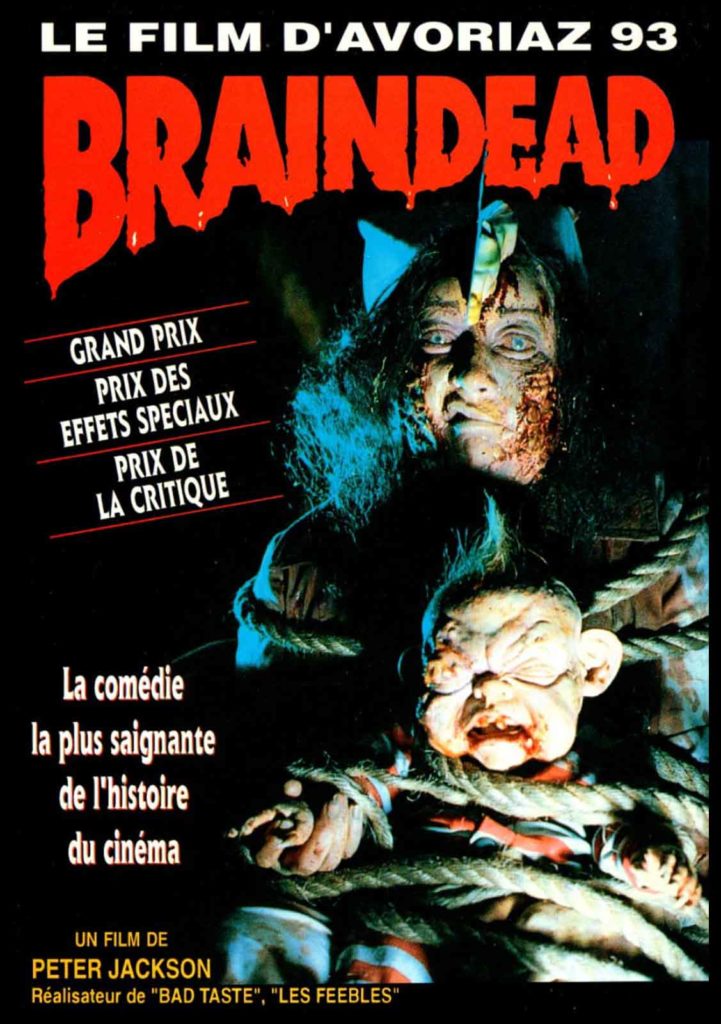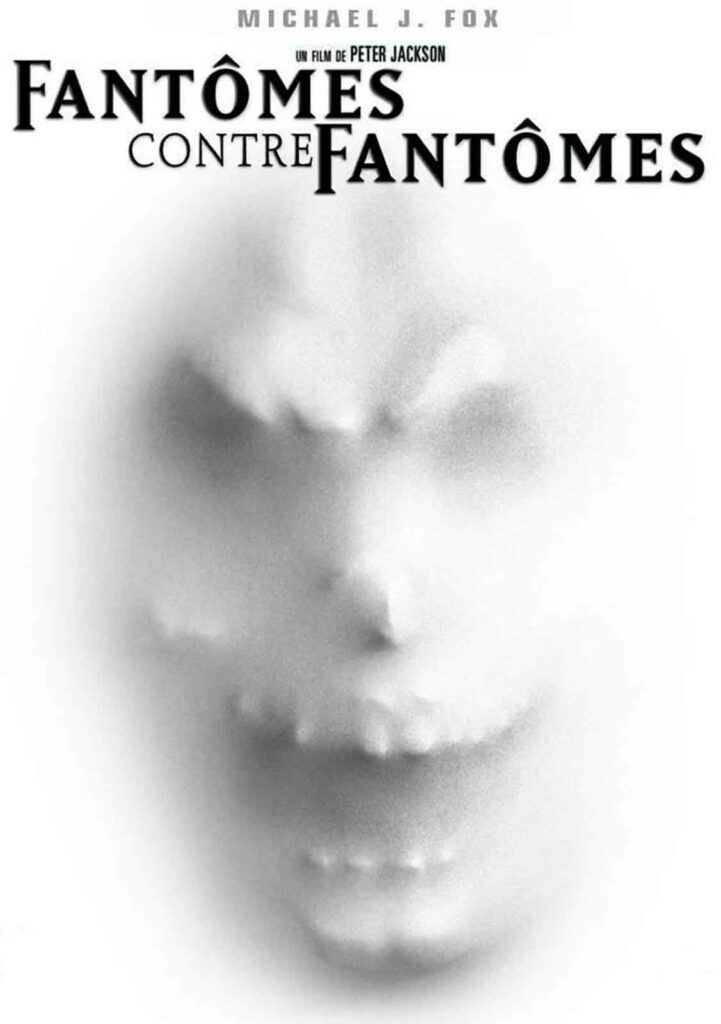Difficile d’évoquer Jack le tueur de Géants sans penser au 7ème voyage de Sinbad, dont il constitue une imitation maladroite assez appauvrie, artistiquement, techniquement et narrativement, malgré un déploiement de moyens conséquents et une armada d’hommes d’effets spéciaux embauchés pour effectuer le travail que Ray Harryhausen, quatre ans plus tôt, avait effectué seul. Celui-ci nous avouera d’ailleurs, en parlant du film : « On dirait Le 7ème voyage de Sinbad avec des costumes différents ! » (1) Adapté d’un conte populaire du moyen âge anglais, le scénario s’ouvre sur l’anniversaire de la princesse Elaine (Judi Meredith), au royaume de Cornouailles. Sous une fausse identité, le sorcier Pendragon (Thorin Thatcher) lui offre une boîte à musique d’où sort un petit automate. Le soir, l’automate se transforme en un hideux géant baptisé Cormoran qui s’empare d’Elaine. Le monstre gagne bientôt la côte et remet la princesse au gnome Garna. Un jeune fermier, Jack (Kerwin Matthews), intervient hardiment, libère Elaine et réussit à tuer Cormoran. Pour le récompenser, le roi le fait chevalier et le désigne pour accompagner la jeune fille au couvent. Mais Constance, la dame de compagnie de la princesse, les trahit après avoir été ensorcelée par Pendragon. Pour retrouver le chemin du château maudit, Jack devra suivre les conseils d’un lutin enfermé dans une bouteille.


Jack le tueur de Géants tente donc ouvertement de recycler les éléments qui firent le succès de Sinbad (héros sautillant, princesse en péril, sorcier maléfique, géants, dragon, squelette, génie dans la bouteille) et le producteur va jusqu’à engager le même réalisateur et les mêmes acteurs principaux ! Mais il manque l’élément essentiel : Harryhausen. De fait, les créatures, malgré un design souvent intéressant, n’ont pas la moindre finesse, ni dans leur morphologie, ni même dans leur animation. « Le travail de sculpture n’était pas très soigné », nous avoue l’animateur Jim Danforth, « et lorsque j’ai finalement été engagé pour participer à l’animation du film, j’ai eu beaucoup de mal à travailler avec sensibilité sur ces figurines grossières. Autant les pattes de bouc des cyclopes de Ray Harryhausen étaient élancées et réalistes, autant celles des géants de ce film étaient grossières et rigides. On aurait dit de simples tubes tordus recouverts de poils ! » (2)
Géants, monstres marins et dragons
De fait, le premier géant, Cormoran, est une réplique servile du cyclope de Sinbad. Le second, Galligantua, est une version bicéphale et chevelue du premier. Le film nous gratifie aussi de deux dragons surprenants, affublés de traits caricaturaux qu’on croirait échappés d’un cartoon. Le premier, surgi des mers, ressemble à un croisement entre un dinosaure et une pieuvre. Le second, attaquant nos héros dans les airs, a un corps de reptile, des ailes de chauve-souris et un faciès canin ! Au détour de quelques séquences, le film évoque La Belle et la Bête (les bras animés dans le couloir) et La Belle au bois dormant (le méchant transformé en dragon). Malgré tous ces emprunts, et un ton général un peu sinistre, le tout jeune spectateur trouvera bien des attraits à ce Jack le tueur de Géants, riche en couleurs, en surprises et en magie.
(1) Propos recueillis par votre serviteur en février 2004
(2) Propos recueillis par votre serviteur en avril 1998
© Gilles Penso
Partagez cet article