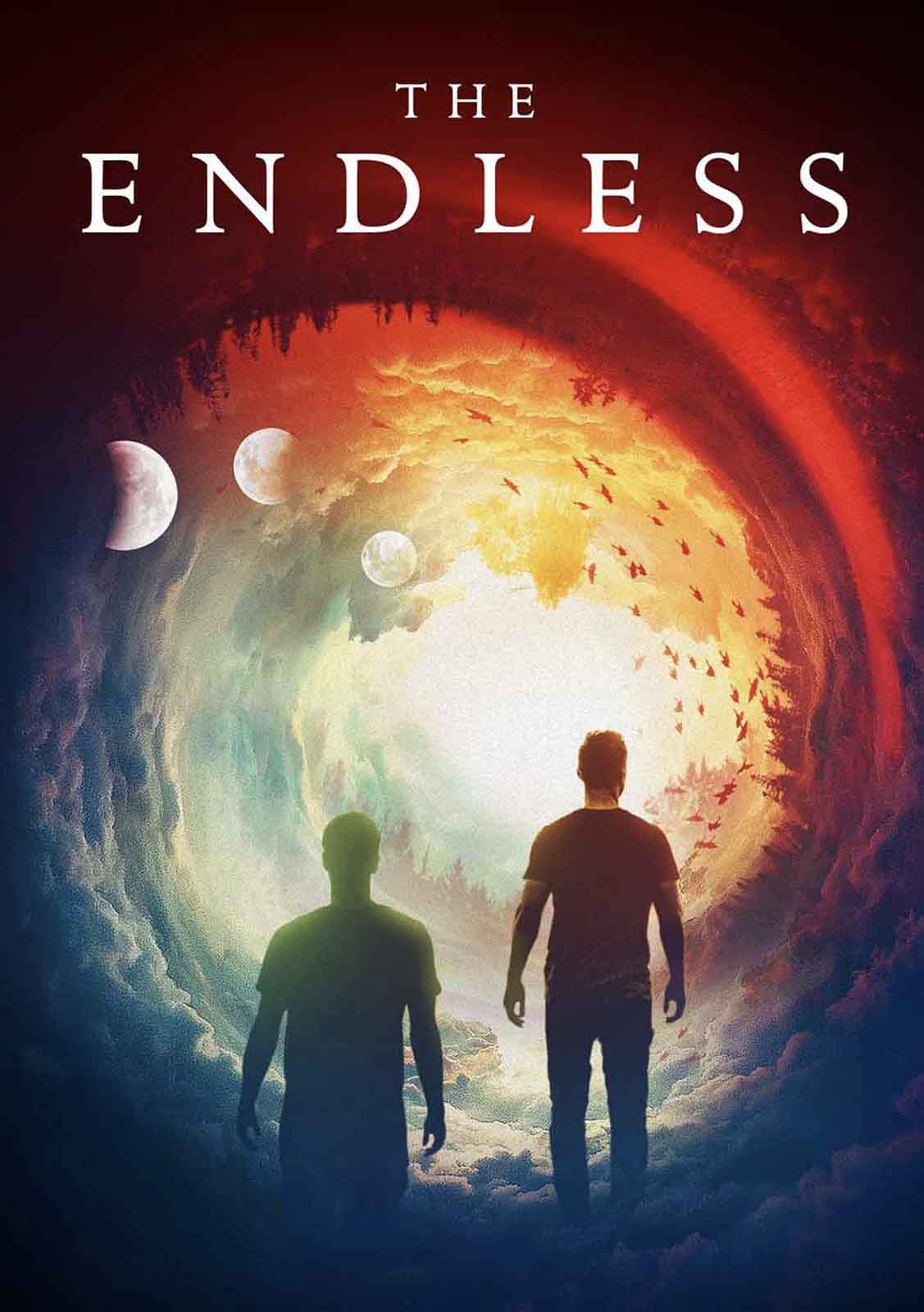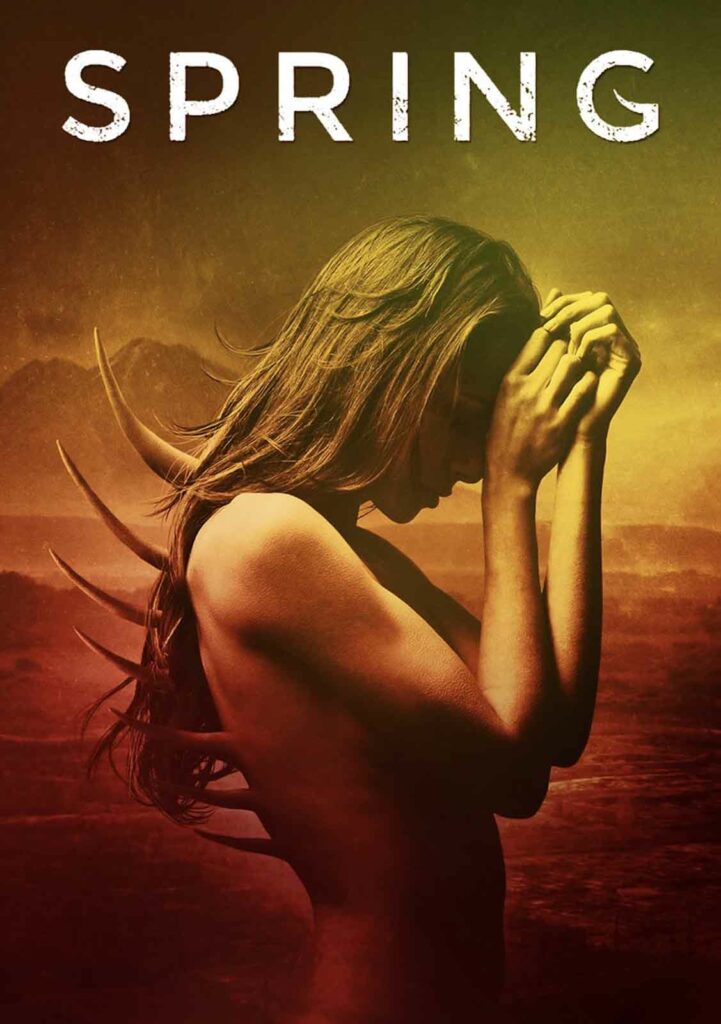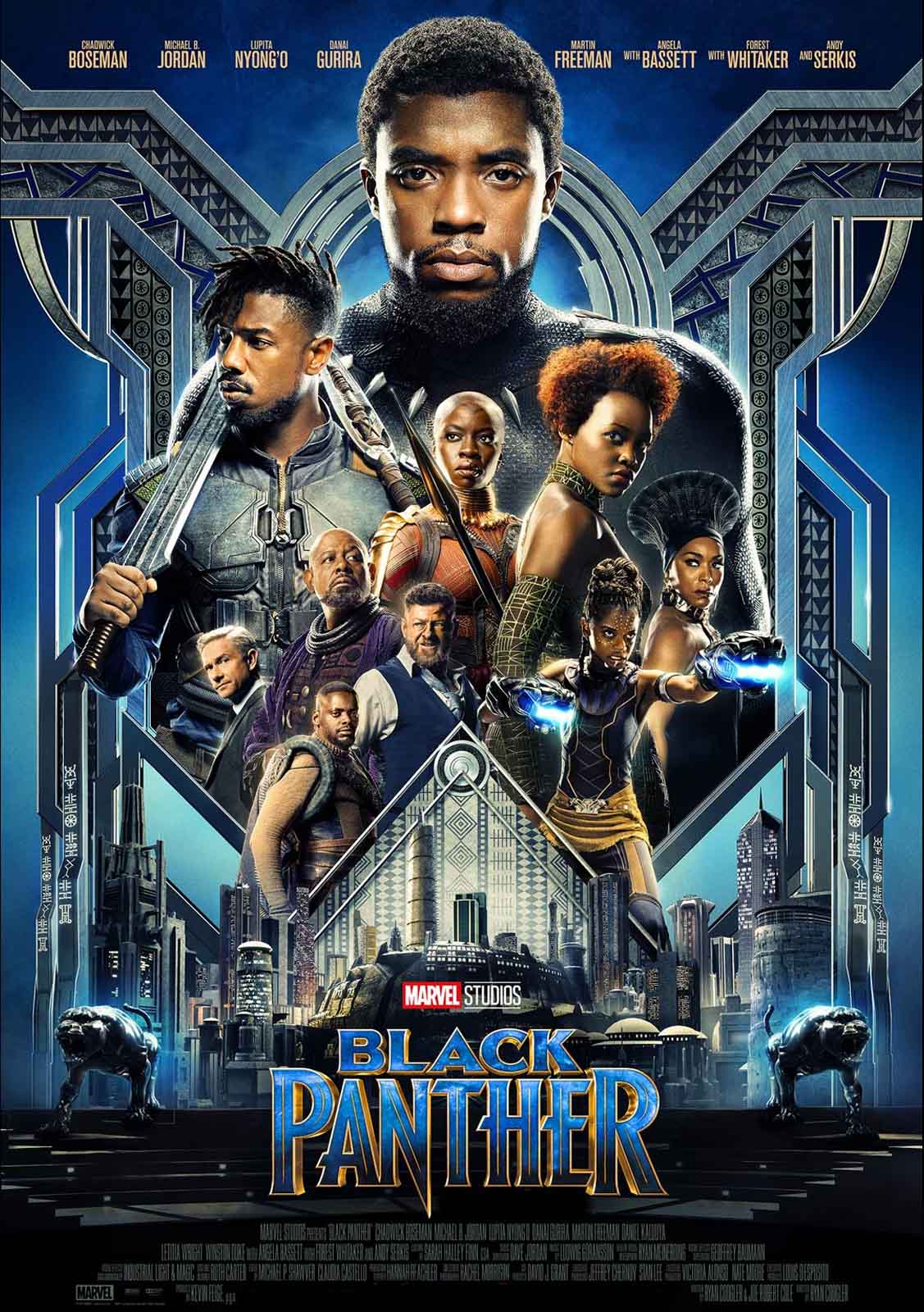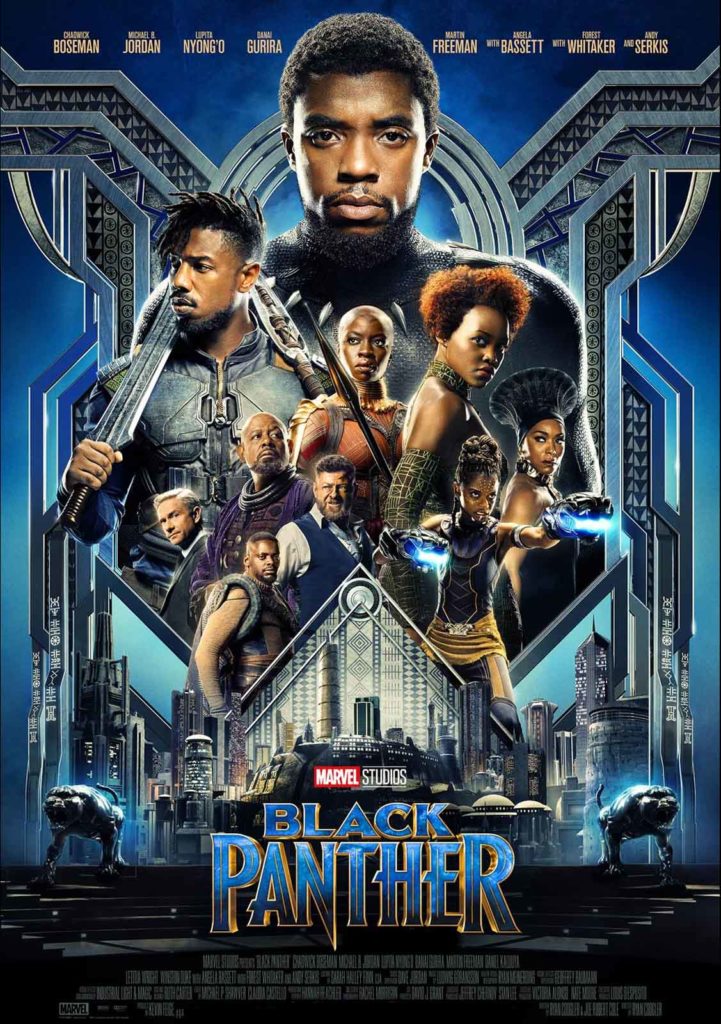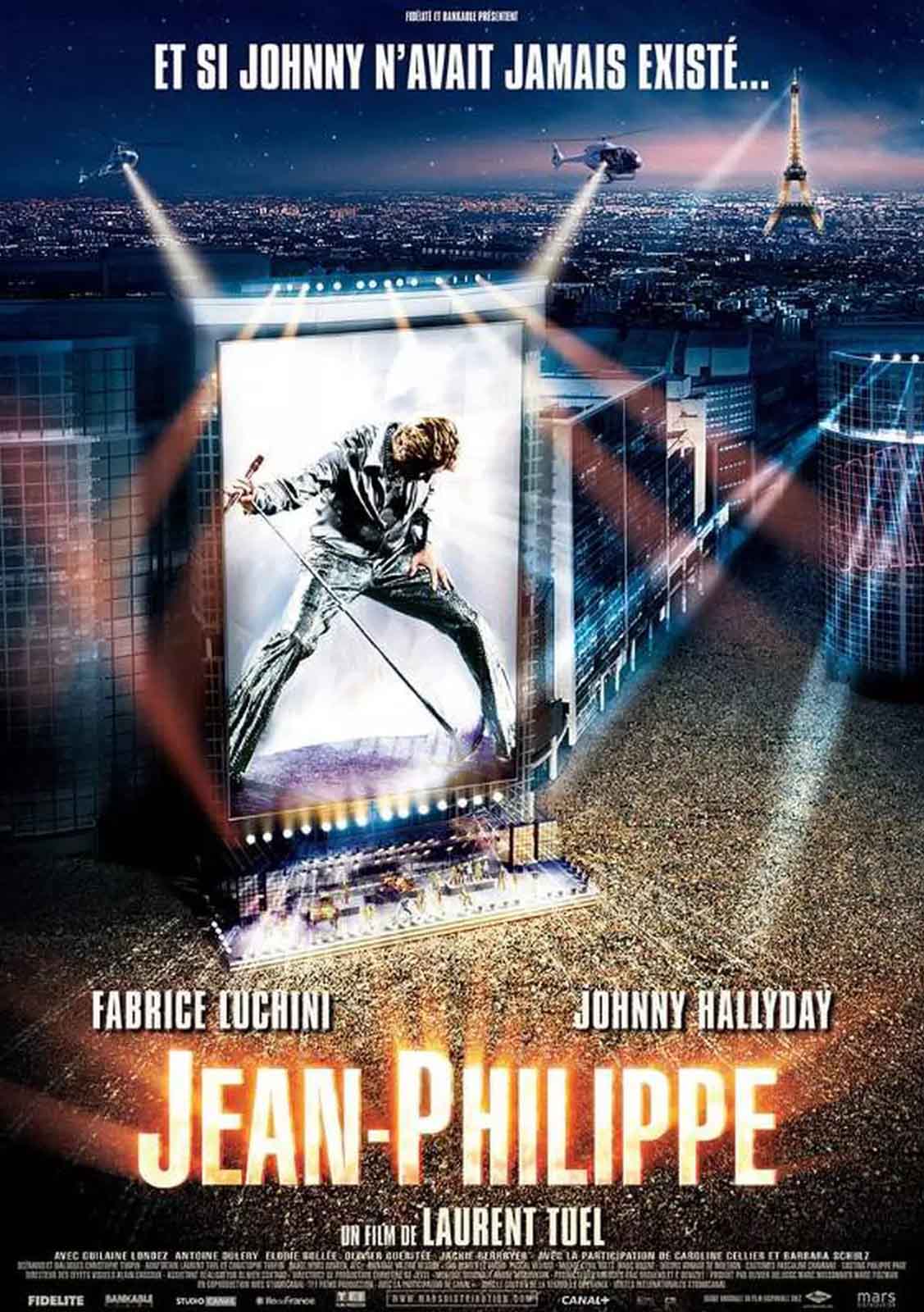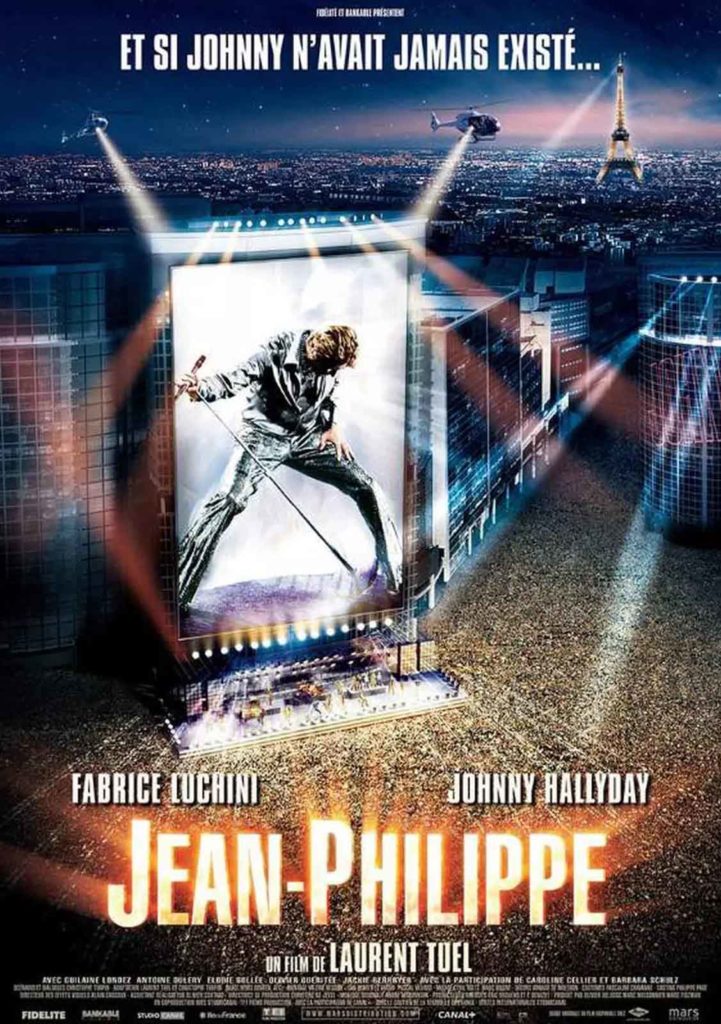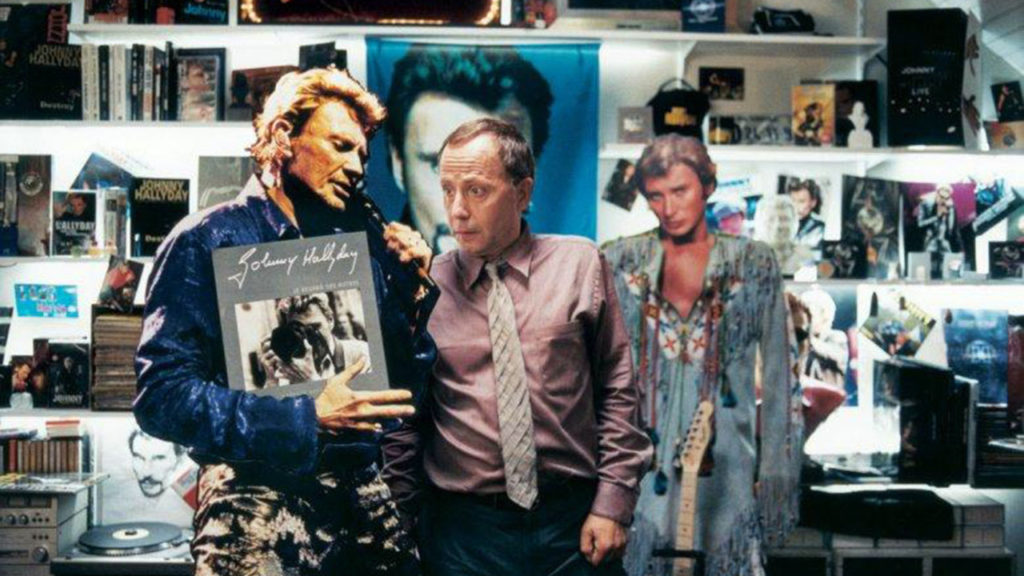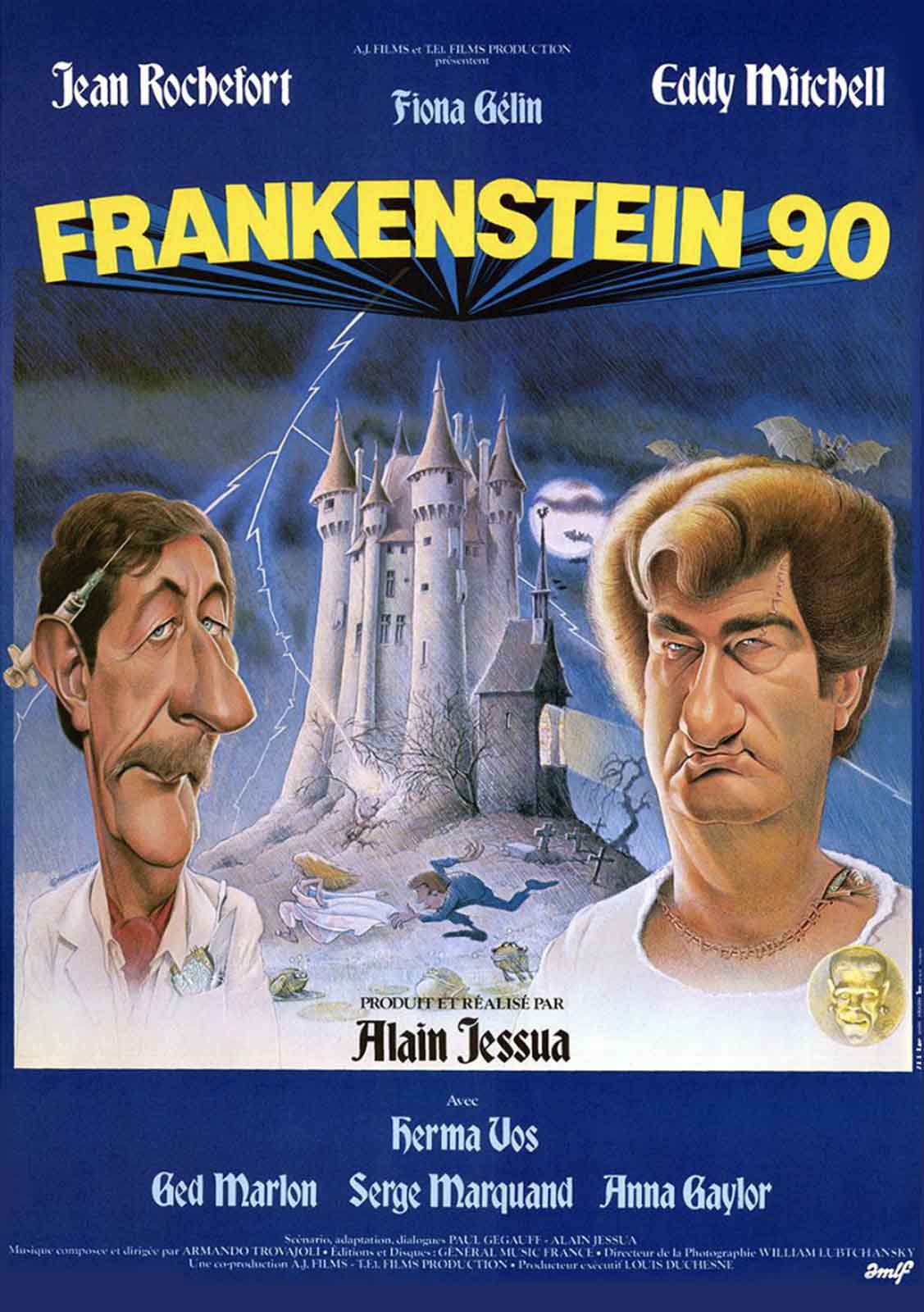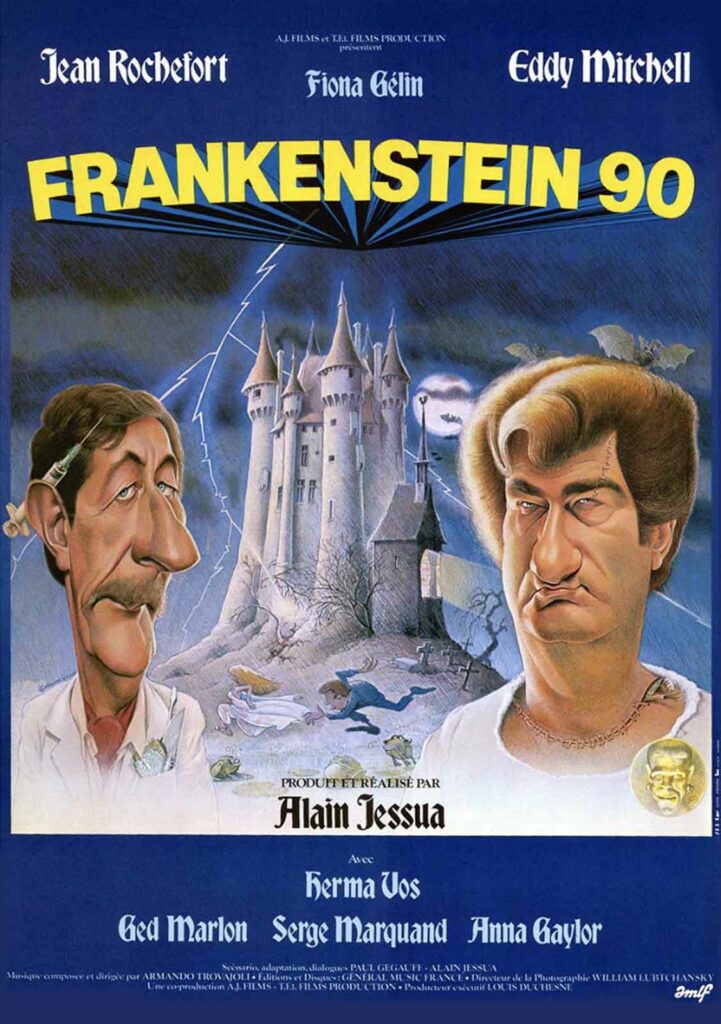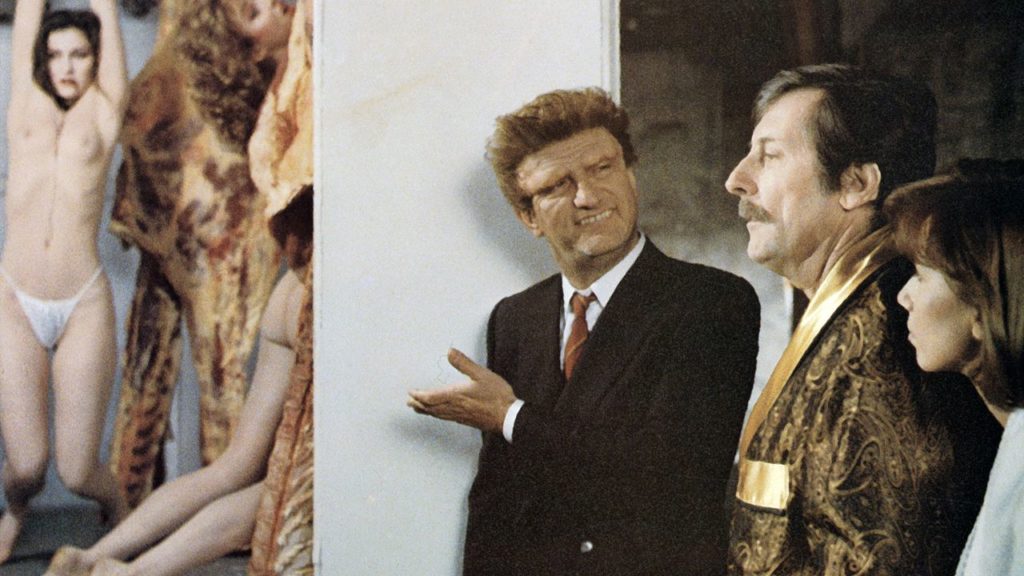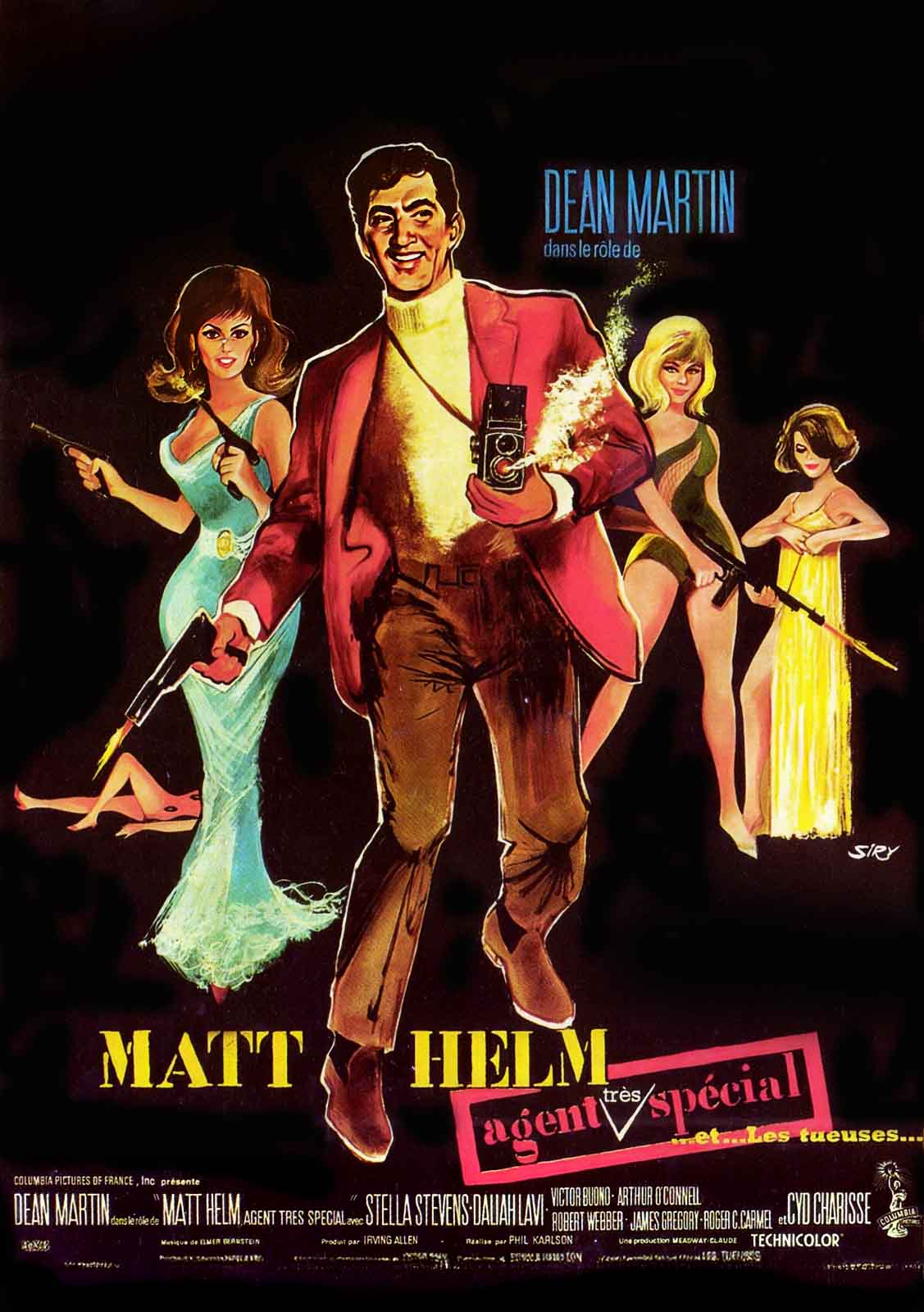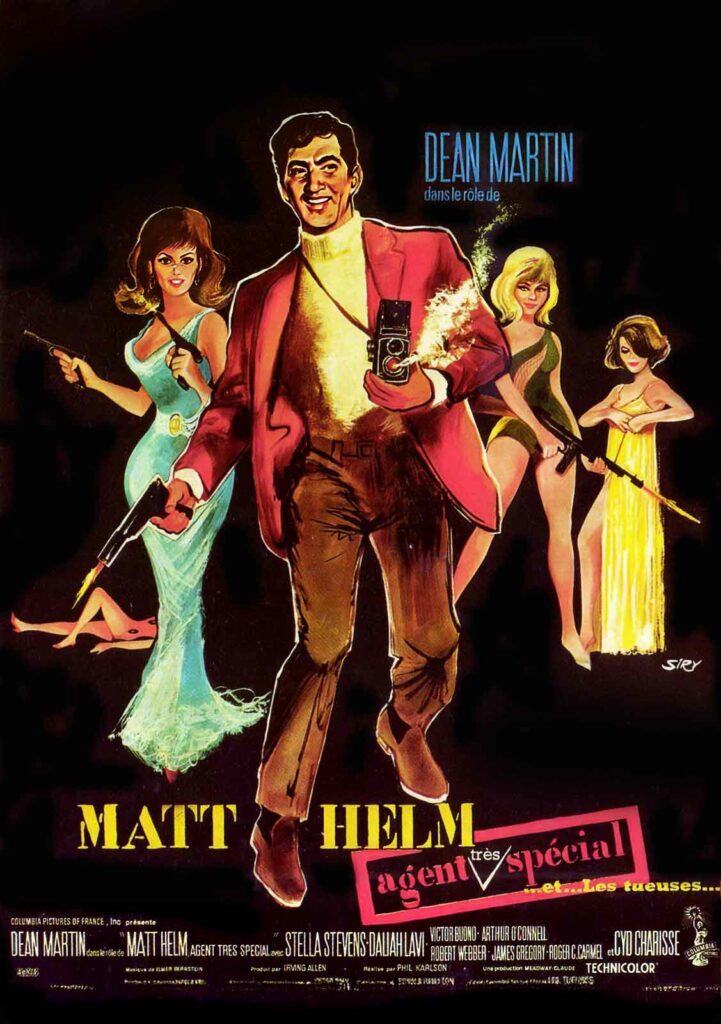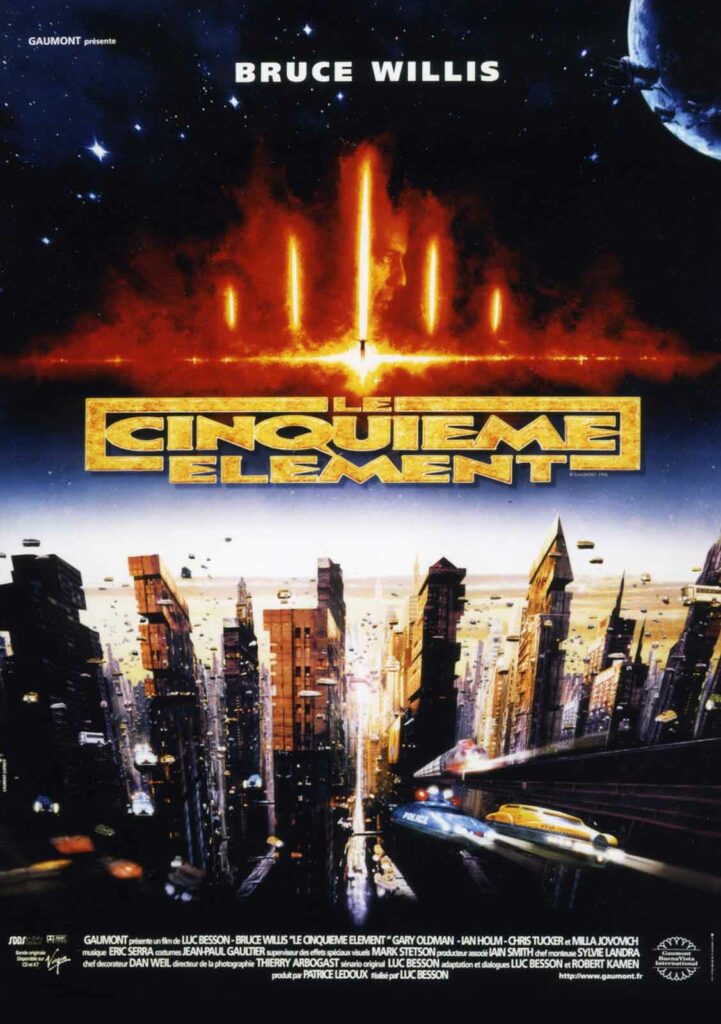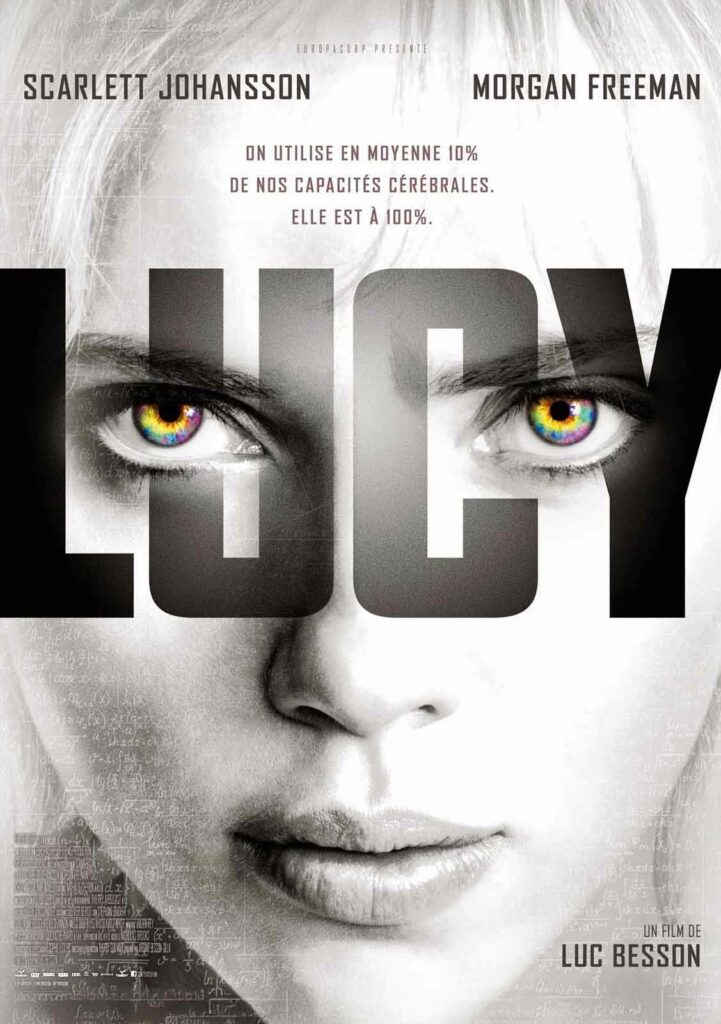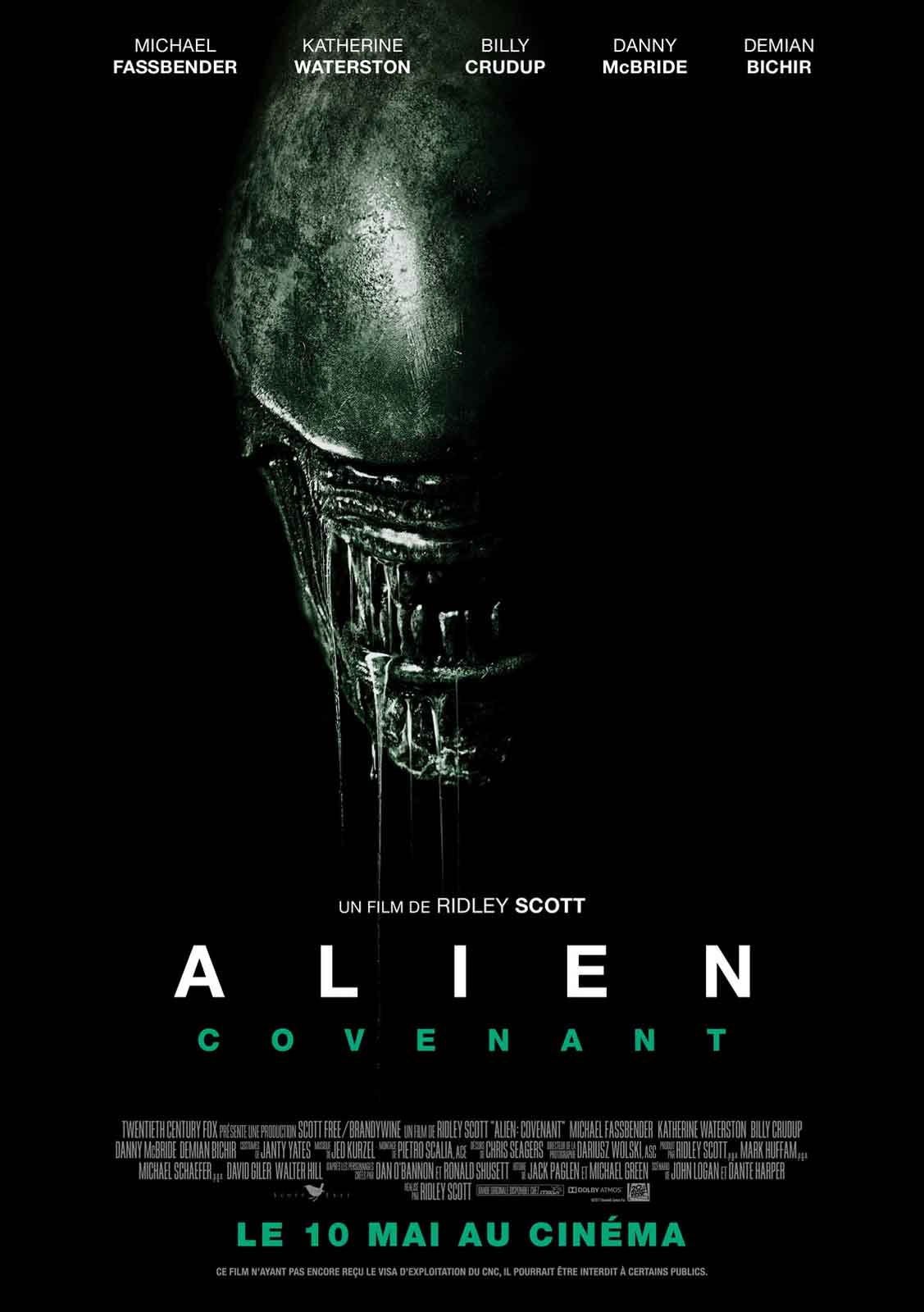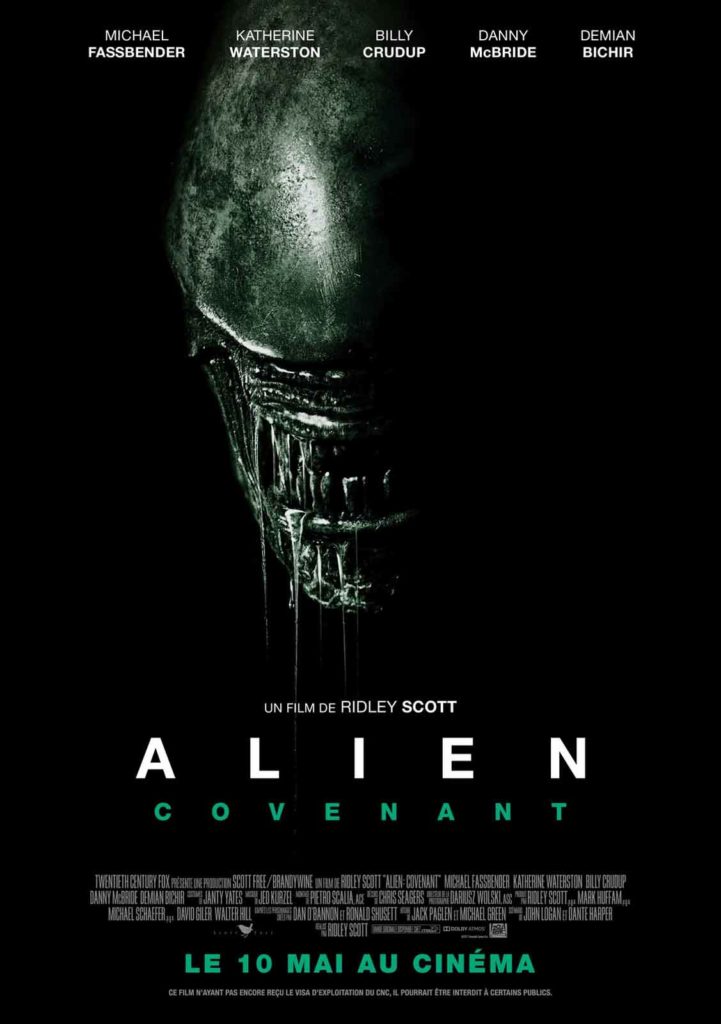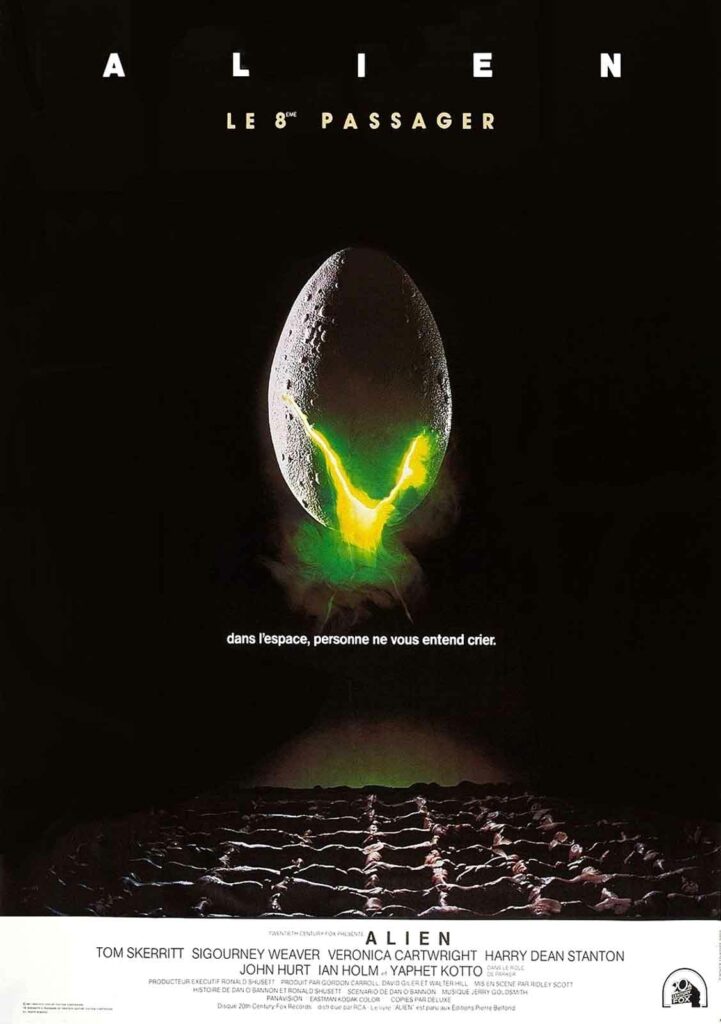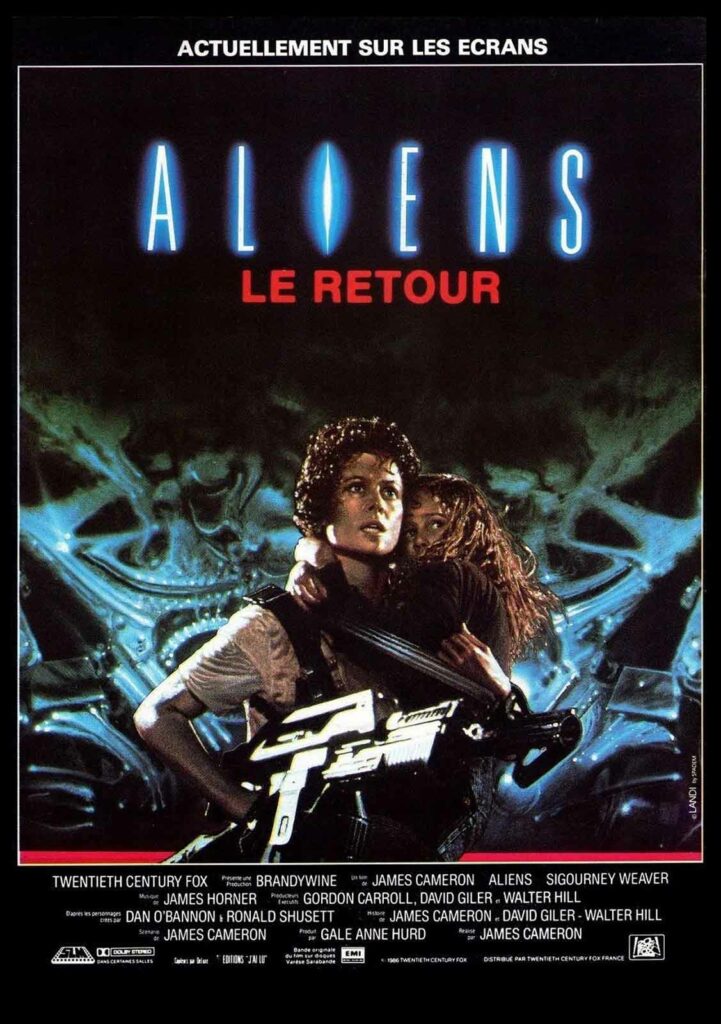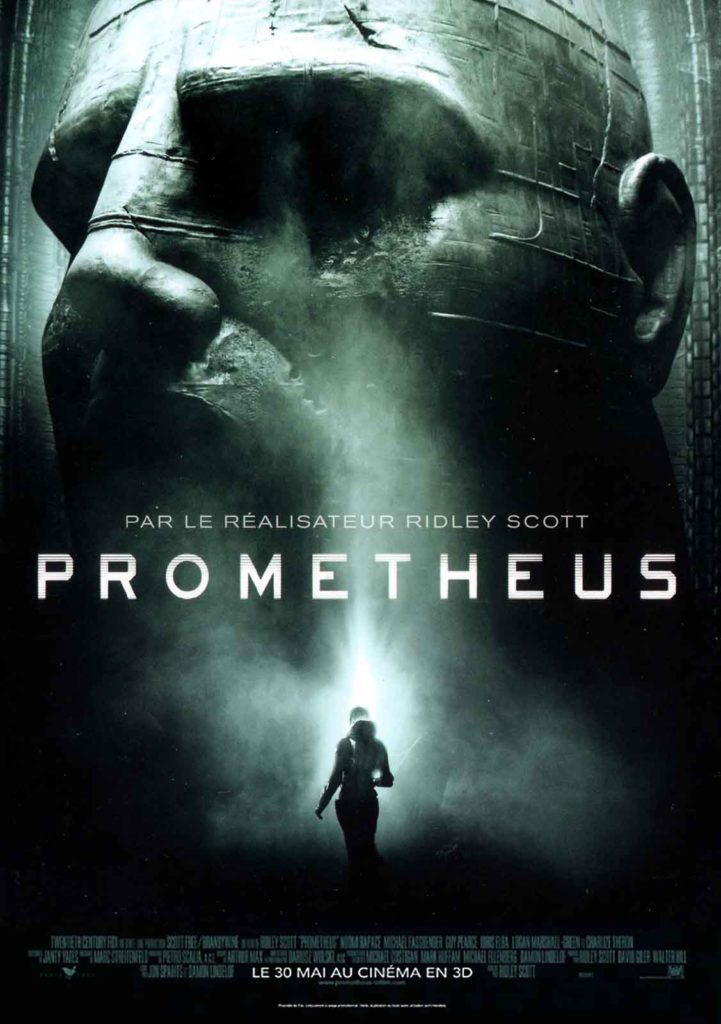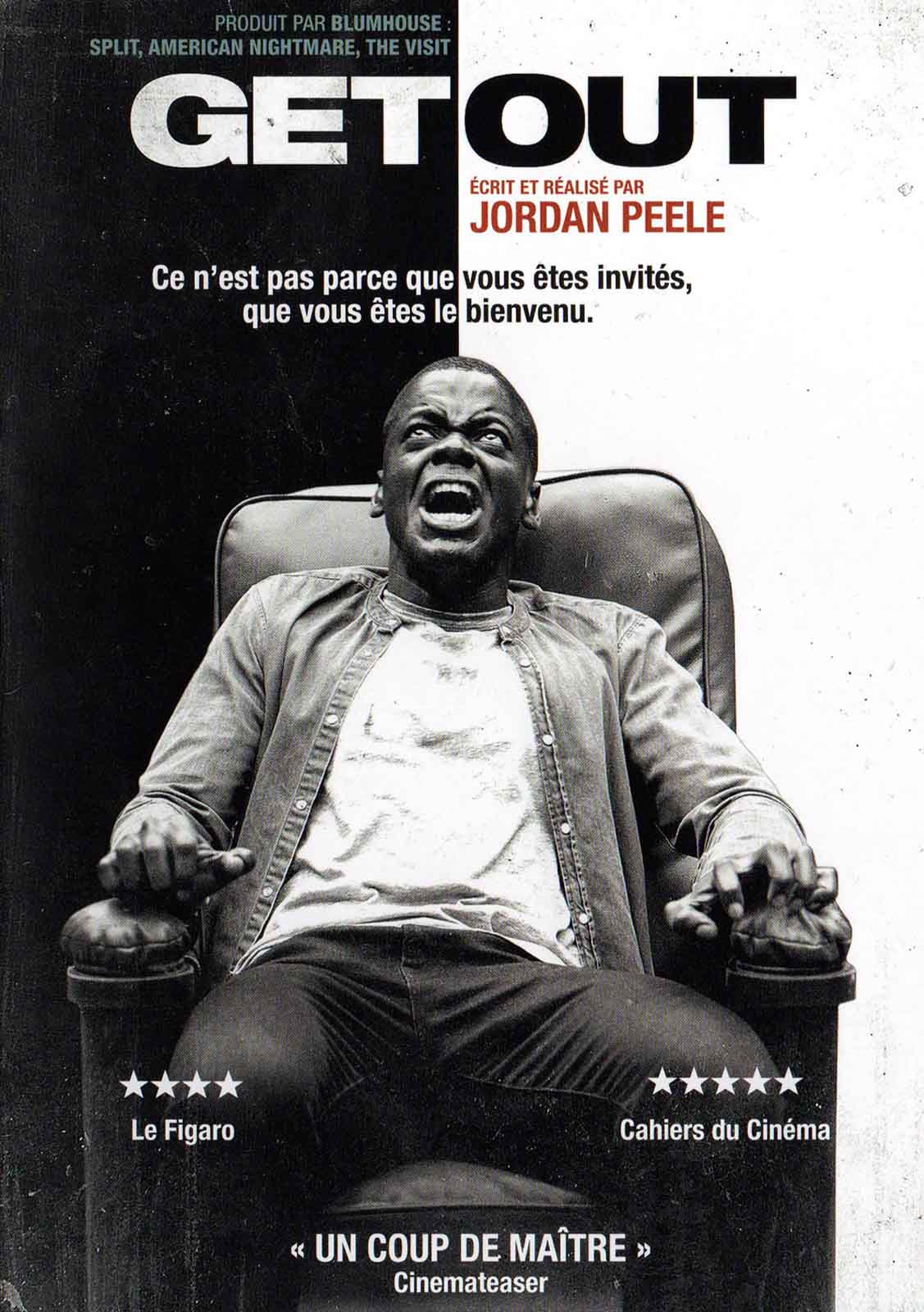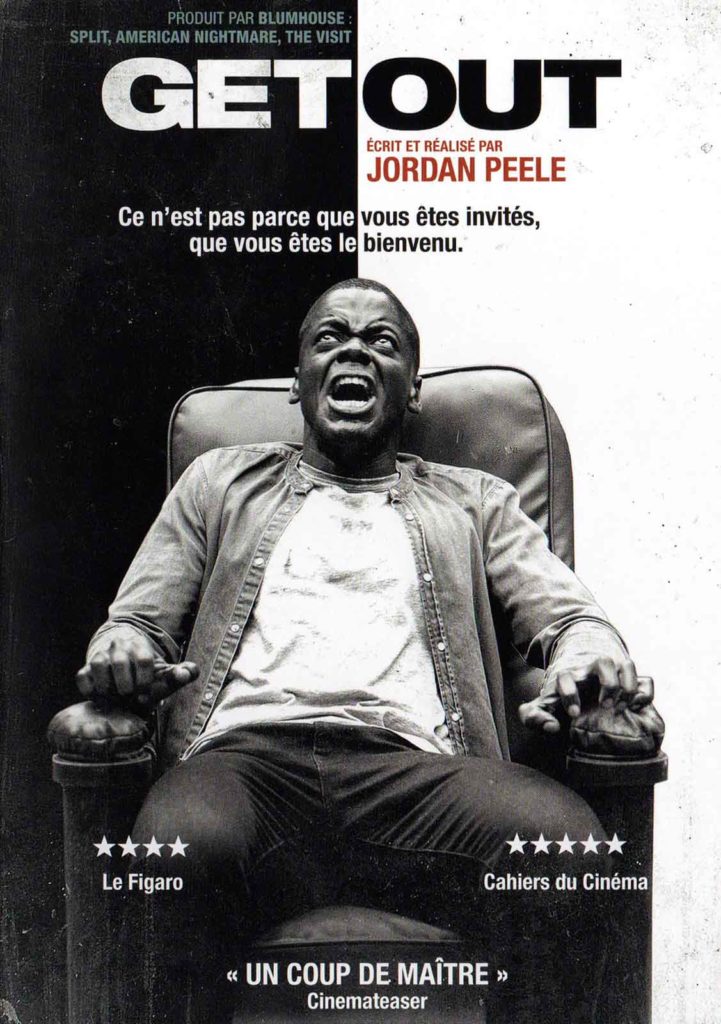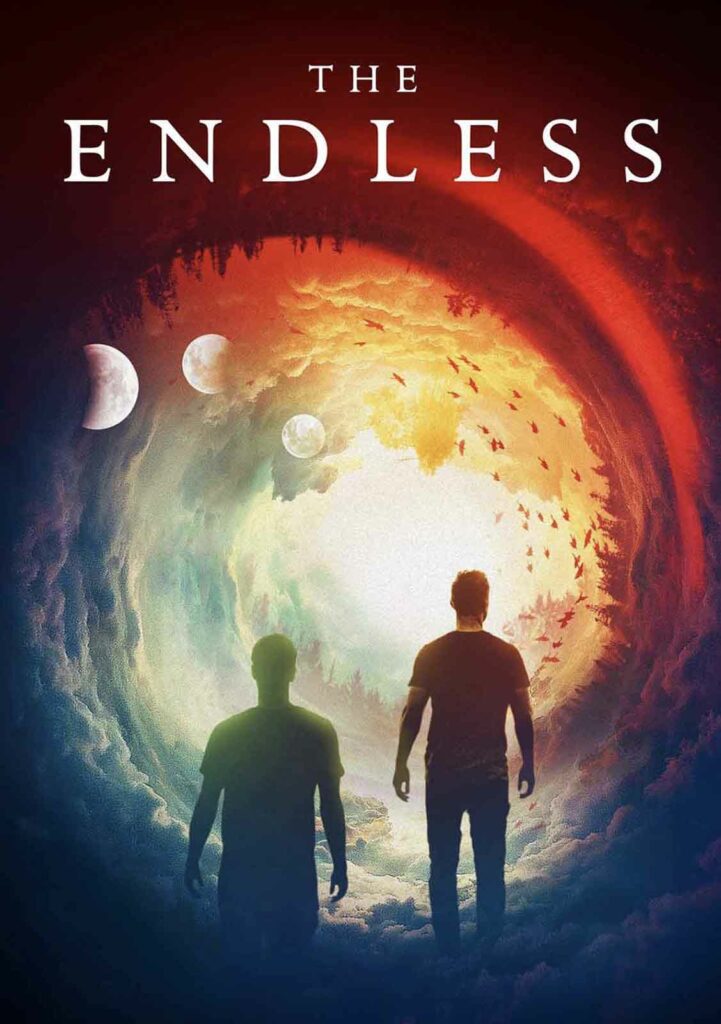
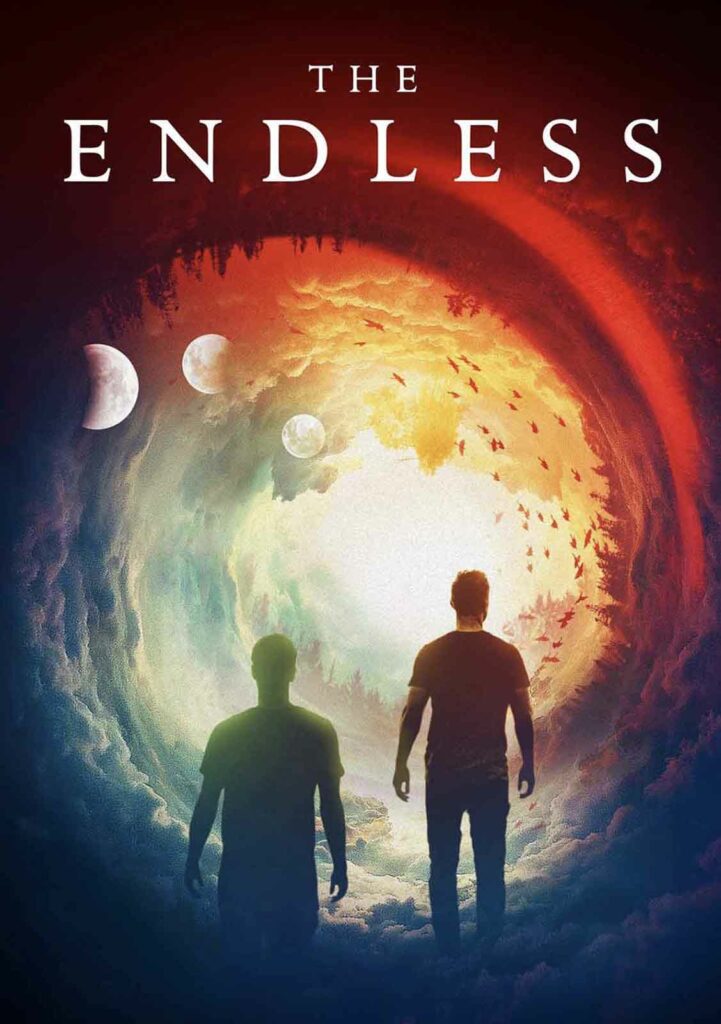
Aaron Moorhead et Justin Benson nous plongent dans l'intimité d'une secte qui semble adorer une entité lovecraftienne
THE ENDLESS
2017 – USA
Réalisé par Aaron Moorhead et Justin Benson
Avec Aaron Moorhead, Justin Benson, Leal Naim, Thomas R. Burke, David Clarke Lawson Jr
THEMA SORCELLERIE ET MAGIE I VOYAGES DANS LE TEMPS I LOVECRAFT
Depuis leurs débuts communs derrière la caméra, Aaron Moorhead et Justin Benson se sont révélés être deux cinéastes à suivre de très près. Rares exemples de réalisateurs ayant parfaitement réussi le mariage du cinéma indépendant à petit budget et du film de genre à mi-chemin entre l’horreur et la science-fiction, les duettistes sont en train de bâtir une filmographie passionnante. Leur premier long-métrage, Resolution, transformait une situation absurde et comique en huis-clos terrifiant. Après cette première réussite, ils enchaînaient sur Spring, une romance pleine de fraîcheur et de spontanéité basculant progressivement dans un fantastique pur imprégné des écrits de H.P. Lovecraft. Avec The Endless, ils continuent de creuser ce sillon singulier.


Le film s’intéresse à deux frères sans le sou recevant un jour une cassette vidéo qui émane visiblement de la secte où ils ont grandi et d’où ils se sont enfuis pour échapper à un suicide collectif. Or apparemment celui-ci n’a jamais eu lieu. Pleins de doutes, regrettant presque cette vie passée qui leur semblait plus harmonieuse que celle qu’ils connaissent actuellement, faite d’expédients et de petits boulots, ils décident de revenir sur place le temps d’une journée. Lorsqu’ils retrouvent la secte qui les avait jadis accueillis, rien ne semble avoir changé, du moins en apparence… Avec un budget toujours aussi anémique, Aaron Moorhead et Justin Benson réalisent des miracles en occupant quasiment tous les postes clés eux-mêmes, devant et derrière la caméra. The Endless est un film ambitieux, sensible, surprenant, parfois spectaculaire, gorgé d’idées de mise en scène étonnantes, et révélant sans la montrer totalement la présence d’une entité monstrueuse toute-puissante. « Notre film traite de l’inconnu et de l’acceptation de choses impalpables », explique Aaron Moorhead. « Or si vous voyez la créature, elle ne vous est plus inconnue. Elle a un corps et devient tangible. Même si vous faites appel aux meilleurs designers et aux meilleurs créateurs d’effets spéciaux, vous perdez cet aspect crucial du récit : le monstre est effrayant parce que sa nature exacte nous est inconnue. » (1)
Boucles temporelles vertigineuses
Le thème de la boucle temporelle s’installe dans le scénario jusqu’au vertige et – fait suffisamment rare pour être noté – échappe à toute redite au regard des nombreux films ayant par le passé abordé un thème similaire. « Nous nous sommes beaucoup questionnés sur la place de l’humain dans l’univers, et le fruit de ces interrogations a nourri l’écriture du scénario », explique Justin Benson. « Nous avons alimenté cette notion de boucle temporelle en essayant de gommer toutes les incohérences. » (2) Etonnamment, The Endless se révèle en cours de route être une sorte de crossover de Resolution, les deux films se rencontrant le temps d’une séquence déstabilisante qui sera malgré tout parfaitement compréhensible pour ceux qui ne connaissent pas le premier long-métrage de Moorhread et Benson. Au-delà de sa mécanique science-fictionnelle, The Endless s’attache à brosser une relation fraternelle fragile et touchante, portée par le jeu subtil et tout en retenue de deux réalisateurs aux talents décidément multiples.
(1) et (2) Propos recueillis par votre serviteur en septembre 2017
© Gilles Penso
Partagez cet article
Partagez cet article