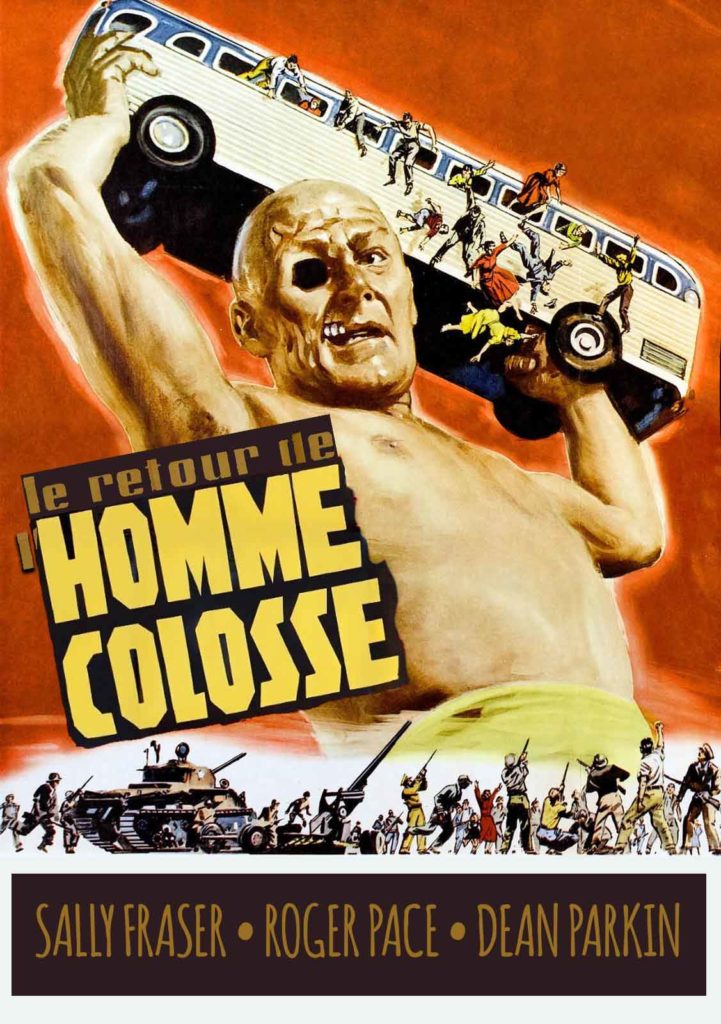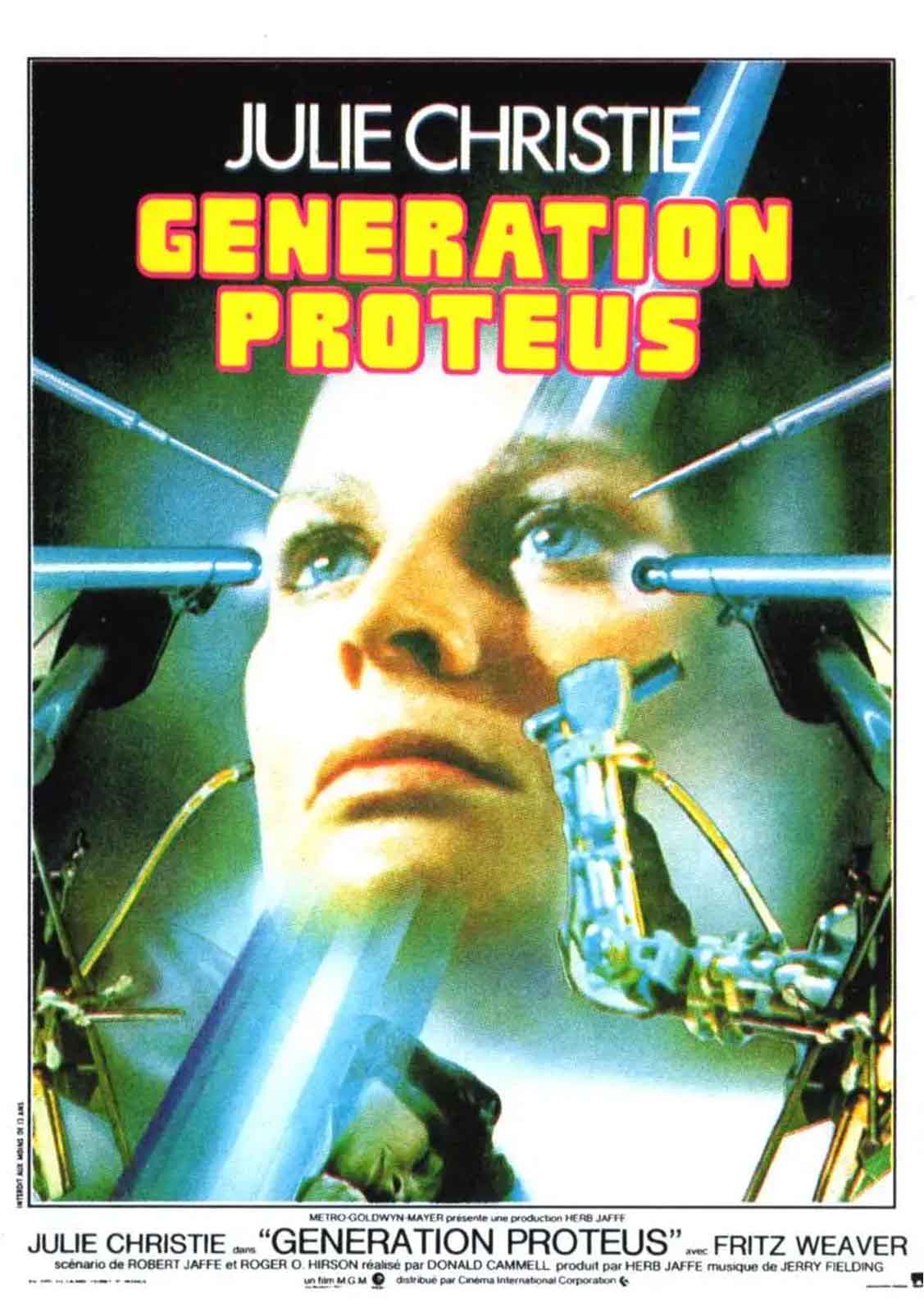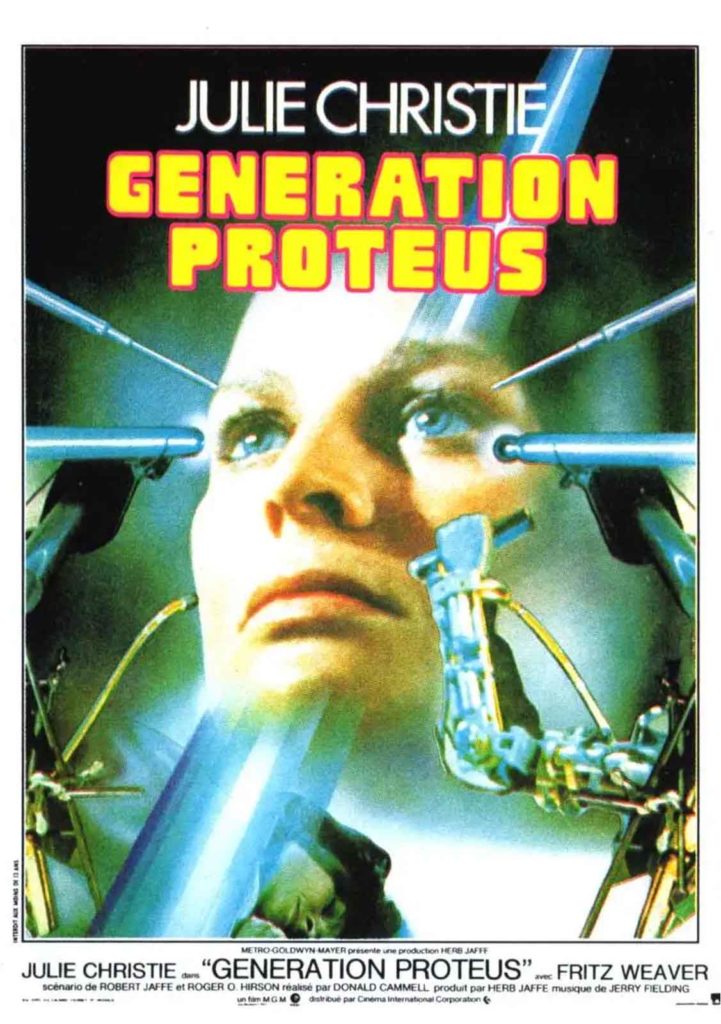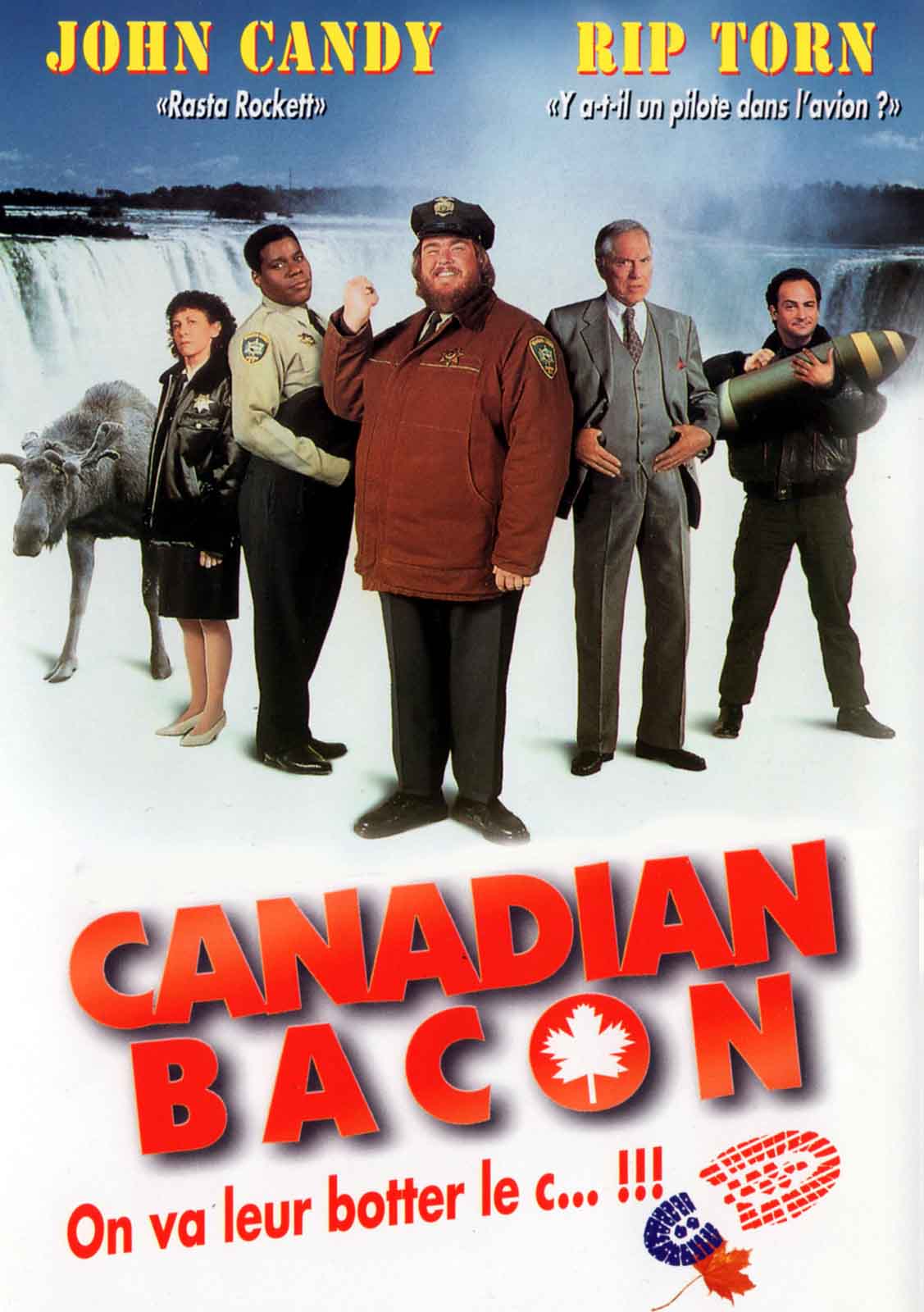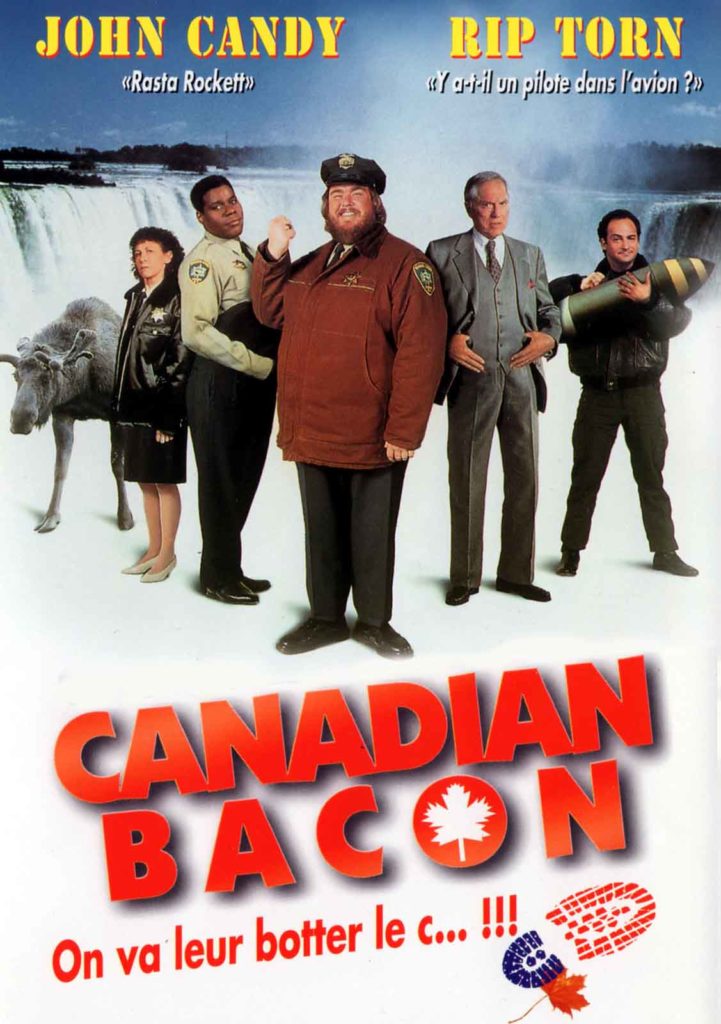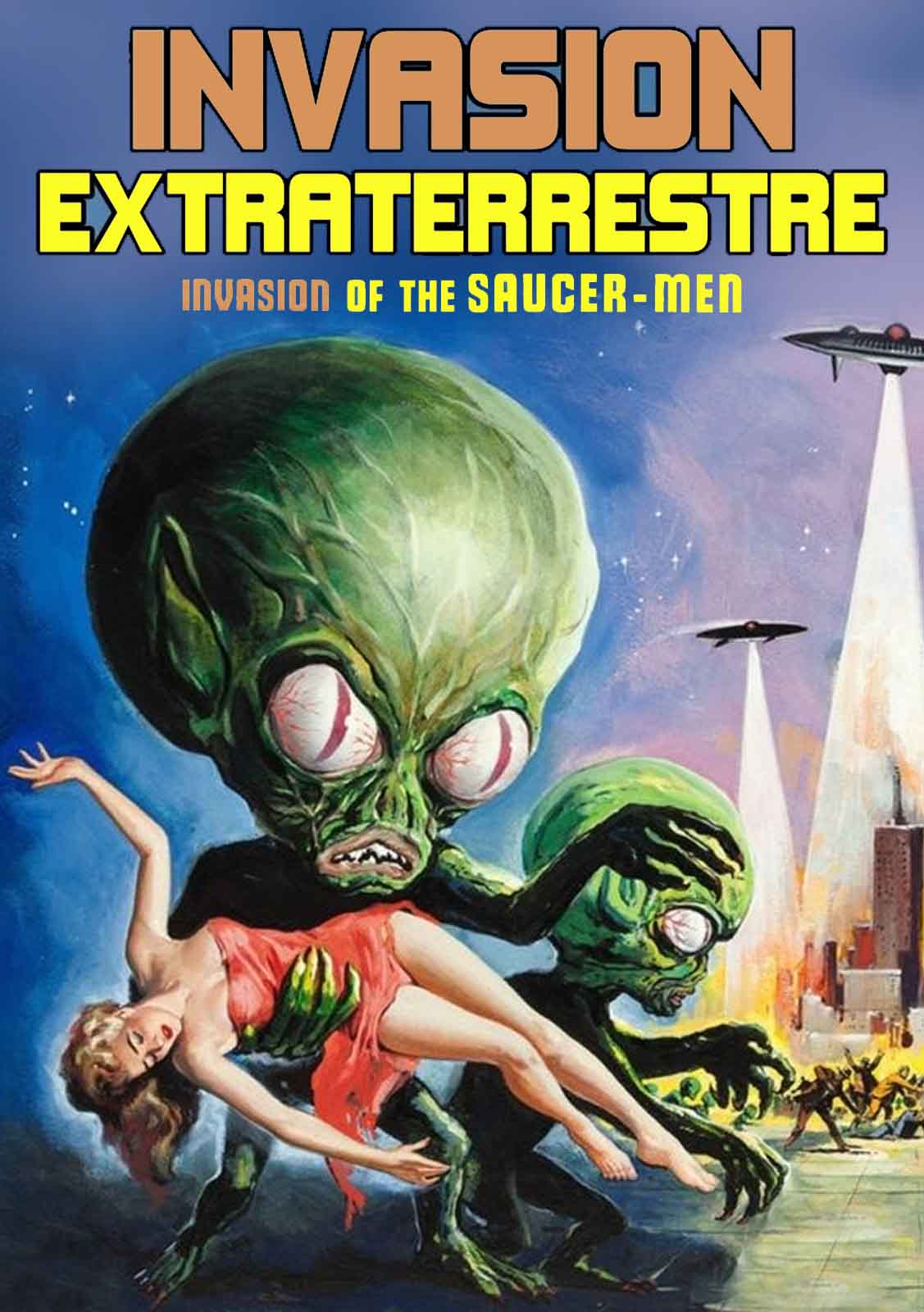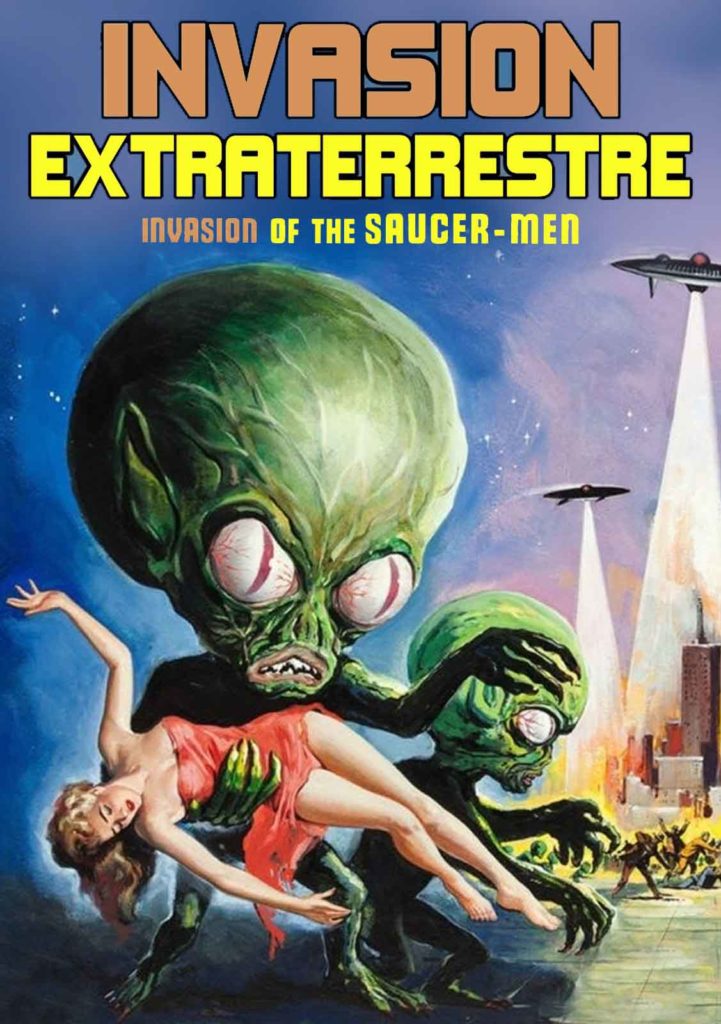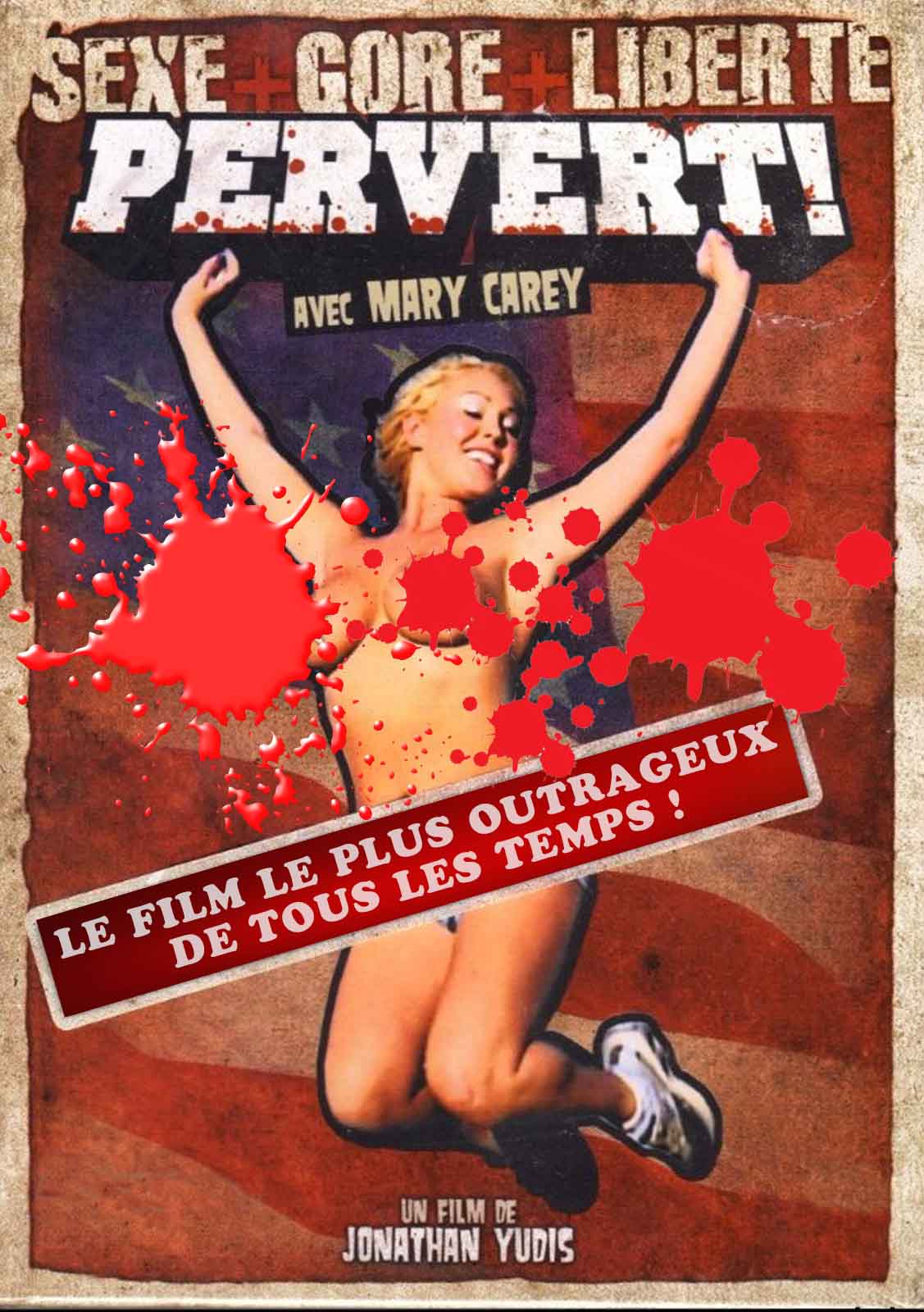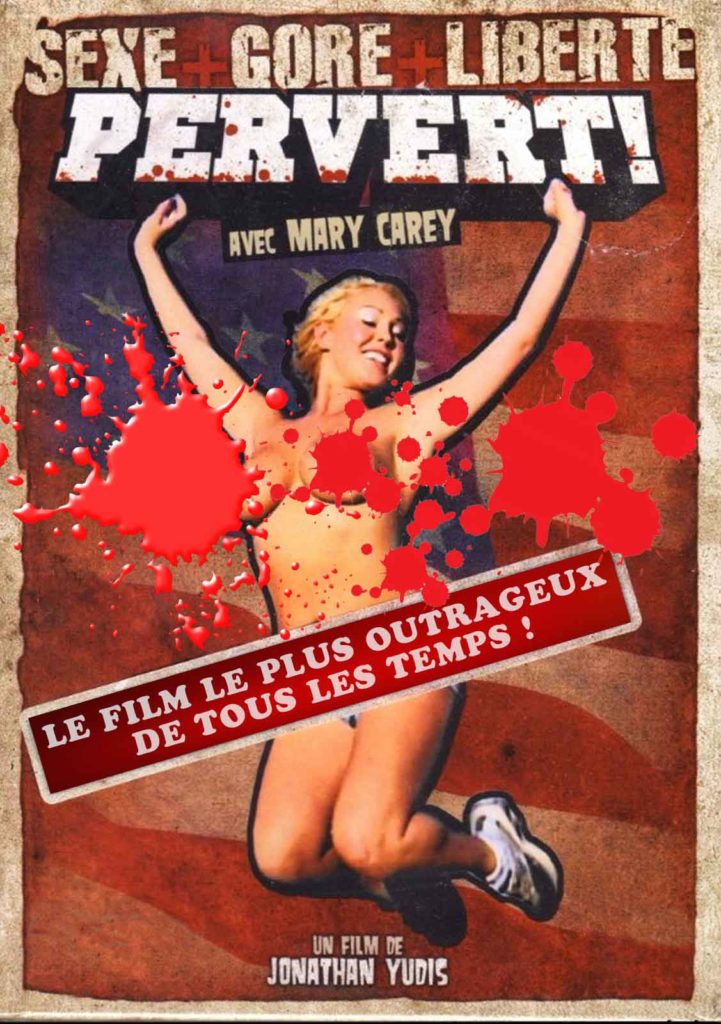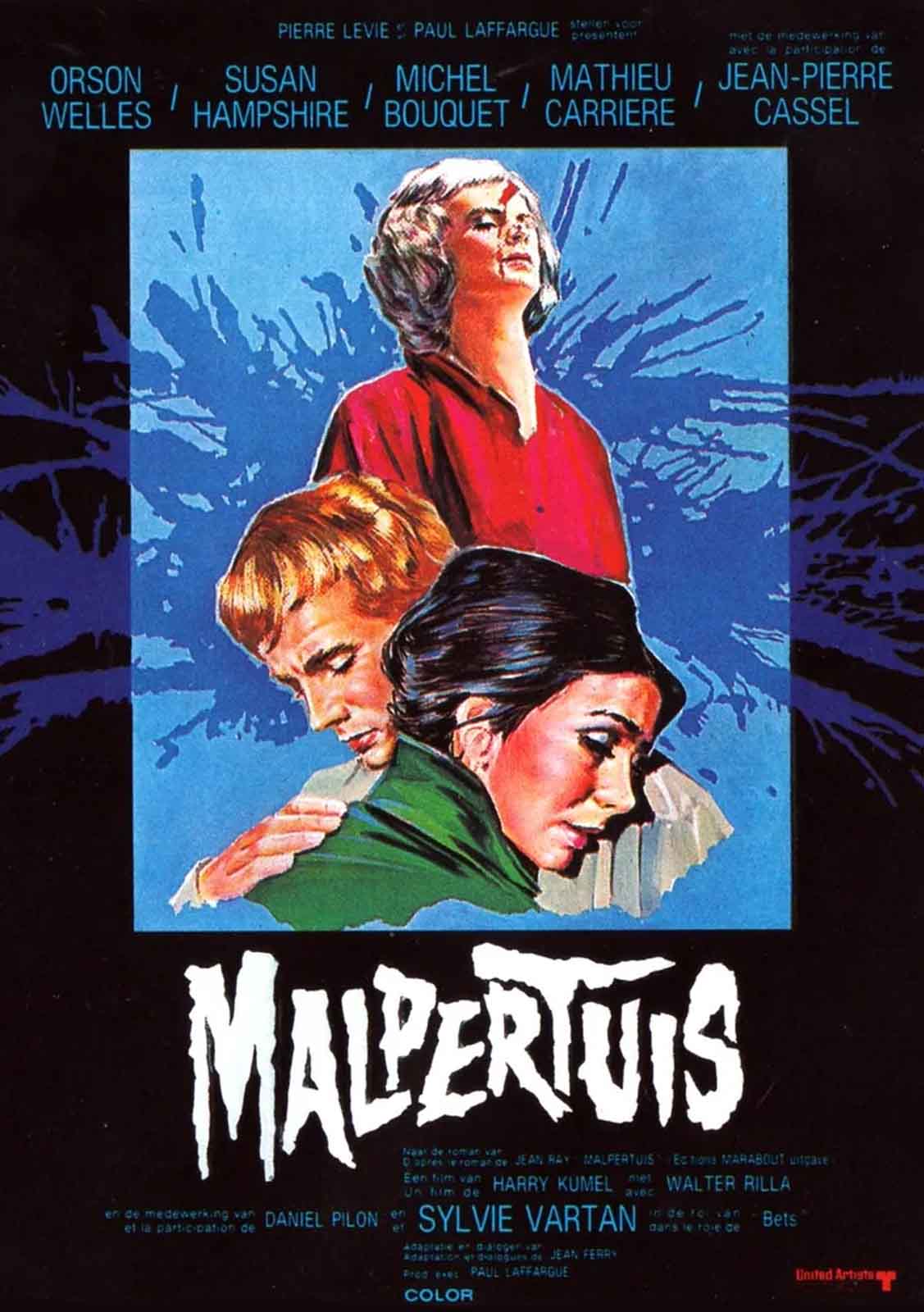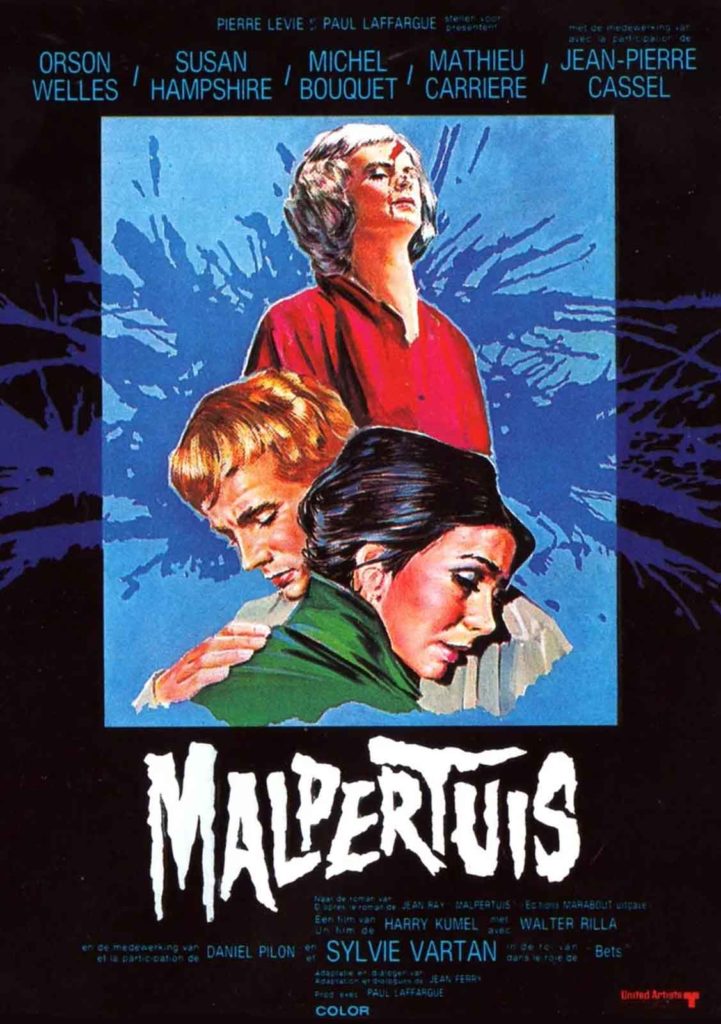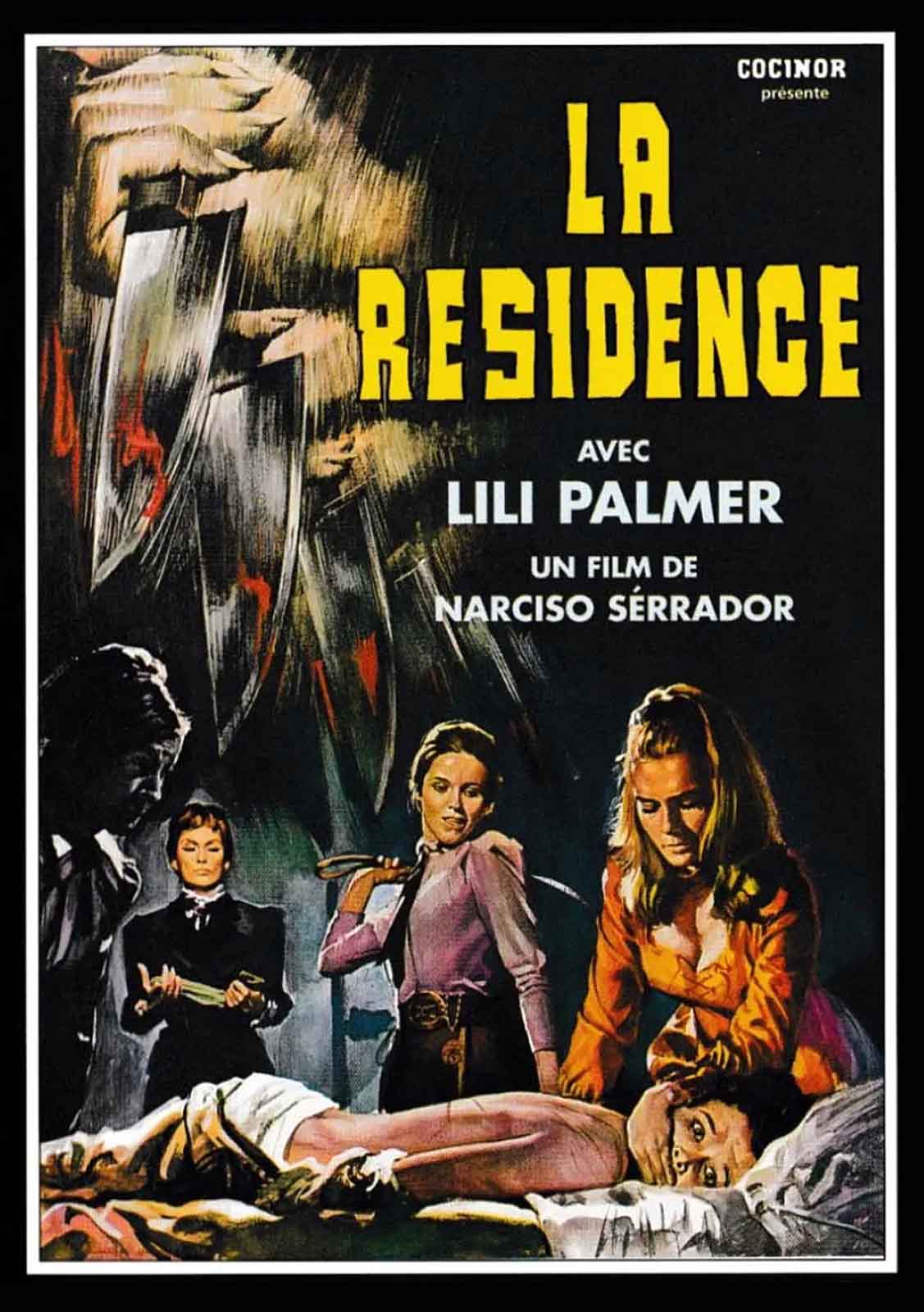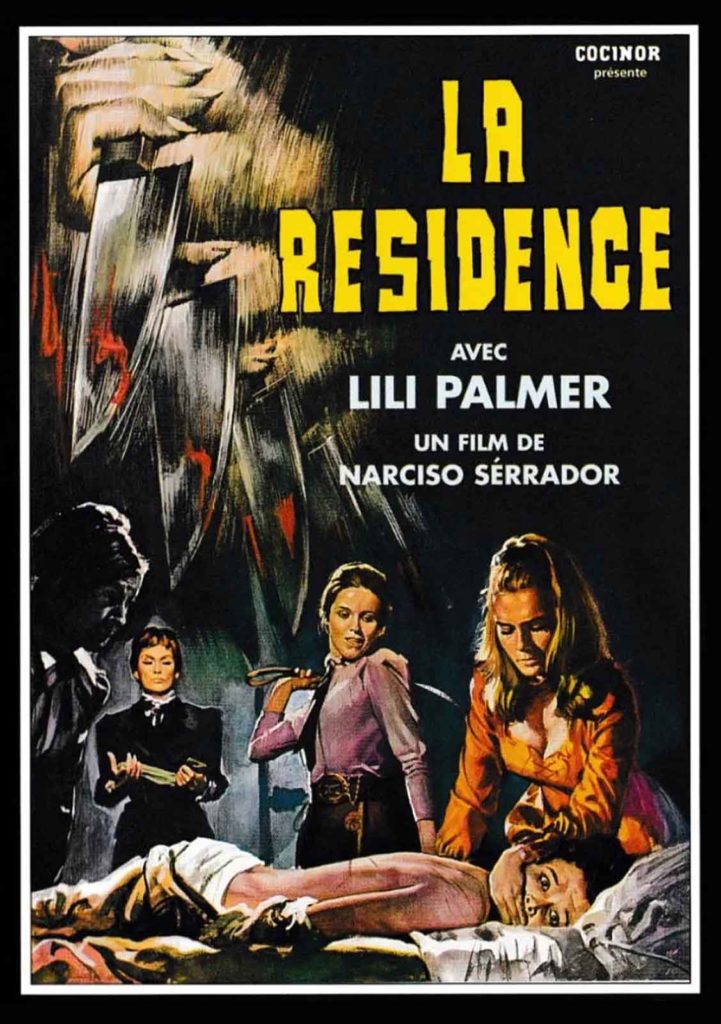Une jeune roboticienne surdouée crée un nouveau modèle de jouet évolutif qui va bientôt échapper à tout contrôle…
James Wan ne manque pas d’idées. L’homme à l’origine des sagas Saw, Conjuring et Insidious ne rate jamais une occasion de décliner les thématiques phares de son genre favori : l’horreur. Tôt ou tard, il allait s’attaquer au motif du jouet maléfique. Certes, la trilogie Annabelle, dérivée du premier Conjuring, abordait déjà frontalement le sujet. Mais avec M3gan, il souhaite coupler la figure de la vilaine poupée à celle du robot tueur, avec en filigrane une réflexion sur les dérives de notre rapport à la technologie. Pour donner corps à cette envie, Wan et son coproducteur Jason Blum s’appuient sur la plume d’Akela Cooper (scénariste des séries American Horror History, Luke Cage et Star Trek : Strange New Worlds, mais aussi du long-métrage Malignant). Pour la mise en scène, le nom de Gerard Johnstone s’impose assez rapidement. La comédie d’horreur Housebound qu’il a signée en 2014 a tapé dans l’œil de Wan qui voit chez lui l’homme de la situation, capable de trouver l’équilibre entre les frissons, l’humour noir et l’émotion. Le film est budgété à 12 millions de dollars. Il en rapportera dix fois plus. Décidément, James Wan est une véritable poule aux œufs d’or !


M3gan est le diminutif de « Modèle 3 Générateur d’Androïde ». Cette poupée d’un mètre 24 de haut, faite de silicone et de circuits électroniques, est la dernière trouvaille de Gemma (Allison Williams), géniale roboticienne qui travaille pour la puissante compagnie de jouets Funki, toujours en quête de la dernière trouvaille qui ravira les enfants et remplira les tiroirs caisses. Le patron de Gemma, David Lin (Ronny Chieng), voit ce prototype d’un mauvais œil et préfèrerait qu’elle se concentre sur les jouets rigolos évolutifs dont raffolent les petites filles. En voyant les capacités étonnantes de M3gan, il se ravise. Cette invention est révolutionnaire. Mais son intelligence artificielle n’est-elle pas susceptible d’échapper à tout contrôle ? La réponse est oui, bien sûr, dans la mesure où le scénario reprend logiquement à son compte la mécanique narrative des mésaventures de Frankenstein, le plus célèbre des apprentis-sorciers. La gentille poupée va se révéler le plus terrifiant des monstres, prenant corps à l’écran grâce aux performances combinées de l’actrice Amie Donald, des créations animatroniques du studio Morot FX et des effets numériques supervisés par Weta Digital. Le résultat est bluffant.
Terminatoy
M3gan prend le temps nécessaire pour nous présenter ses deux personnages centraux et leur état émotionnel : Cady, la fillette soudain orpheline, et Gemma, sa jeune tante s’improvisant maladroitement famille d’accueil. Sans précipitation et avec une subtilité qui s’attache aux détails, le film aborde la gestion du deuil mais aussi l’équilibrage délicat entre une vie professionnelle passionnante et une vie personnelle soudain complexifiée. Lorsque M3gan entre en piste, ce n’est pas seulement pour s’annoncer comme une émule féminine de Chucky ou pour saisir l’opportunité de discourir sur les dérives possibles de l’intelligence artificielle (bien que ces deux éléments soient majeurs dans la progression du film et dans ses futurs rebondissements), mais surtout pour tirer la sonnette d’alarme sur la propension des humains à déléguer aux machines leurs propres responsabilités. Car ce qui préside à la création et au lancement de cet androïde ludique est avant tout l’incapacité – ou la non-volonté – pour Gemma de s’occuper de sa nièce à temps plein. En voulant faire de M3gan une quasi-mère de substitution, elle amorce involontairement le drame. Contrairement à Chucky, la poupée robotique n’est pas intrinsèquement maléfique mais agit selon ce qui lui semble le plus approprié. En ce sens, nous sommes plus proches d’Isaac Asimov que de Don Mancini. La force du design de ce jouet intelligent repose sur la balance habile entre l’artificialité et le mimétisme humain. L’anthropomorphisme se pare ici d’une couche d’irréalisme suffisamment marquée (le visage sans émotion, les grands yeux fixes) pour susciter le malaise. Inévitablement, les mécanismes d’une épouvante plus classique, hérités de Jeu d’enfant et de ses suites, se mettent en œuvre au cours du troisième acte, reposant sur des effets efficaces mais connus. Le climax va sans doute trop loin dans sa volonté de satisfaire les spectateurs et leur envie légitime d’un affrontement musclé et spectaculaire. La subtilité s’évapore donc au moment du final, sans pour autant atténuer l’impact du film et les passionnantes ramifications de son scénario.
© Gilles Penso
Partagez cet article