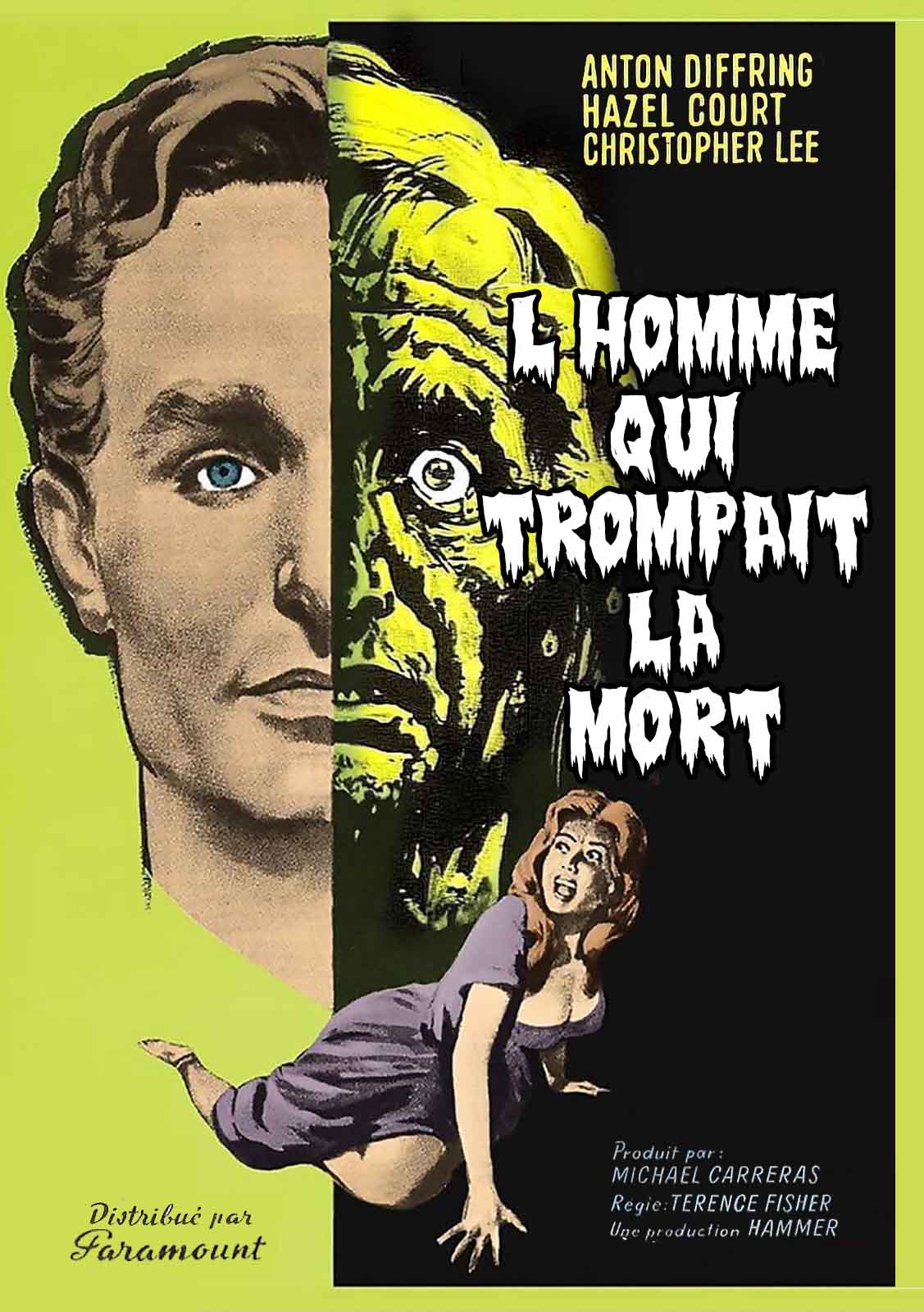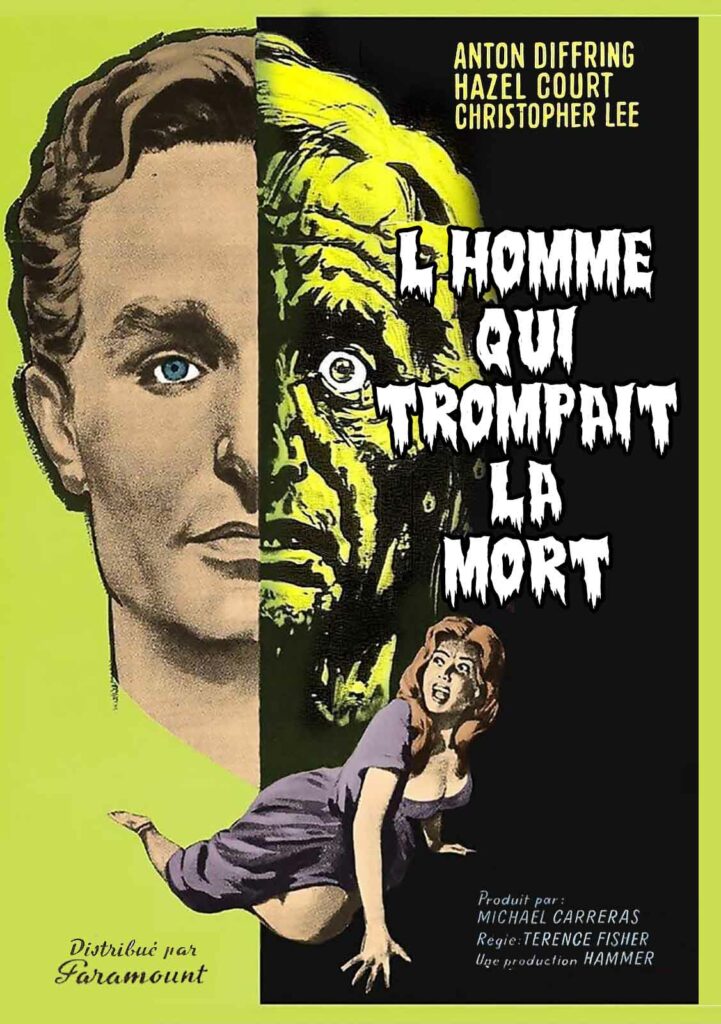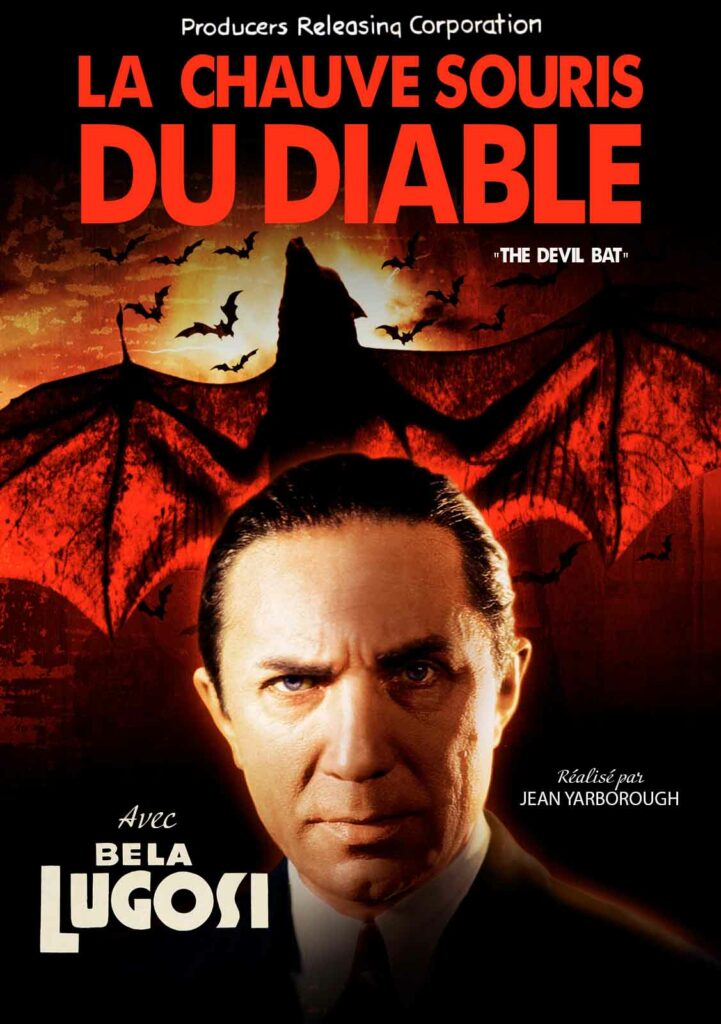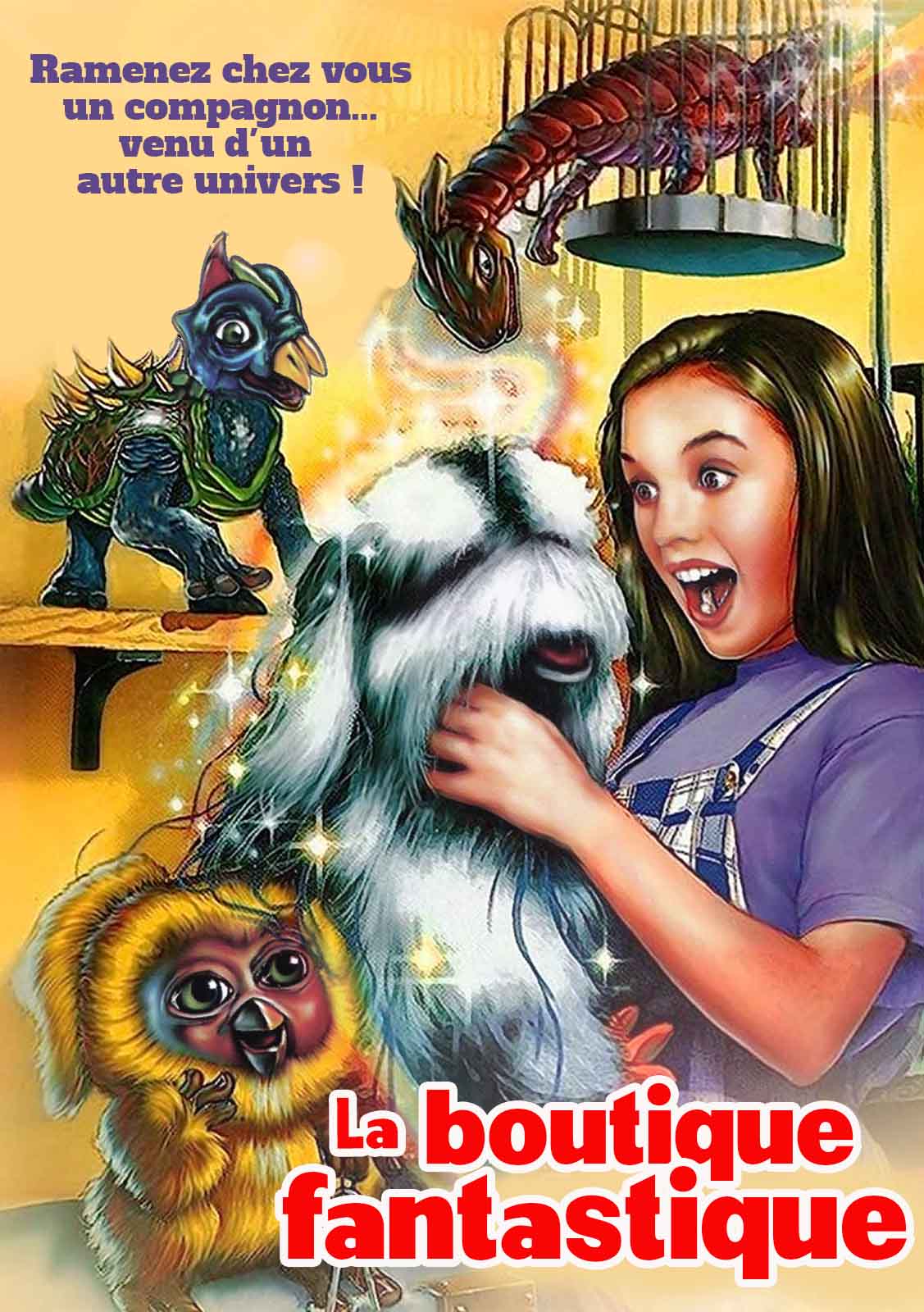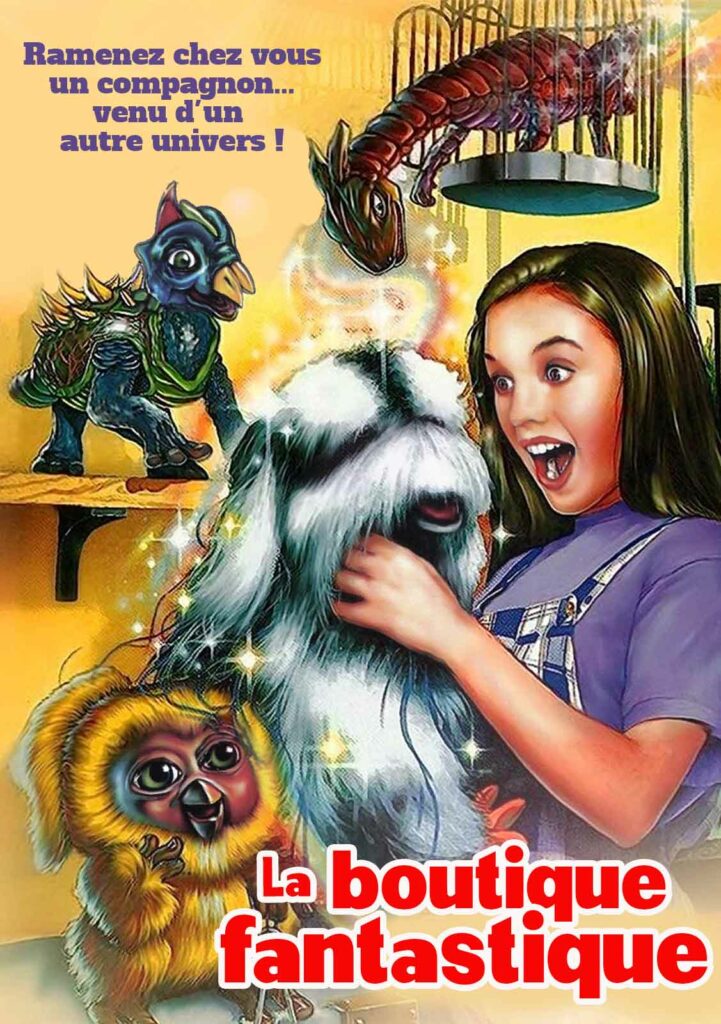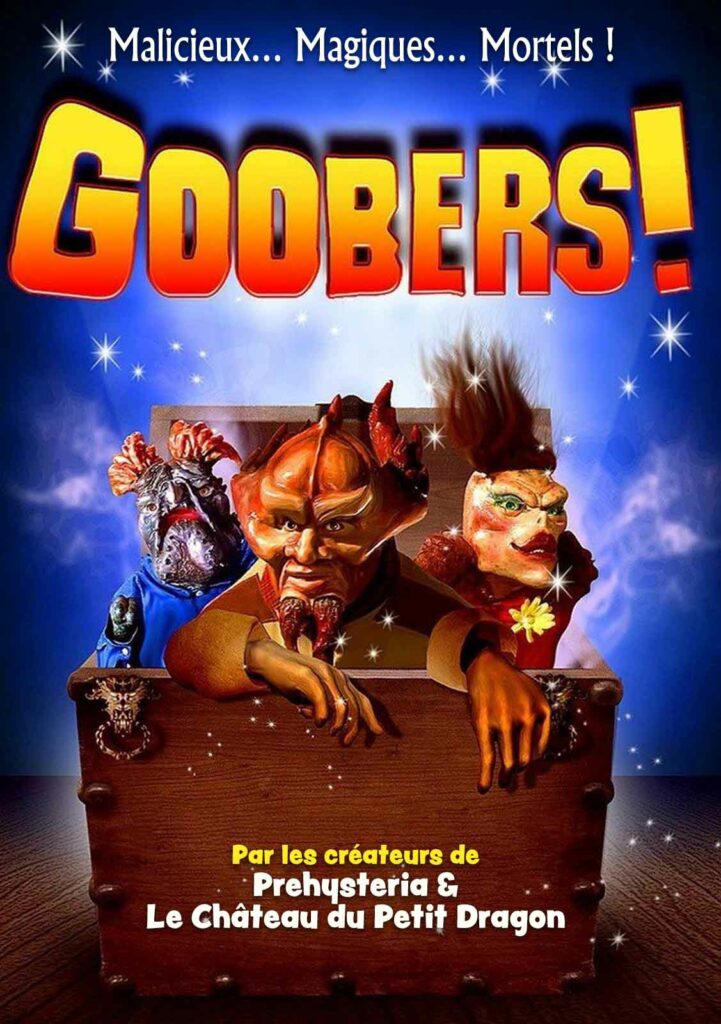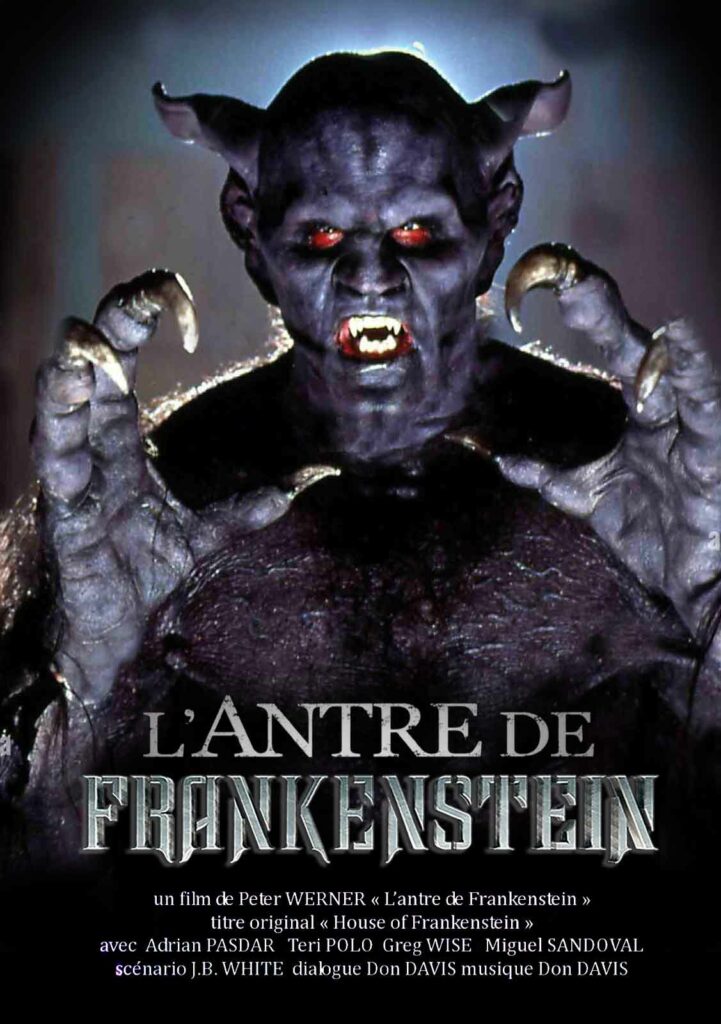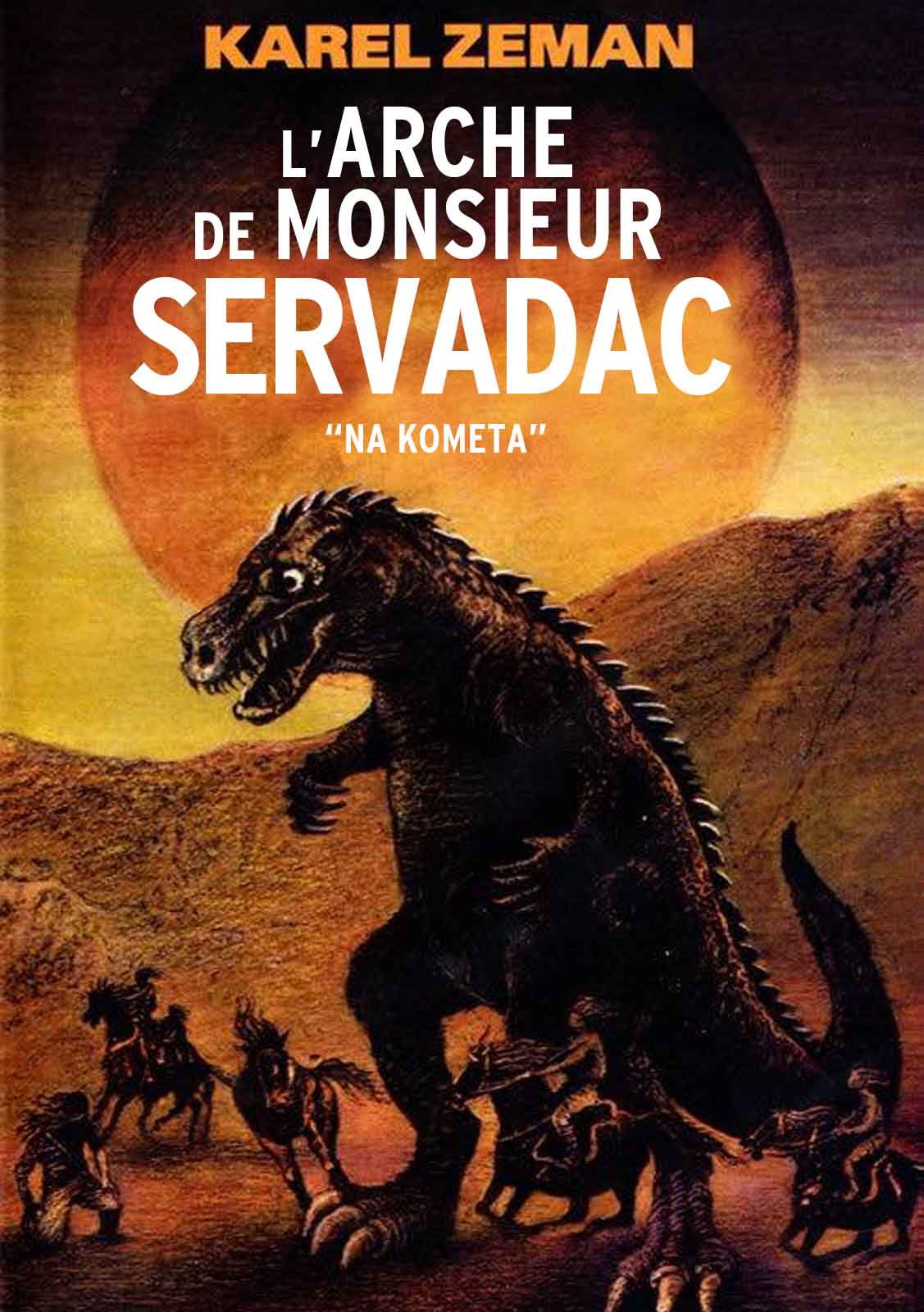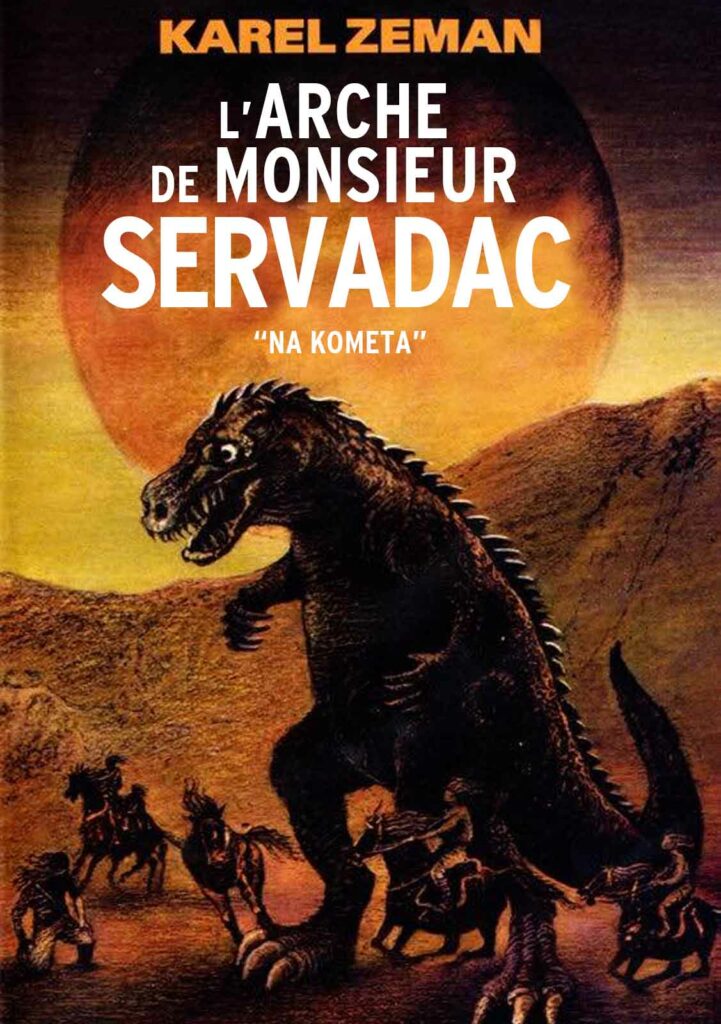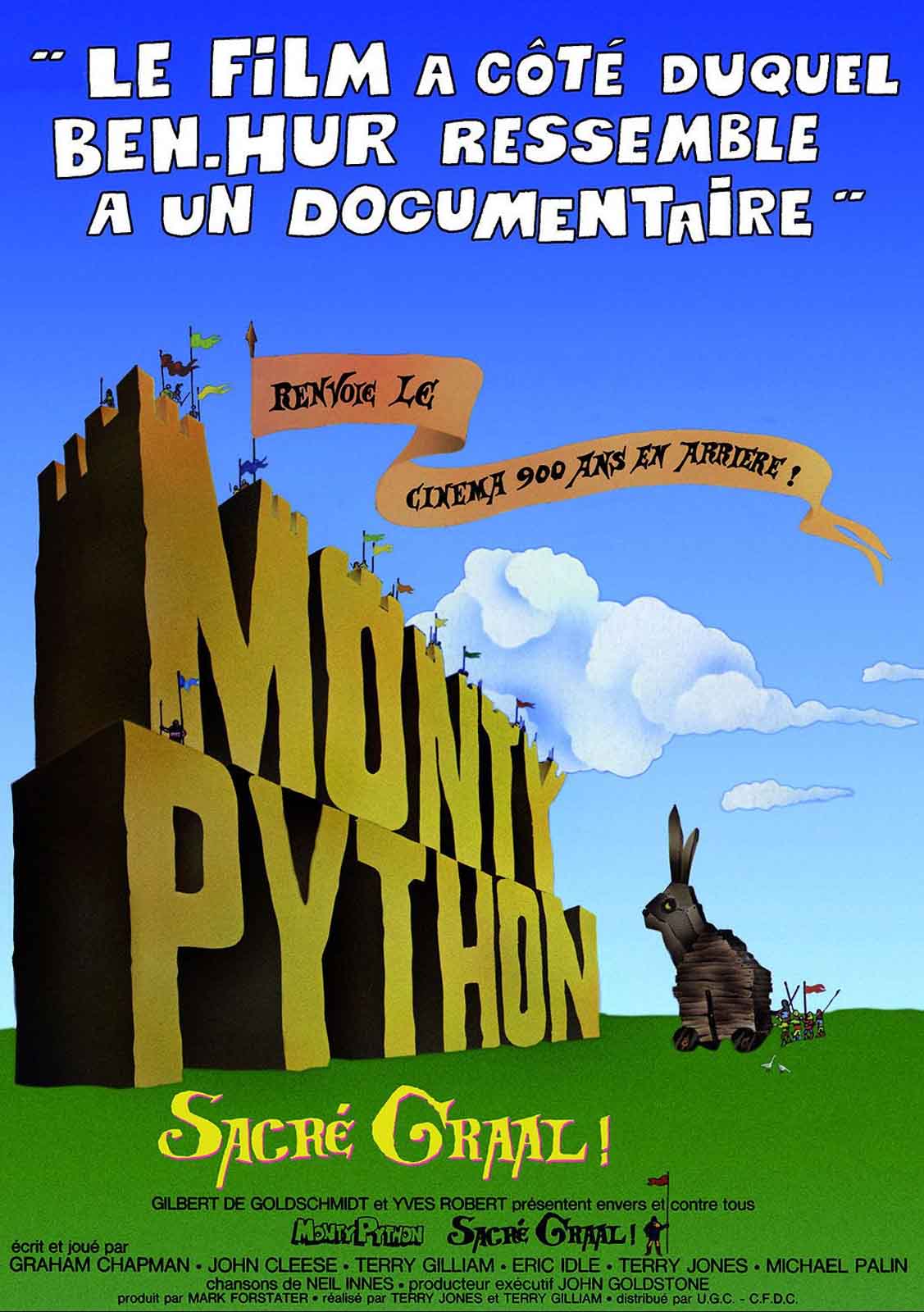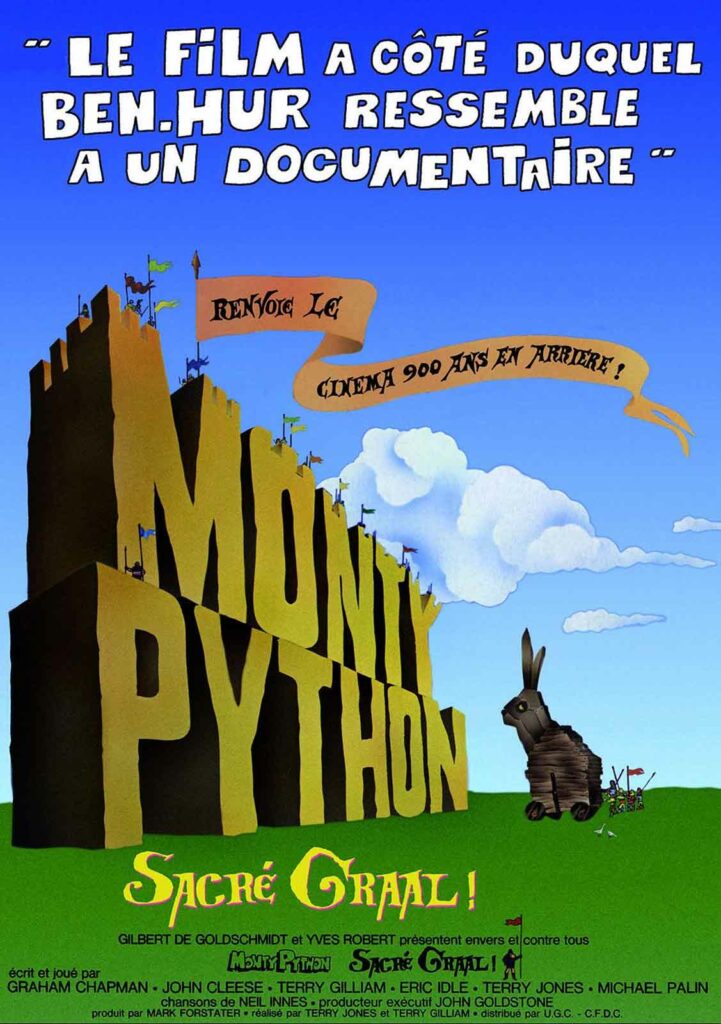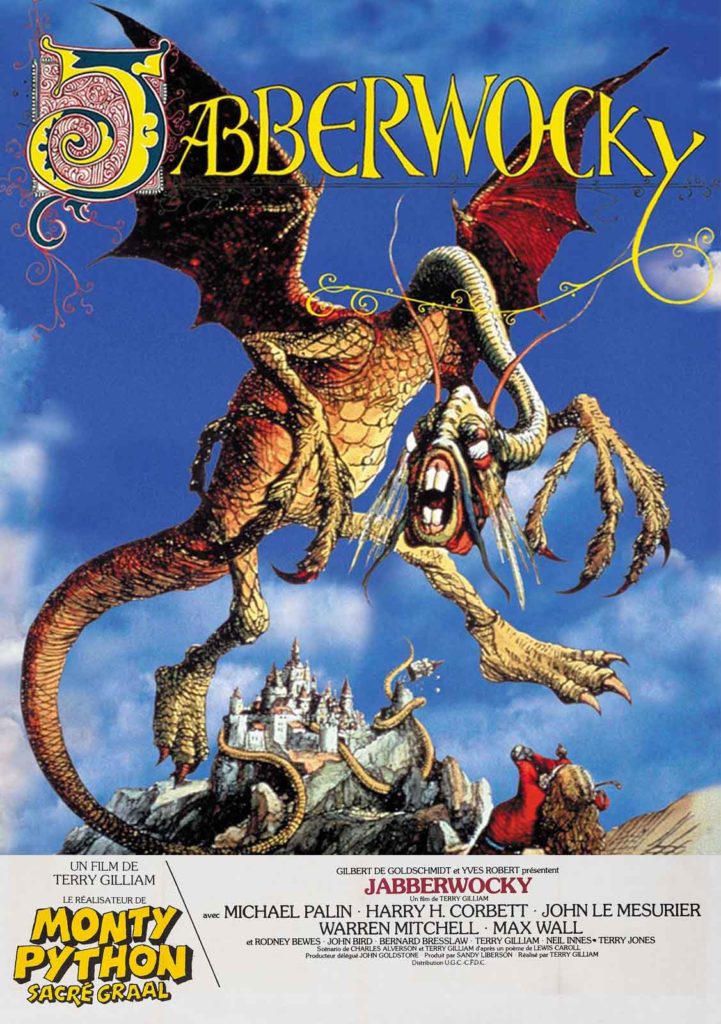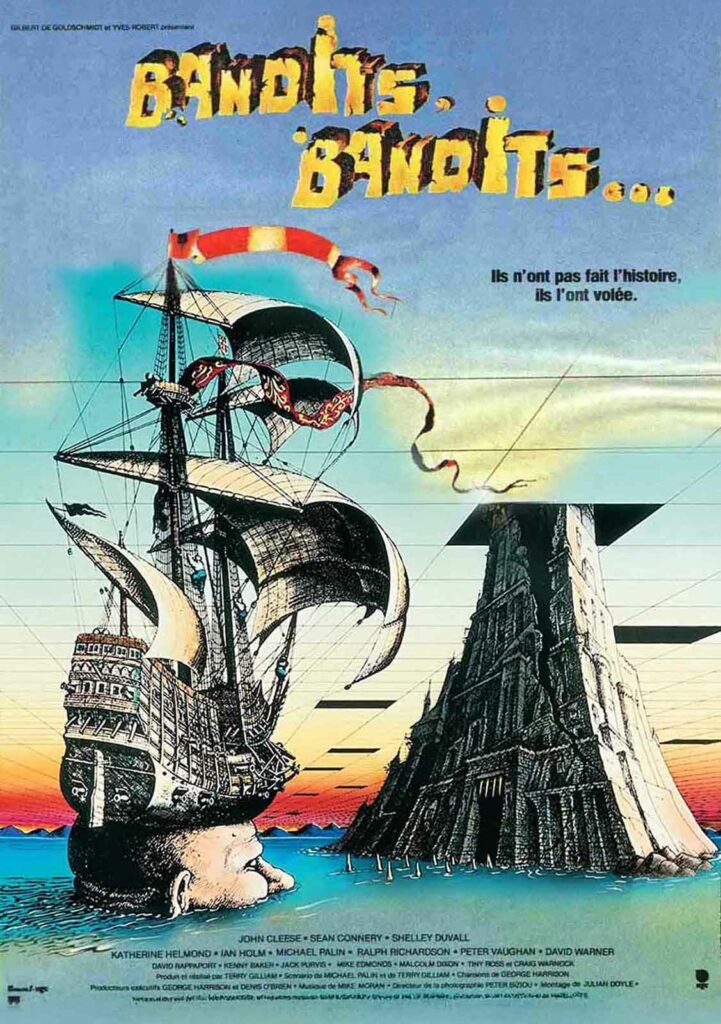Après avoir rencontré à peu près tous les monstres du studio Universal, le duo comique Abbott et Costello atterrit en Égypte…
ABBOTT AND COSTELLO MEET THE MUMMY
1955 – USA
Réalisé par Charles Lamont
Avec Bud Abbott, Lou Costello, Eddie Parker, Marie Windsor, Mel Welles, Michael Ansara, Richard Deacon
THEMA MOMIES I SAGA UNIVERSAL MONSTERS
En dix ans de carrière, le duo comique Abbott et Costello rencontra le monstre de Frankenstein, le loup-garou, Dracula, l’homme invisible, Docteur Jekyll et Mister Hyde et même des Martiens. Pour leur dernière aventure, ils se frottent donc à une momie, le temps d’une parodie franchement poussive. Échoués dans un cabaret égyptien et engoncés dans de fort peu seyantes tenues coloniales, les deux nigauds entendent la conversation d’une table voisine. Le docteur Gustav Zoomer (Kurt Katch), un archéologue renommé, entend bien ramener à la civilisation la momie Klaris qu’il vient de découvrir. Abbott et Costello souhaitent proposer leurs services pour escorter la précieuse relique, mais Zoomer est éliminé par une secte d’adorateurs de Klaris qui comptent la ramener à la vie. Pour parvenir à leurs fins, il ne leur manque plus qu’un médaillon sacré qui échoue entre les mains du maladroit duo. Tous deux sont donc à la fois pris en chasse par les fidèles de Klaris, mais aussi par une bande rivale dirigée par Madame Rontru (Marie Windsor, héroïne de l’inénarrable Cat Women on the Moon), qui cherche à mettre la main sur le légendaire trésor de la momie.


À ce scénario très modérément palpitant viennent hélas se greffer des gags ratés qui ont le malheur de traîner en longueur. Que ce soient le jeu de mot sur « mummy » et « momie », l’interminable échange verbal à propos d’une pelle et d’une pioche, les multiples apparitions et disparitions du corps de Zoomer ou la manière dont les deux nigauds tentent de se repasser le médaillon censé porter malheur, tout ça tombe à plat et s’avère franchement embarrassant. Mais le sort le plus triste est celui réservé à la momie elle-même. Interprétée par le cascadeur Eddie Parker, qui endossa déjà la défroque de Mister Hyde dans une précédente aventure d’Abbott et Costello, elle est affublée d’un costume et d’un maquillage grossiers, œuvre d’un Bud Westmore que l’on connut bien plus inspiré (avec L’Étrange créature du lac noir notamment). Quant à son rôle, il se limite à quelques surgissements apathiques hors de son sarcophage, une poignée de grognements et deux ou trois déambulations à pas lents.
Trois momies pour le prix d’une
Pour corser l’affaire, le scénariste John Grant a joué la carte du quiproquo en faisant intervenir deux fausses momies au cours du climax. L’idée aurait pu donner lieu à bon nombre de situations burlesques, mais elle est terriblement sous-exploitée et ne sert finalement qu’à relancer mollement un script anémique. Fidèles à leurs habitudes, Abbott s’énerve, Costello pousse des cris en courant comme un dératé, et le spectateur soupire. Universal a pourtant mis le paquet, ne lésinant ni sur les décors (notamment un vaste temple dédié à Klaris et de nombreuses rues « égyptiennes » animées reconstituées en studio), ni sur les luxueux morceaux musicaux qui scandent régulièrement le récit. Mais Deux nigauds et la momie ne décolle jamais vraiment, et le studio achève là de bien pathétique manière les exploits de l’un de ses monstres les plus légendaires. Il faudra donc attendre que la compagnie anglaise Hammer reprenne à son compte le mythe pour que la momie renaisse de ses cendres avec le panache qu’elle mérite.
© Gilles Penso
Partagez cet article