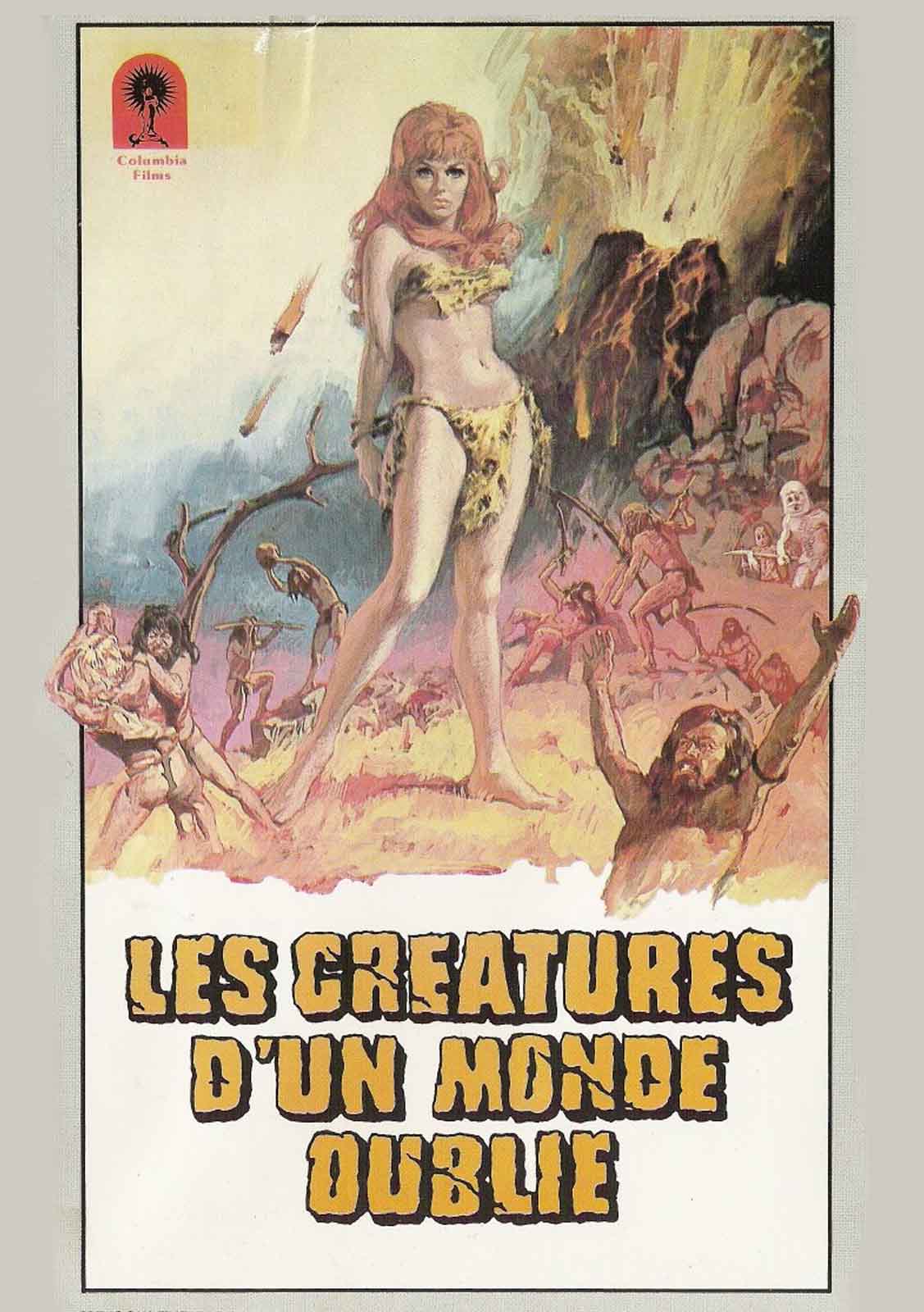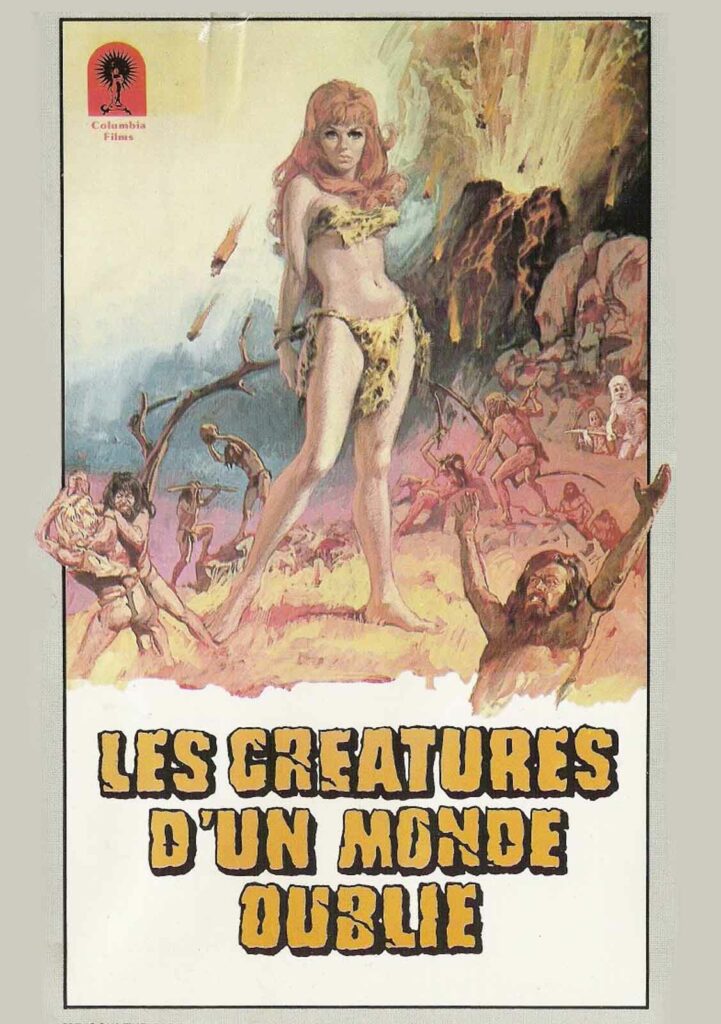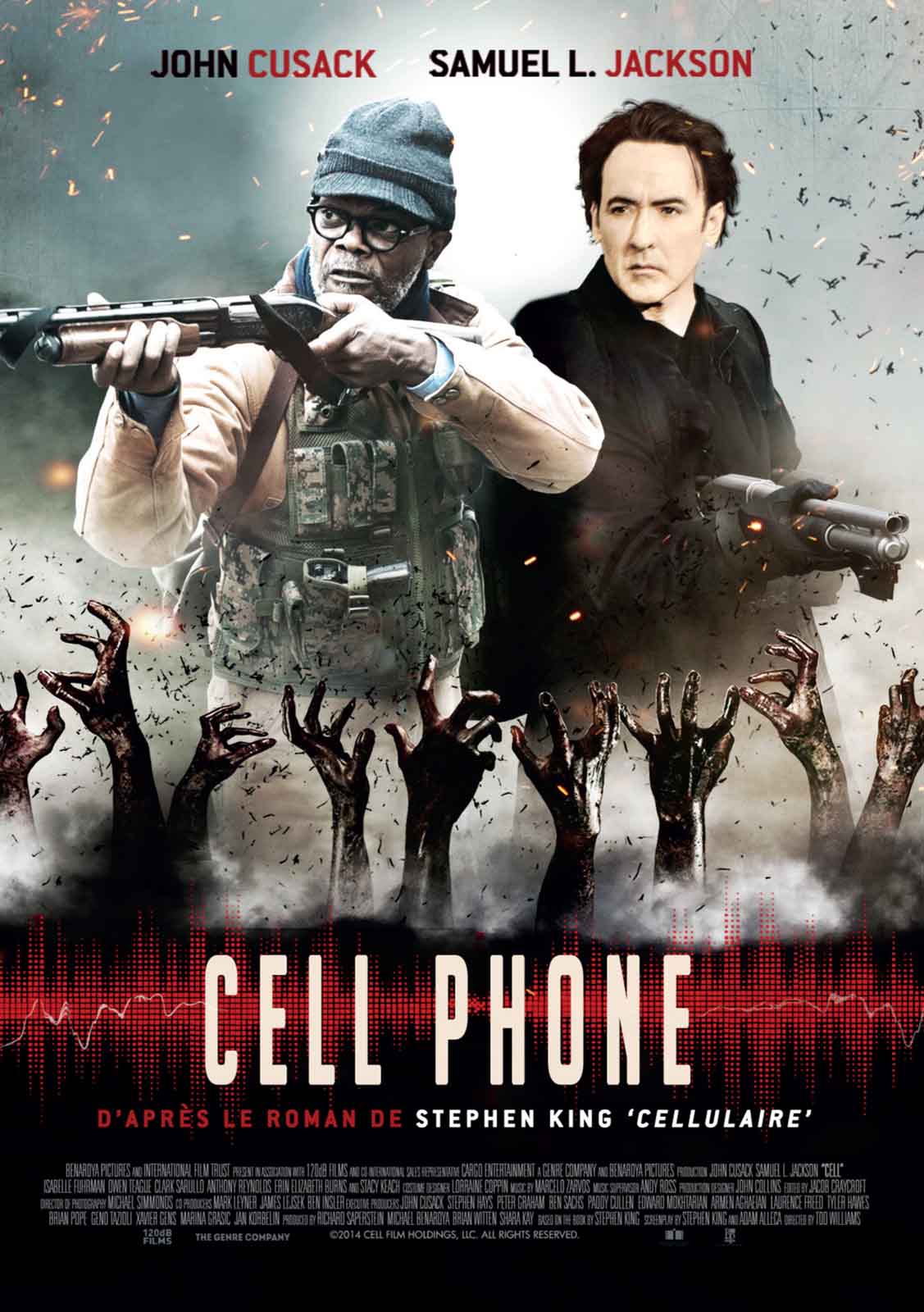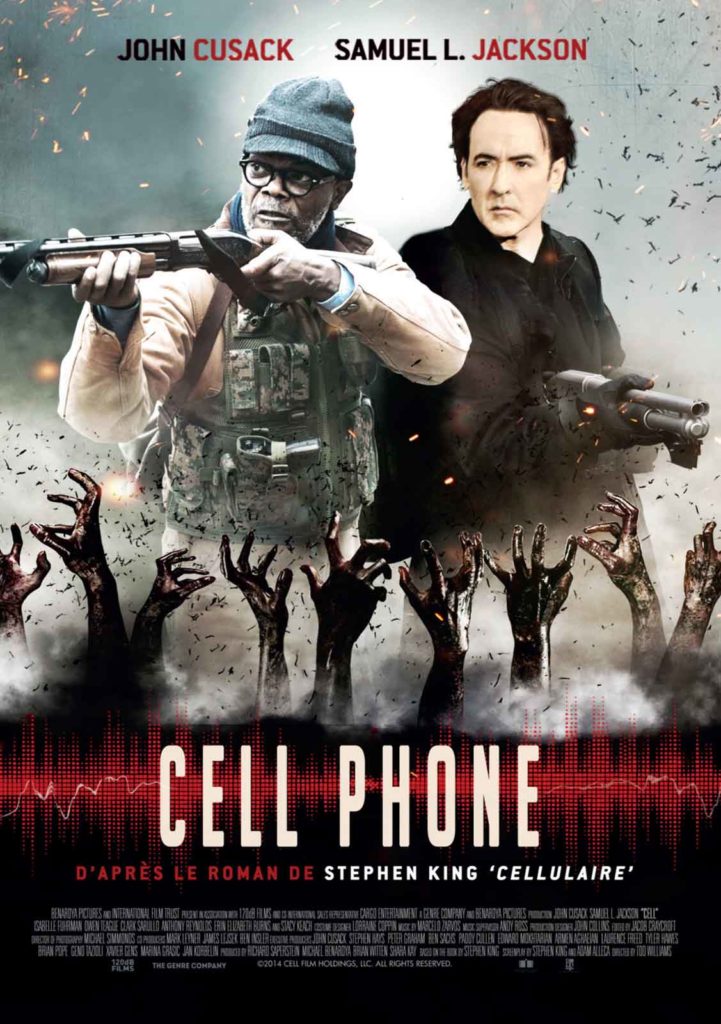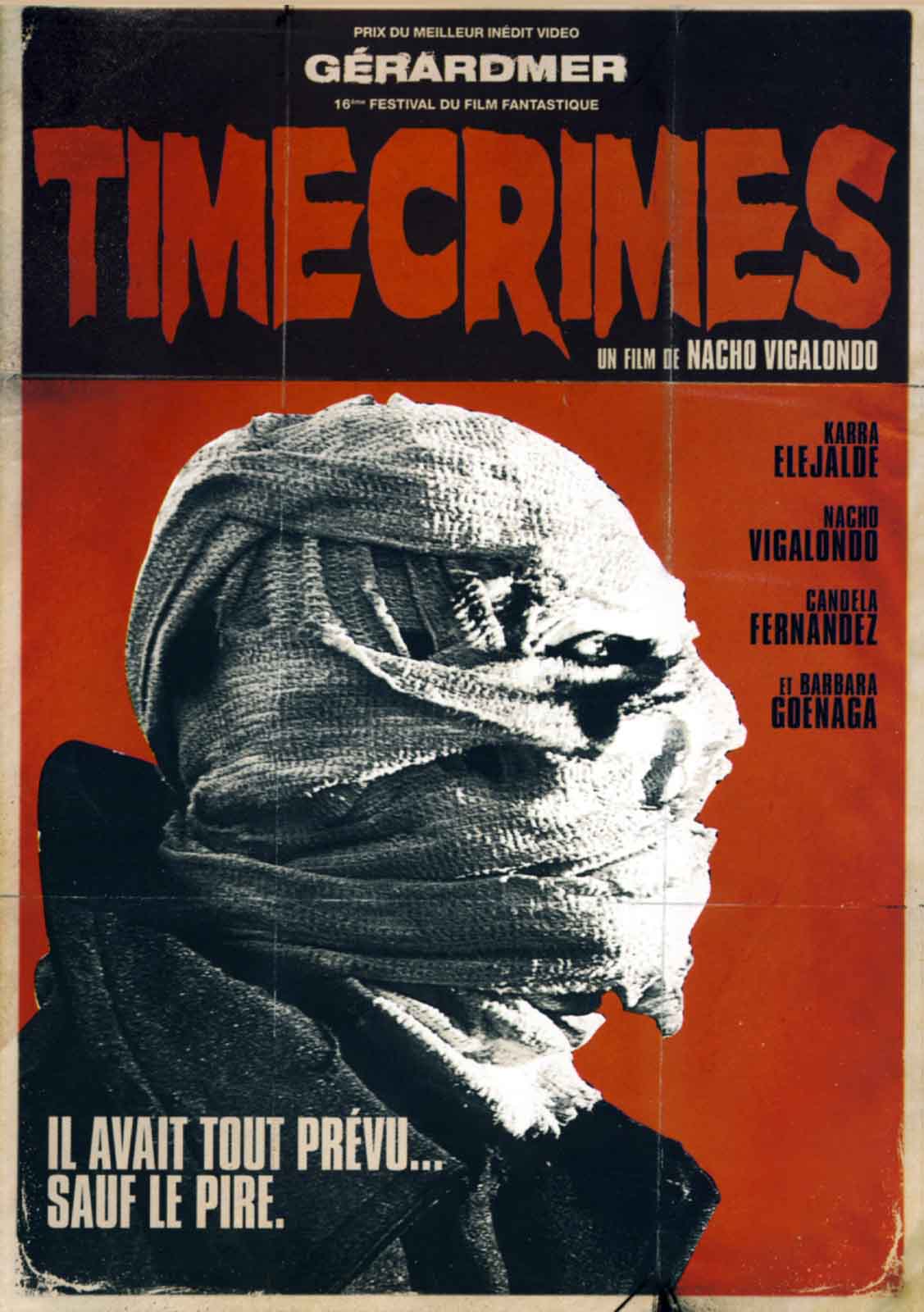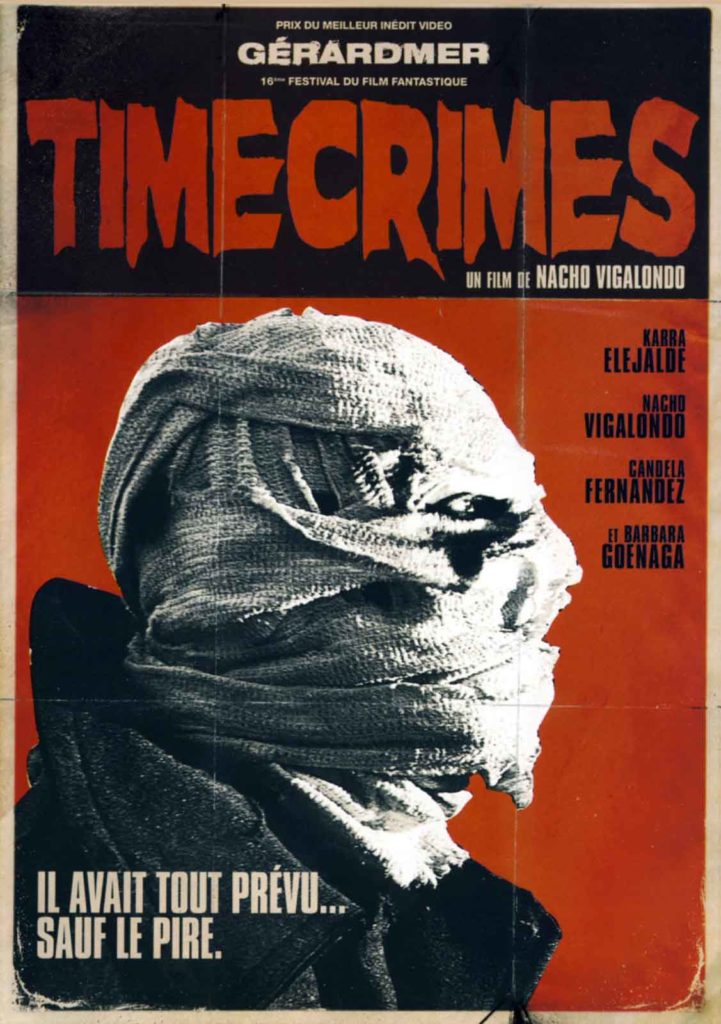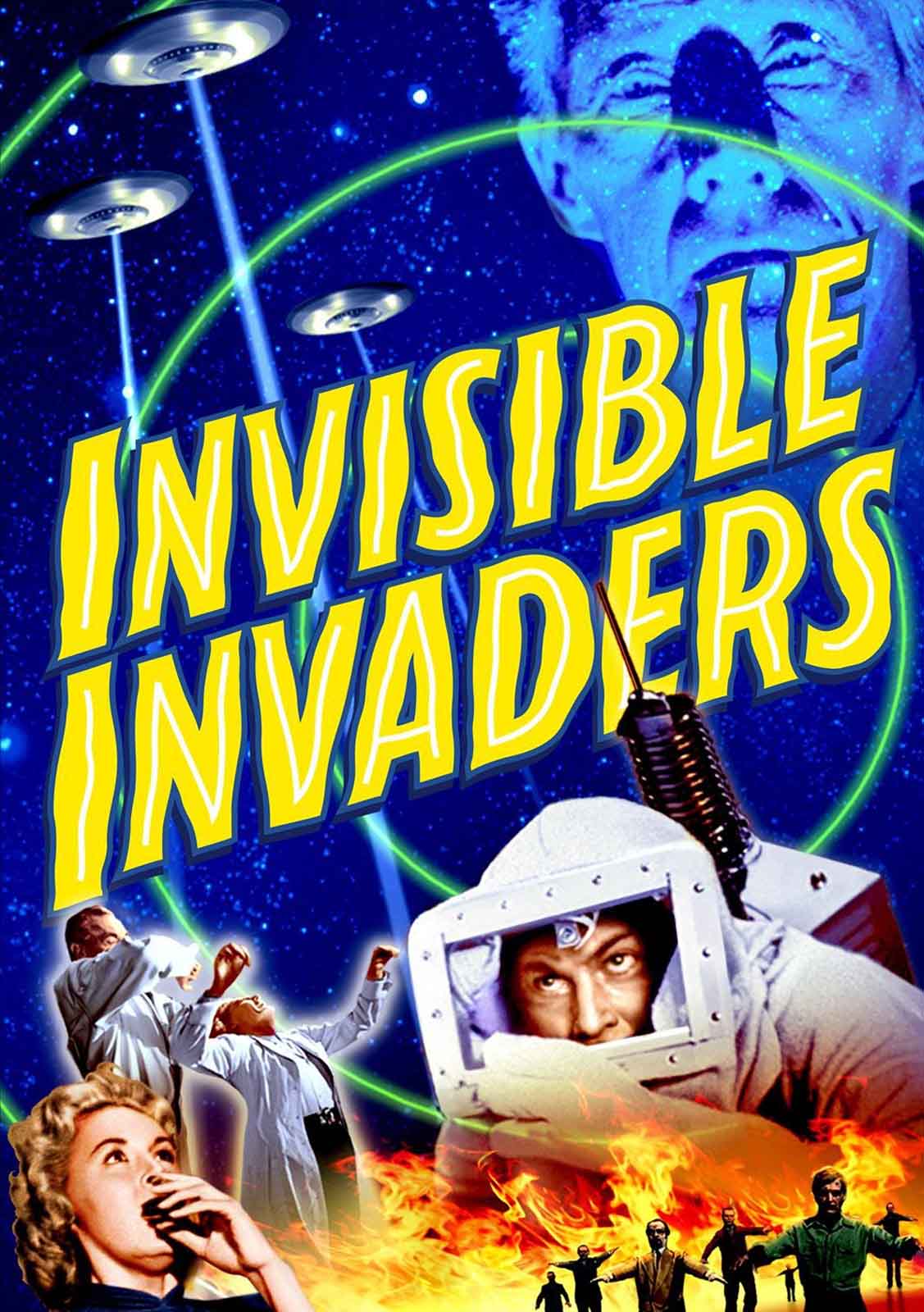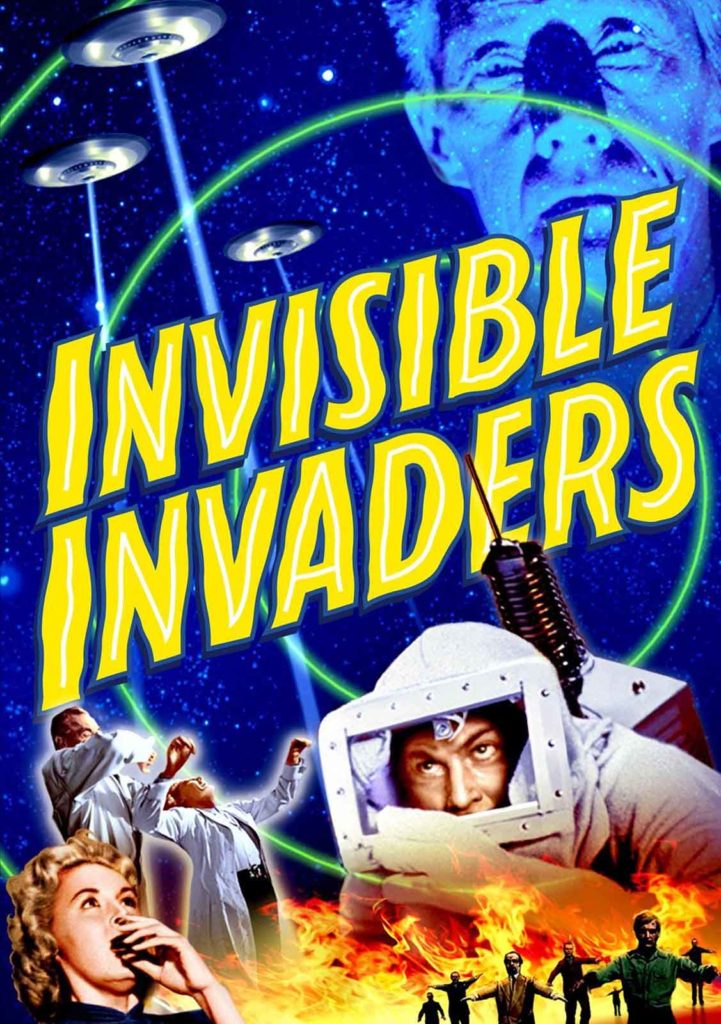Pour clore sa trilogie inspirée par le classique de John Carpenter, David Gordon Green prend une voie pour le moins surprenante…
Écrit en même temps qu’Halloween Kills et tourné dans la foulée, cet ultime chapitre de la trilogie inaugurée en 2018 reprend en toute logique une partie du casting des deux films précédents. Jamie Lee Curtis revient donc jouer la grand-mère « badass » Laurie Stode, Andi Matichak sa petite-fille Allyson, Will Patton le sympathique officier de police Frank Hawkins et James Jude Courtney le monolithique Michael Myers (avec comme toujours quelques apparitions de Nick Castle, interprète original du tueur au masque blanc). Désireux de rendre plusieurs hommages à John Carpenter, le film multiplie à outrance les clins d’œil à La Nuit des masques mais aussi à The Thing (à travers un extrait diffusé à la télévision pendant le prologue) et surtout à Christine. Le personnage central Corey Cunningham (Rohan Campbell) s’inspire en effet du Arnie Cunningham qu’incarnait en 1983 Keith Gordon et suit le même parcours, muant progressivement le sympathique garçon sage en être maléfique mû par des pulsions incontrôlables. Même sa métamorphose physique prend une tournure similaire. S’il est soucieux de se référer à ses aînés, Halloween Ends cherche parallèlement à briser les habitudes en aventurant ses péripéties là où on ne les attend pas. La démarche n’est pas inintéressante. En théorie du moins…


L’intrigue d’Halloween Ends se situe quatre ans après les événements décrits dans Halloween Kills. Les derniers meurtres perpétrés par Michael Myers et sa disparition mystérieuse ont laissé la ville d’Haddonfield dans un bien piteux état. Une ambiance oppressante s’insinue ainsi parmi les habitants, comme laissés hagards à la suite du chaos dont ils furent frappés. Pour panser ses blessures et exorciser les démons intérieurs qui la rongent, Laurie Strode a décidé d’écrire ses mémoires. D’où une voix off récurrente qui pousse Jamie Lee Curtis à philosopher sur les notions de bien et de mal comme le faisait jadis Donald Pleasence dans le rôle du psychiatre Loomis. Une autre voix off vient régulièrement scander le récit, celle d’un animateur radio trublion et impertinent incarné par Keraun Harris. Bientôt, le film centre tous ses enjeux sur le jeune Corey, traumatisé par un accident survenu un soir où il jouait les baby-sitters et devenu dès lors une sorte de paria introverti. C’est là que ce bon vieux Michael Myers décide de ressurgir de sa tanière pour plonger une fois de plus Haddonfield dans le cauchemar…
La contagion du mal
On ne pourra pas reprocher à Halloween Ends son manque d’audace, le film s’efforçant de proposer une variante inattendue sur un motif usé jusqu’à la corde. L’intention est bonne, mais le résultat est hélas complètement à côté de la plaque. Tout le récit tourne autour des malheurs de ce pauvre Corey Cunningham victime des circonstances et d’un environnement hostile, en opposition avec la thématique du « mal absolu » qui caractérise le personnage de Michael Myers dès sa petite enfance. Ici, la psychopathie meurtrière n’est plus innée mais acquise. Or le scénario, indécis, semble vouloir coupler à cette idée première (« on ne nait pas tueur, on le devient ») une seconde notion complémentaire (contradictoire ?) selon laquelle le Mal et la folie meurtrière sont contagieux. Ce motif nous rappelle les exubérances joyeuses de Jason va en enfer, si ce n’est qu’Halloween Ends prend son sujet très au sérieux. Le film joue même la carte du drame psychologique, comme s’il cherchait à tout prix à s’élever au-dessus de son sujet. Après un prégénérique absurde et un gigantesque passage à vide (près de quarante minutes sans la moindre péripétie palpitante), le scénario part dans tous les sens, s’acheminant vers un climax grotesque digne d’un épisode de Tom et Jerry puis vers un final totalement invraisemblable. Nous n’étions pourtant pas contre une sortie de route osée transportant la franchise hors des sentiers battus (comme à l’époque du Halloween 3 de Tommy Lee Wallace). Mais Halloween Ends donne le sentiment de vouloir faire le grand écart entre l’innovation radicale et l’asservissement aux codes de la saga sans parvenir à trouver un juste milieu satisfaisant.
© Gilles Penso
Partagez cet article