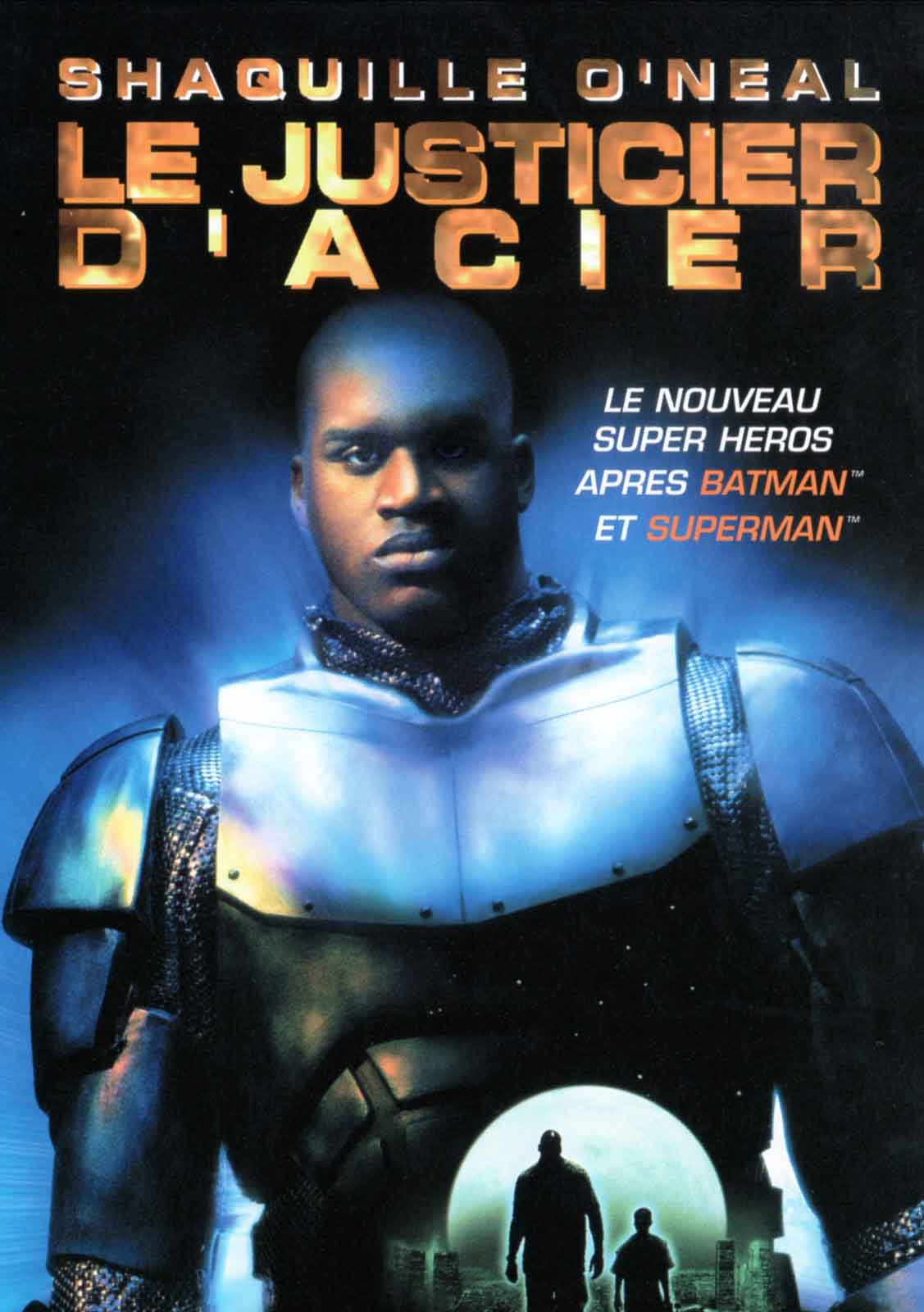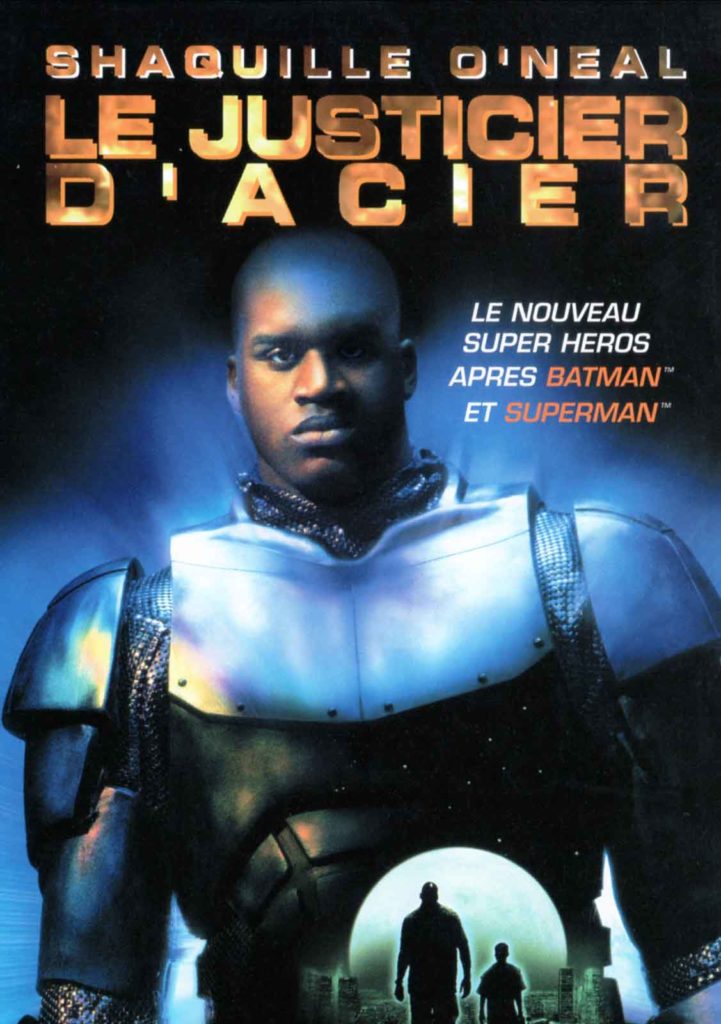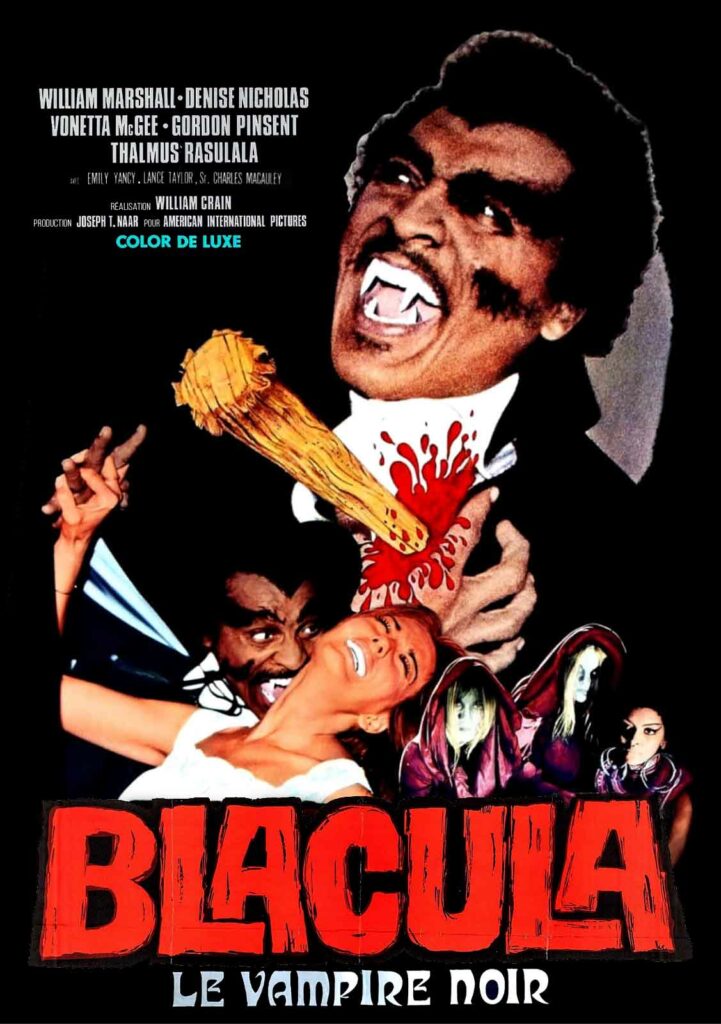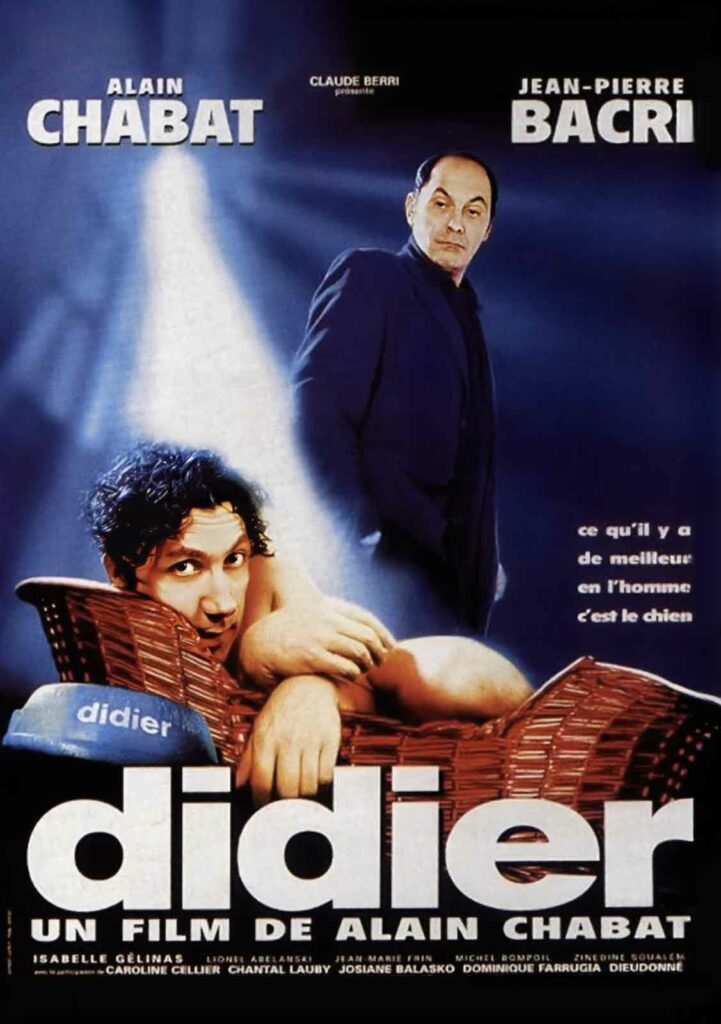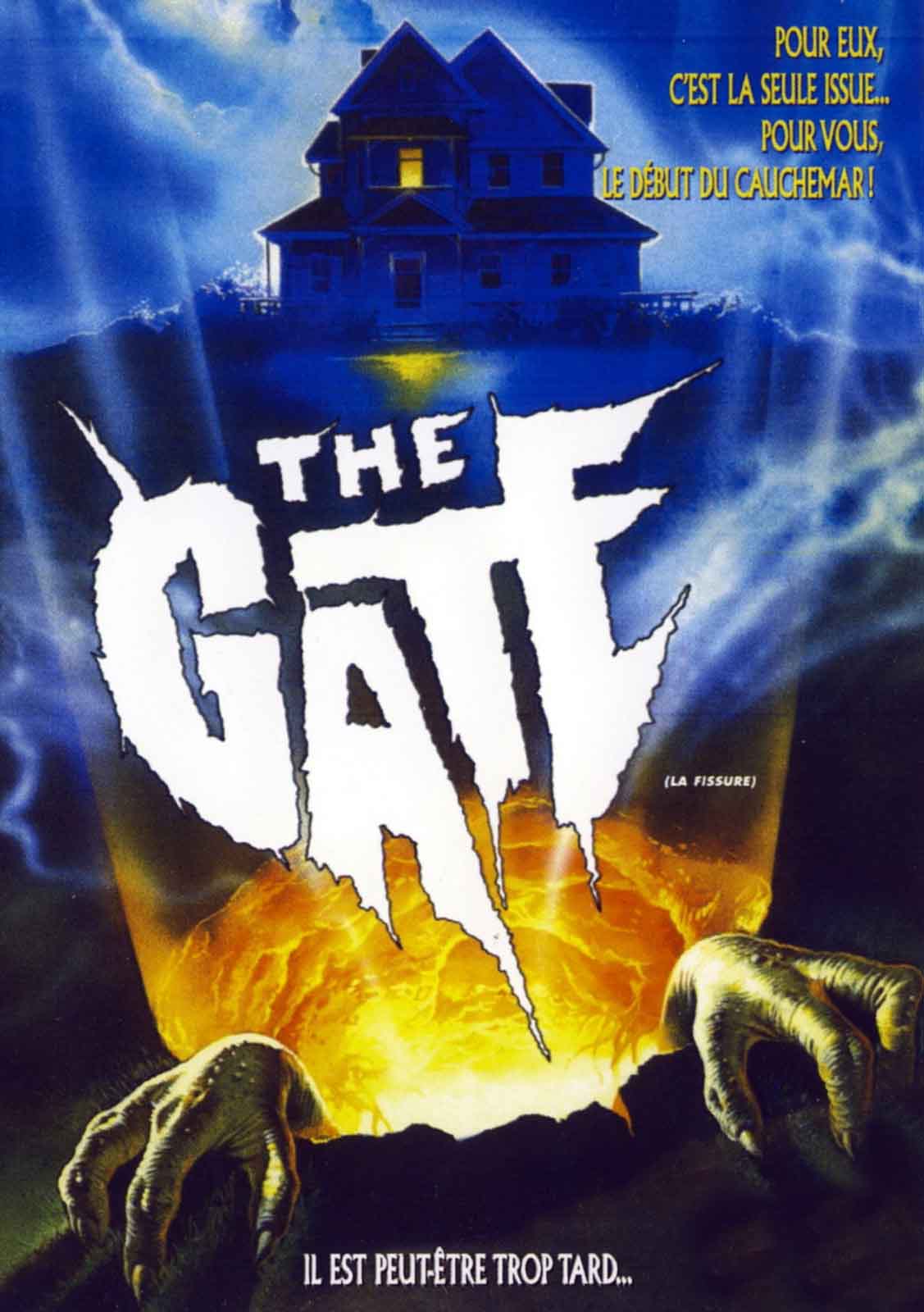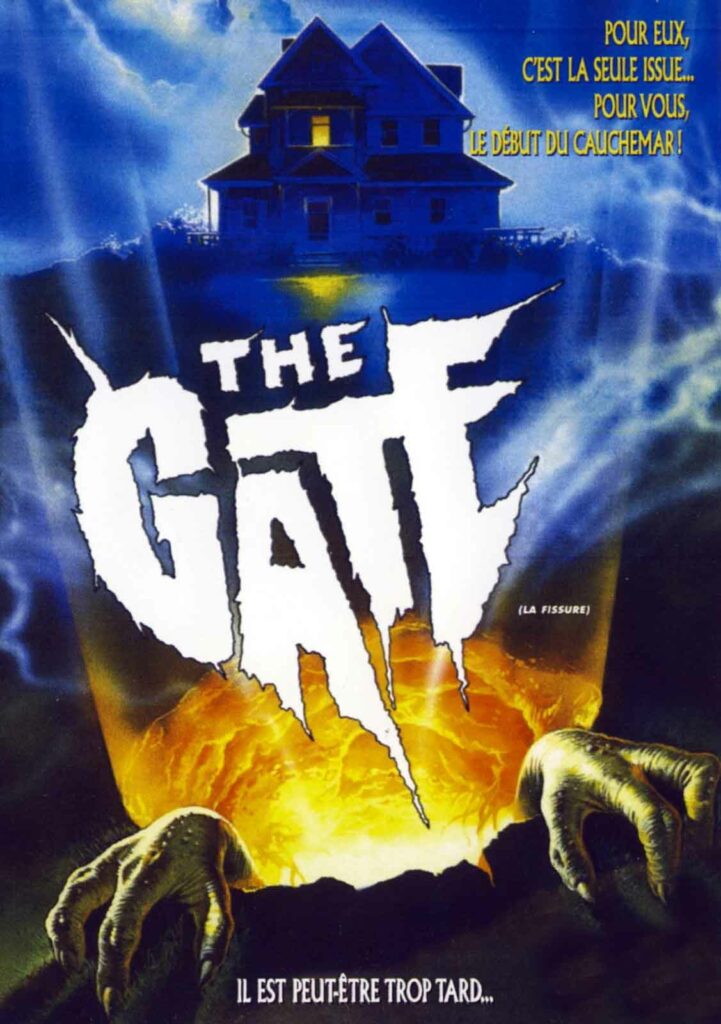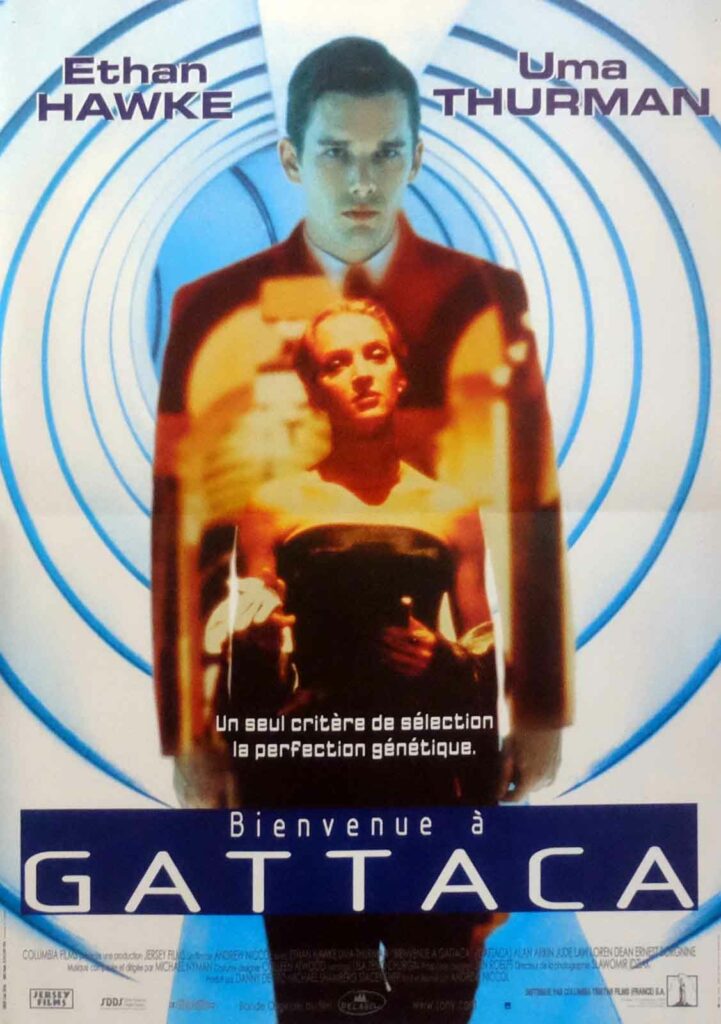A peine esquissée dans le Daredevil de Mark Steven Johnson, la super-héroïne incarnée par Jennifer Gardner aura eu droit à son propre long-métrage
ELEKTRA
2005 – USA
Réalisé par Rob Bowman
Avec Jennifer Garner, Terence Stamp, Goran Visnjic, Kirsten Prout, Will Yun Lee, Cary-Hiroyuki Tagawa, Bob Sapp, Chris Ackerman
THEMA SUPER-HEROS I SAGA MARVEL
Même les fans les plus irréductibles du Marvel Comic Group attendaient cet Elektra avec beaucoup de méfiance. Comment pouvait-il en être autrement, quand on voit à quel point le personnage fut sabordé dans le calamiteux Daredevil de Mark Steven Johnson ? Pourtant, ce spin-of à priori fort dispensable part avec deux atouts en poche : un scénario évacuant toute référence au film précédent, et une mise en scène assurée par un Rob Bowman très inspiré (celui-là même qui nous offrit l’étonnant Règne du feu). Revenue d’entre les morts grâce au maître des arts martiaux Stick (interprété par l’immense Terence Stamp), Elektra gagne désormais sa vie comme tueuse à gage. Sa réputation d’assassin infaillible la précède de loin, ce qui nous vaut une savoureuse séquence d’ouverture mettant trop brièvement en vedette le savoureux Jason Isaacs. Sa nouvelle mission consiste à s’installer dans une maison en bord de mer et d’abattre ses voisins. Lorsqu’elle constate que ses cibles sont un père et sa fille de 13 ans, Mark et Abby Miller, elle renonce à sa mission. Aussitôt, ses victimes potentielles sont assaillies par une horde de démons-ninjas dépêchés par une organisation maléfique dénommée « La Main ». De tueuse, Elektra se mue donc en protectrice et se heurte aux pouvoirs surnaturels d’adversaires hors du commun.


On le voit, la rupture avec Daredevil est totale, les exploits urbains du justicier aveugle ayant ici cédé le pas à une aventure purement fantastique mâtinée de sorcellerie et de mysticisme. Montée sur le podium des superstars grâce à son rôle musclé dans la série d’espionnage Alias, Jennifer Garner campe ici un personnage pas très éloigné de l’agent Sidney Bristow qui la rendit célèbre, dont on retrouve au moins deux composantes fondamentales : une aptitude impressionnante aux combats les plus variés, et un crise d’identité génératrice de dilemmes fréquents. Nimbé d’une noirceur surprenante en pareil contexte, Elektra s’inspire largement du cinéma asiatique, dont il reprend de nombreux codes sans toutefois verser dans la caricature imitative. D’où de surprenantes échauffourées défiant les lois de la gravité (la super-héroïne y évite les projectiles avec plus de grâce que Keanu Reeves dans Matrix) et des effets spéciaux empreints de poésie et de magie.
Une aventure teintée de magie et de mysticisme
A ce titre, les trois super-vilains qu’affronte Elektra en pleine forêt sont de mémorables trouvailles : Stone, un colosse qui semble aussi solide que du roc, Typhoïde, une femme pâle comme la mort qui fait faner les fleurs sur son passage et délivre des baisers fatals, et surtout Tatoo, dont les tatouages prennent vie et pour espionner ou attaquer ses adversaires à la vitesse de l’éclair. Même s’il ne transcende pas le genre, le scénario d’Elektra révèle quelques intéressantes surprises, notamment la nature du « trésor » que convoitent ardemment les sbires à la solde de « La Main », et se passe du second degré décalé souvent de mise chez les super-héros adaptés à l’écran. Doté en outre d’un casting impeccable, le film de Rob Bowman se détache donc du lot surchargé de films de justiciers en collants, mais l’accueil très mitigé que lui réserva le public le laissa sans suite.
© Gilles Penso
Partagez cet article