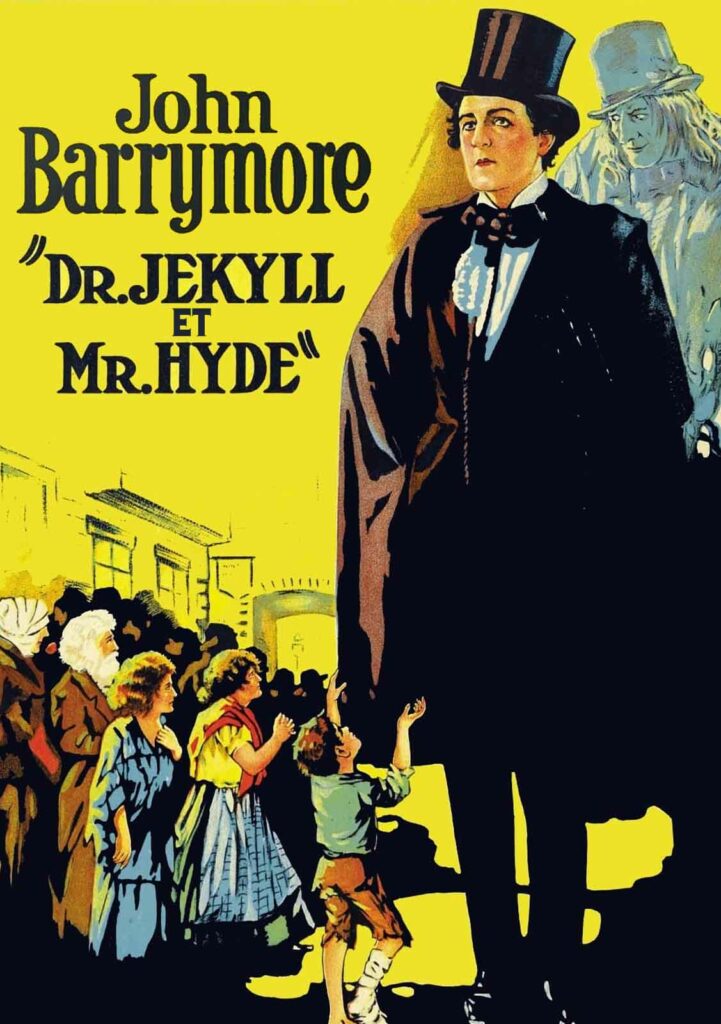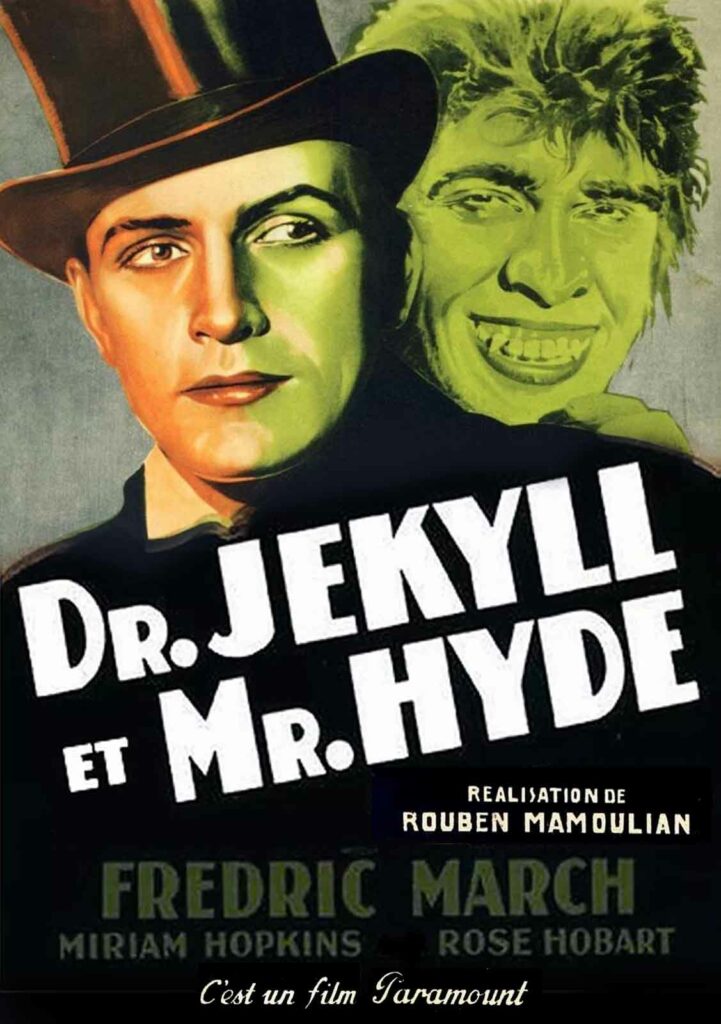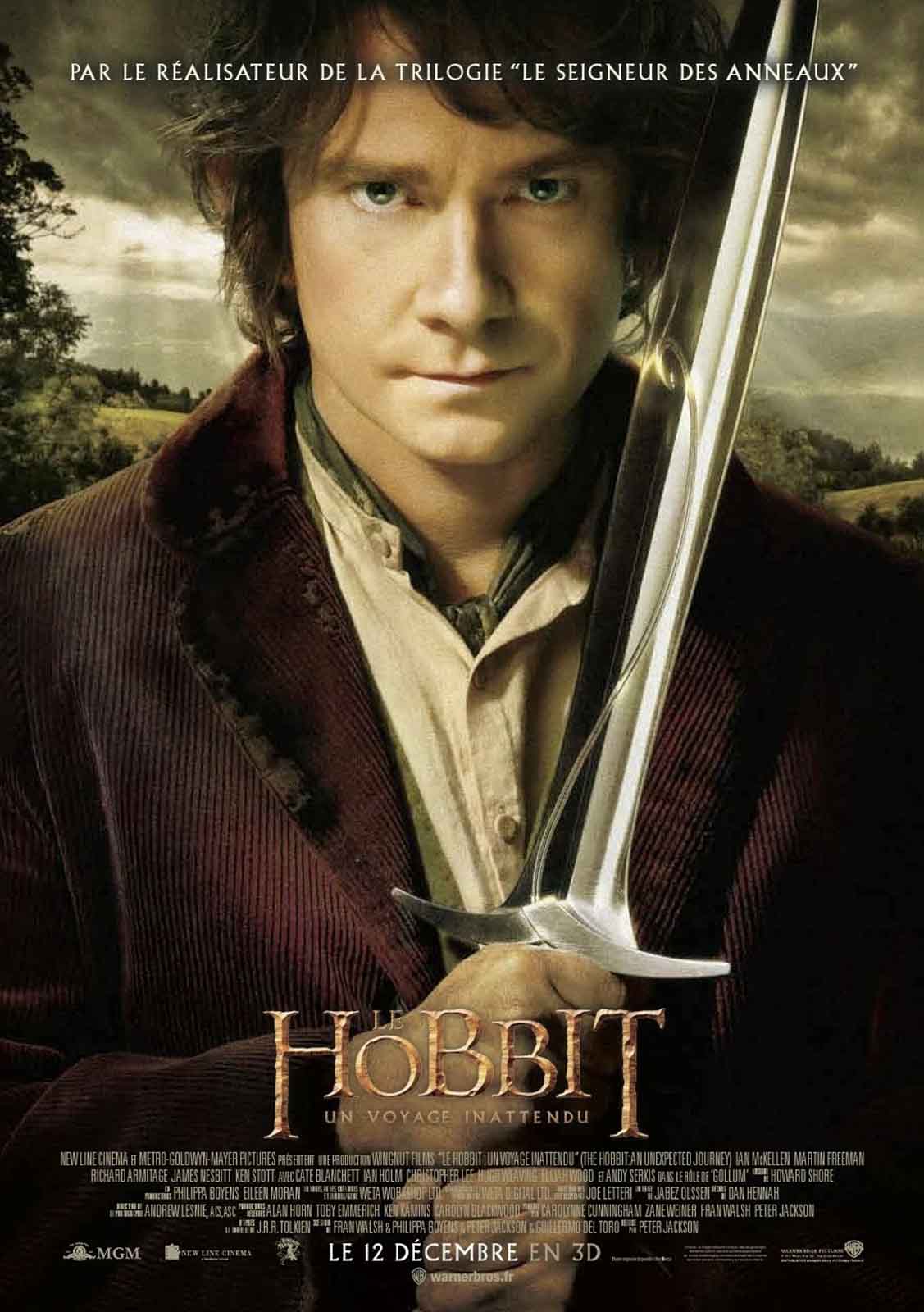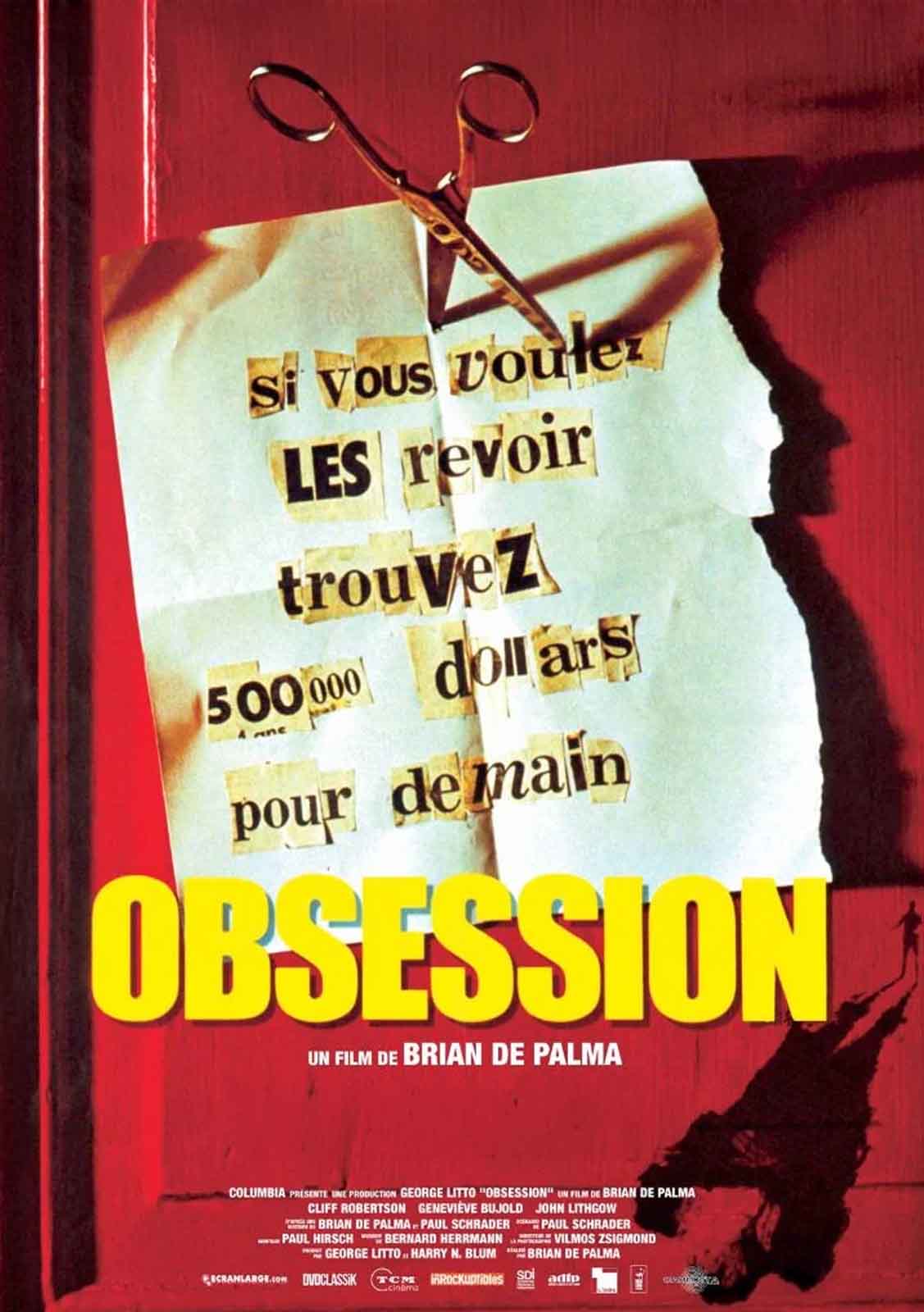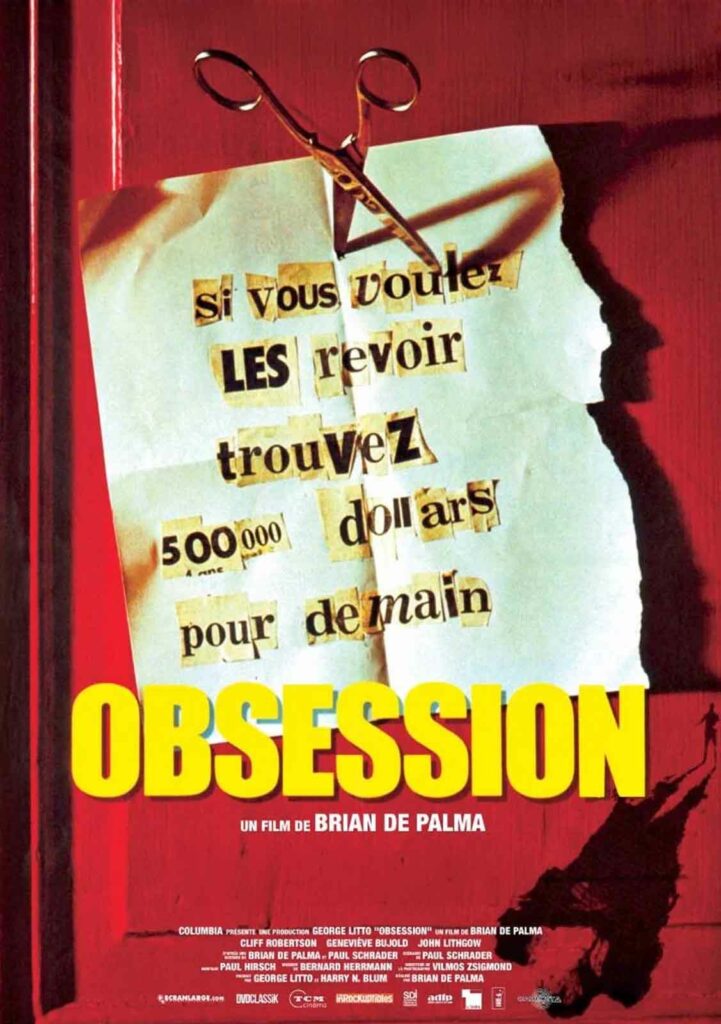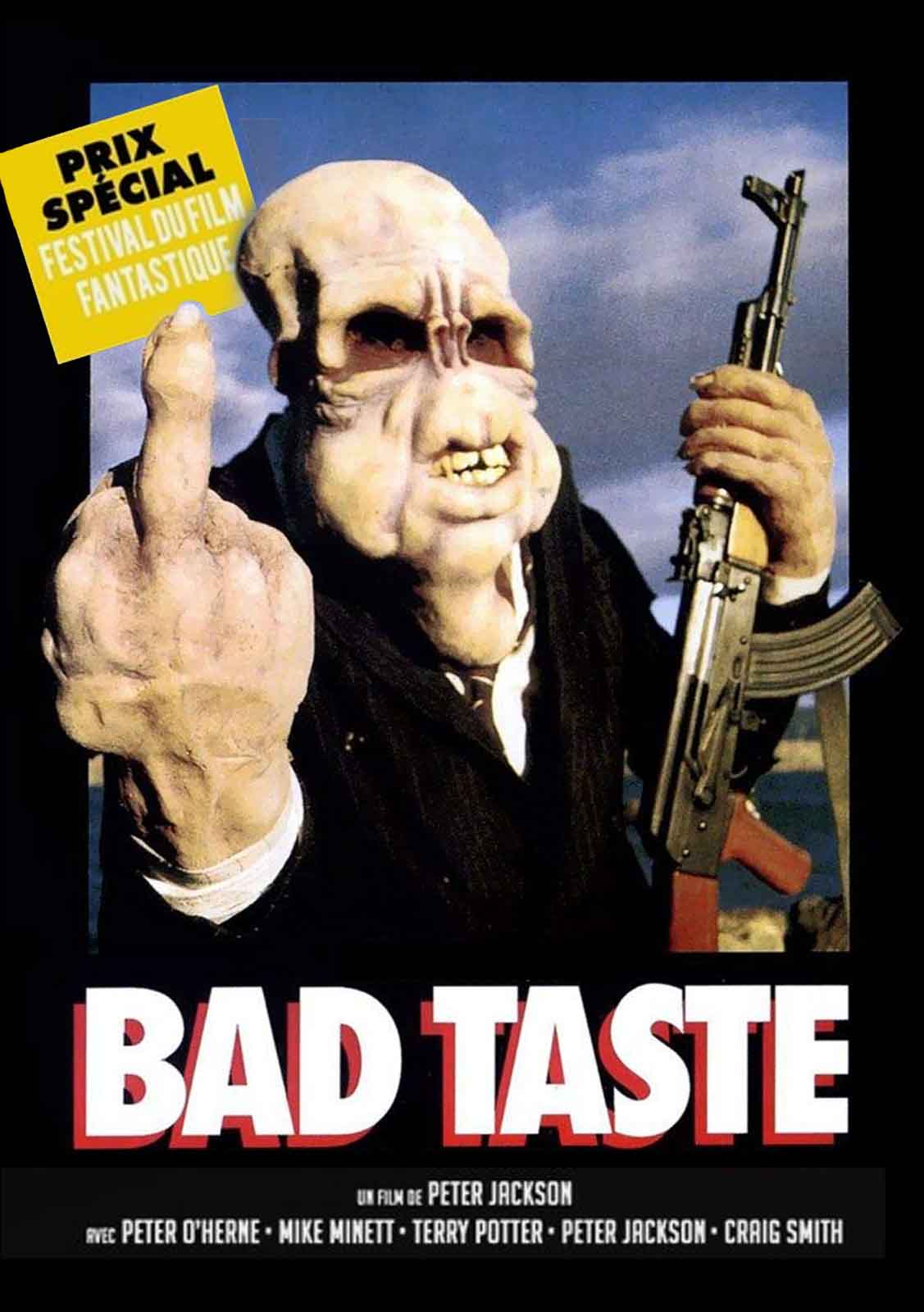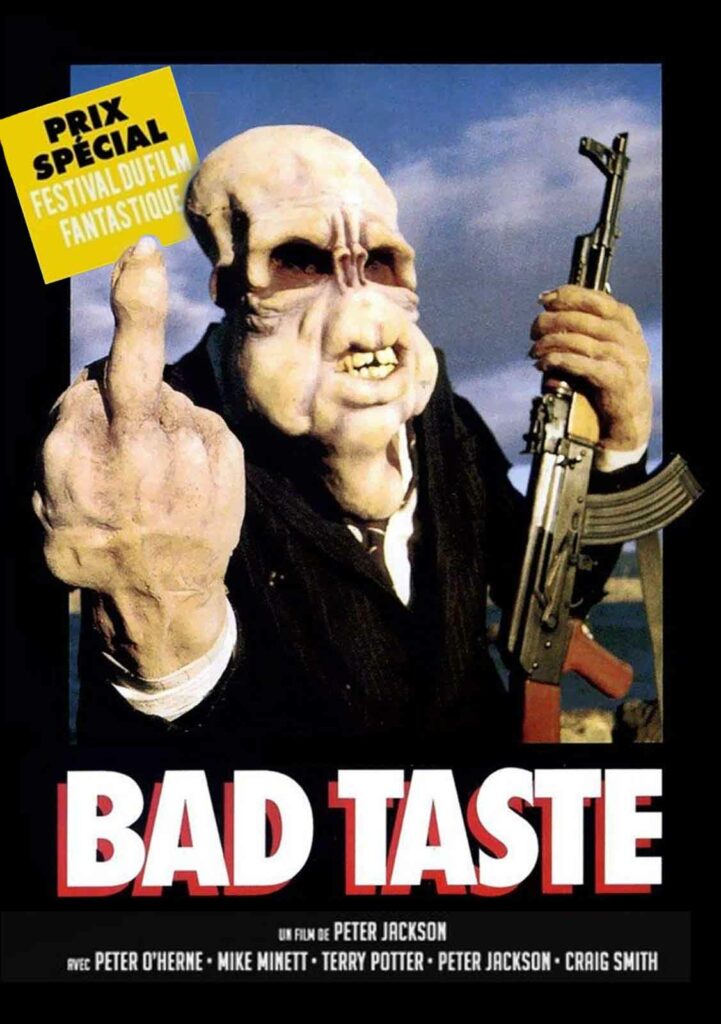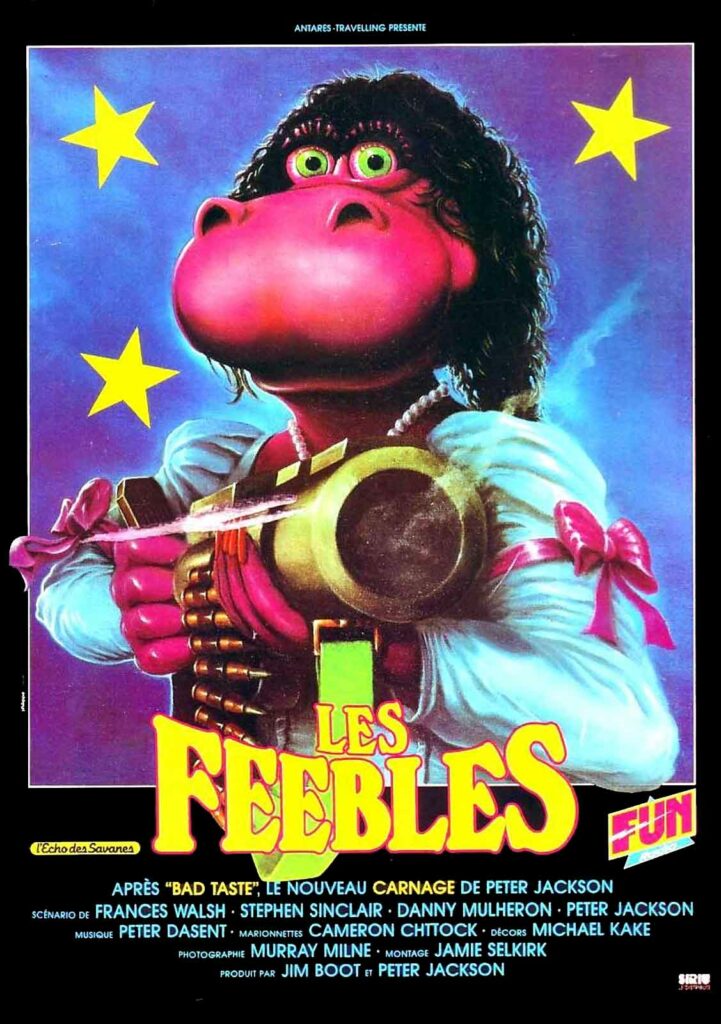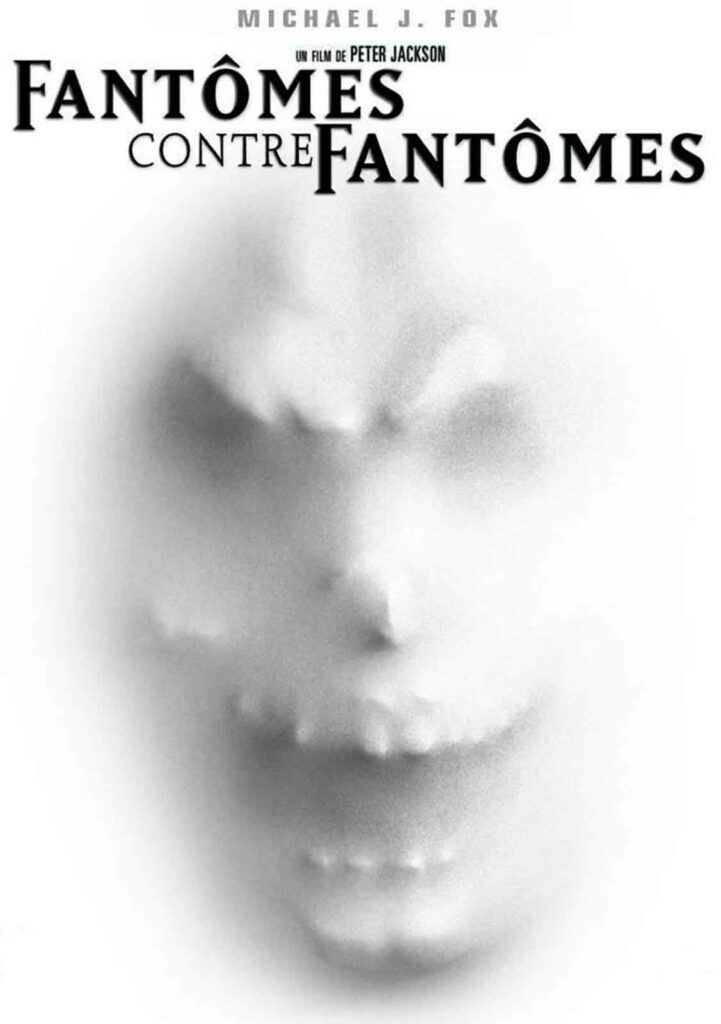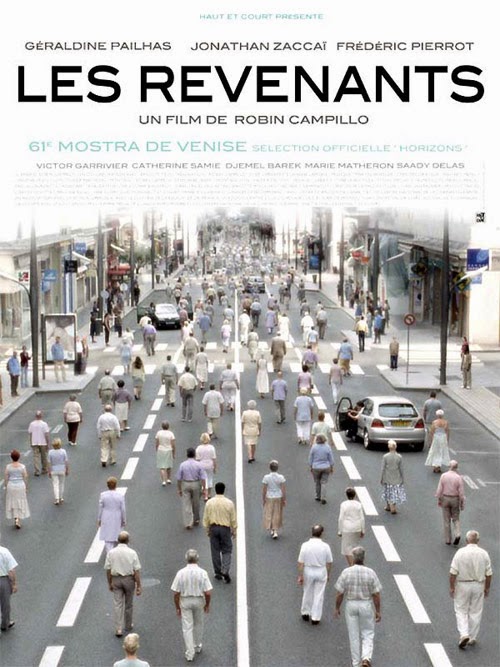Une variante française de Docteur Jekyll et Mister Hyde mise en scène à la fin des années 50 par Jean Renoir
LE TESTAMENT DU DOCTEUR CORDELIER
1959 – FRANCE
Réalisé par Jean Renoir
Avec Jean-Louis Barrault, Michel Vitold, Jean Topart, Jacques Catelain, Gaston Modot, Teddy Bilis, Micheline Gary
THEMA JEKYLL ET HYDE I DOUBLES
Renfloué par la ressortie de son chef d’œuvre La Grande illusion après une longue traversée du désert financière, Jean Renoir décide à la fin des années 50 de se tourner vers les nouveaux médias et accepte de tourner Le Testament du docteur Cordelier pour la RTF. Cette co-production destinée à la fois au grand et au petit écran lui permet ainsi d’expérimenter le tournage en multicaméras. Le cinéaste apparaît d’ailleurs lui-même au cours du prologue, sur un plateau de télévision, pour introduire le récit, qui n’est rien d’autre qu’une adaptation officieuse du roman « L’Etrange Cas du Docteur Jekyll et de Mister Hyde ». A l’exception des noms des personnages et de la transposition de l’intrigue dans la banlieue ouest de Paris, le texte de Robert Louis Stevenson est quasiment respecté à la lettre. Éminent psychiatre, le Docteur Cordelier laisse au notaire Joly un testament dont le légataire est un certain Opale. Or cet Opale est un personnage repoussant qui agresse sous les yeux de Joly une petite fille en pleine nuit, puis se réfugie dans le laboratoire de Cordelier. Joly supplie ce dernier de réviser son testament. Mais Cordelier proteste fermement, affirmant qu’Opale lui est nécessaire pour ses expériences sur le cerveau. En désespoir de cause, Joly consulte le docteur Séverin, farouche concurrent de Cordelier, mais celui-ci se contente de lui conseiller de ne pas se mêler de cette affaire, qu’il résume sous forme d’« un testament d’un fou à un autre fou ». Entre-temps, Opale poursuit ses exactions, agressant une femme avec son bébé, un homme malade, un infirme, finissant même par assassiner Séverin.


Dans le double rôle vedette, Jean-Louis Barrault est étonnant. Digne comme un sociétaire de la comédie française dans le rôle de Cordelier, il se barde de tics et s’octroie une démarche bizarrement balancée sous la défroque d’Opale, une canne à la main, des habits trop grands et un maquillage l’enlaidissant (mains velues, fausses dents, joues gonflées), le tout aux accents d’une partition claudicante pour xylophone signée Joseph Kosma. Traité sous l’angle d’une enquête policière, le scénario suit les piétinements de la police, incapable de mettre la main sur le sinistre individu malgré leur perquisition dans son cloaque à Pigalle. Jusqu’à l’épilogue qui nous révèle le fin mot de l’histoire (que les lecteurs de Stevenson avaient évidemment deviné depuis le début).
Guérir l'infection morale
On découvre dans ce flash-back révélateur un Cordelier en début de carrière, qui n’hésite pas à fricoter avec sa servante allemande, l’accorte Lise, ou à abuser d’une de ses patientes endormies. Dégoûté par son propre comportement, il abandonne sa clientèle et s’adonne à la recherche pour régler le problème du mal. Son objectif : « guérir l’infection morale comme les antibiotiques guérissent l’infection physique », à l’aide d’un remède de son cru. On connaît le résultat : un dédoublement de personnalité extrême qui s’achemine inexorablement vers un drame insoluble. Dynamique, la mise en scène de Renoir ne parvient pas à éviter totalement la théâtralisation un peu déplacée de certaines séquences (Séverin, notamment, surjoue à outrance), ce qui n’empêche pas Le Testament du docteur Cordelier de s’afficher comme l’une des meilleures adaptations – non officielle, mais qu’importe – du roman de Stevenson.
© Gilles Penso
À découvrir dans le même genre…
Partagez cet article