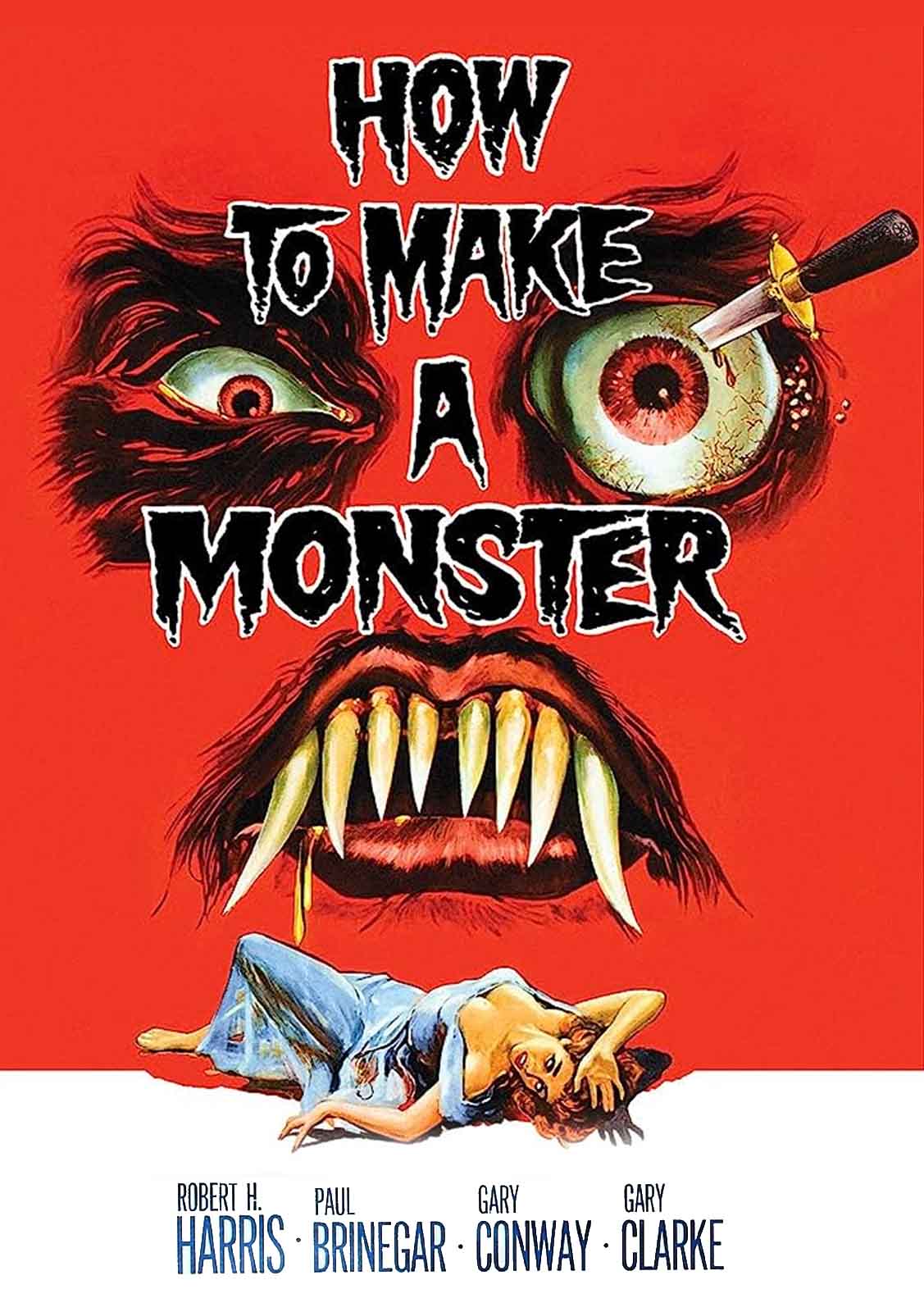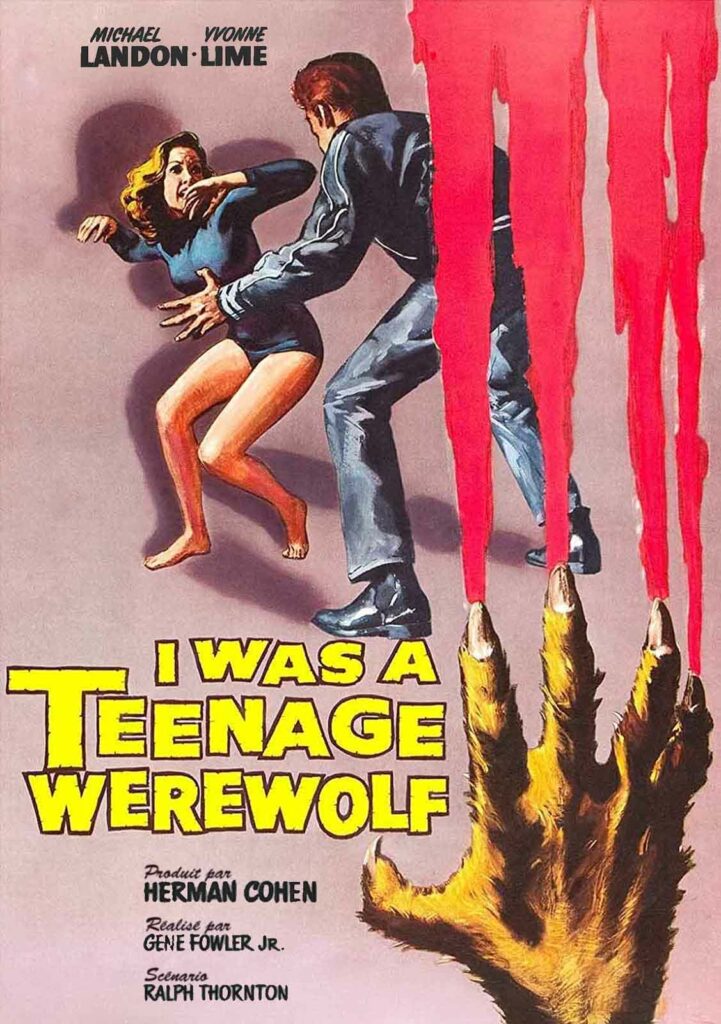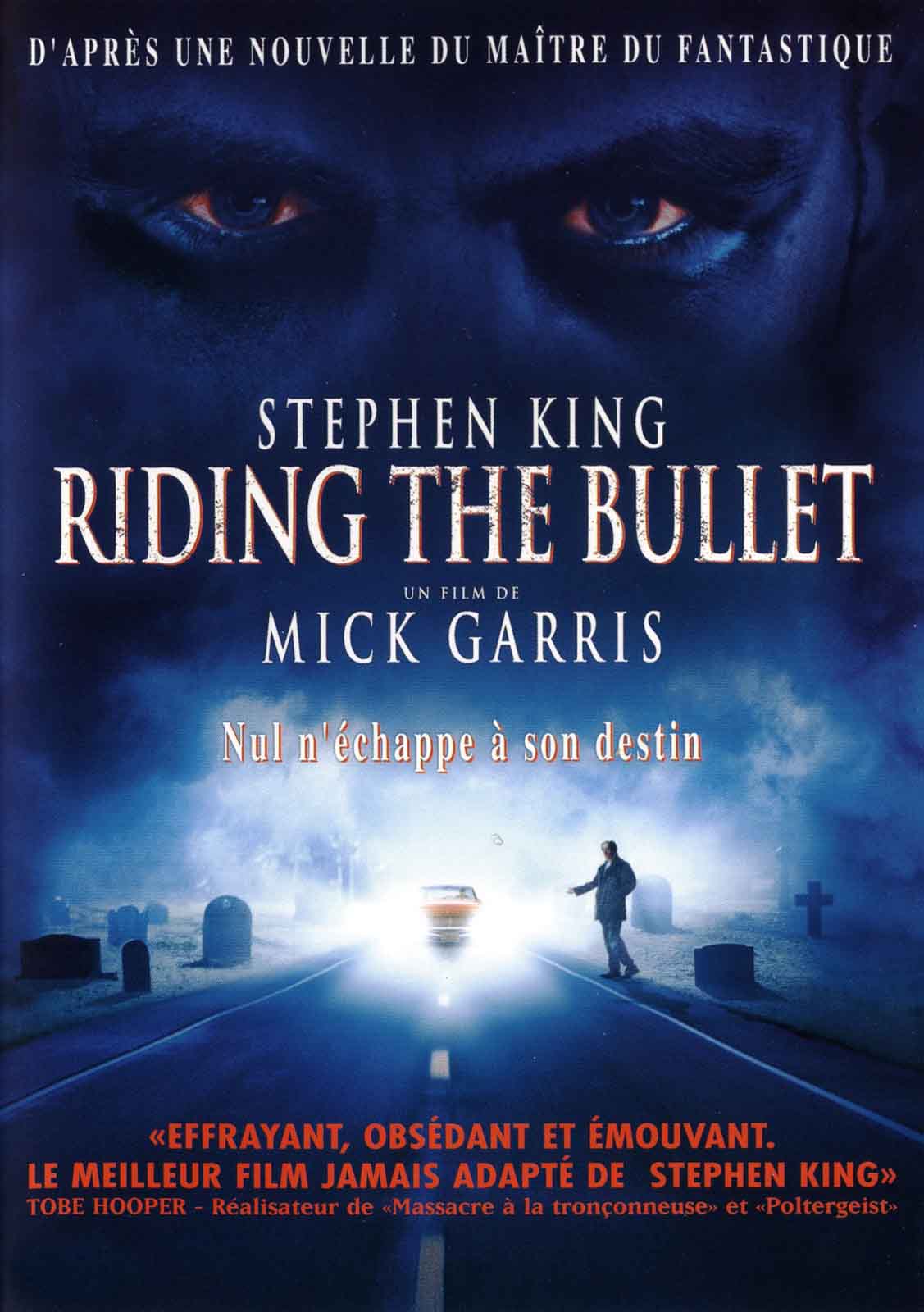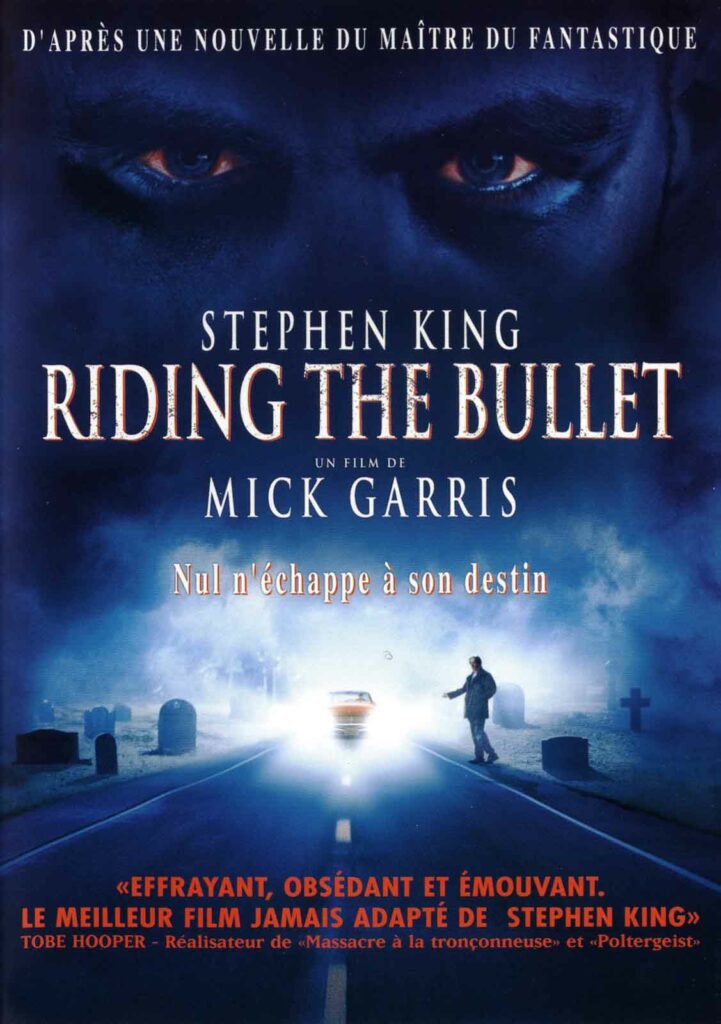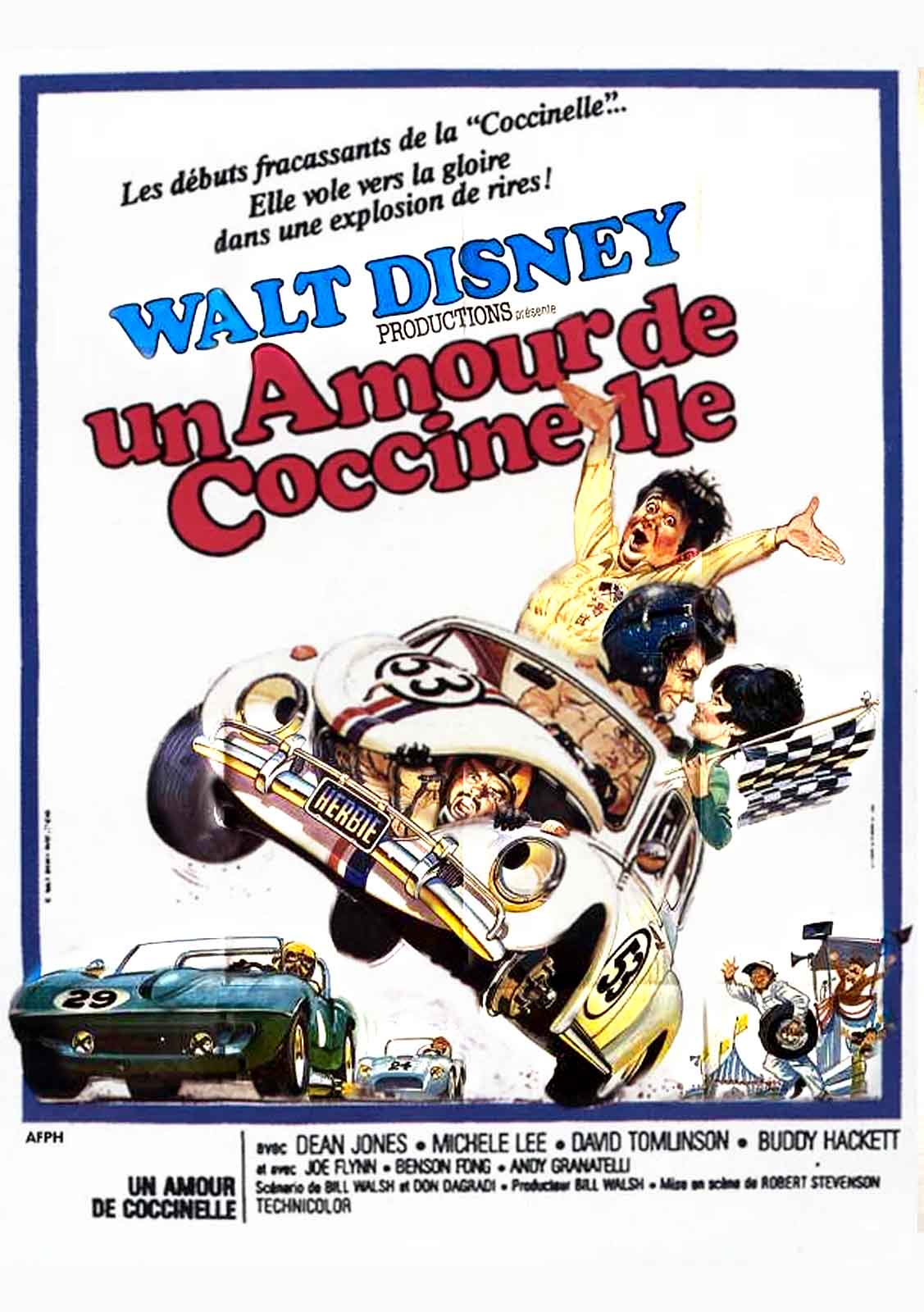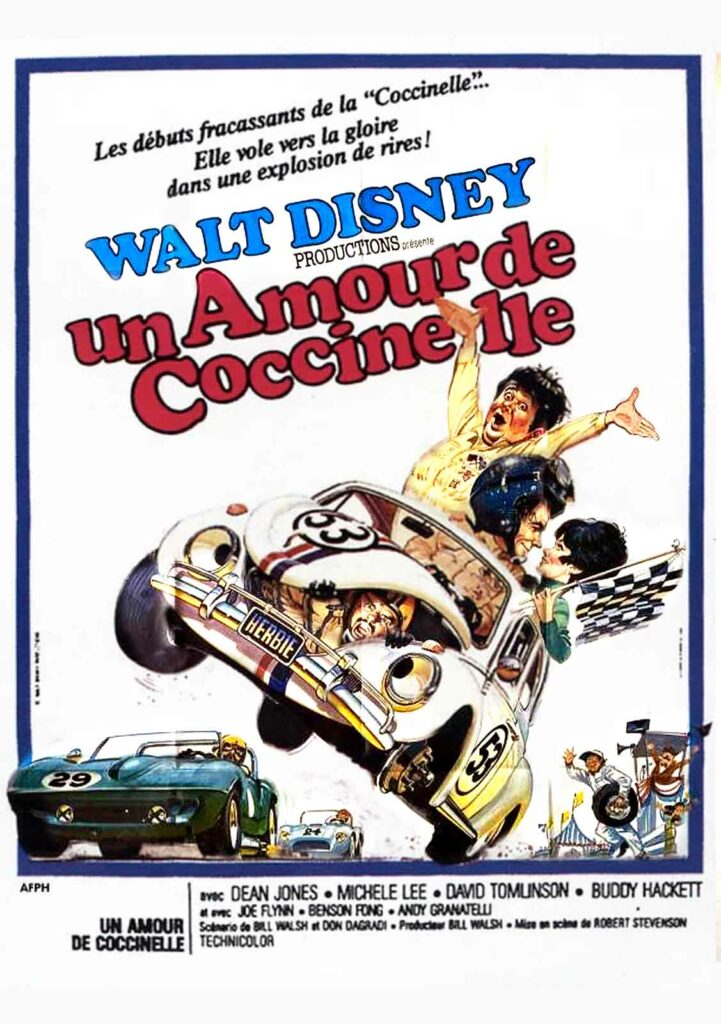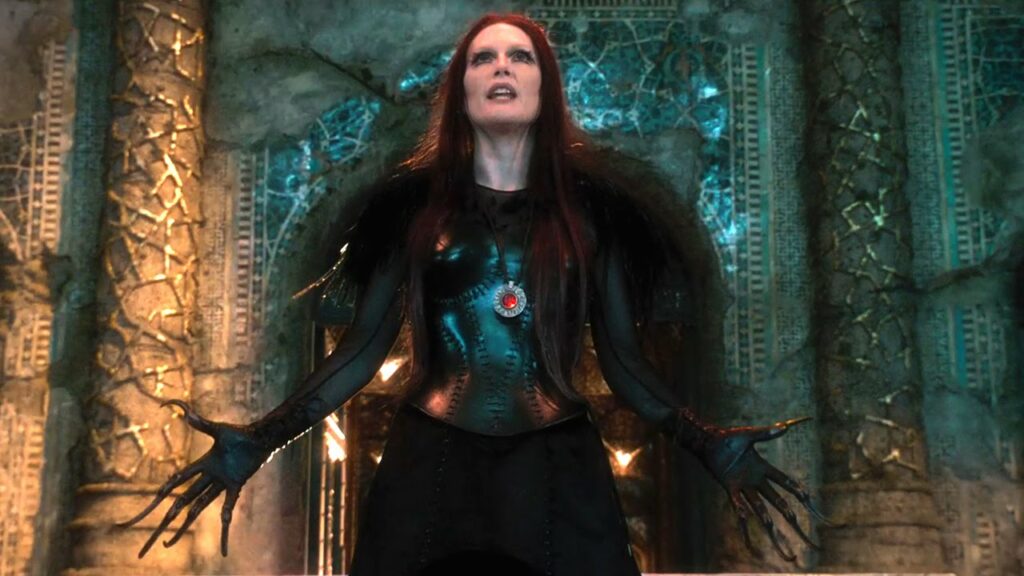Un thriller d’épouvante à base de machinations, de sous-entendus, de faux-semblants et de chats diaboliques…
EYE OF THE CAT
1969 – USA
Réalisé par David Lowell Rich
Avec Michael Sarrazin, Gayle Hunnicutt, Eleanor Parker, Tim Henry, Laurence Naismith, Jennifer Leak, Linden Chiles
THEMA MAMMIFÈRES
L’ombre d’Edgar Poe et de Boileau et Narcejac plane sur ce film extrêmement stylisé à mi-chemin entre le thriller psychologique et le conte d’épouvante. La sublime Gayle Hunnicutt, dont les mini-jupes sixties révèlent une paire de jambes interminables, incarne Cassia Lancaster, une esthéticienne sans scrupule qui projette d’assassiner une de ses clientes malades (Eleanor Parker) dans l’espoir de récupérer sa fortune. Pour y parvenir, elle demande à Wylie (Michael Sarrazin), le neveu de la moribonde, de la persuader de modifier son testament. Un problème vient cependant s’immiscer dans cette conspiration huilée : Wylie a une terrible phobie des chats, depuis qu’un félin a failli l’étouffer dans son berceau. Or la tante Danny, qui dort sous une tente à oxygène, vit au milieu d’une flopée de matous grassouillets auxquels elle a légué sa fortune… Truffé d’effets de montage surprenants, Les Griffes de la peur annonce l’originalité de sa facture dès son générique de début tout en split-screens, soutenu par une partition du génial Lalo Schifrin. Nous étions alors dans les années fastes d’un cinéma libre et inventif, celles où Mike Nichols réalisait Le Lauréat et Sam Peckinpah Guet-apens.


D’ailleurs, les décors naturels de San Francisco où fut tourné le film évoquent bien plus le naturalisme de Bullit que la sophistication de Sueurs froides, même si l’influence d’Alfred Hitchcock est ici assez prégnante. Ce n’est sans doute pas un hasard, dans la mesure où Joseph Stefano, auteur du script des Griffes de la peur, fut aussi celui de Psychose. L’atmosphère générale du film est à la fois très malsaine et étrangement détendue, notamment à travers les étranges relations que Danny entretient avec ses neveux, méprisant celui qui lui est dévoué et adulant celui qui n’a que de vénales intentions. Pour ce dernier, elle semble même nourrir des intentions quasi-incestueuses. Lorsque Wylie constate sa mauvaise mine, elle lui rétorque ainsi avec une voix pleine de sous-entendus : « Je me croyais encore un peu attirante ».
Catfight
Tout le métrage baigne dans une espèce d’humour pince sans rire très british. On parle d’assassiner quelqu’un comme on irait chez le coiffeur. A vrai dire, Les Griffes de la peur est avant tout le récit d’une machination, les chats ne venant ponctuer l’intrigue que sporadiquement, le temps d’effrayer notre protagoniste félinophobe. Dans le climax, ils révèlent cependant une agressivité surnaturelle, constellant de taches écarlates la robe immaculée de l’héroïne au cours d’une séquence fort bien réalisée. Il faut bien reconnaître que le scénario de Stefano est un peu léger, et que le film souffre de nombreuses pertes de rythme. D’où certaines scènes de remplissage d’une gratuité effrontée, comme ce combat entre deux jeunes filles en mini-jupes (lorsqu’on sait que ce type de séquence s’appelle « catfight » en anglais, on comprend l’ironie de la chose). Fort heureusement, la réalisation imaginative de David Lowell Rich dynamite le récit en permanence. La scène de la cavalcade du fauteuil roulant est à ce titre exemplairement filmée et montée. Le metteur en scène ne fera jamais mieux, signant même dix ans plus tard un médiocre Airport 80.
© Gilles Penso
Partagez cet article