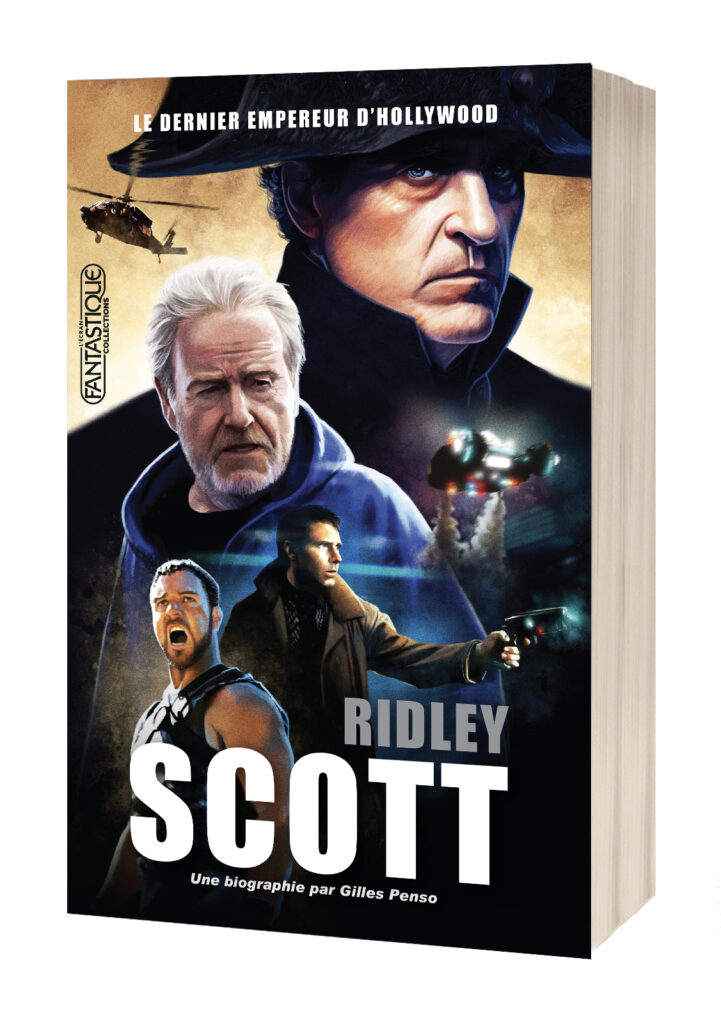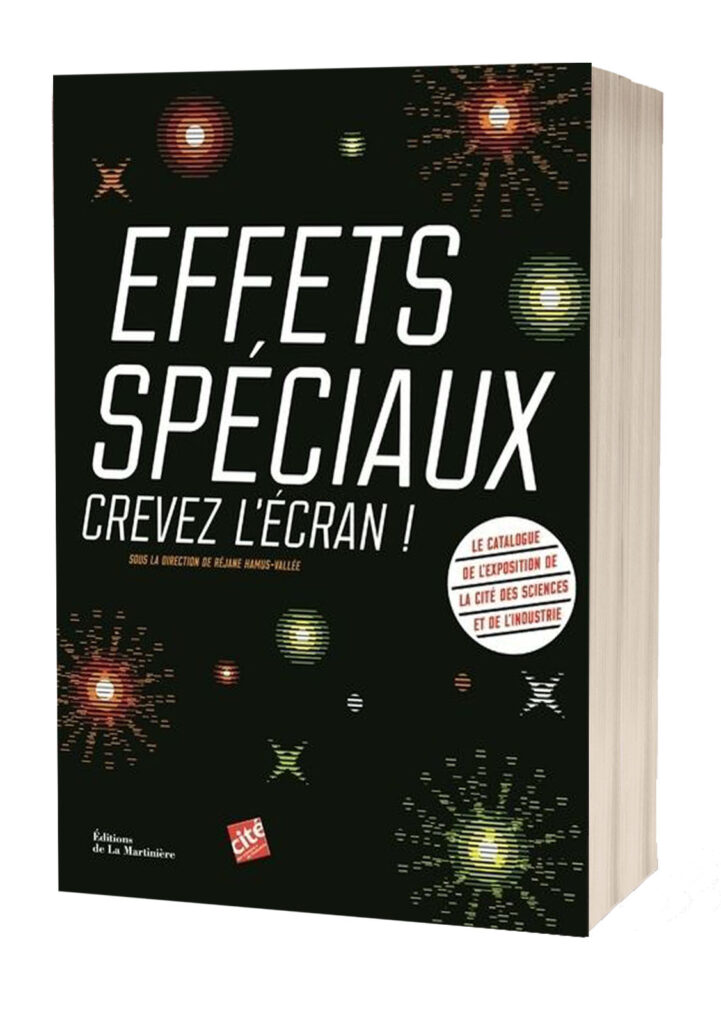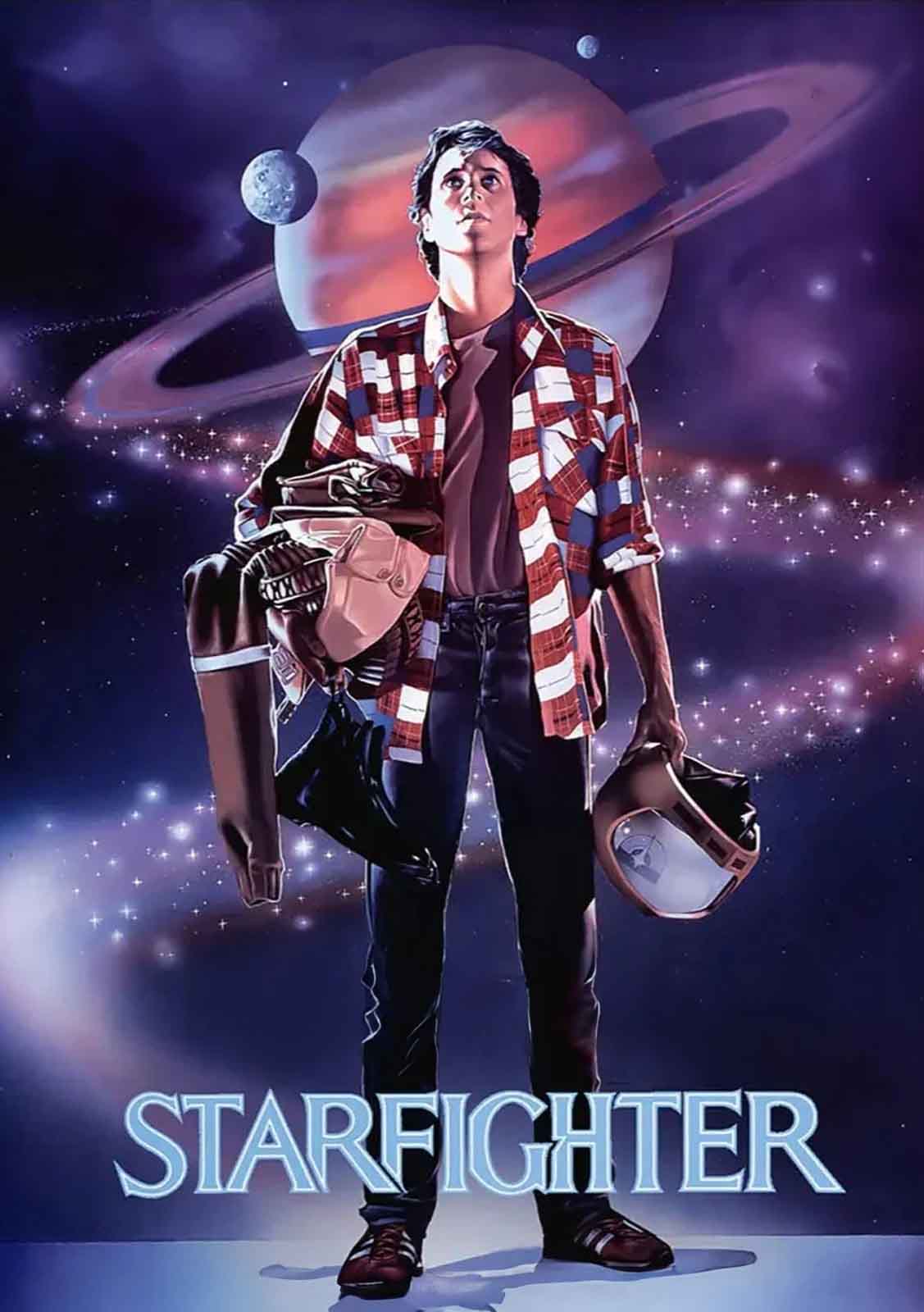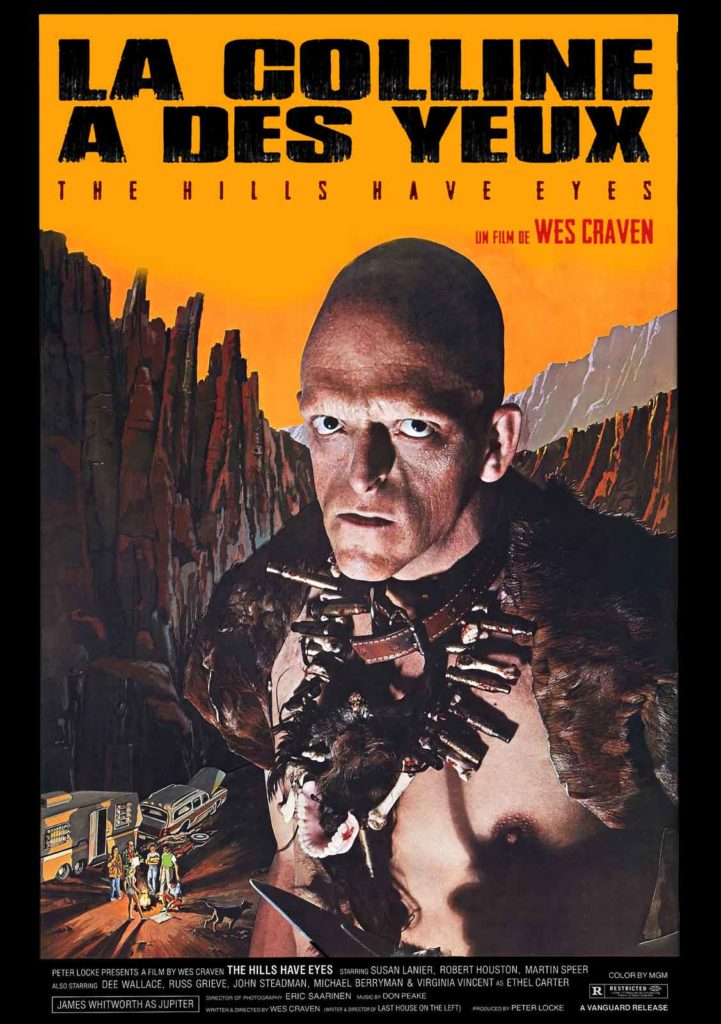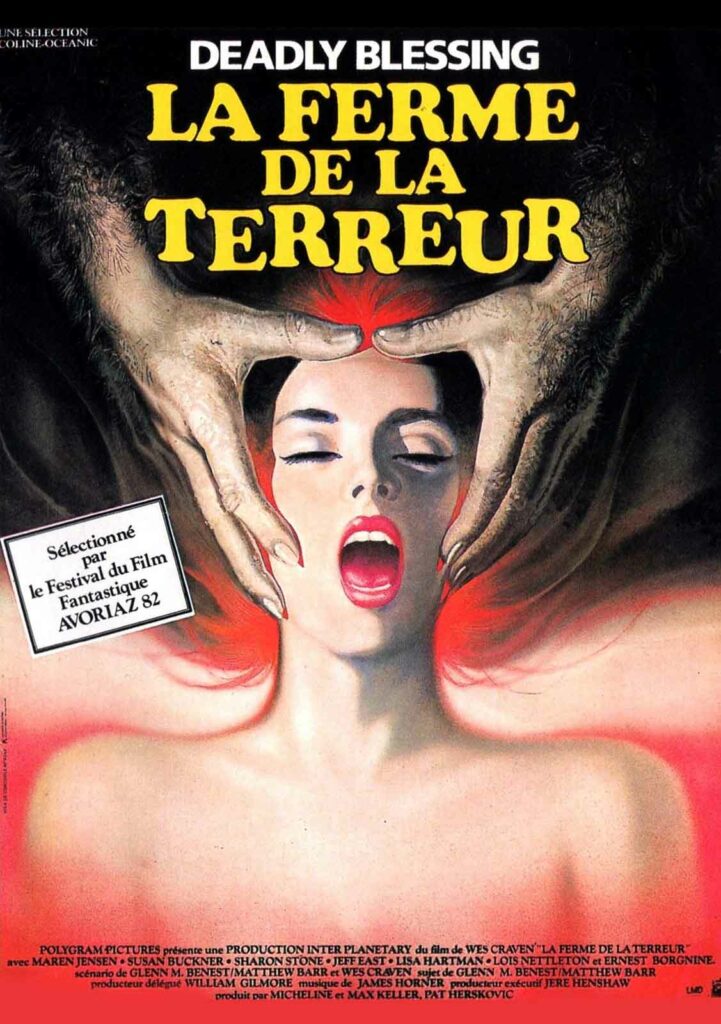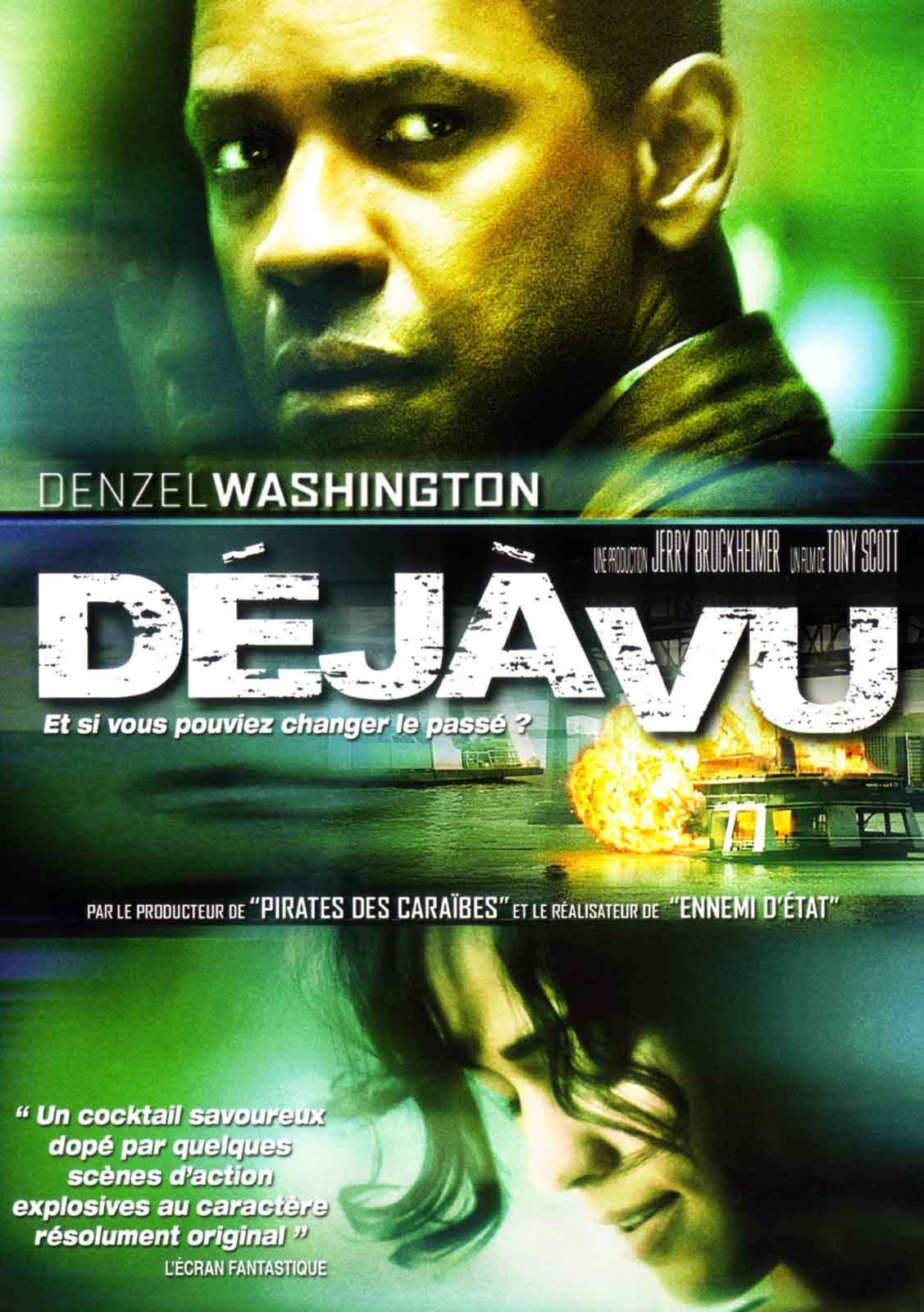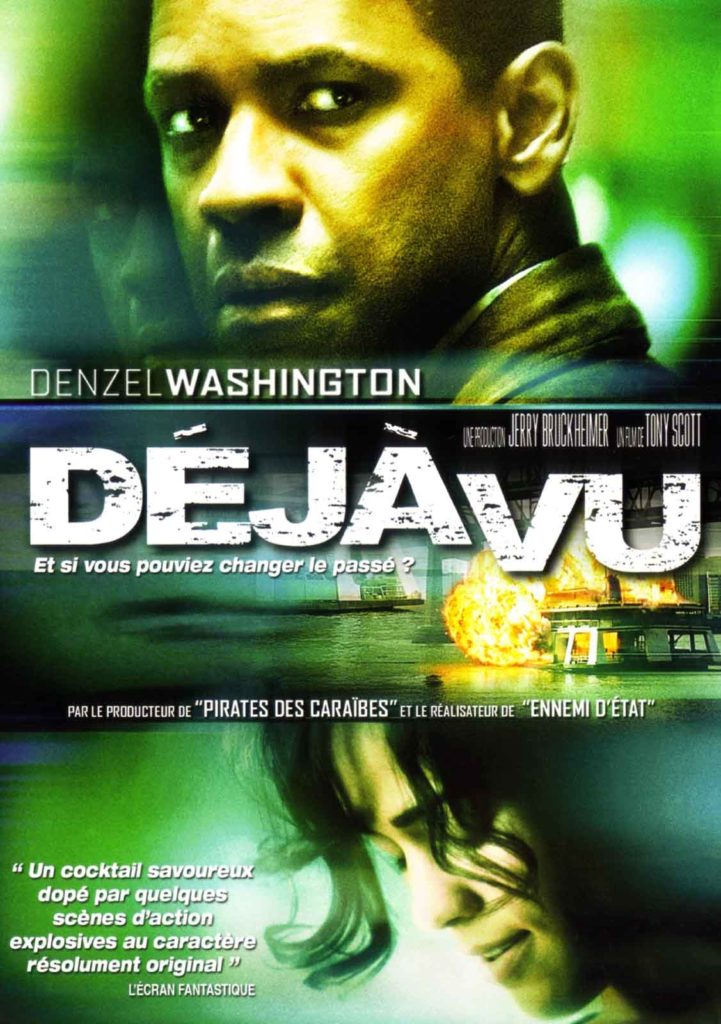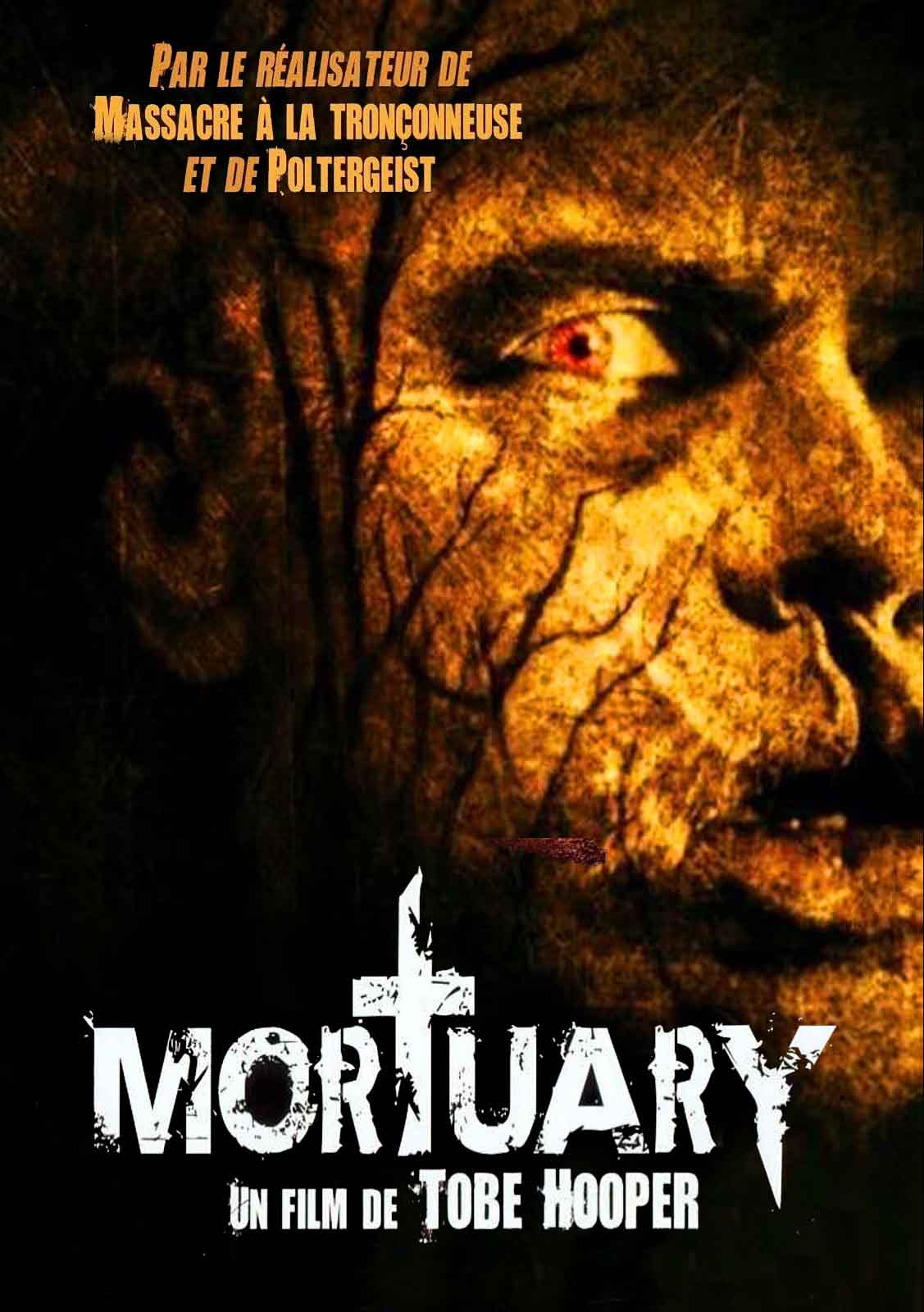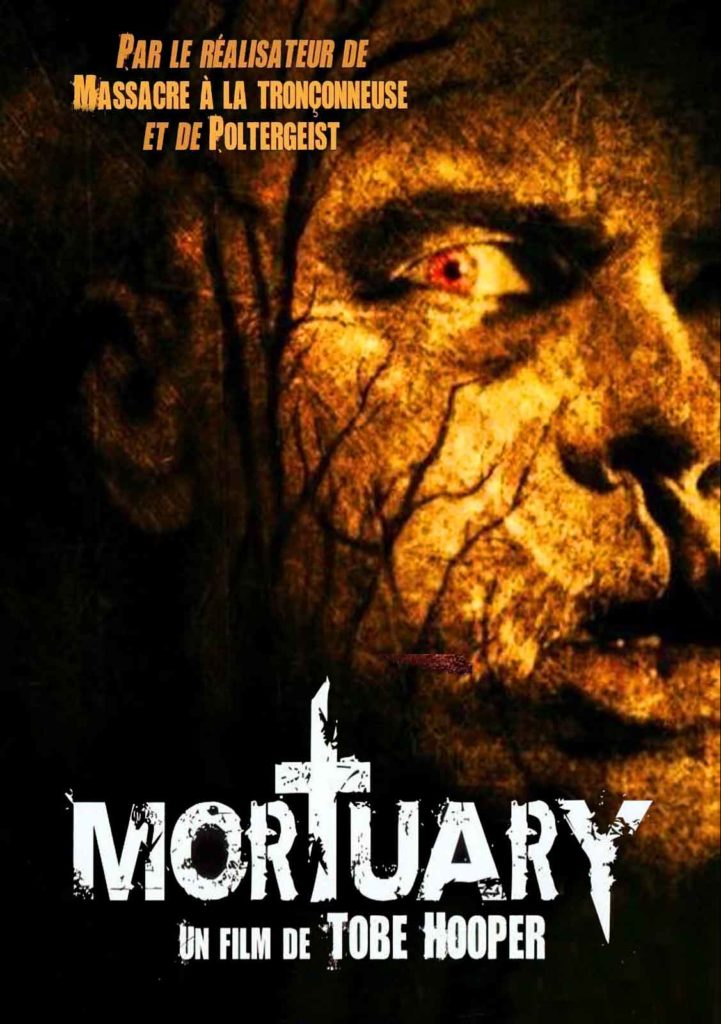Alors qu'une pluie de météorite a rendue aveugle la majorité de la population, des plantes géantes carnivores surgissent à la surface de la Terre…
DAY OF THE TRIFFIDS
1962 – GB
Réalisé par Steve Sekely
Avec Howard Keel, Nicole Maurey, Janette Scott, Kieron Moore, Mervyn Johns, Ewan Roberts, Alison Leggatt, Geoffrey Matthews
THEMA VEGETAUX I CATASTROPHES
Futur auteur des « Coucous de Midwich » qui allait se muer en classique du cinéma de science-fiction (le fameux Village des damnés), John Wyndham écrivait en 1951 « Le Jour des Triffides », un éprouvant récit post-apocalyptique narrant les déboires d’un petit groupe ayant survécu à un cataclysme planétaire. Onze ans après la publication du roman, le metteur en scène d’origine hongroise Steve Sekely en tirait une adaptation cinématographique spectaculaire. Si les personnages et les péripéties imaginées par Wyndham ont considérablement été modifiés par le scénario, l’esprit général reste le même, et les prémisses du film, notamment, sont assez similaires à ceux du livre. Hospitalisé pour une opération des yeux, Bill Masen (Howard Keel, futur personnage récurrent de la série Dallas) rate l’événement dont tout le monde parle : une pluie de météorites multicolore. Mais lorsqu’il se réveille au petit matin, il doit bien reconnaître qu’il a une chance inouïe. En effet, la majeure partie de la population est devenue aveugle au lendemain du phénomène astronomique. En enlevant ses bandages, il découvre donc un monde ravagé, livré à lui-même et à la panique. Un malheur ne venant jamais seul, la pluie de météorites a également donné vie à des plantes géantes carnivores, les triffides, bien décidées à profiter de la cécité de la population pour en faire son plat du jour.


S’il oublie bon nombre d’éléments imaginés par Wyndham, notamment les gangs organisés qui pillent la ville en kidnappant les rares humains encore voyants, le scénario concocte de toutes pièces des séquences de suspense mémorables. Notamment cet avion de ligne sur le point de s’écraser dans la mesure où les pilotes ne voient plus les commandes, le triffide qui menace Bill et la petite Suzan dans les bois brumeux, ou encore celui qui surgit en pleine nuit pour attaquer un couple dans un phare… « Quand cette chose “marchait“, elle se déplaçait comme un homme qui marche avec des béquilles » narrait l’écrivain. Une vision surréaliste fort bien rendue ici grâce à des trucages mécaniques et des effets sonores efficaces.
Cataclysme à grande échelle
Mais là où les effets spéciaux coupent littéralement le souffle, c’est dans la description du cataclysme à grande échelle qui frappe la planète. Via des caches, des maquettes et des matte paintings ingénieux, le film nous décrit de gigantesques incendies ravageant Tokyo, un Arc de Triomphe parisien jonché de véhicules accidentés, ou encore les rues de Londres envahies de passants aveugles se déplaçant comme des zombies. Des images qui préfigurent le cinéma catastrophe des années 70. Après avoir réuni un petit groupe de survivants, notre héros tachera de prendre la fuite à travers l’Europe, jusqu’à un climax à grande échelle le mettant aux prises avec des centaines de triffides, seul et armé d’un simple lance-flammes. Dommage que le film s’achève sur un happy-end aussi convenu que tiré par les cheveux, au lieu d’opter pour la fin ouverte et un tantinet pessimiste suggérée par le livre. En 1981, Ken Hannam réalisera la mini-série Day of the Triffids, moins marquante, certes, mais plus fidèle au matériau littéraire initial.
© Gilles Penso
Partagez cet article