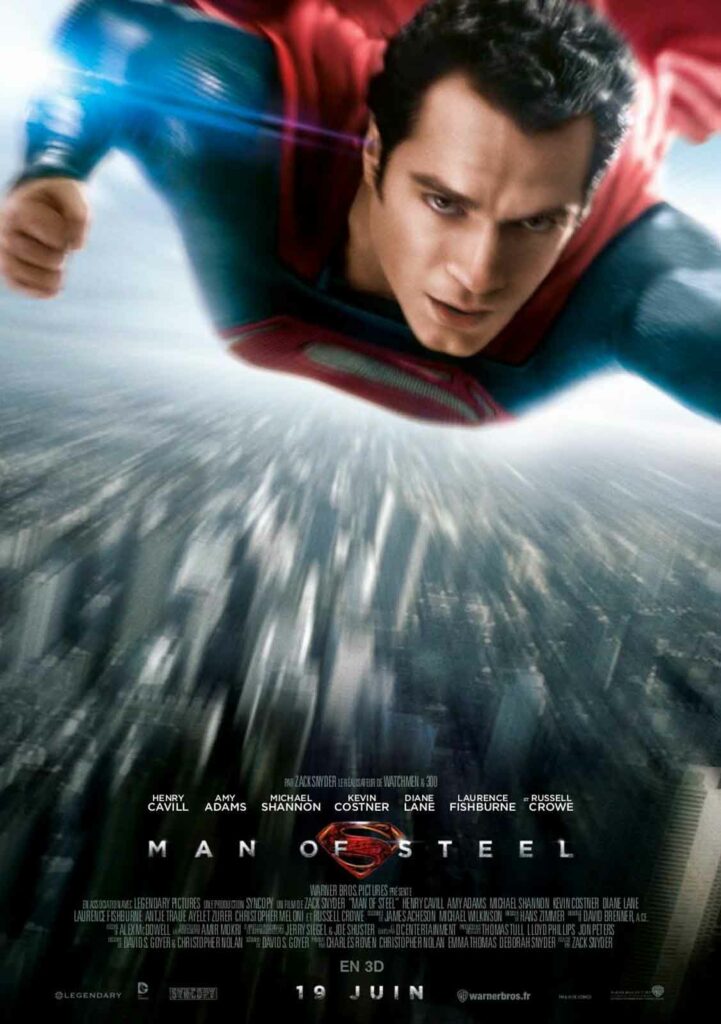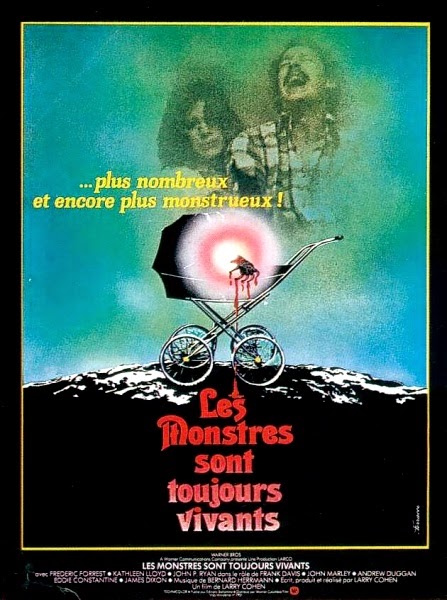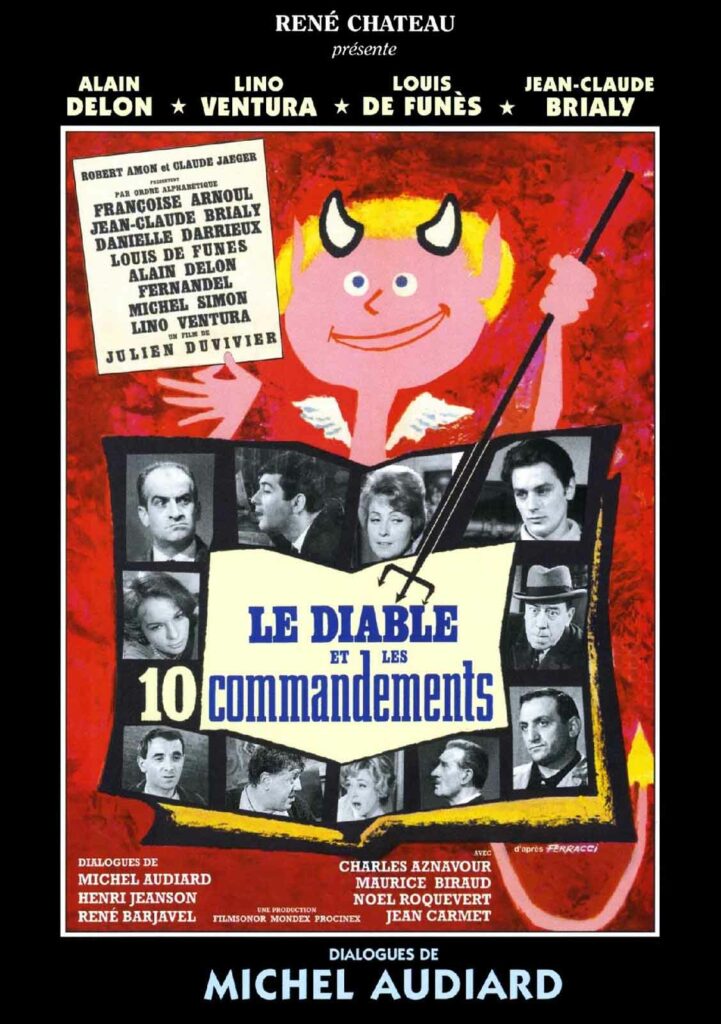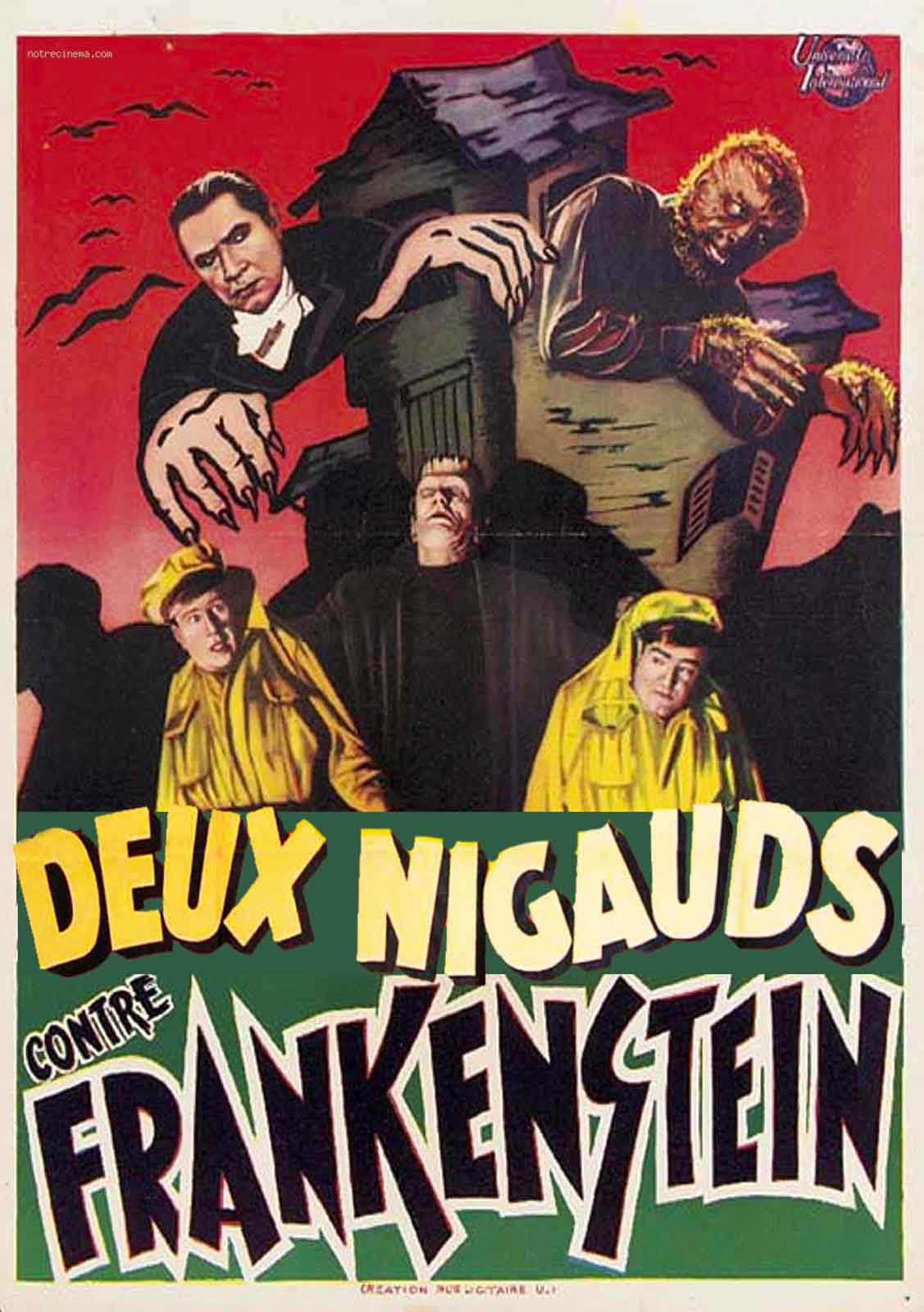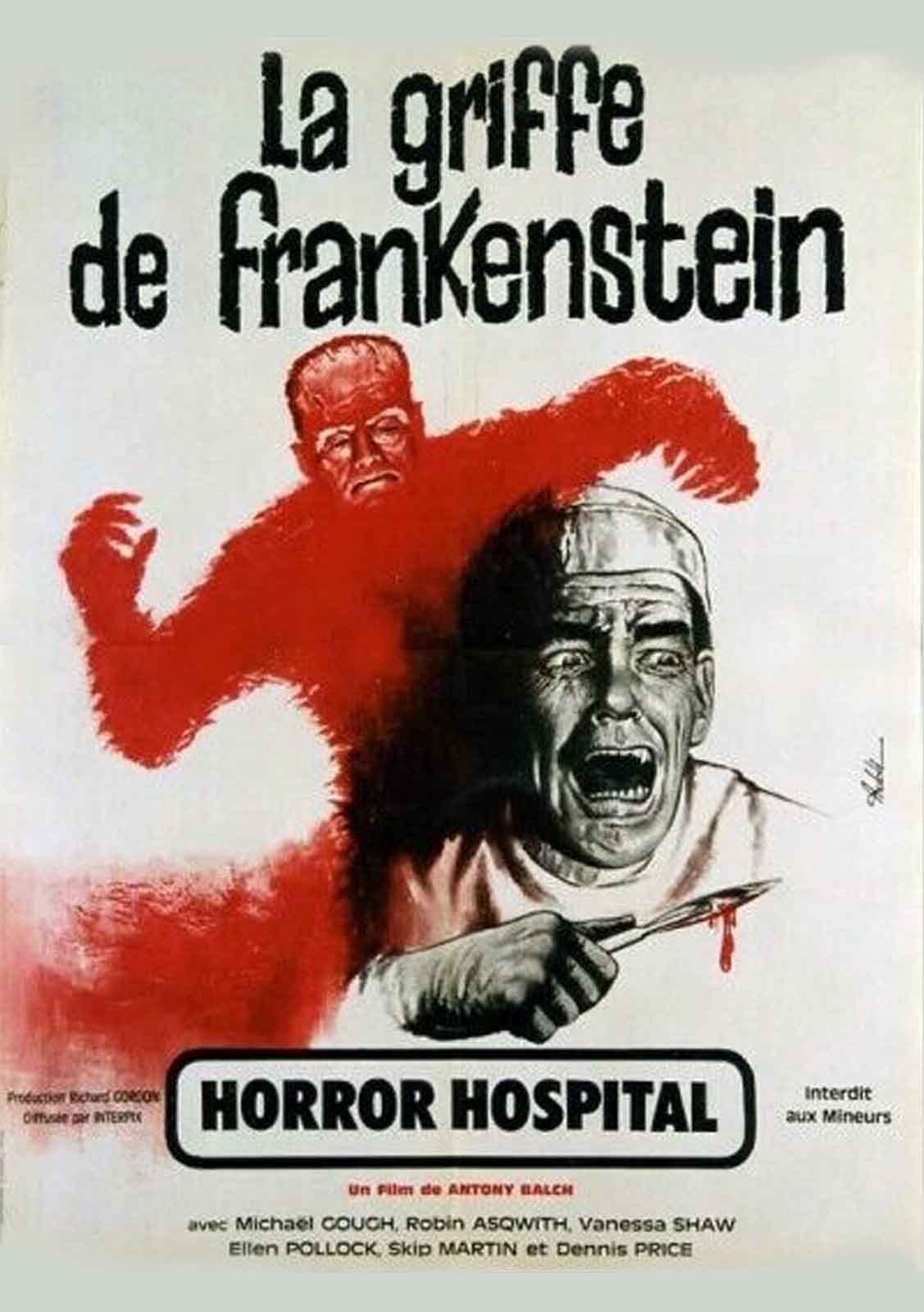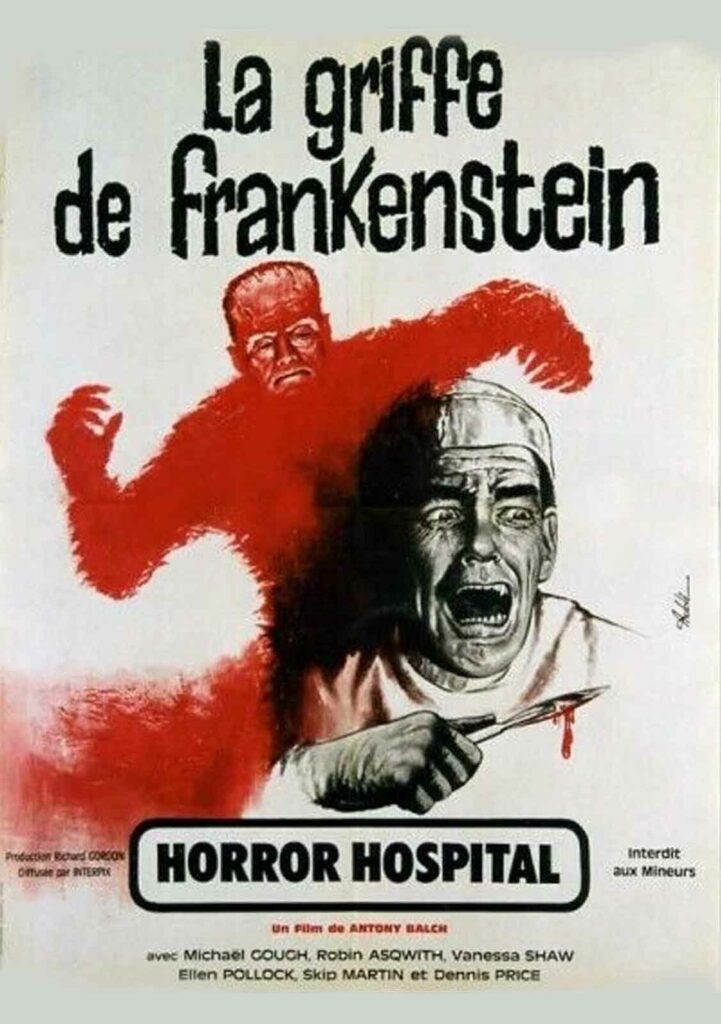Brad Pitt affronte des hordes de zombies dans un film ultra-spectaculaire à défaut d'être cohérent
WORLD WAR Z
2013 – USA
Réalisé par Marc Forster
Avec Brad Pitt, Mireille Enos, Daniella Kertesz, James Badge Dale, Ludi Boeken, Matthew Fox, Fana Mokoena, David Morse
THEMA ZOMBIES
Quand on est le fils de Mel Brooks et d’Anne Bancroft, il n’est pas évident d’affirmer sa propre personnalité sans être à l’ombre de ses prestigieux géniteurs. A travers deux ouvrages atypiques détournant le motif de l’invasion de morts-vivants, Max Brooks s’est pourtant fait un prénom et a su rencontrer le succès. Après un faux manuel pratique, « Guide de Survie en Territoire Zombie » (2003), il imagine avec « World War Z » (2009) une guerre mondiale entre humains et zombies narrée par plusieurs témoins du drame. Sous la houlette du studio Paramount, Brad Pitt, Dede Gardner et Jeremy Kleiner, associés au sein de la compagnie de production Plan B, confient à Marc Forster l’adaptation de « World War Z », et décident d’abandonner la narration à la première personne pour une structure plus classique. Les premières scènes nous révèlent le quotidien de Gerry Lane (Brad Pitt), ancien enquêteur des Nations Unies désormais homme au foyer soucieux de prendre soin de son épouse et de ses deux filles. La petite famille se retrouve bientôt bloquée dans un embouteillage, en plein centre de Philadelphie. L’attente dure, quelques clameurs étranges retentissent, des motos se faufilent nerveusement entre les voitures… Et puis soudain, c’est le chaos : une explosion, un carambolage spectaculaire, prélude à l’horreur massive.


Lorsque la caméra s’élève pour nous révéler des milliers de zombies arpentant les rues embouteillées en quête de chair fraiche, au milieu des flammes et de la panique, le vertige nous prend. World War Z accumule ainsi les séquences dantesques. Point d’orgue de cette démesure : des milliers de zombies qui grimpent les uns sur les autres pour constituer une titanesque pyramide grouillante partant à l’assaut des plus hautes murailles, voire des hélicoptères en plein vol ! Ici, la nature des créatures semble hybride. Les esprits cartésiens se réfèrent à la propagation d’un virus, mais les causes surnaturelles ne sont pas écartées. A l’avenant, les monstres empruntent tour à tour les deux attitudes qu’on attribue respectivement aux morts-vivants et aux infectés. Lorsqu’ils sont « au repos », sans stimulation particulière, ils traînent la patte en gémissant mollement, comme chez George Romero. Mais si une victime potentielle titille leurs tympans, leur rythme s’accélère brusquement et ils s’avèrent capables de folles acrobaties.
Aux premières loges du chaos
On peut regretter que World War Z, évacue toute séquence gore au profit d’une action soutenue, sans doute pour toucher un large public. Mais le défaut principal du film réside dans ses incohérences scénaristiques. En choisissant des centaines de points de vue différents, l’écrivain nous proposait d’appréhender la situation dans sa globalité. Mais les scénaristes ont opté pour un seul protagoniste. Du coup, c’est à lui que tout arrive, de manière parfois assez invraisemblable. Il est aux premières loges des débuts de l’infection, assiste en direct au renversement d’une cité jusqu’alors parfaitement protégée, survit par miracle à un crash aérien et trouve tout seul la solution pour éradiquer le fléau. Malgré le charisme de Brad Pitt, une telle accumulation de coïncidences est un peu difficile à avaler, et gâche un peu le plaisir d’un spectacle qui, par ailleurs, s’avère particulièrement généreux.
© Gilles Penso
Partagez cet article