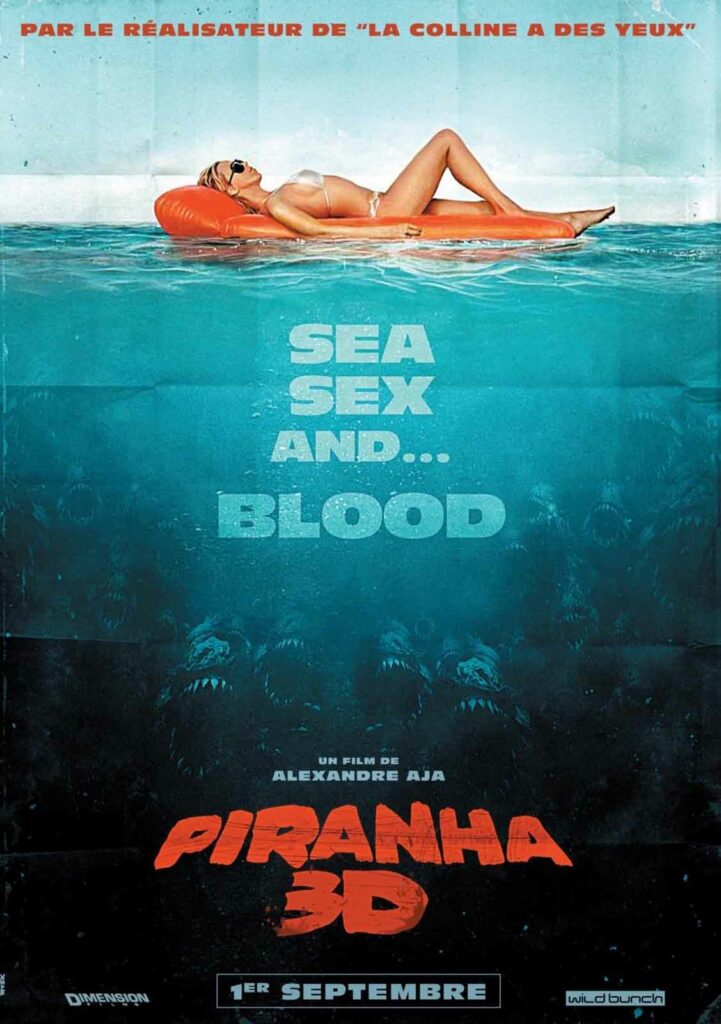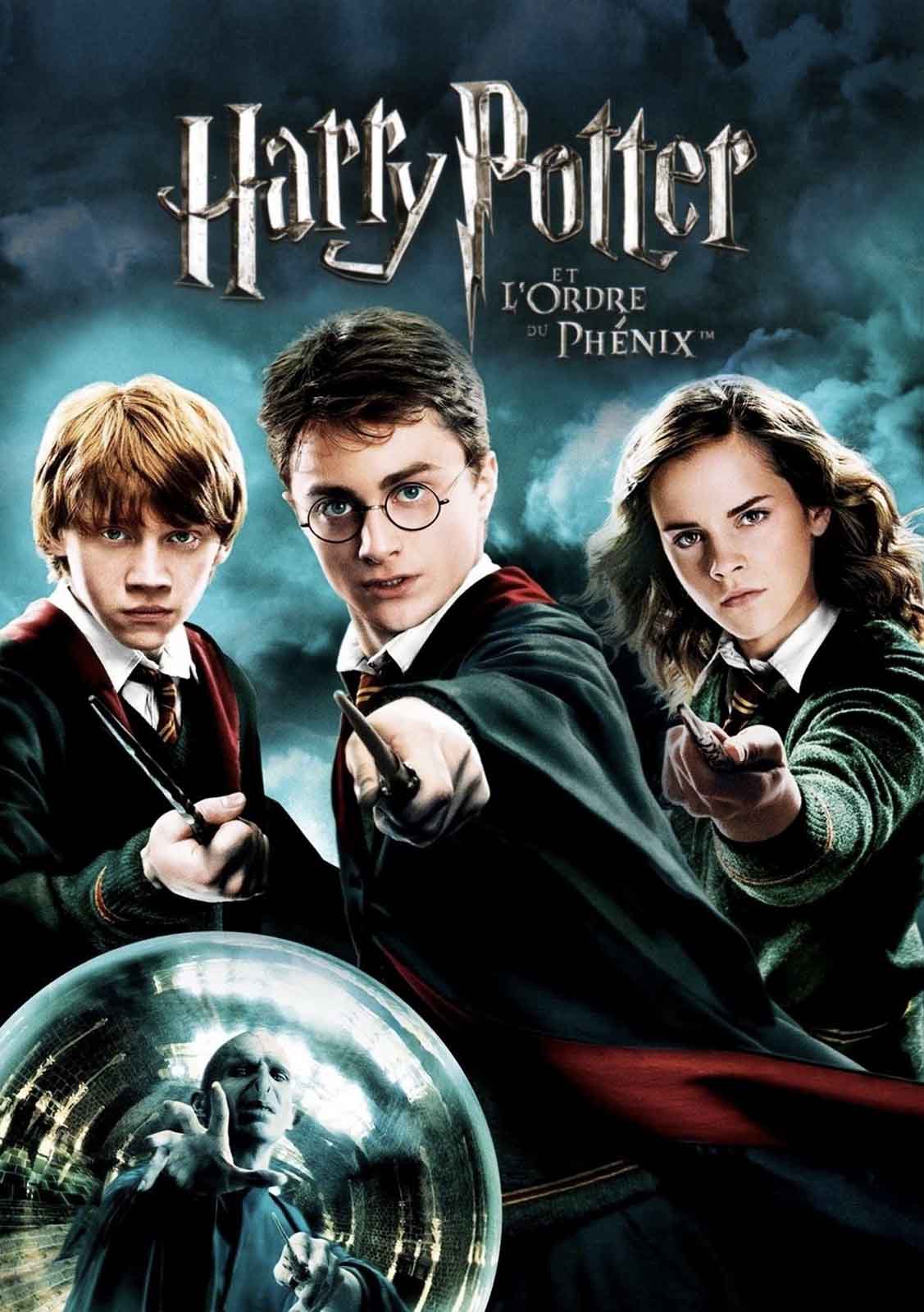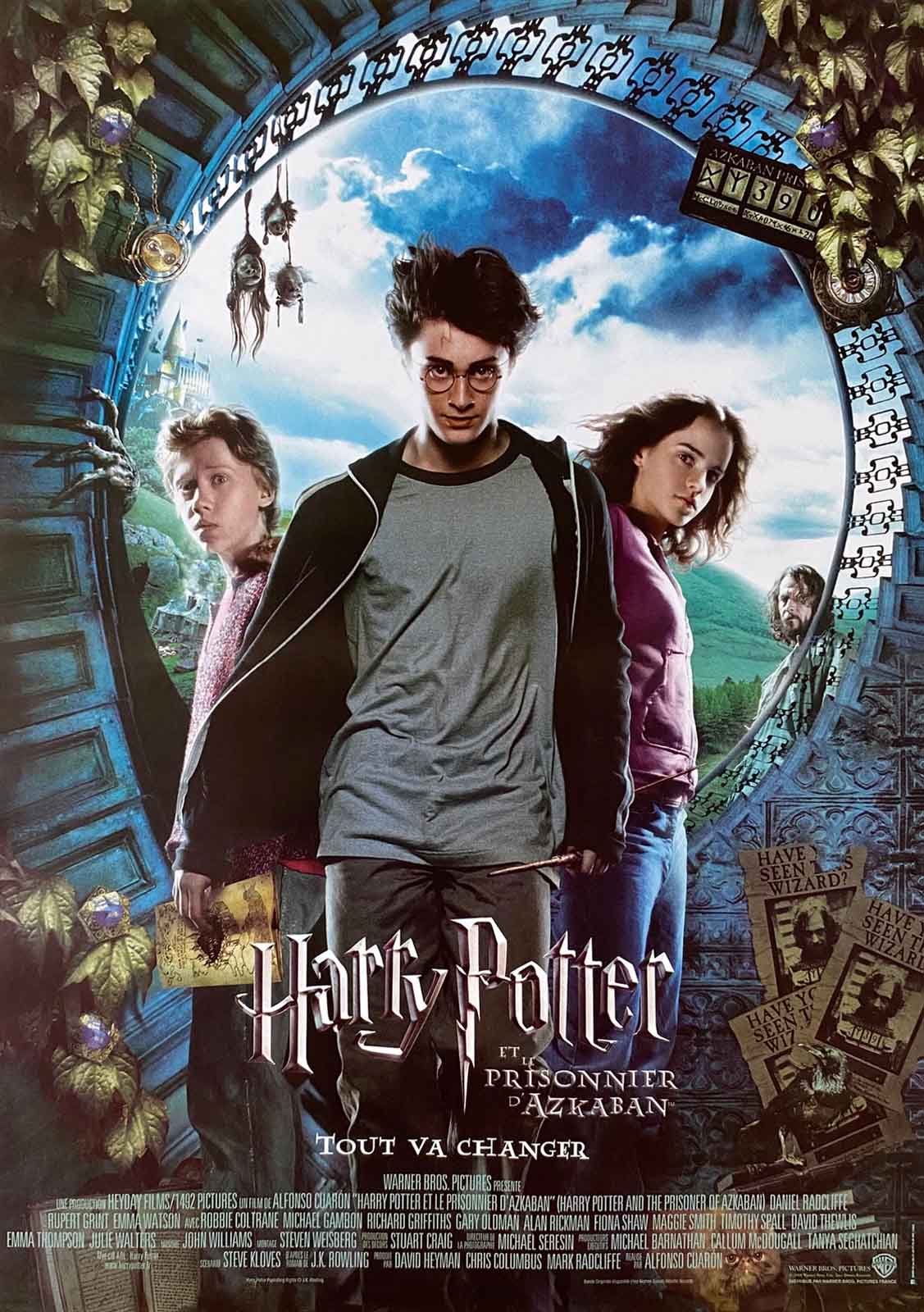Une séquelle décevante qui annihile tout effet de surprise et multiplie à loisir les incohérences…
THE DESCENT PART 2
2009 – GB
Réalisé par Jon Harris
Avec Shauna MacDonald, Natalie Mendoza, Krysten Cummings, Gavan O’Herlihy, Joshua Dallas, Anna Skellern, Douglas Hodge
THEMA CANNIBALES
Tous ceux qui avaient été fortement impressionnés et très agréablement surpris par The Descent (et ils sont nombreux) accueillirent avec beaucoup de suspicion l’annonce d’une pourtant inévitable séquelle. Comment retrouver la hargne, la surprise, la nouveauté et la spontanéité du huis clos de Neil Marshall ? D’autant que ce dernier cède ici le pas à son monteur Jon Harris, passant pour la première fois derrière la caméra. Autant le dire tout de suite : la déception dépasse largement toutes nos craintes. Le premier problème majeur de cette suite est qu’elle repose sur le montage américain de The Descent, sensiblement différent de la version originale vue en Europe. En effet – attention, la phrase qui suit est réservée à ceux qui ont vu le premier film – si Neil Marshall avait réservé à son héroïne Sarah un sort peu enviable en la laissant définitivement enfermée dans les dédales souterrains où régnaient les redoutables « crawlers », les distributeurs US ont opté pour un ridicule happy ending lui permettant de ressortir à la surface et de s’échapper.


The Descent part 2 reprend donc l’action à ce stade précis. Sarah (toujours incarnée par Shauna MacDonald) est passablement traumatisée, et une équipe de secours dirigée par l’acariâtre shérif Vaines (Gavan O’Herlihy) s’apprête à redescendre sous terre afin de retrouver les cinq disparues. Via un prétexte scénaristique gros comme une maison, Sarah est sommée d’intégrer cette équipe, et le cauchemar recommence sans surprise… Le film multiplie dès lors les incohérences (certains personnages morts dans le film précédent reviennent ici en pleine forme), les effets faciles (les monstres n’en finissent plus de surgir dans le champ de la caméra en faisant « bouh ! » pour nous effrayer), les caractérisations caricaturales (Sarah s’est muée en véritable Terminator, le shérif est un sale type antipathique sans l’once d’une nuance) et les rebondissements absurdes (la scène finale, dans le genre, vaut son pesant de cacahuètes).
Une équipe de secours héritée d'Aliens
Mangeant un peu à tous les râteliers, Jon Harris se dit que quelques trucages gore ne peuvent pas faire de mal, faisant donc gicler le sang et charcutant la chair humaine dès que l’occasion se présente, et confond rythme et rapidité, concoctant des scènes d’action parfaitement illisibles – ce qui est tout de même un comble pour un ex-monteur. Certes, deux ou trois séquences de suspense surnagent, notamment lorsque les protagonistes doivent braver leur vertige, mais l’ensemble gravite désespérément au premier degré, oubliant toutes la métaphore de la pénétration de l’intimité féminine qui sous-tendait le premier The Descent pour se contenter d’en imiter servilement – et maladroitement – les scènes choc. C’est d’autant plus dommage que le pitch de cette séquelle – une équipe de secours menée par la survivante d’un massacre part à la chasse aux monstres sur un terrain hostile – rappelait beaucoup celui d’Aliens et aurait donc pu donner lieu à un second épisode mouvementé transcendant les composantes du premier opus. Mais il eut fallu à la barre du projet des artistes animés par une vision, un sens artistique et un discours qui font ici cruellement défaut.
© Gilles Penso
Partagez cet article