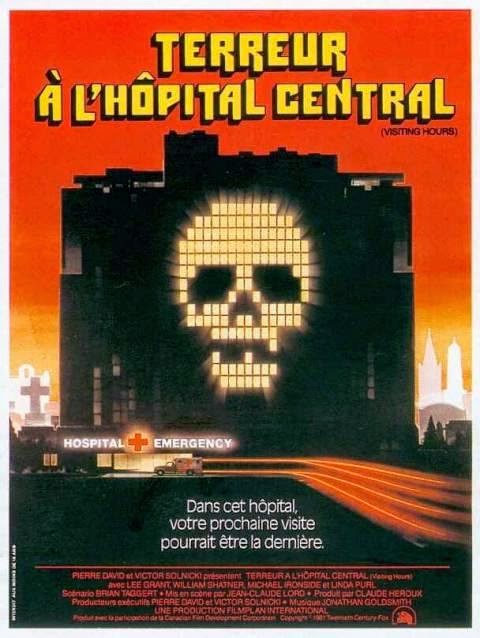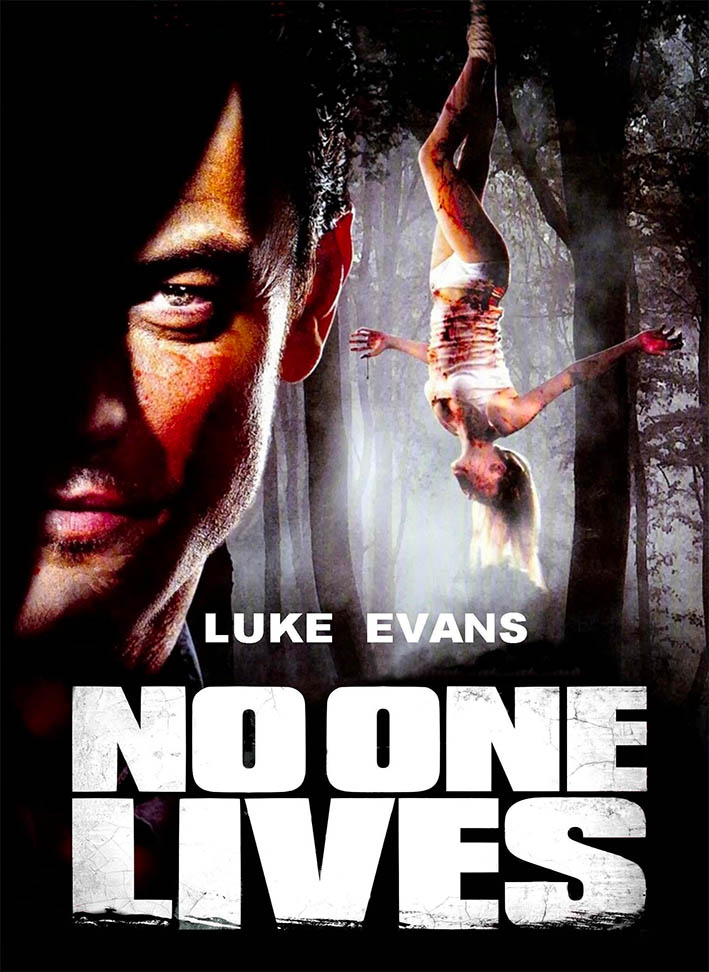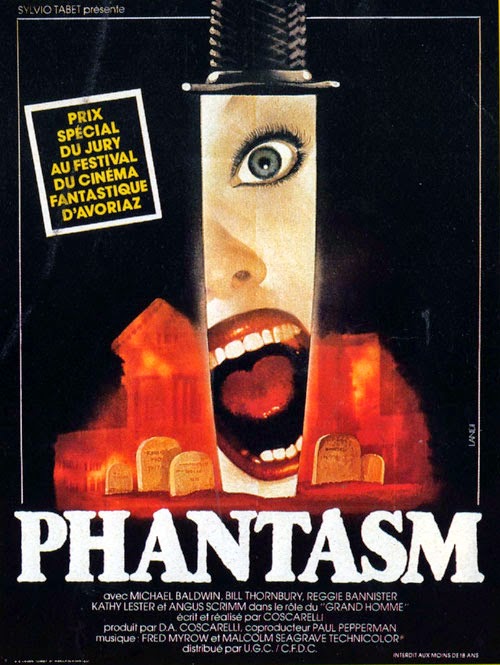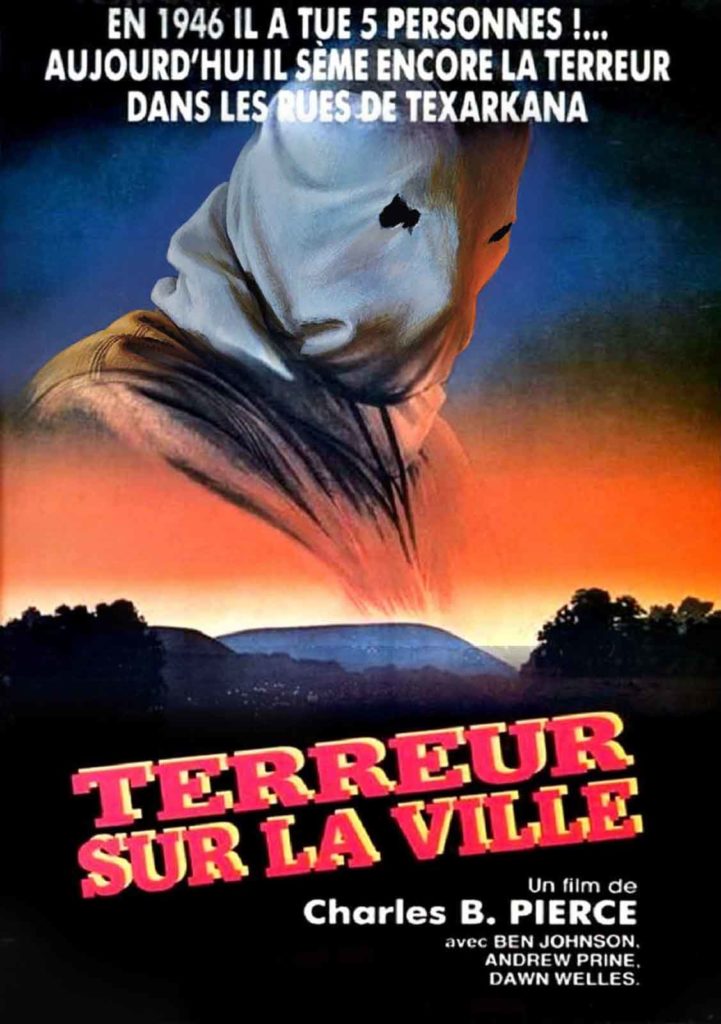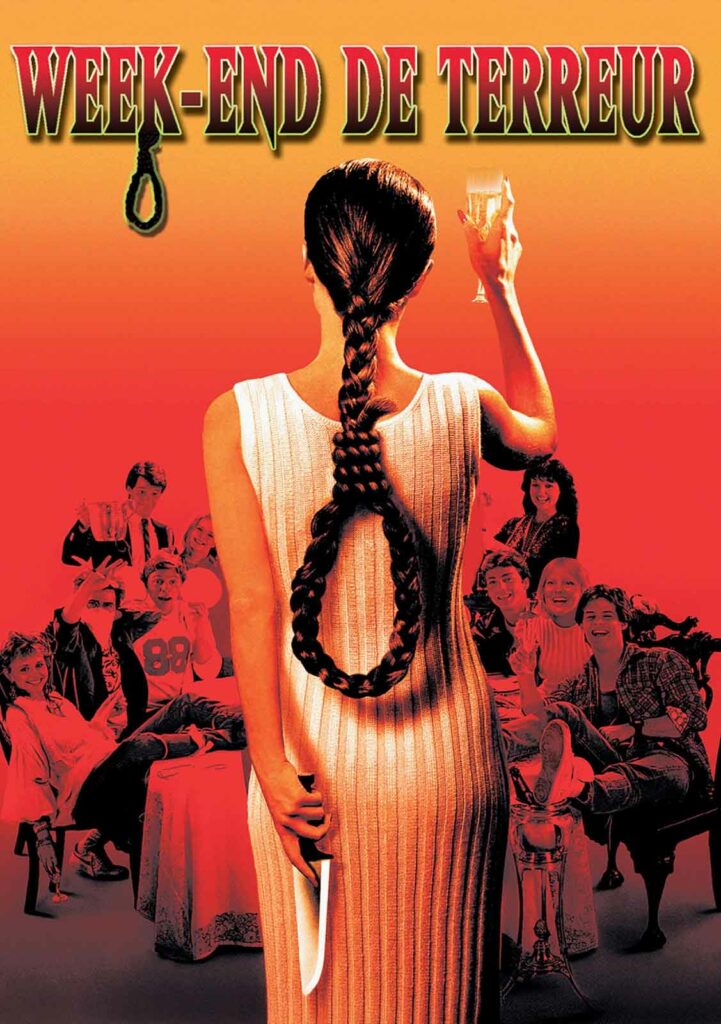Evan Goldberg et Seth Rogen nous racontent la fin du monde en rallongeant un de leurs courts-métrages burlesques
THIS IS THE END
2013 – USA
Réalisé par Evan Goldberg et Seth Rogen
Avec Paul Rudd, Emma Watson, Jay Baruchel, Seth Rogen, James Franco, Jonah Hill, Jason Segel, Rihanna
THEMA CATASTROPHES
Seth Rogen et Evan Goldberg, en étirant sur un format long l’idée de base du court-métrage Jay & Seth vs the Apocalypse, ne composent rien d’autre qu’une bromédie faisant de l’œil à tous les amateurs de la Apatow Academy. Une brochette d’acteurs sur le devant dans la scène vous invite dans ses coulisses avant d’affronter des démons priapiques. Tout un programme… Hasard du calendrier des productions, deux œuvres envisagent, à quelques mois d’intervalle, l’Apocalypse à traverse le prisme d’une bande de losers. Et quelle bande ! Côté britannique, la bande d’Edgar Wright fait le tournée des pubs et se retrouvent nez à nez avec des extraterrestres robotiques. Côté américain, la fiesta organisée chez James Franco réunit entre autres Seth Rogen, Jay Baruchel, Jason Segel, Michael Cera, Christopher Mintz-Plasse, Jonah Hill, Craig Robinson, Danny McBride et Rihanna.


N’en jetez plus, le gotha de la nouvelle vague hollywoodienne est au quasi complet pour une blague de potaches remplie d’autodérision qui fait s’effriter quelque peu le vernis de la bienséance. Presque quarantenaires et plus du tout puceaux, les enfants d’Apatow relèguent les faux-semblants au placard et se paient une heure de vérité à coups de répliques virulentes, de dialogues surréels (le débat autour de l’éjaculation de Franco et McBride) et peintures grossières (Michael Cera, bien loin de l’image de Juno, est un cocaïnomane patenté se livrant à une série de débauches). Evidemment, l’équipée décadente ne peut éviter longtemps les foudres divines et ne trouvera le salut et la rédemption qu’en se détachant de la vie matérielle et en se montrant altruiste, une quête des plus ardue pour ce concentré de mégalomanie.
Improvisations et roue libre
Si, en théorie, C’est la fin atteint, en termes de comédie, l’apogée du genre (une certaine authenticité due à la grande place laissée à l’improvisation et au jeu en roue libre), à l’écran, la réalité s’avère moins excitante. La mécanique de l’humour s’attarde invariablement sous la ceinture et accorde une part déraisonnable aux diverses sécrétions humaines (du vomi, de la pisse, de la merde à la pelle). En outre, le scénario patine sévère et enferre ses protagonistes entre quatre murs, ce qui contraint l’histoire à se cantonner à une pléiade de répliques rarement drôles et à un ersatz de possession démoniaque directement tiré de L’Exorciste. Lorsque les parois s’écroulent, le métrage loupe une nouvelle fois les rails (l’intrigue n’évolue pas d’un iota, les effets spéciaux oscillent du médiocre au mauvais) mais offre ponctuellement l’une ou l’autre idées un tant soit peu loufoques (un come-back inespéré pour les enfants des 90’s, un Channing Tatum méconnaissable, un démon géant aussi bien monté que mal foutu). C’est la fin possède un certain tonus et de très bonnes intentions mais ne peut éviter la noyade à force de devoir suivre au plus près chacun de ses personnages qui tentent tant bien que mal de tirer leur épingle dans cette mélasse ultra-référentielle. Un trop-plein qui vire à l’indigestion… Avec son lot de vomi…
© Damien Taymans
Partagez cet article