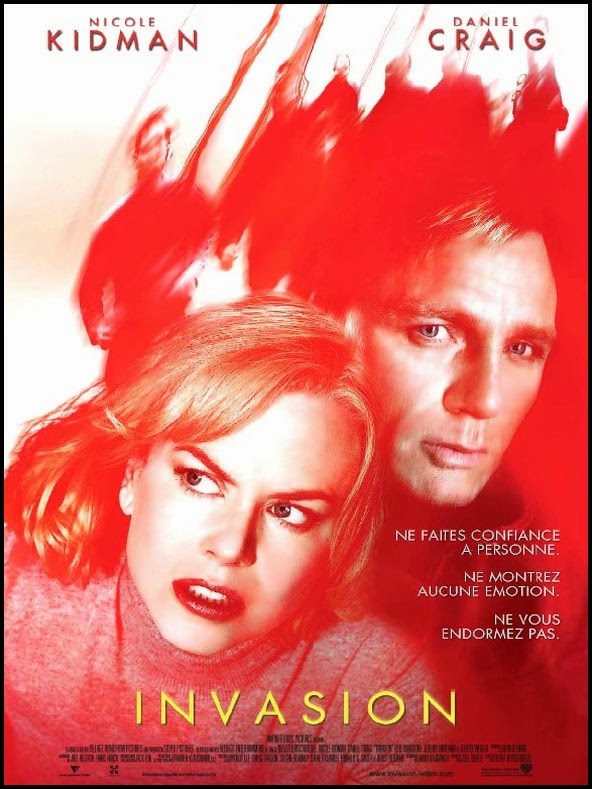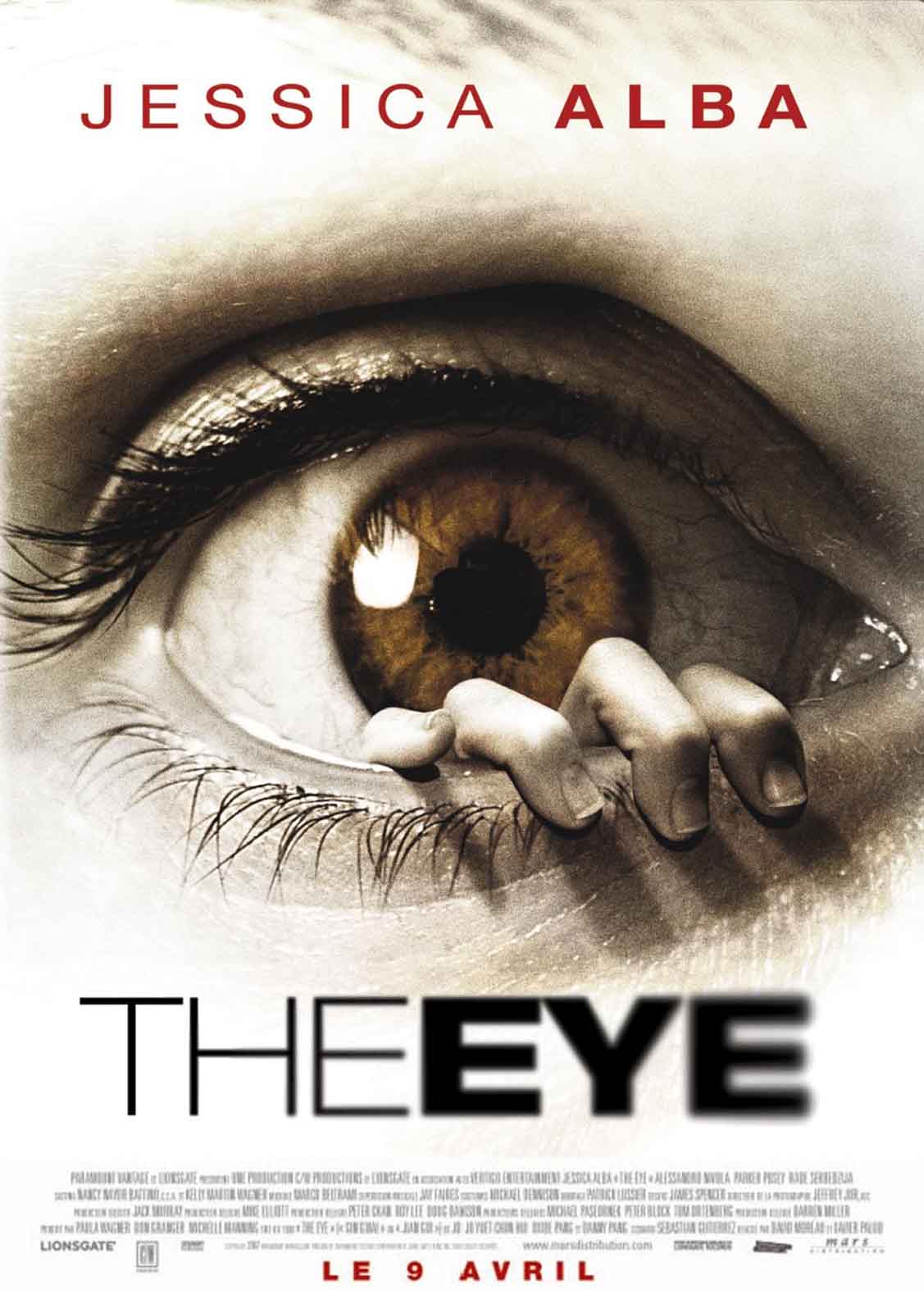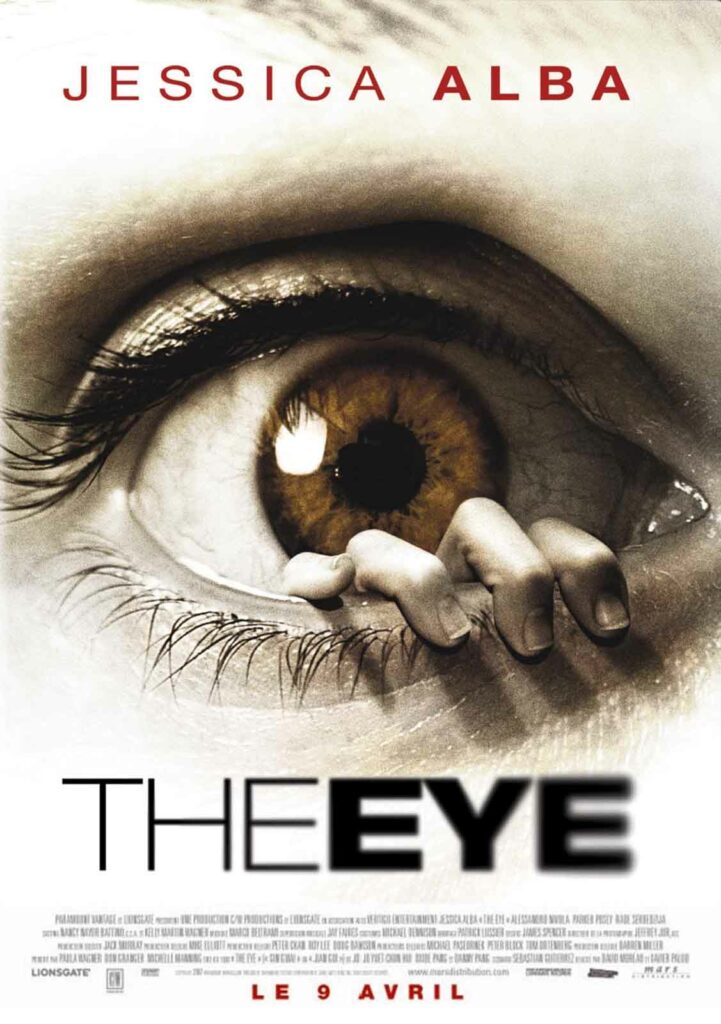Dans cette séquelle sans surprise, trois touristes américaines en voyage en Europe tombent dans un piège qui va les livrer à des amateurs de tortures
HOSTEL PART 2
2007 – USA
Réalisé par Eli Roth
Avec Jay Hernandez, Roger Bart, Richard Burgi, Edwige Fenech, Lauren German, Stanislav Ianevski, Roman Janecka
THEMA TUEURS
S’il s’efforce d’améliorer les problèmes de rythme et de structure du premier opus, notamment à travers une narration parallèle qui permet d’entrer un peu plus vite dans le vif du sujet, ce second Hostel se démarque difficilement de son aîné, dont il reprend servilement la trame et les ingrédients, se contentant principalement de changer le sexe de ses protagonistes. Alors qu’elles sont en vacances dans une Europe fort peu engageante, Beth, Lorna et Whitney, trois jeunes Américaines, rencontrent une femme charmante et mystérieuse avec laquelle elles sympathisent. Celle-ci se propose de leur faire découvrir pour le week-end un établissement de cure où elles pourront se reposer et s’amuser. Attirées par cette offre, les touristes la suivent avec enthousiasme et tombent dans un piège redoutable. Livrées à de riches clients associant l’horreur au plaisir, les malheureuses ne vont pas tarder à vivre un cauchemar absolu…


Avec cette séquelle, le problème majeur demeure : Eli Roth, incapable d’assumer un discours cohérent et une tonalité idoine, se laisse porter par toutes ses envies et part dans tous les sens : l’horreur gothique (l’effroyable séquence du massacre à la faux qui se réfère directement au personnage d’Elizabeth Bathory), le gore au second degré (le cannibale interprété par Ruggero Deodato qui déguste une pauvre victime lentement dépecée vive, le final excessif qui semble cligner de l’œil vers Street Trash), l’approche psychologique (le point de vue des « tueurs » qui sont en quête d’un pouvoir dont ils manquent cruellement dans leur propre foyer), la dénonciation d’un système abominable gangréné par l’argent (les enchères effectuées on-line sur les futures victimes, comme si des bourreaux pouvaient choisir sur Ebay les personnes qu’ils souhaitent trucider)…
La quête du dégoût
Mais à tant sauter d’un style à l’autre, Hostel 2 ne touche personne et ne fait rien ressentir, à l’exception bien sûr du dégoût suscité par ses scènes de torture outrancières et désespérément complaisantes. Soucieux de bien marquer ses influences cinématographiques, notamment les films de genre italiens, Roth a orné son casting de quelques figures emblématiques transalpines. Ainsi, outre l’apparition du réalisateur de Cannibal Holocaust, on remarque la présence d’Edwige Fenech (L’Île de l’épouvante de Mario Bava, Nue pour l’assassin d’Andrea Bianchi) dans le rôle d’un professeur d’art, et celle de Luc Merenda (Le Parfum du diable et Torso de Sergio Martino) sous la défroque d’un inspecteur de police. Le réalisateur lui-même a fait mouler son visage par l’équipe des maquillages spéciaux pour que sa tête décapitée trône au milieu de dizaines d’autres dans une pièce sinistrement surréaliste, aux allures de salle de trônes, que n’aurait pas reniée le Comte Zaroff. Finalement aussi vain que le premier, cet Hostel 2 multiplie les passages horrifiques (un homme dévoré par des chiens, un visage découpé à la scie circulaire, des décapitations et des mutilations en tout genre, une émasculation digne d’Umberto Lenzi) à défaut de développer un récit palpitant et de discourir sur les horreurs qu’il étale.
© Gilles Penso
Partagez cet article