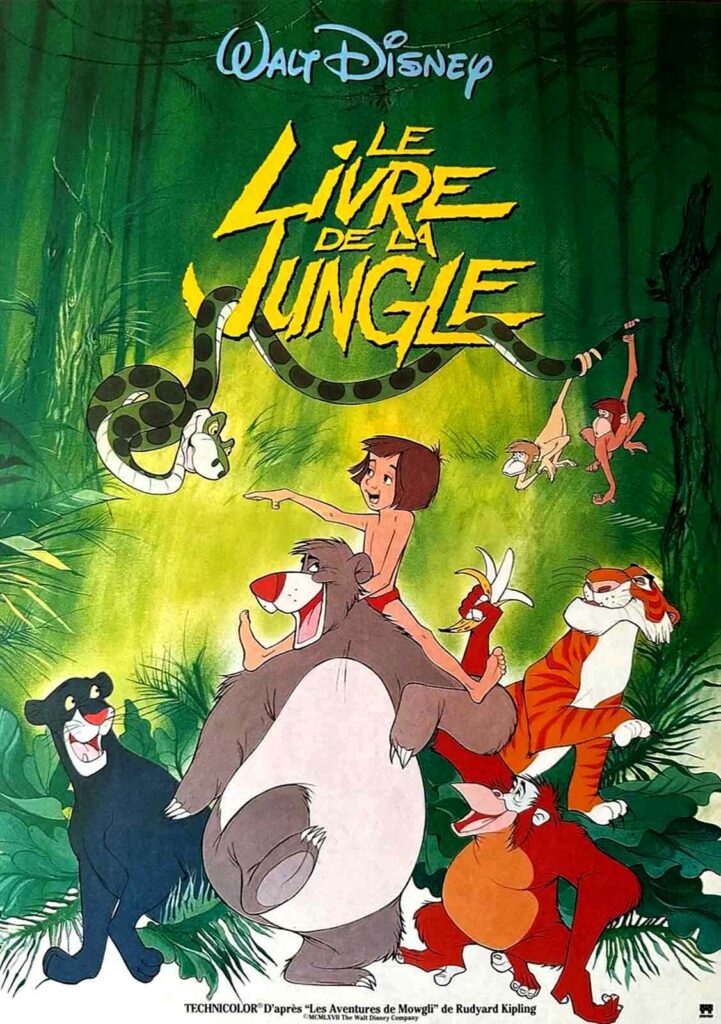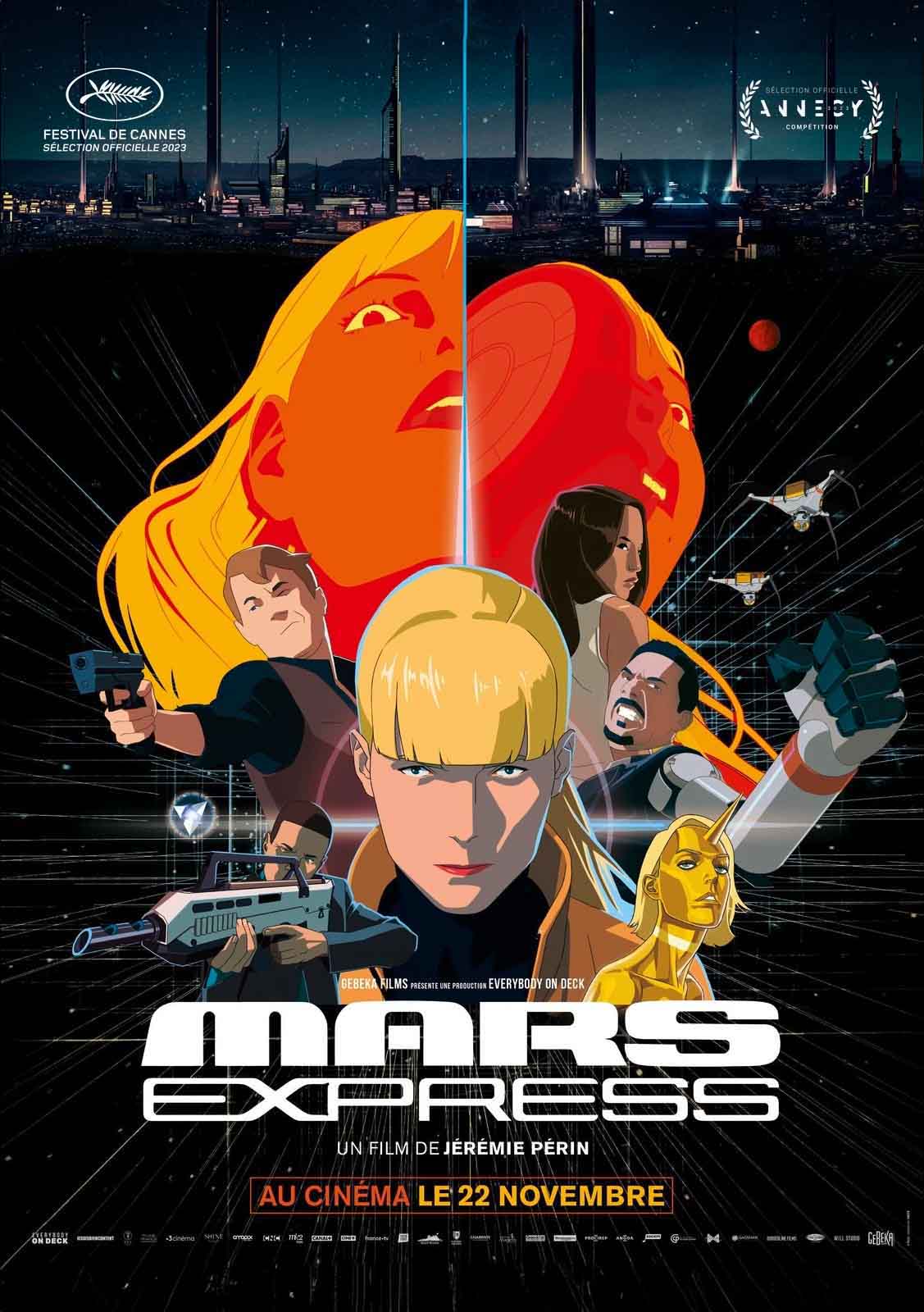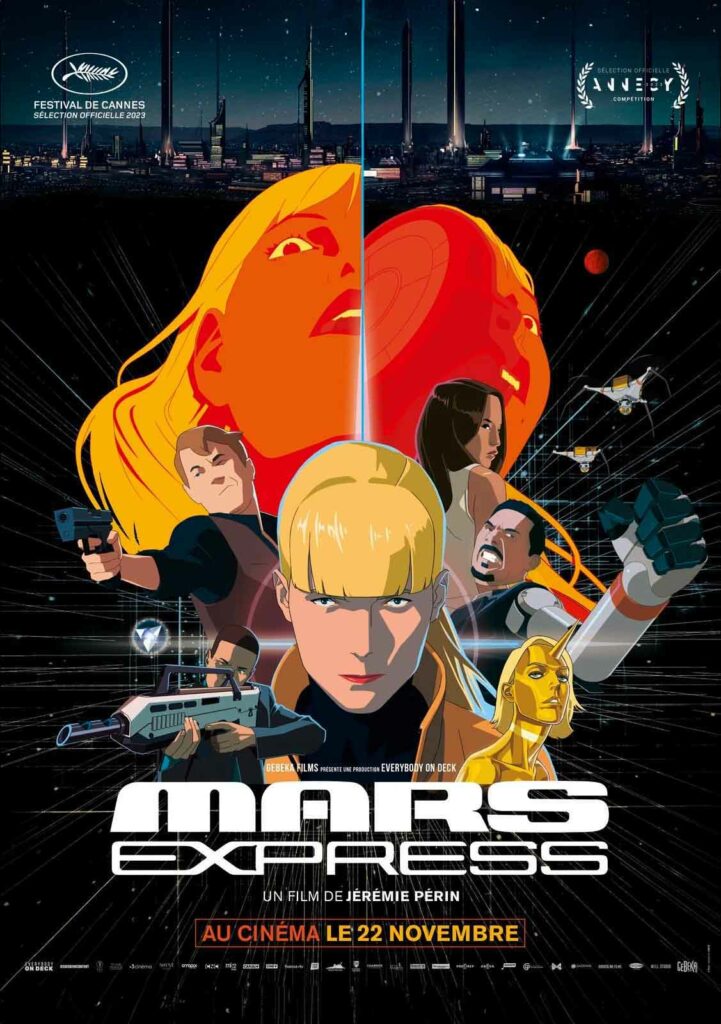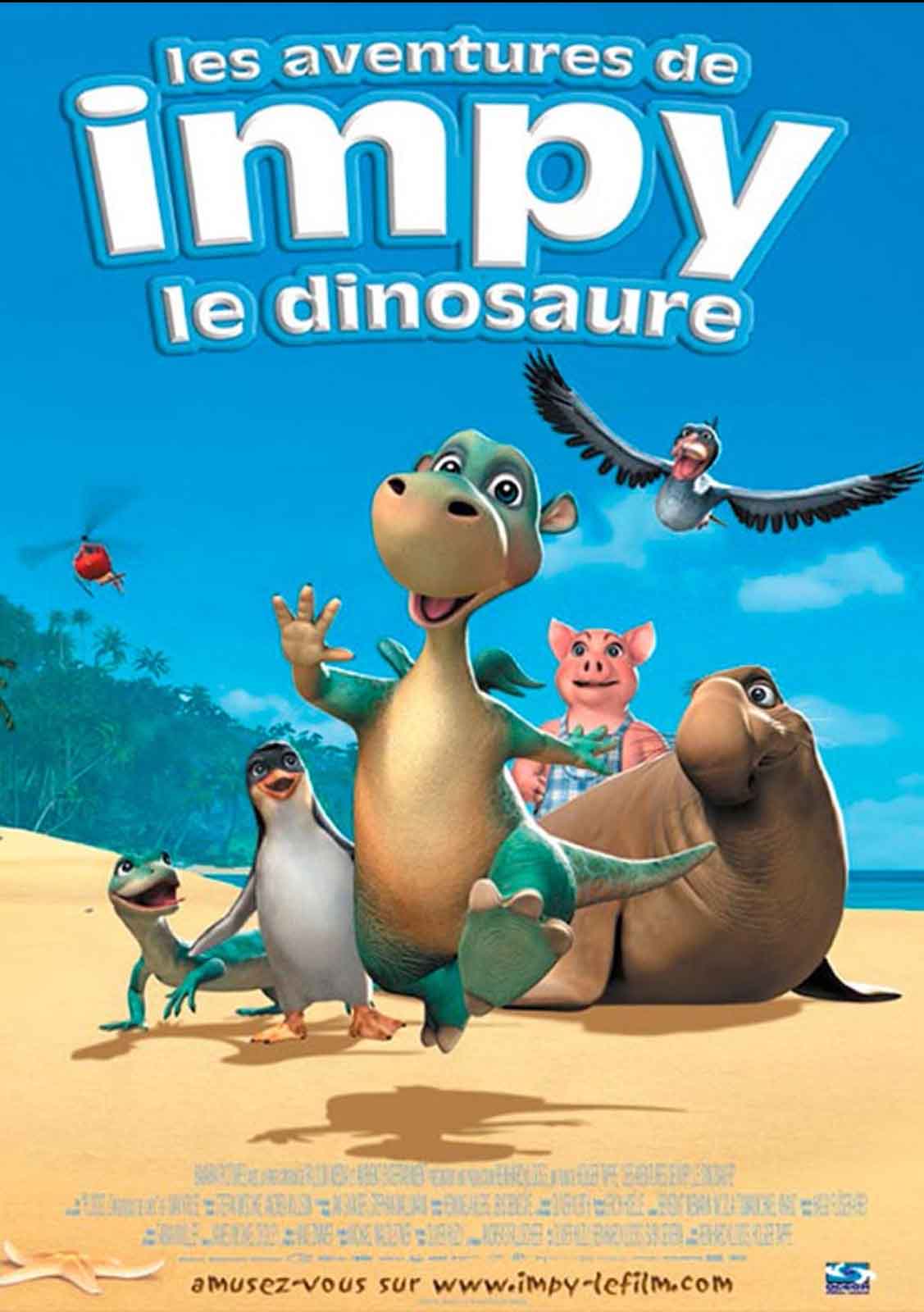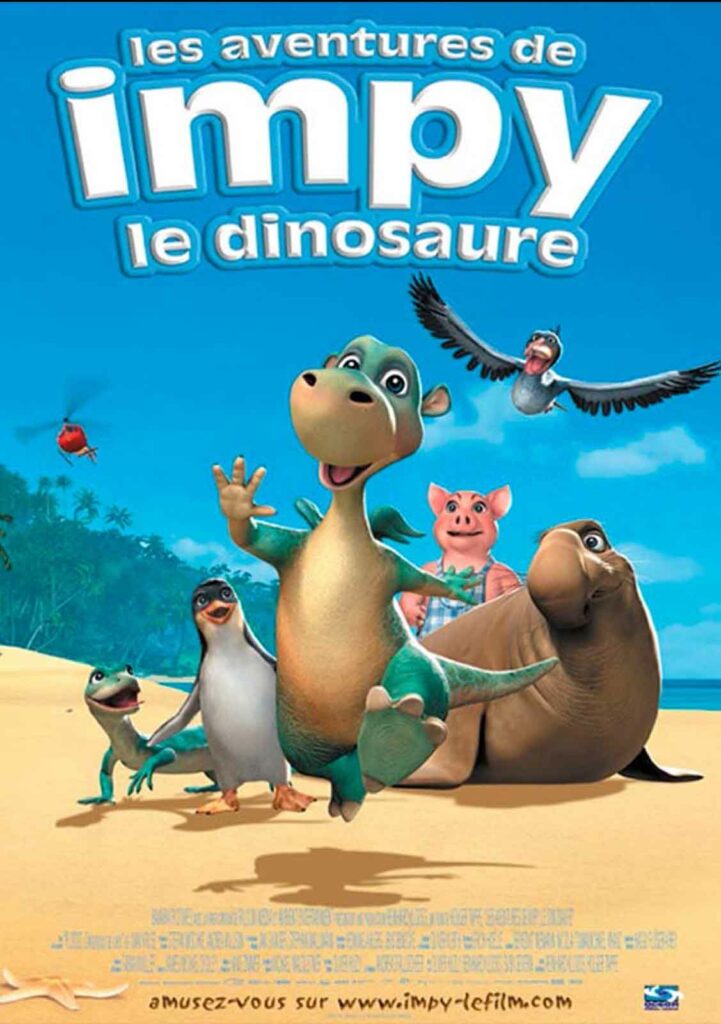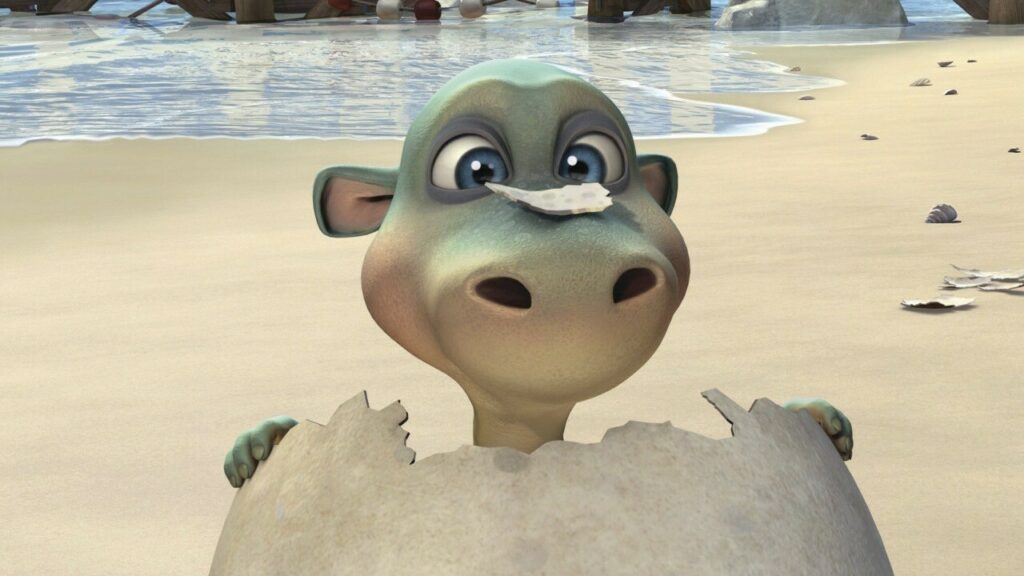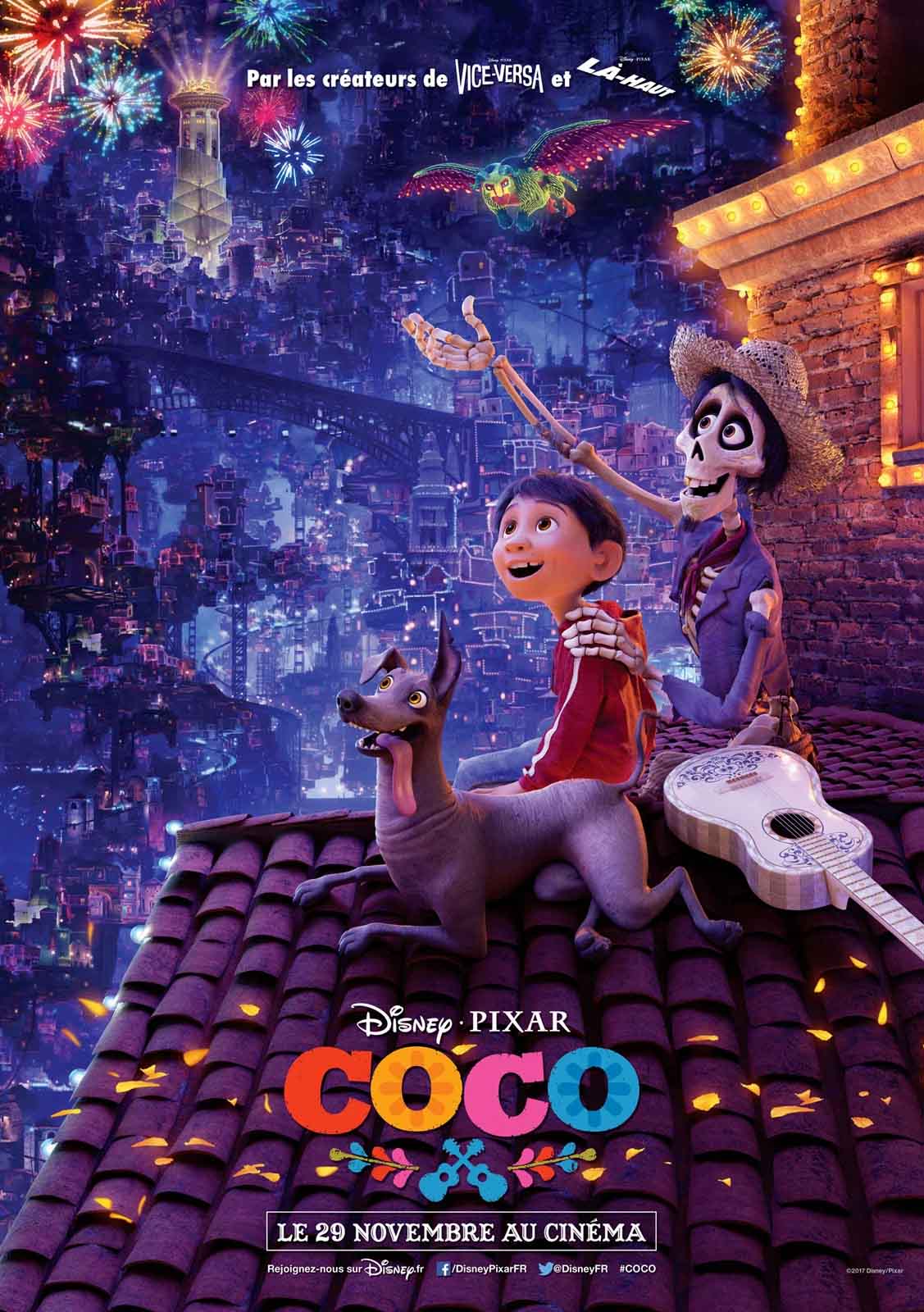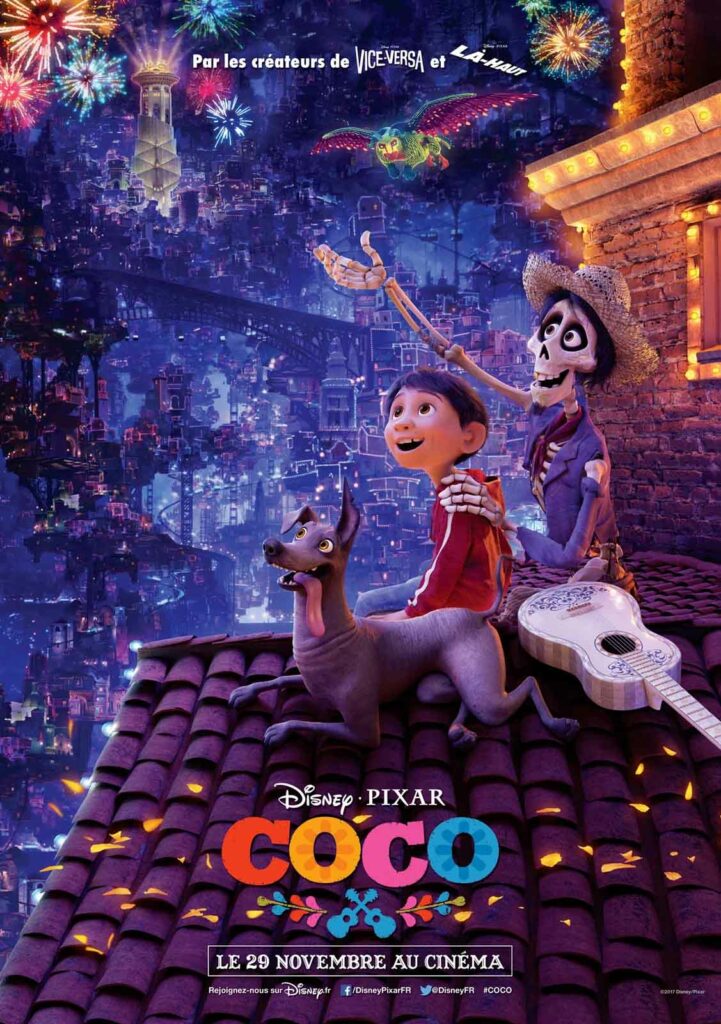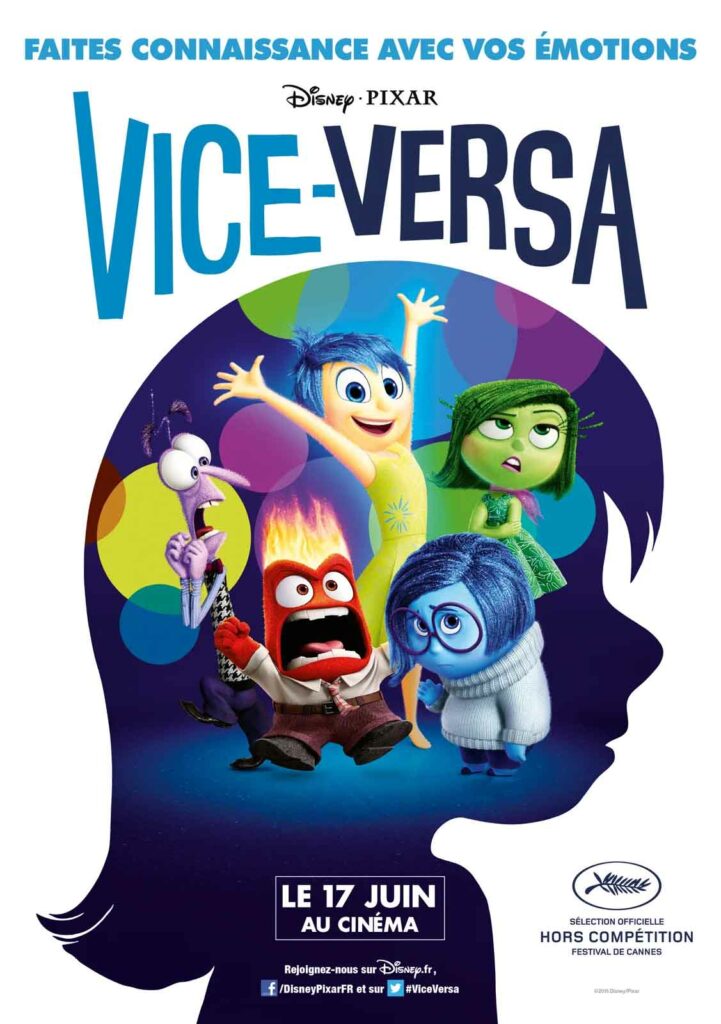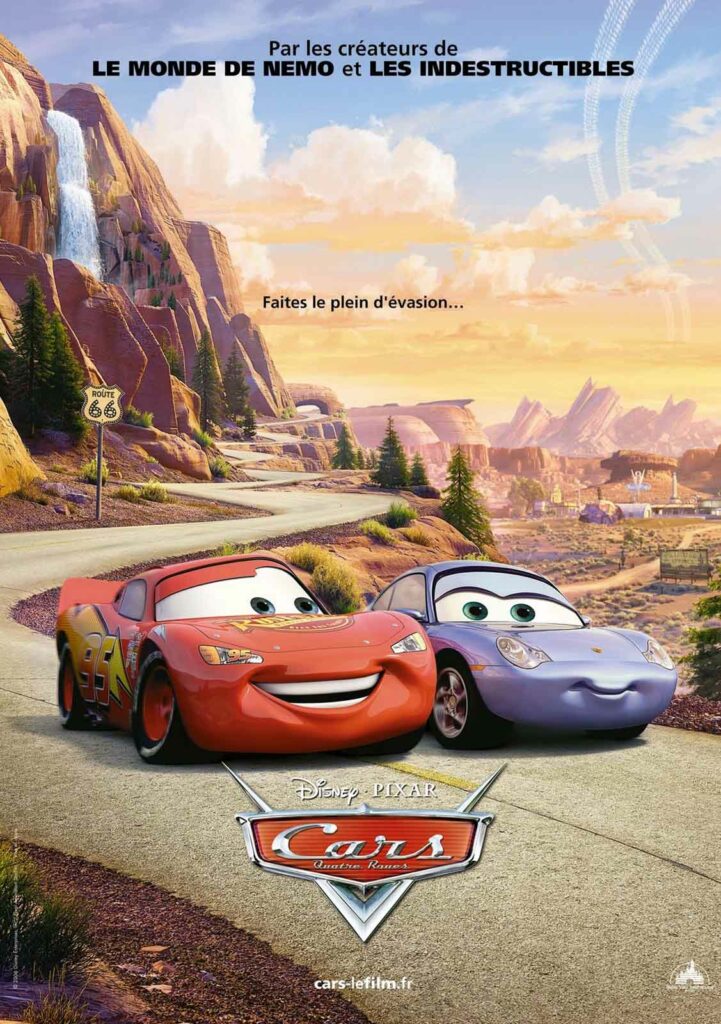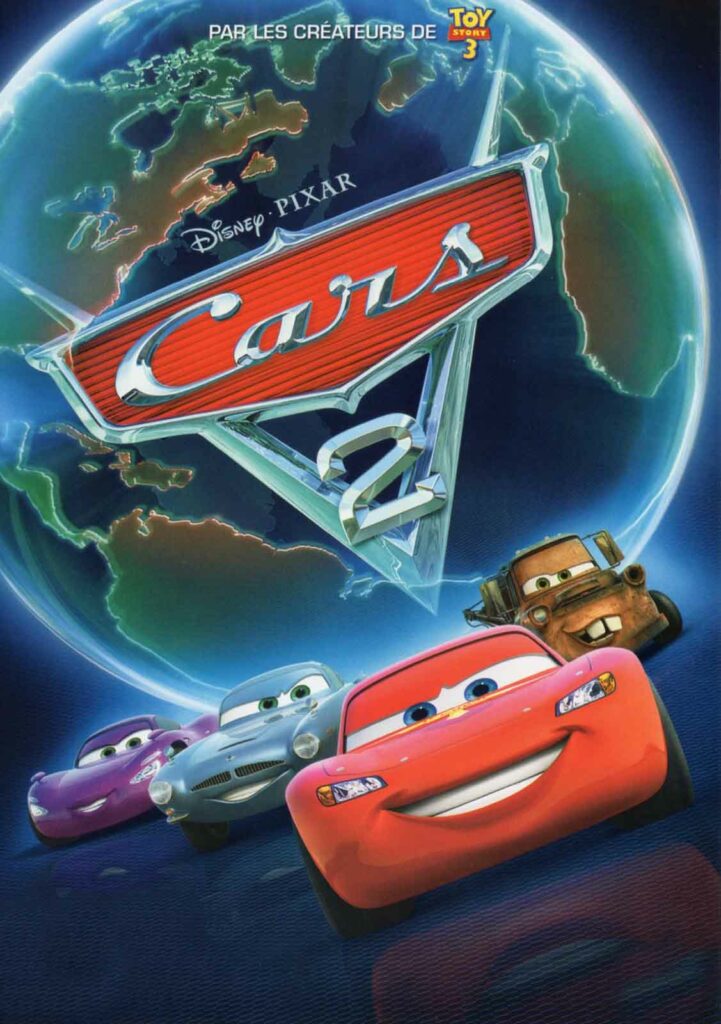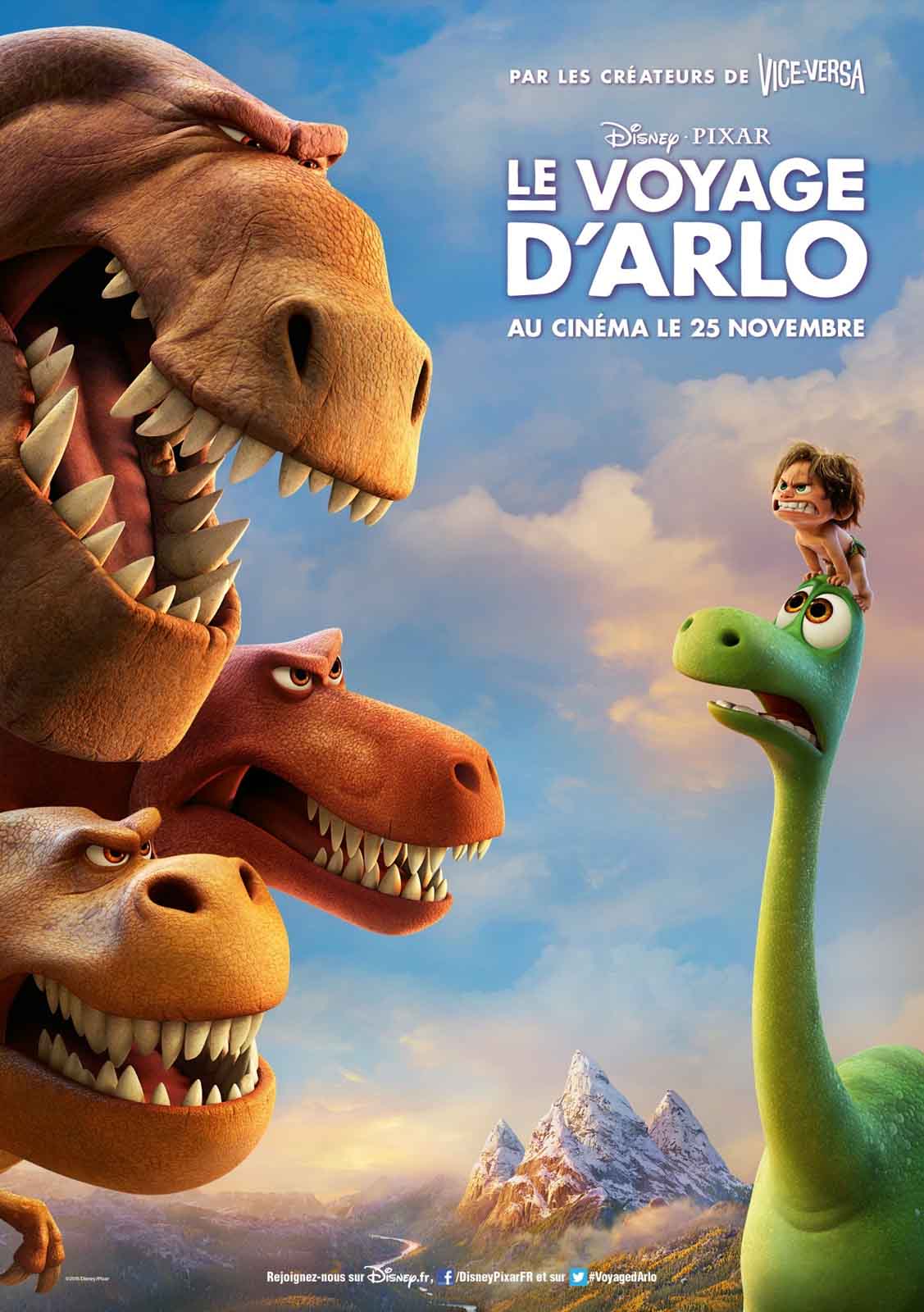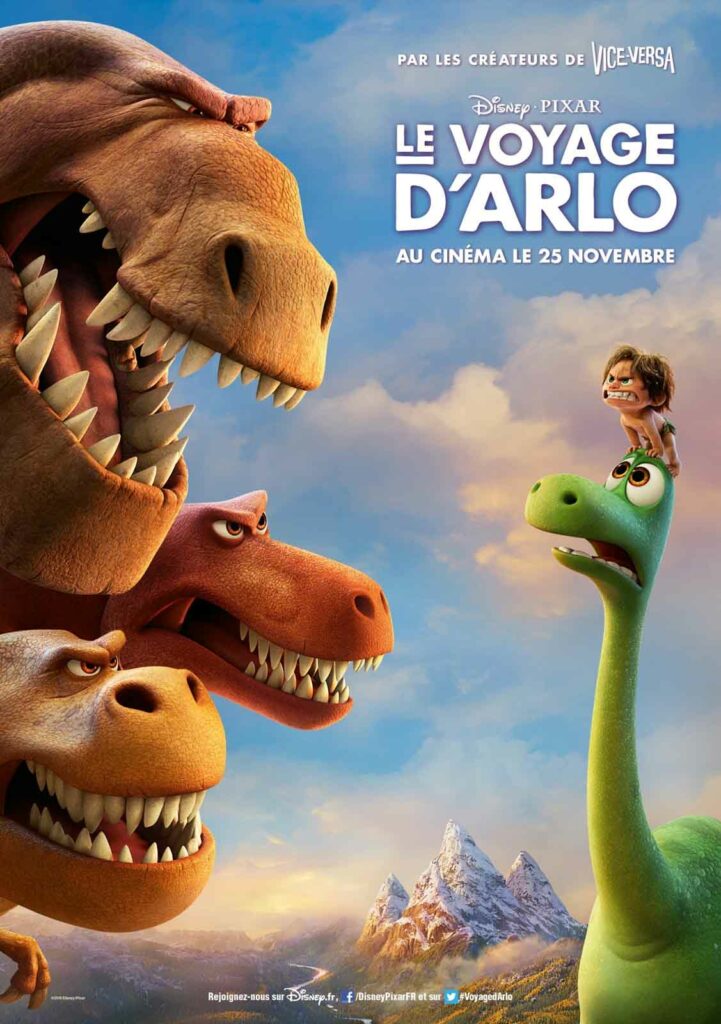Robert Zemeckis réinvente le célèbre conte de Dickens en sollicitant la même technologie que pour Le Pôle express et La légende de Beowulf…
Après Le Pôle express et La Légende de Beowulf, Robert Zemeckis continue de délaisser provisoirement les prises de vues réelles pour poursuivre ses expérimentations dans le domaine de la performance capture, via les technologies développées au sein de la compagnie ImageMovers Digital qu’il a fondée en 2007. « Je suis tombé amoureux du cinéma numérique lorsque j’ai réalisé Le Pôle Express », affirme-t-il. « Depuis lors, je n’ai cessé de chercher des idées de films pouvant bénéficier de ce moyen d’expression artistique. Il y a quelques années, j’ai pensé que “A Christmas Carol“ fonctionnerait parfaitement dans ce format. Je suis donc immédiatement retourné lire le livre pour me rafraîchir la mémoire. J’ai alors réalisé que la performance capture pourrait être le moyen idéal de reprendre cette histoire classique que tout le monde connaît et de la revisiter d’une manière nouvelle et passionnante ». (1) Pour prêter voix et corps aux personnages en images de synthèse du film, Zemeckis sollicite Gary Oldman, Colin Firth, Cary Elwes, Robin Wright, Bob Hoskins et surtout Jim Carrey qui hérite non seulement du rôle de Scrooge à tous les âges de sa vie mais aussi de celui des trois fantômes qui lui rendent visite la nuit de Noël.


Comme le prouve le générique de début du Drôle de Noël de Scrooge, le cinéaste est toujours adepte des mouvements de caméra vertigineux en plan-séquence. La technologie 100% numérique se met ainsi au service de sa virtuosité et laisse le champ libre à sa folle inventivité. Plusieurs scènes du film sont ainsi conçues comme des « rides » immersifs parfaitement adaptés à un visionnage en relief. Chaque apparition spectrale induit d’ailleurs une idée forte de mise en scène différente, permettant autant de déclinaisons du principe du voyage dans le temps, un thème que l’on sait cher au réalisateur de Retour vers le futur. Si l’esprit des Noëls passés nous transporte dans une envolée immersive en continuité (le plan-séquence dure près de douze minutes !), celui des Noëls présents nous offre un étrange don d’ubiquité en plaçant sa narration sur deux plans physiques superposés (Scrooge et le spectre contemplent le monde des humains qu’ils survolent depuis une pièce dont le plancher est transparent). Quant à l’esprit des Noëls futurs, il joue sur les ombres portées et les changements d’échelle, Scrooge se retrouvant soudain ramené à la taille d’une souris dans une sinistre ville fantôme.
Carrey…ment effrayant
La fameuse « uncanny valley », qui donne le sentiment désagréable que les avatars numériques ont le regard vide et le teint cadavéreux, est toujours un peu gênante pour tous les personnages aux traits humains trop réalistes. Fort heureusement, elle s’évapore lorsque les physionomies sont plus volontiers caricaturales, notamment avec Scrooge lui-même et tous les fantômes qui viennent lui rendre visite à tour de rôle. La mise en scène déborde d’idées visuelles, la musique d’Alan Silvestri dote le conte d’une dimension épique et la direction artistique de Doug Chiang est somptueuse. Le Drôle de Noël de Scrooge a donc à peu près tout pour plaire. Mais sa tonalité semble poser problème, notamment le grand nombre d’éléments sans doute trop effrayants qui le ponctuent et qui s’adaptent mal à un public d’enfants (le surgissement horrifique des spectres, le caractère macabre des « enfants de l’ignorance et de la misère », le corbillard lancé aux trousses de Scrooge, le sépulcral esprit des Noëls futurs…). Sans doute est-ce une des raisons de l’accueil très mitigé que reçut le film lors de sa sortie. Ses résultats décevants au box-office, tout comme ceux de Milo sur Mars deux ans plus tard, finirent d’ailleurs par précipiter la fermeture de la compagnie ImageMovers Digital.
(1) Extrait d’une interview publiée dans Movieweb en novembre 2010.
© Gilles Penso
Partagez cet article