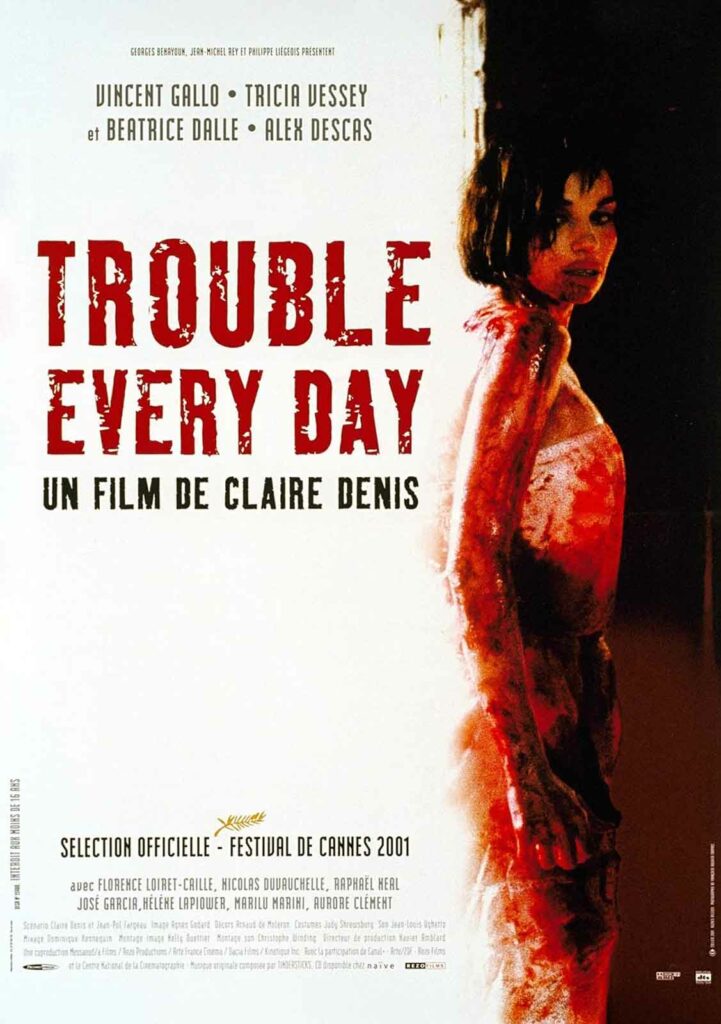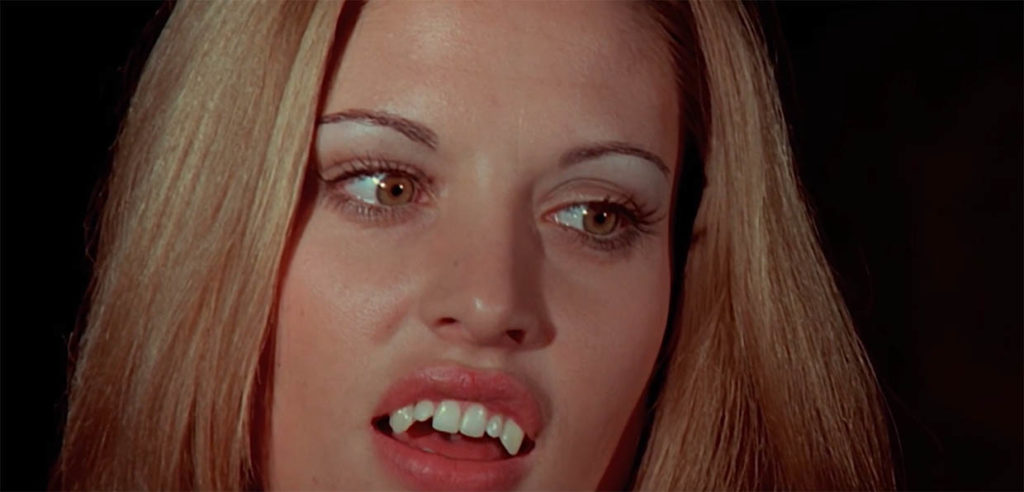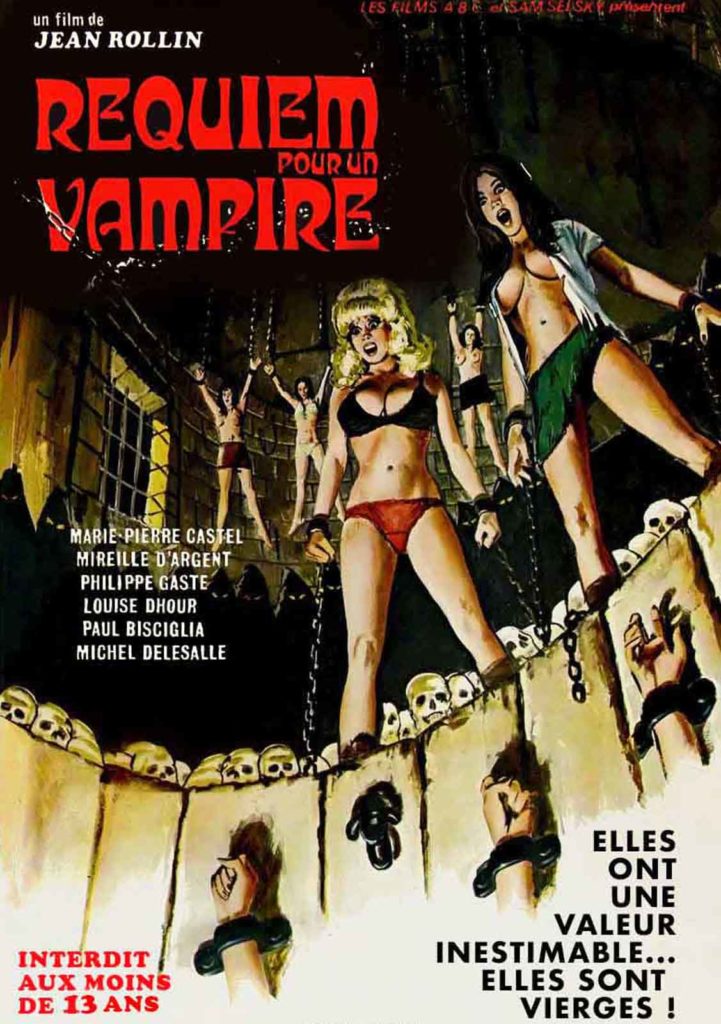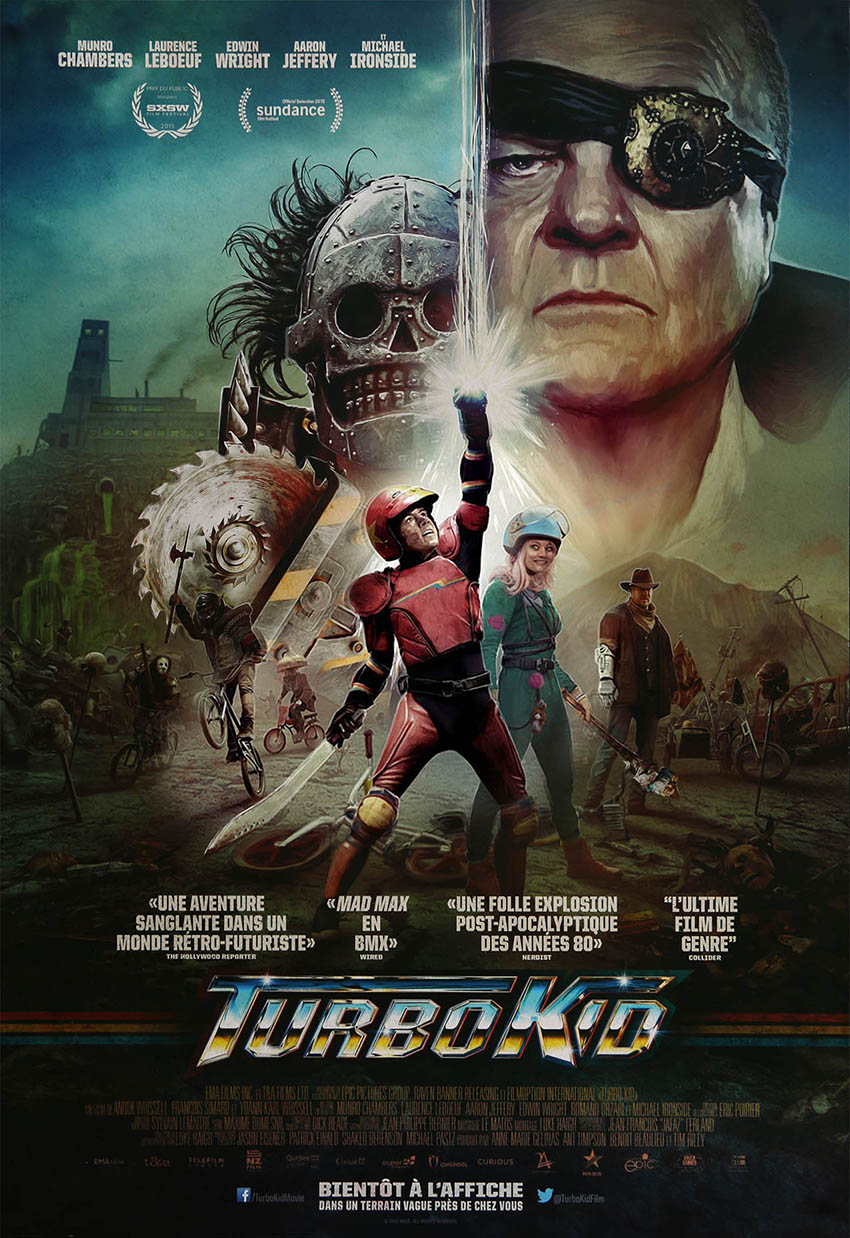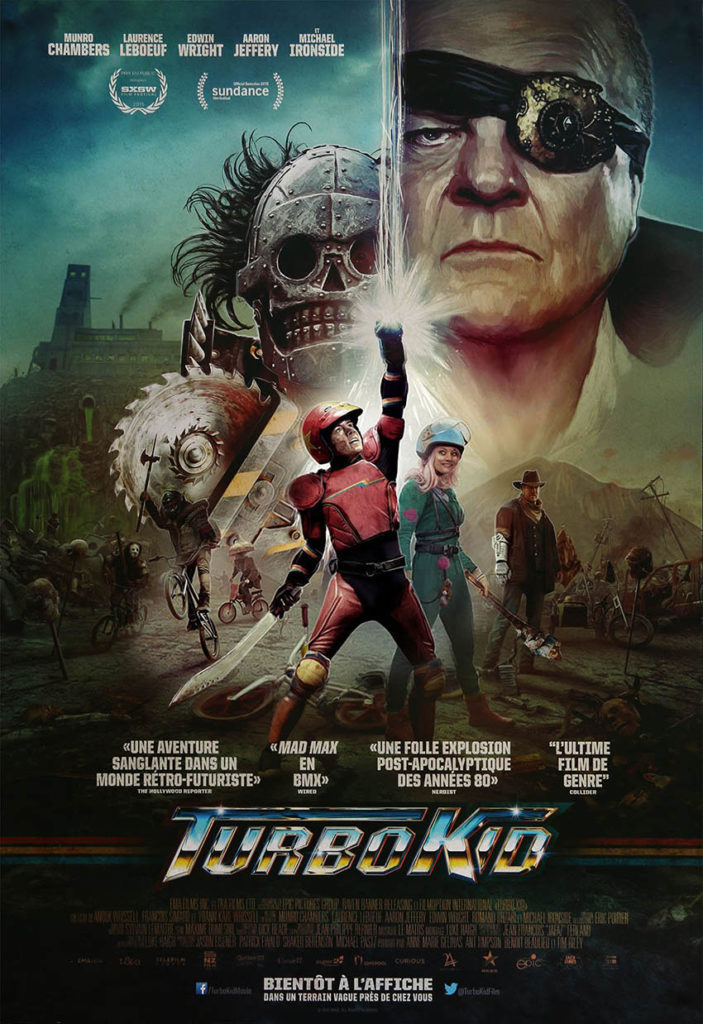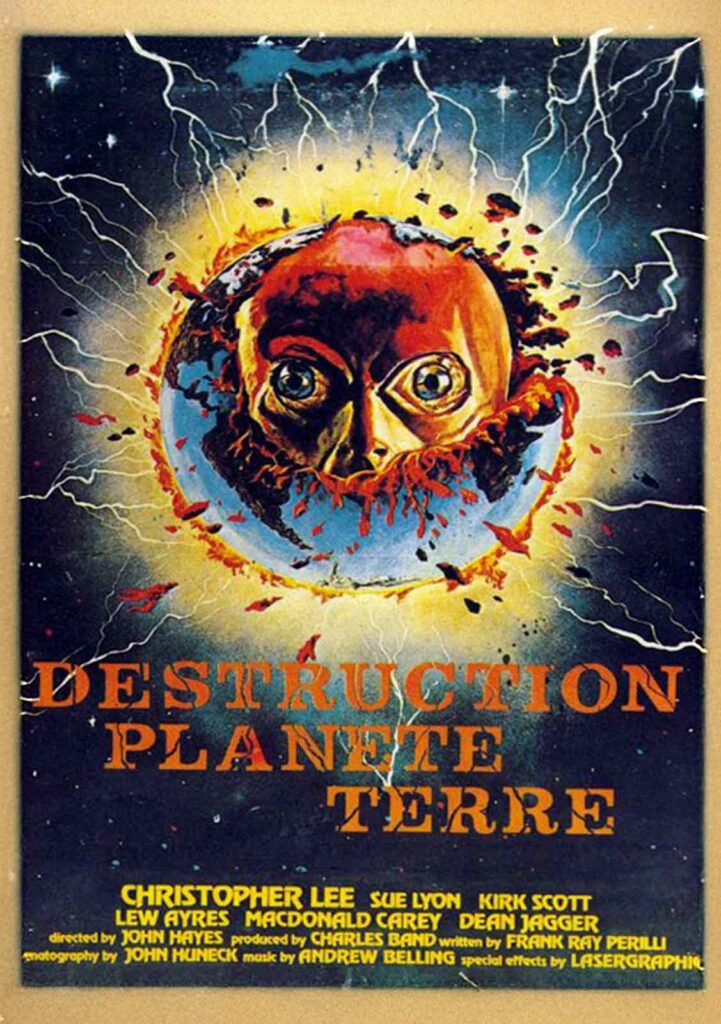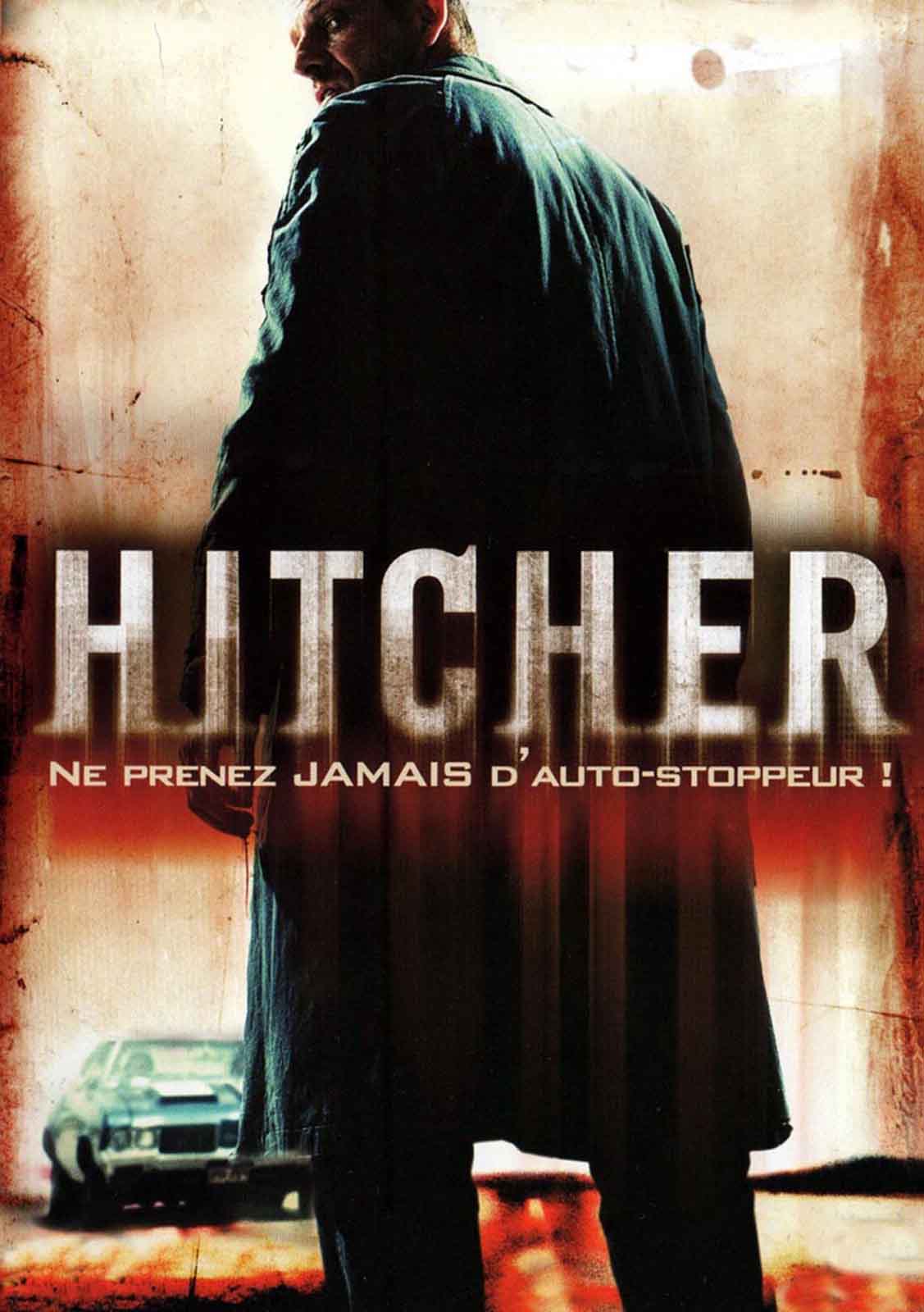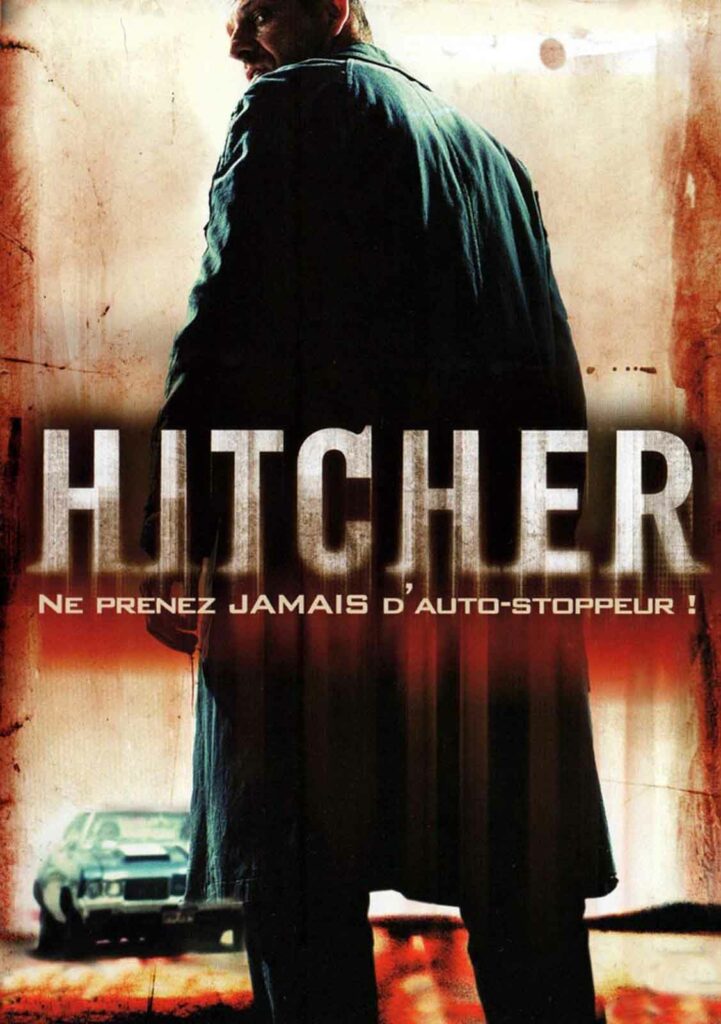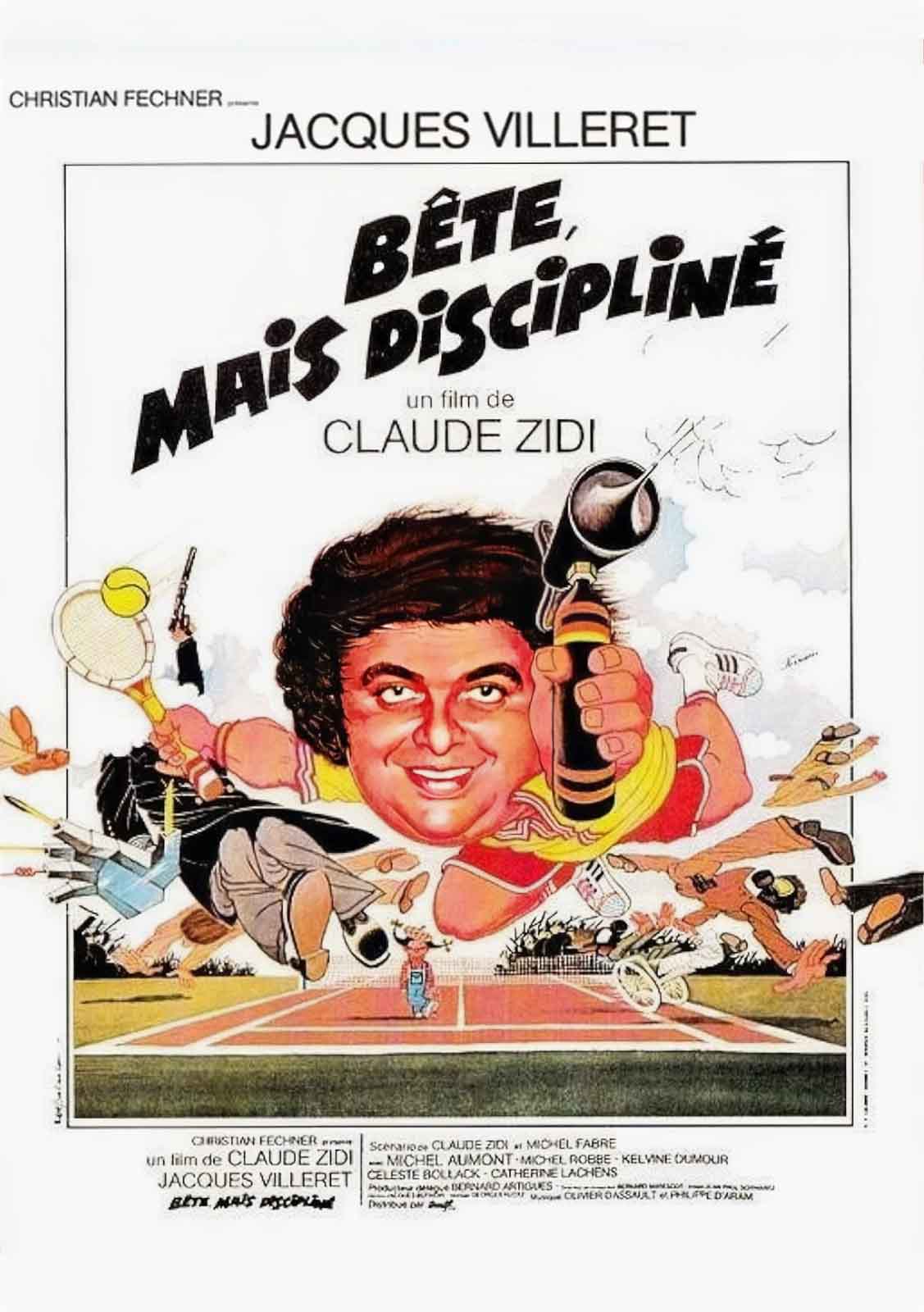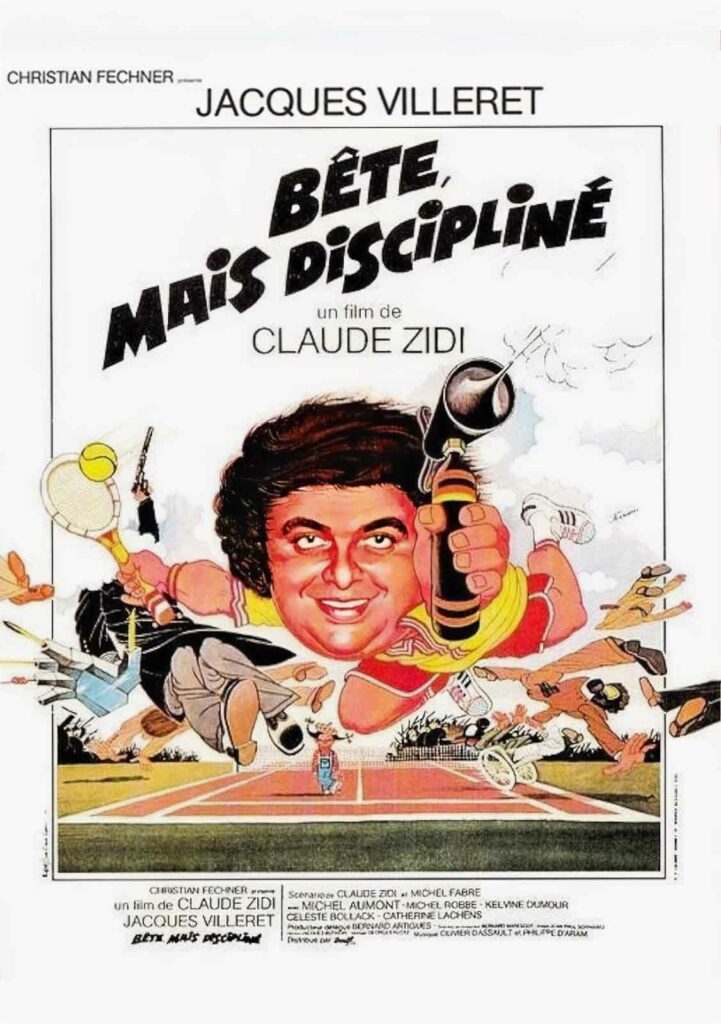Bourvil incarne un modeste fonctionnaire qui se découvre le pouvoir extraordinaire de traverser les murs
GAROU-GAROU, LE PASSE-MURAILLE
1951 – FRANCE
Réalisé par Jean Boyer
Avec Bourvil, Raymond Souplex, Joan Greenwood, Gérard Oury, Roger Tréville, Marcelle Arnold, Jacques Erwin, Frédéric O’Brady, René Worms, Nina Myral
THEMA POUVOIRS PARANORMAUX
« Il y avait à Montmartre, au troisième étage du 75 bis de la rue d’Orchampt, un excellent homme nommé Dutilleul, qui possédait le don singulier de passer à travers les murs sans en être incommodé ». C’est sur ces mots que commence la nouvelle « Le Passe-Muraille » de Marcel Aymé, qui sera publiée une première fois en 1941 avant son intégration dans un recueil d’histoires courtes deux ans plus tard. En quelques mots, l’auteur banalise ainsi une situation extraordinaire pour mieux brocarder ses semblable, au sein de la période trouble de l’occupation qui imprègne fortement plusieurs de ses récits de l’époque. Séduits par « Le Passe-Muraille », le réalisateur Jean Boyer et le scénariste Michel Audiard décident de l’adapter pour le grand écran au début des années 50. Le texte original étant très court, ils le complètent de nouvelles séquences, agencent les événements différemment, modifient les attributs de plusieurs personnages et reconstruisent la personnalité et les caractéristiques physiques du héros pour les adapter à leur interprète Bourvil.


Le futur compère de Fernandel et Louis de Funès incarne ainsi Léon Dutilleul, un modeste fonctionnaire du ministère de l’enregistrement qui vit chez sa sœur Germaine (Marcelle Arnold) et son mari Gaston (Jacques Erwin). Un soir, en rentrant chez lui passablement éméché, Léon découvre qu’il peut passer à travers les murs, profitant dès lors de cet étrange pouvoir pour terrifier son tyrannique beau-frère et son chef de service. Il consulte un médecin excentrique (Frédéric O’Brady) qui ne décèle là rien d’alarmant, avant d’avouer lui-même qu’il essaie depuis des années de traverser les murs. Joignant le geste à la parole, il exhibe son crâne couvert de bandages ! Léon raconte son étrange récit à son ami artiste peintre Gen-Paul (Raymond Souplex). « Celui qui tire nos ficelles t’a choisi comme cobaye pour expérimenter sa dernière invention », commente ce dernier. « Mon explication n’est peut-être pas très scientifique mais elle en vaut bien un autre. » A force d’espionner ses semblables à la dérobée en abusant de ses capacités hors-norme, Léon finit par tomber sur Lady Brockson (Joan Greenwood), une voleuse qui commet ses forfaits la nuit dans un justaucorps noir fort seyant. Le cœur de notre passe-muraille chavire aussitôt. « Tu ne peux pas tomber amoureux d’une dactylo, comme tout le monde ? » réagit Souplex, qui a décidemment les meilleures répliques du film. Pour épater la belle et lui montrer les dangers du métier de voleur, Léon se lance dès lors dans une série de cambriolages spectaculaires qu’il va signer « Garou-Garou ».
« Monsieur coucou »
Avec son rythme enlevé, ses personnages truculents et ses dialogues percutants, Garou-Garou, le passe-muraille est un petit régal de comédie fantastique. Même les effets spéciaux artisanaux supervisés par Paul Raibaud s’avèrent efficaces. Conçus principalement à l’aide de caches et de contre-caches dessinés à la main, ils collent parfaitement à la simplicité décrite par Marcel Aymé. Œuvre centrale de la très longue filmographie de Jean Boyer (dont il constitue le trente-cinquième long-métrage), ce conte excentrique marque la première rencontre entre Gérard Oury (alors comédien) et Bourvil. Les deux hommes se retrouveront avec succès une décennie plus tard dans Le Corniaud, La Grande vadrouille et Le Cerveau. Pour toucher le marché américain, une version alternative du film fut tournée en anglais simultanément sous le titre Mister Peek-A-Boo (« Monsieur coucou »). Garou-Garou, le passe muraille existe aussi dans une version colorisée, mais c’est évidemment dans son noir et blanc d’origine que les puristes le préfèrent.
© Gilles Penso
Partagez cet article