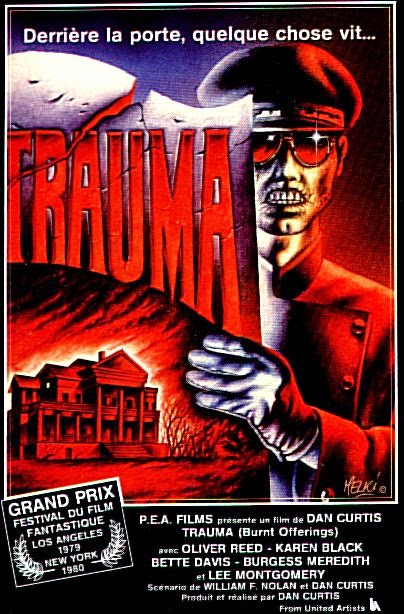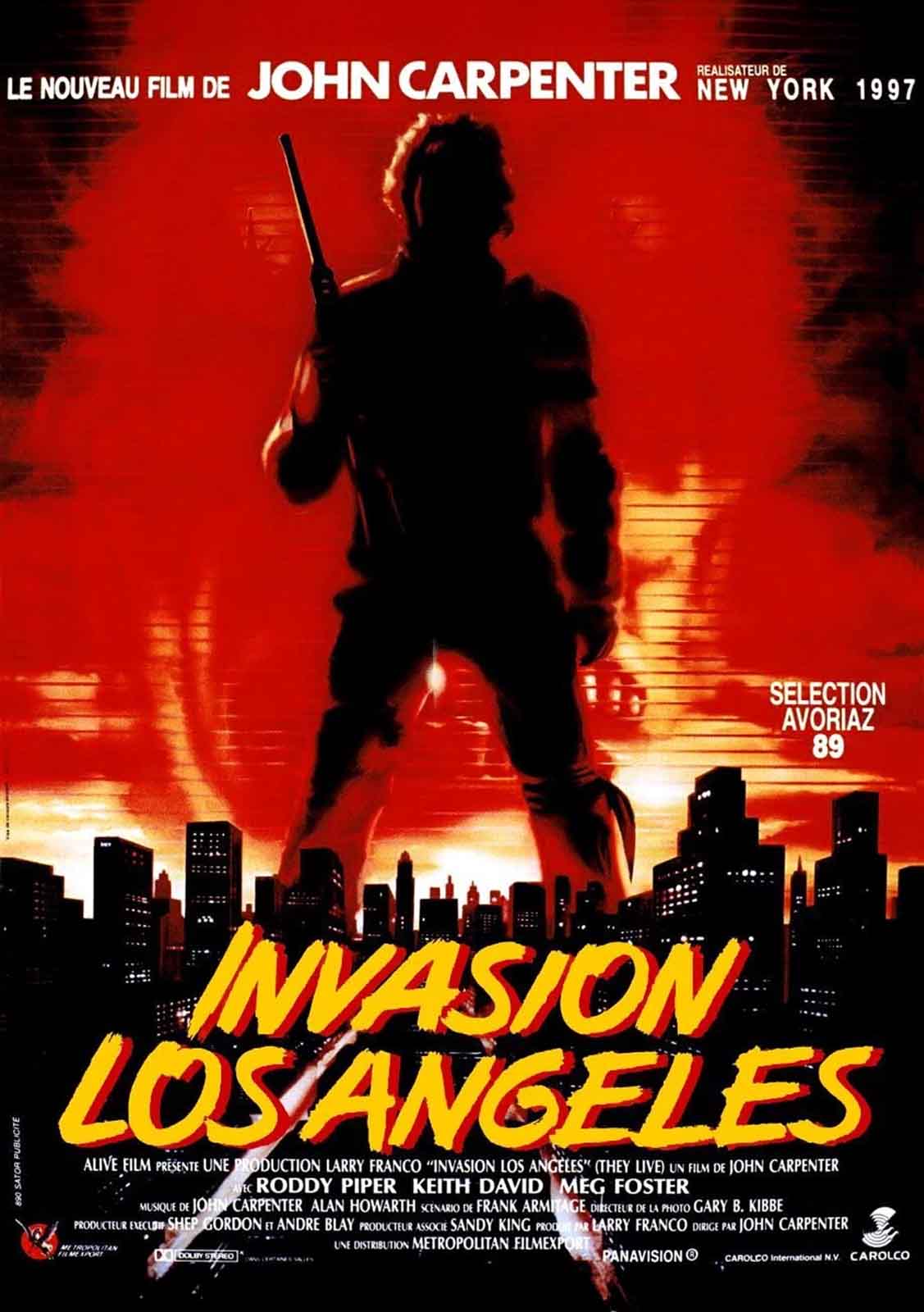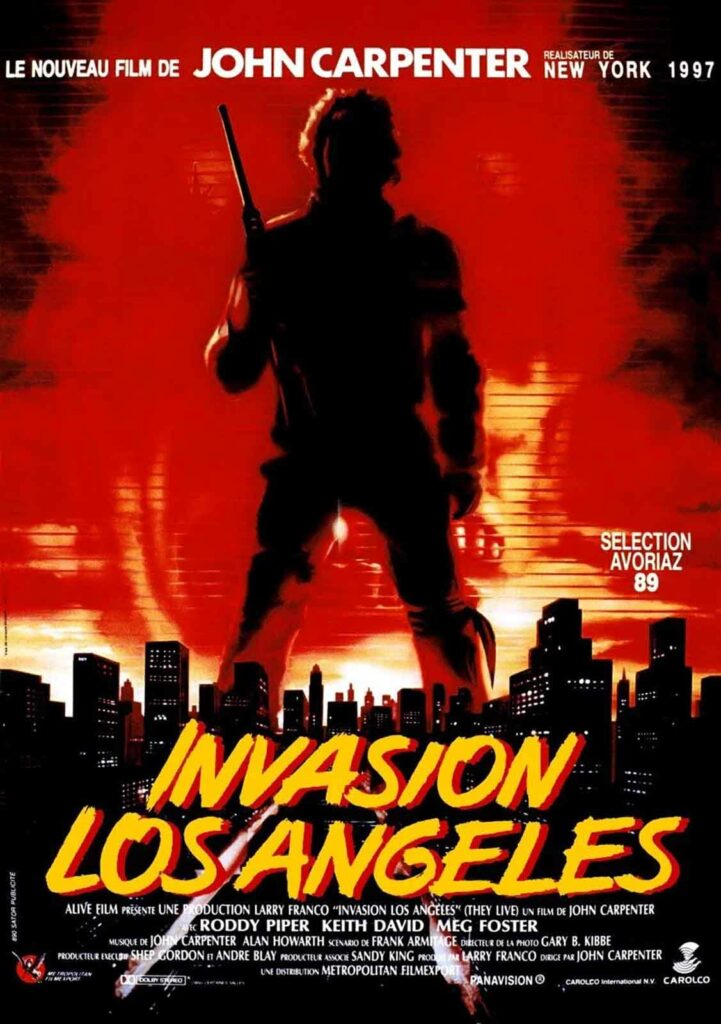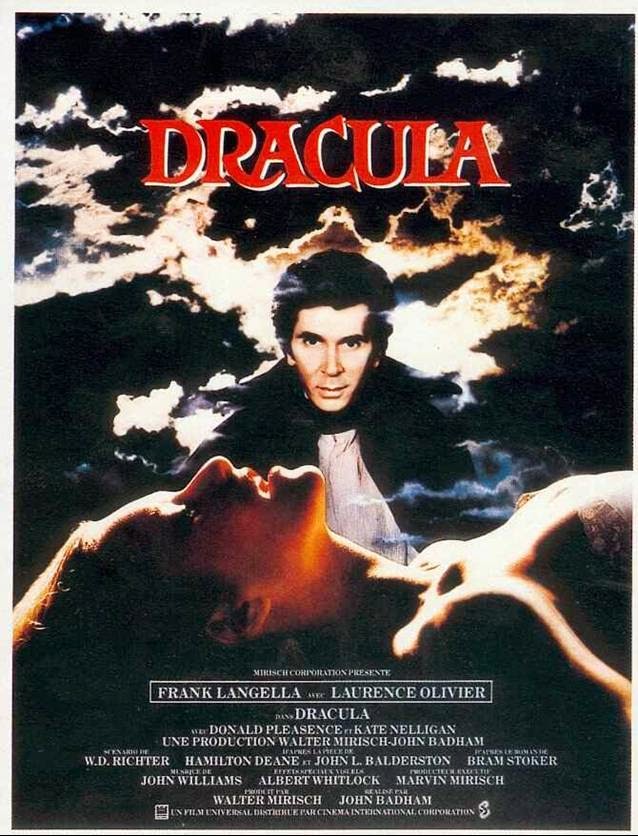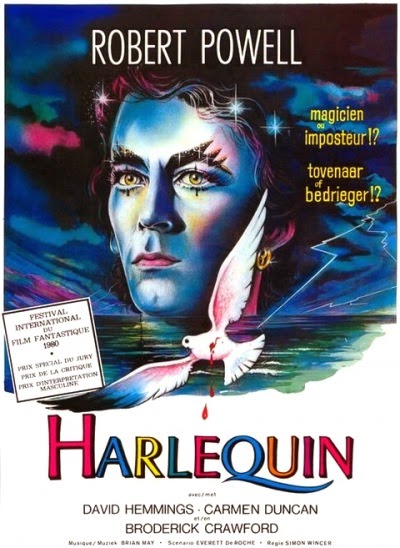Distrayante mais totalement facultative, cette seconde "modernisation" du classique de Ray Harryhausen ne vaut que pour son bestiaire original
THE WRATH OF THE TITANS
2012 – USA
Réalisé par Jonathan Liebesman
Avec Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes, Rosamund Pike, Edgar Ramirez, Toby Kebbell, Bill Nighy, Danny Huston
THEMA MYTHOLOGIE
Le Choc des Titans de Louis Leterrier nous avait laissé une impression plutôt mitigée. Si quelques séquences marquantes surnageaient, notamment le climax et son très impressionnant Kraken, le scénario péchait par manque de finesse, et certains choix artistiques – des faire-valoir pseudo-comiques, un Pégase noir, une Méduse trop numérique pour convaincre, une 3D bricolée à la va-vite – laissaient singulièrement à désirer. Pourtant, les salles se remplirent et le studio Warner mit aussitôt en chantier une suite. Exit Leterrier, place donc à Jonathan Liebesman, dont la filmographie très inégale compte notamment Massacre à la tronçonneuse : le commencement et World Invasion: Battle Los Angeles. Le cahier des charges du cinéaste était pour le moins prometteur, puisqu’il annonçait ce second opus comme un film de monstre mixé avec le Gladiator de Ridley Scott. Alléchant n’est-ce pas ? Pourtant, face au résultat final, la désillusion s’avère cruelle. Les amateurs du Choc des Titans original de Ray Harryhausen et Desmond Davis crient une nouvelle fois à la trahison, les férus de mythologie grecque s’arrachent les cheveux face à une réinterprétation aussi farfelue qu’indigente des grands mythes fondateurs, et les autres se disent que, finalement, le film de Louis Leterrier n’était pas si mal.


Dix ans après avoir vaincu le Kraken, Persée (Sam Worthington, toujours) est devenu un brave pêcheur, père d’un gentil Helios et veuf de la belle Io. Un jour, papa Zeus (Liam Neeson, venu cachetonner sans conviction sous sa fausse barbe) annonce à Persée que rien ne va plus et que si les hommes arrêtent de prier les dieux, ces derniers perdront tous leurs pouvoirs et disparaîtront. Alors, le redoutable Cronos, qui sommeille au fin fond du Tartare, s’éveillera et sèmera le chaos. Bientôt, une créature infernale surgit des tréfonds de la terre et nous laisse espérer que le film va finalement décoller. Car cette superbe chimère bicéphale, mi-chèvre mi-lion, affublée d’un serpent en guise de queue et d’une haleine enflammée, est la vedette d’une séquence de combat extrêmement spectaculaire. Hélas, ce sera le seul vrai morceau de bravoure du film.
La grande foire d'empoigne
Car si d’autres créatures pittoresques pointent le bout de leur nez et semblent se référer ouvertement au bestiaire de Ray Harryhausen (le cheval ailé Pégase, trois cyclopes géants, un minotaure aux allures de démon cornu, des guerriers siamois et bicéphales et enfin le gigantesque et incandescent Cronos), la mise en scène de Liebesman ne sait jamais les mettre en valeur. Batailles illisibles, topographie imprécise, montage épileptique, tous les travers du cinéma d’action mal maîtrisé sont ici de mise. C’est d’autant plus dommage que les studios d’effets spéciaux sollicités par la production (Framestore et The Motion Picture Company en tête) ont effectué un travail par ailleurs remarquable. Cette grande foire d’empoigne où s’agitent des dieux déchus, des guerriers humains et des monstres féroces finit donc par nous laisser indifférent, et nous rappelle que Ray Harryhausen disait vrai lorsqu’il nous affirmait avec un sourire en coin : « On ne peut pas raconter la mythologie grecque avec une explosion toutes les cinq minutes ! »
© Gilles Penso
Partagez cet article