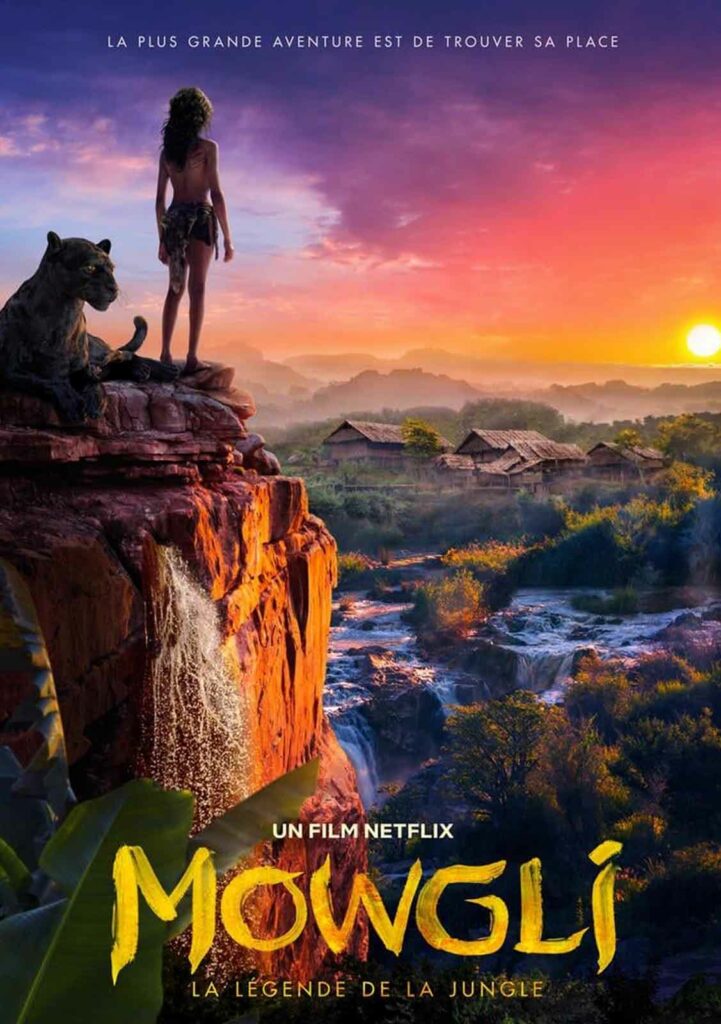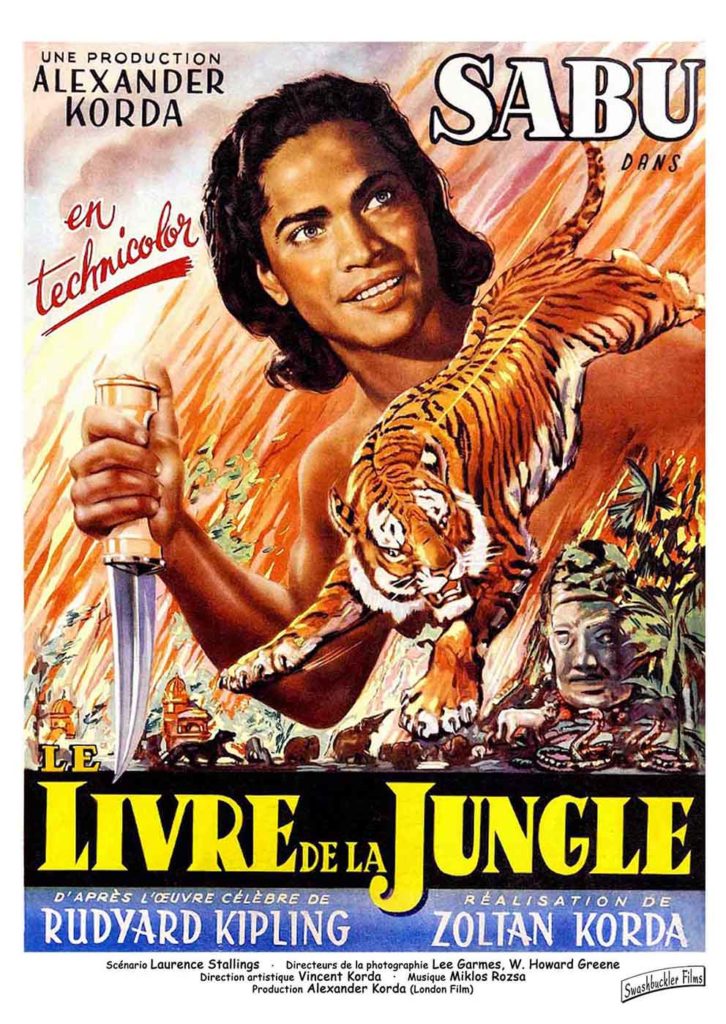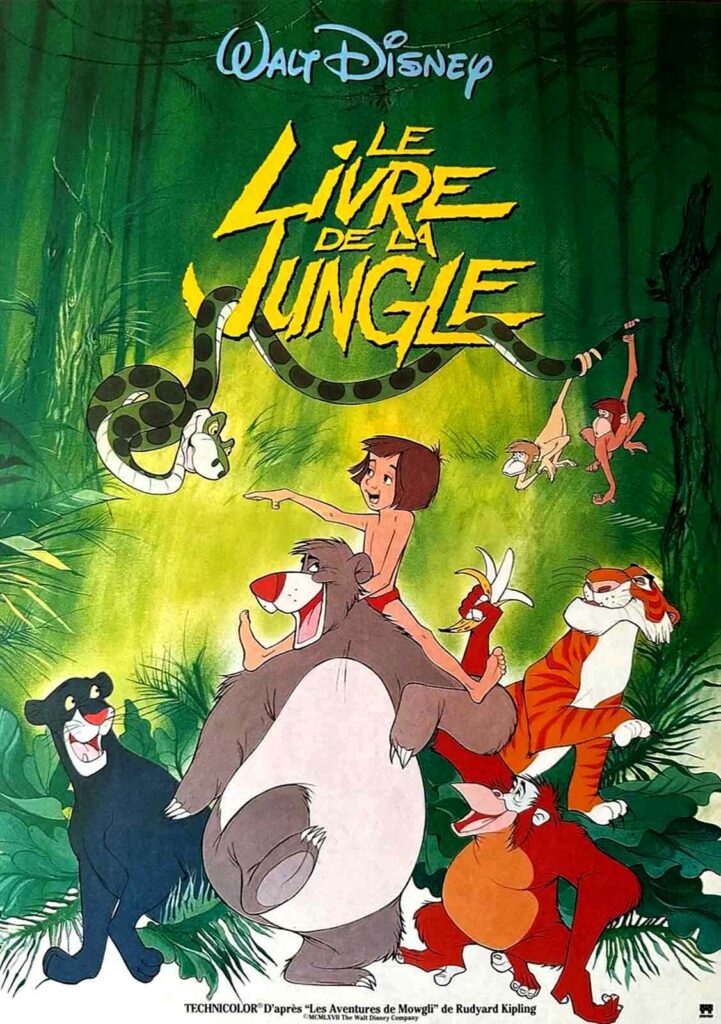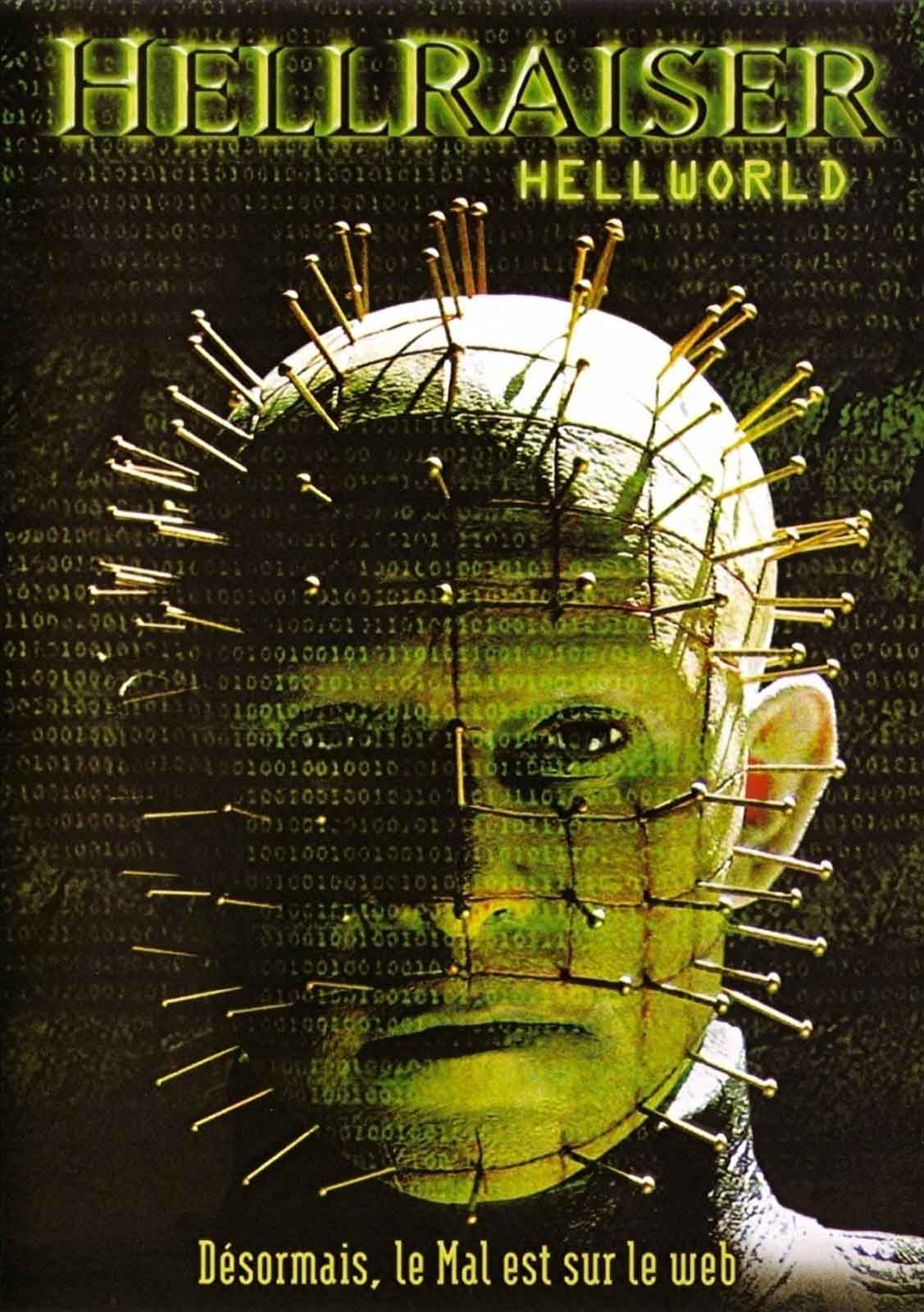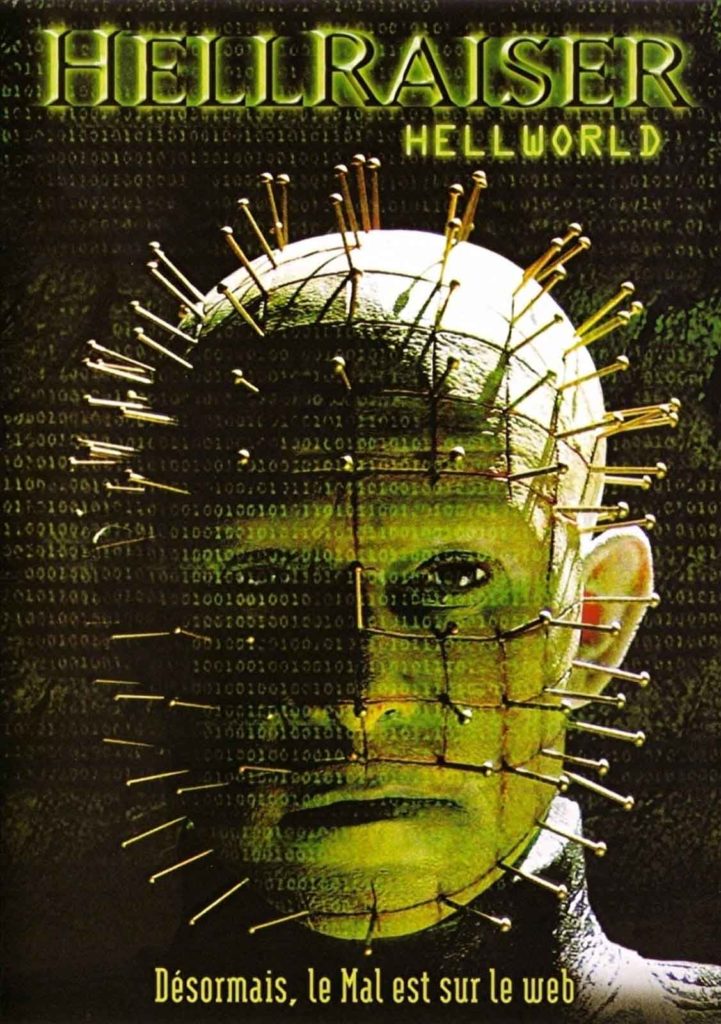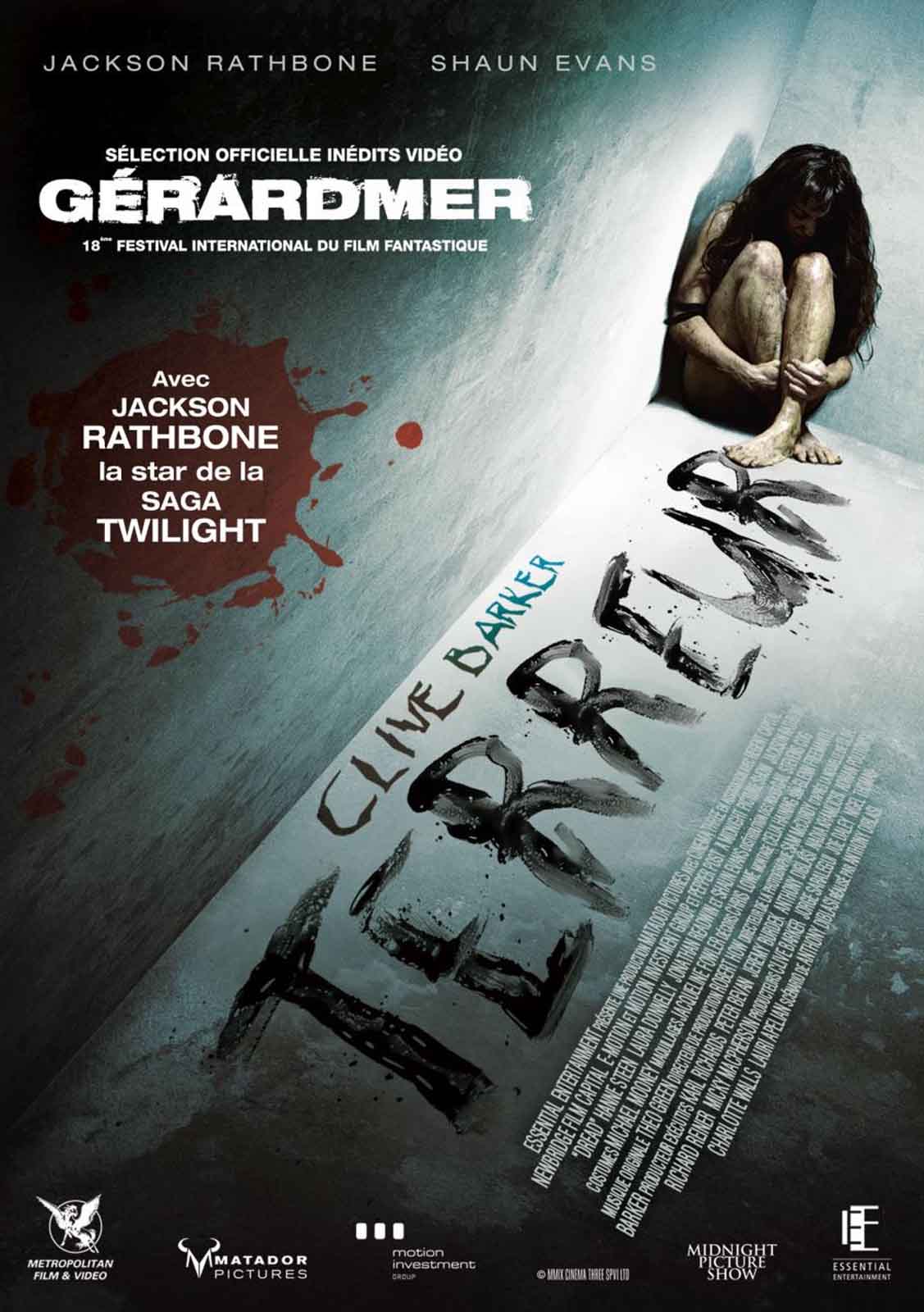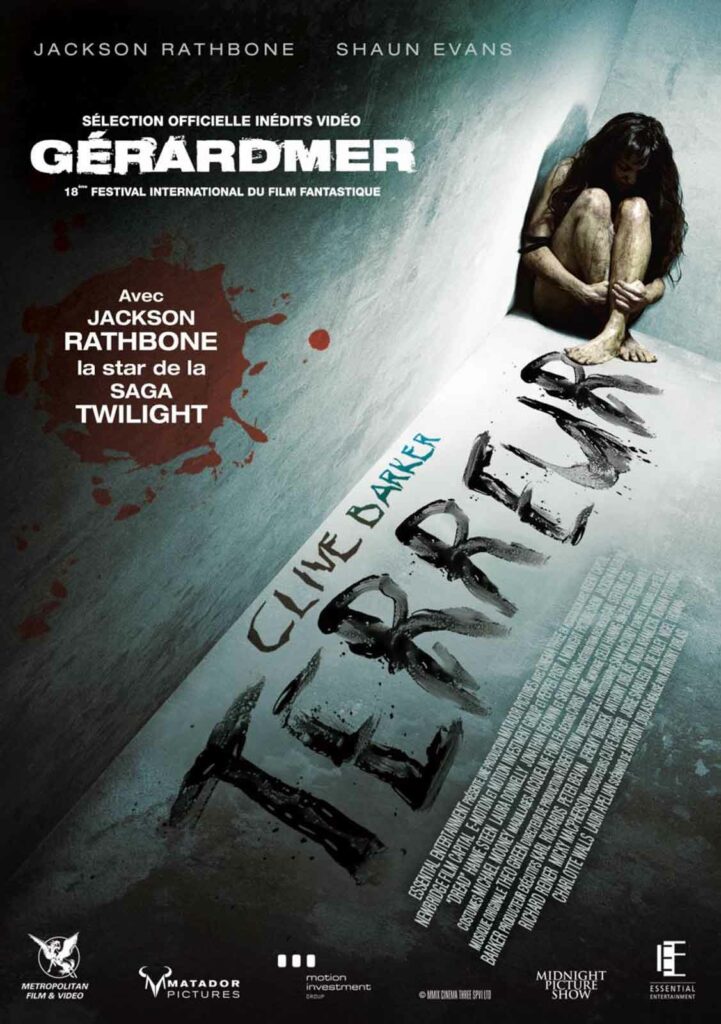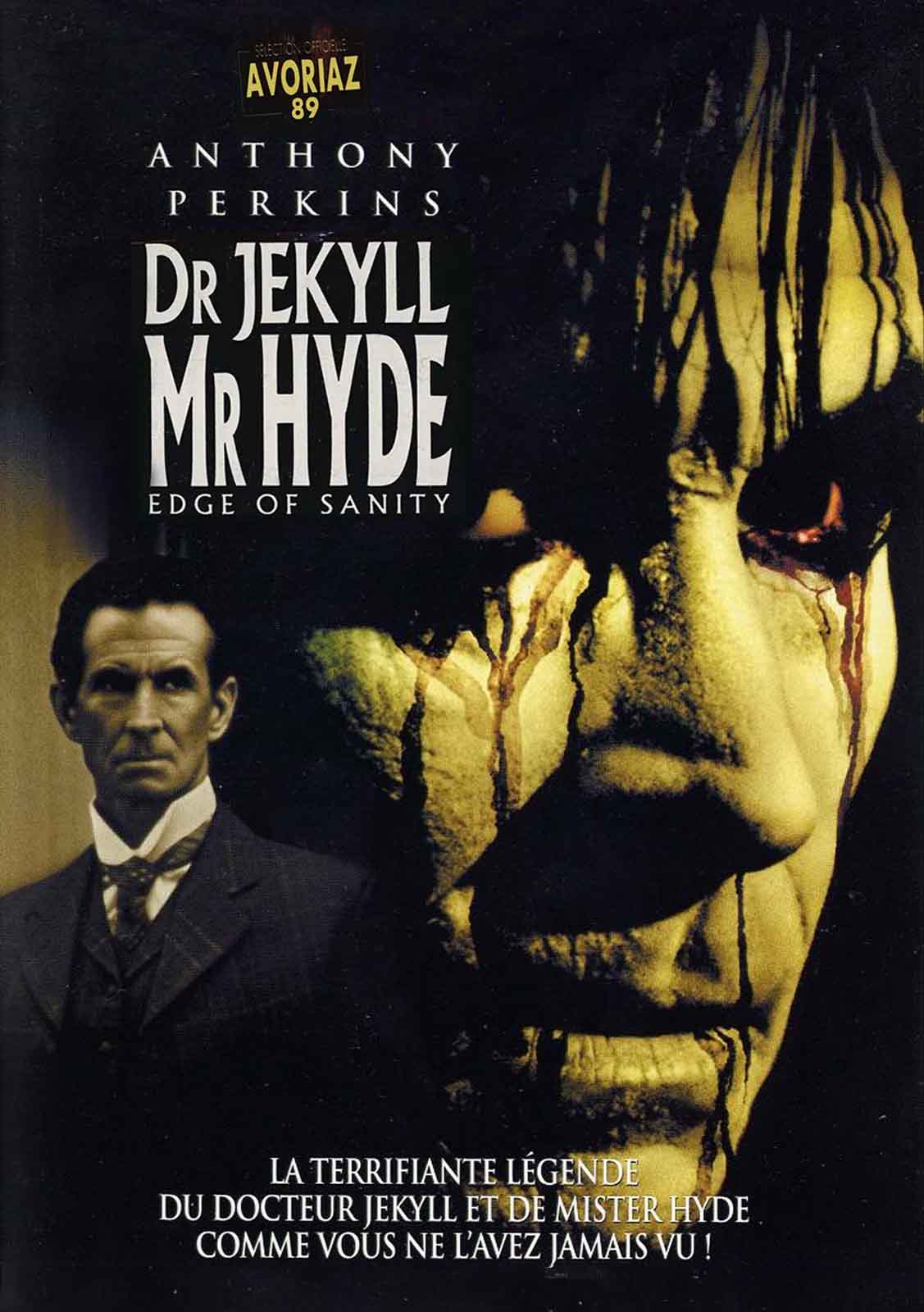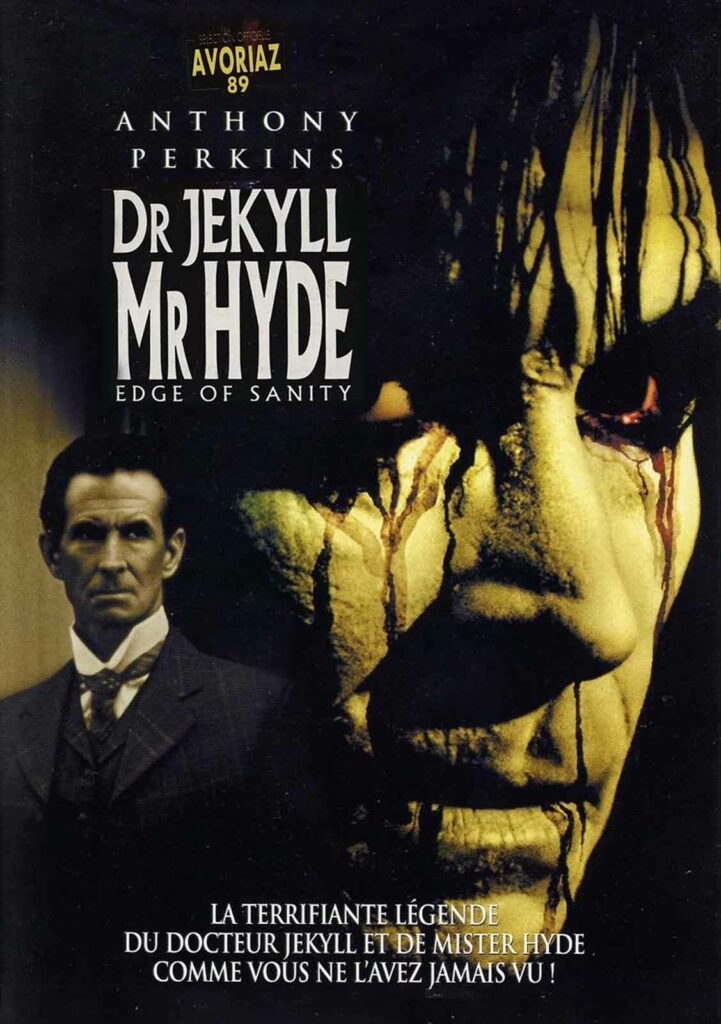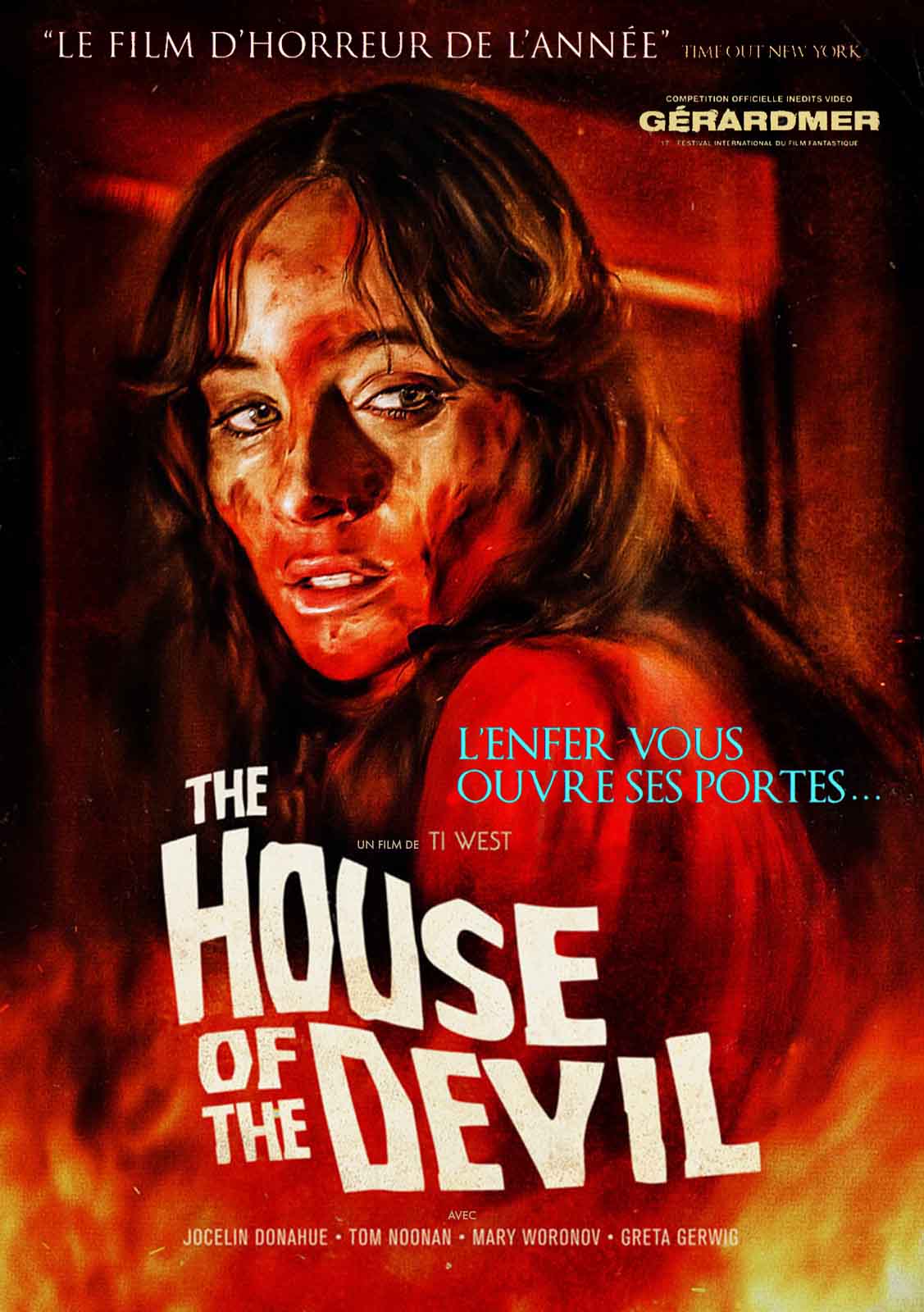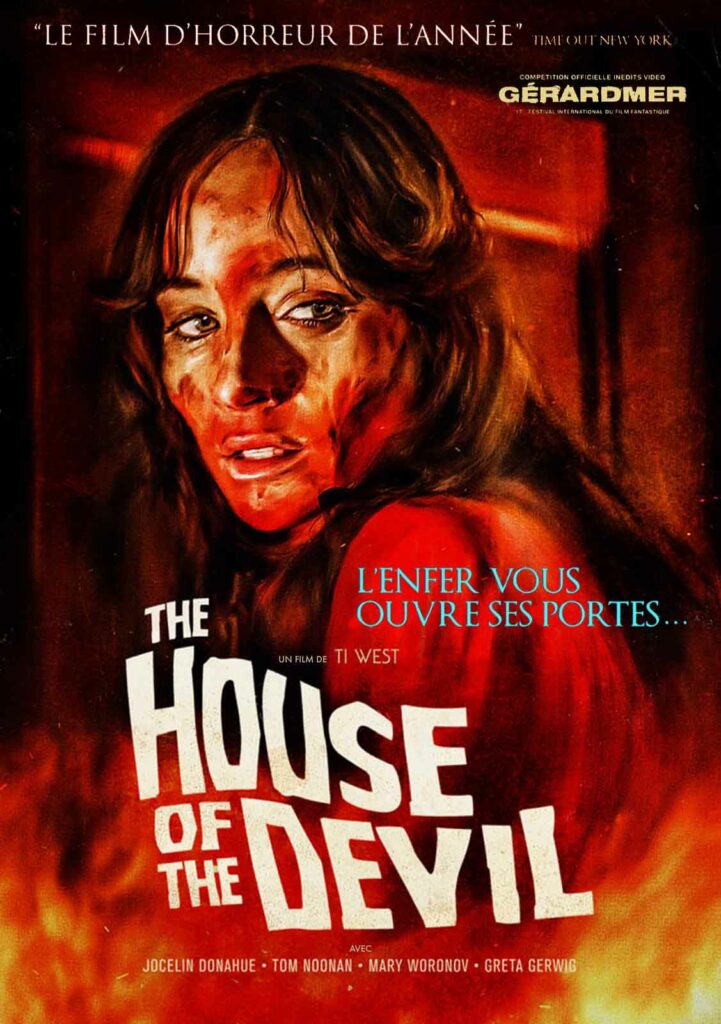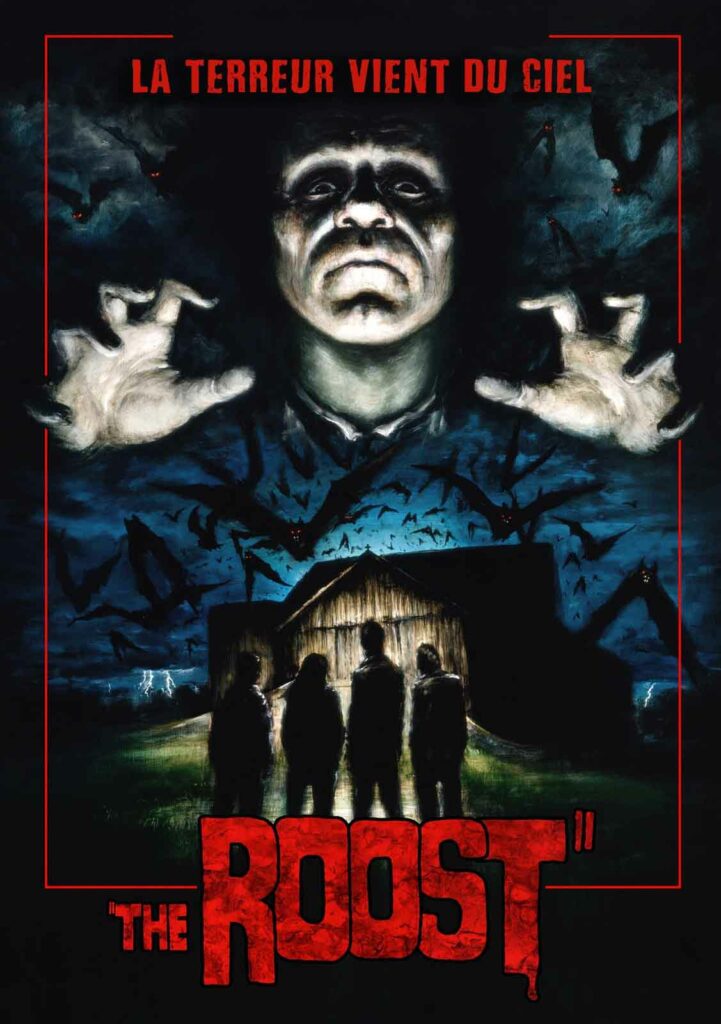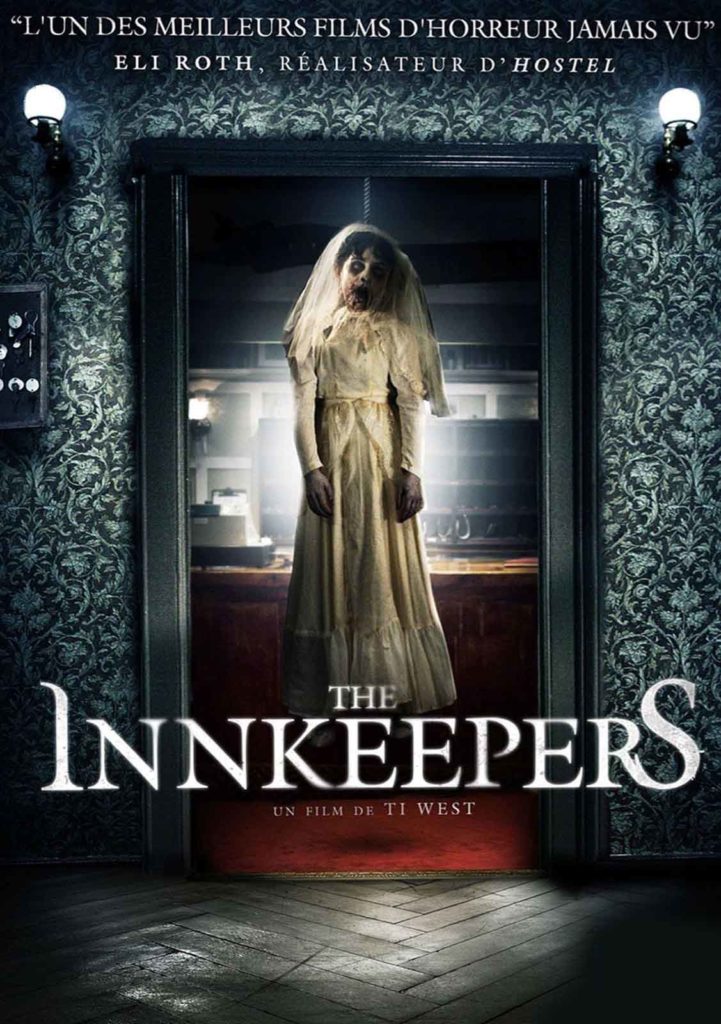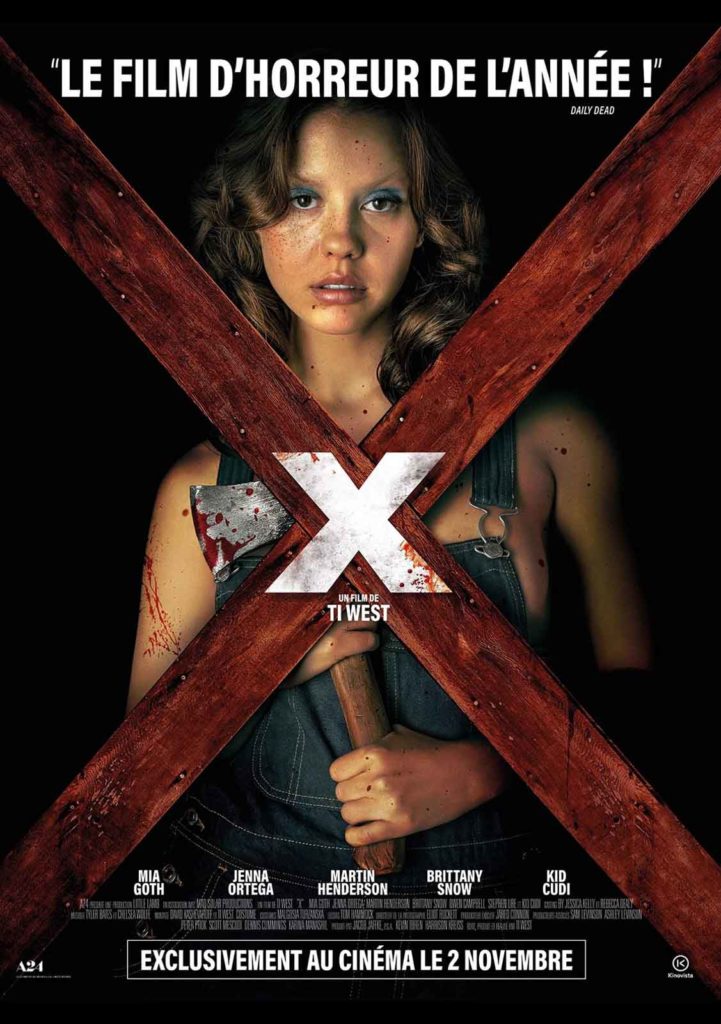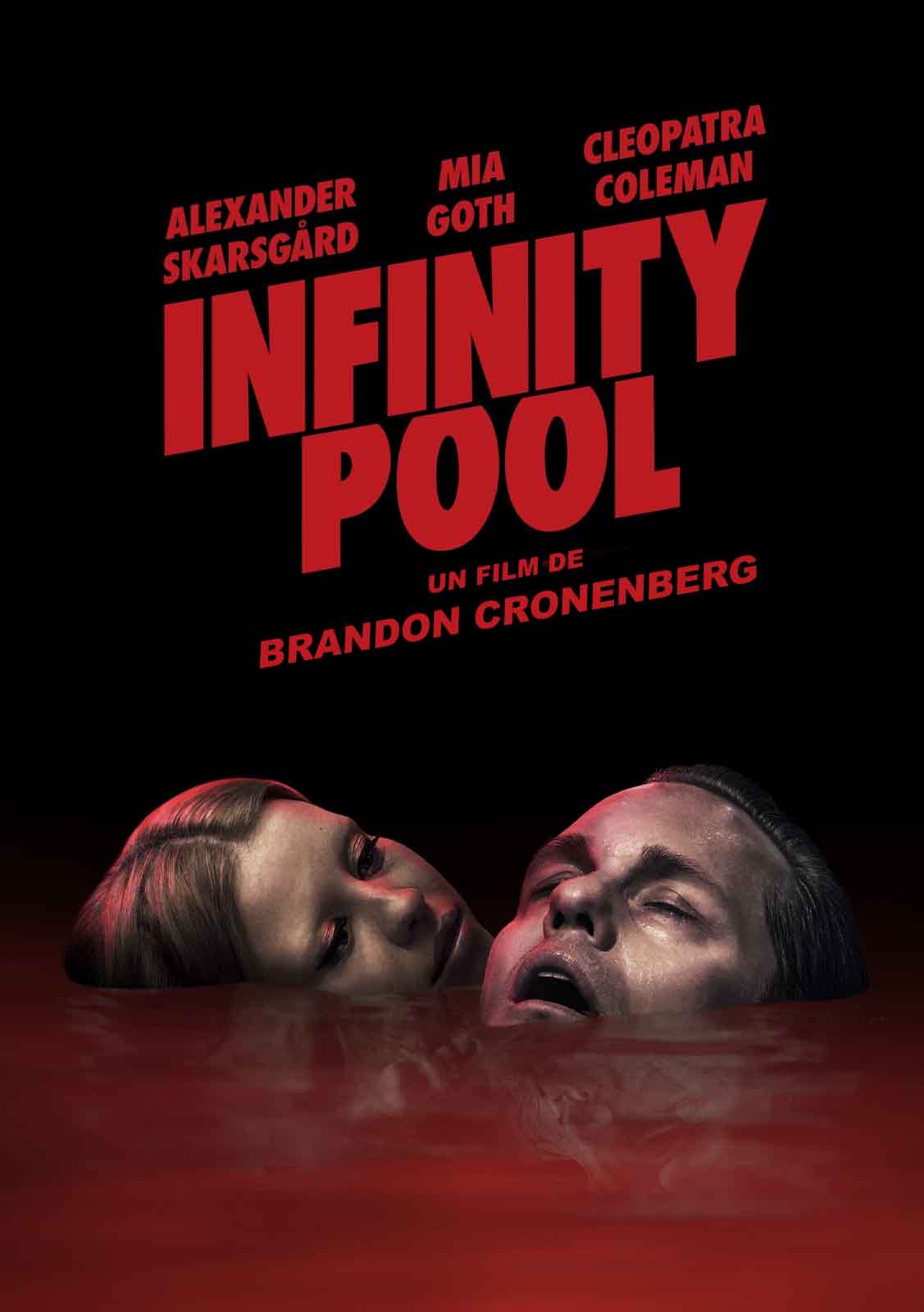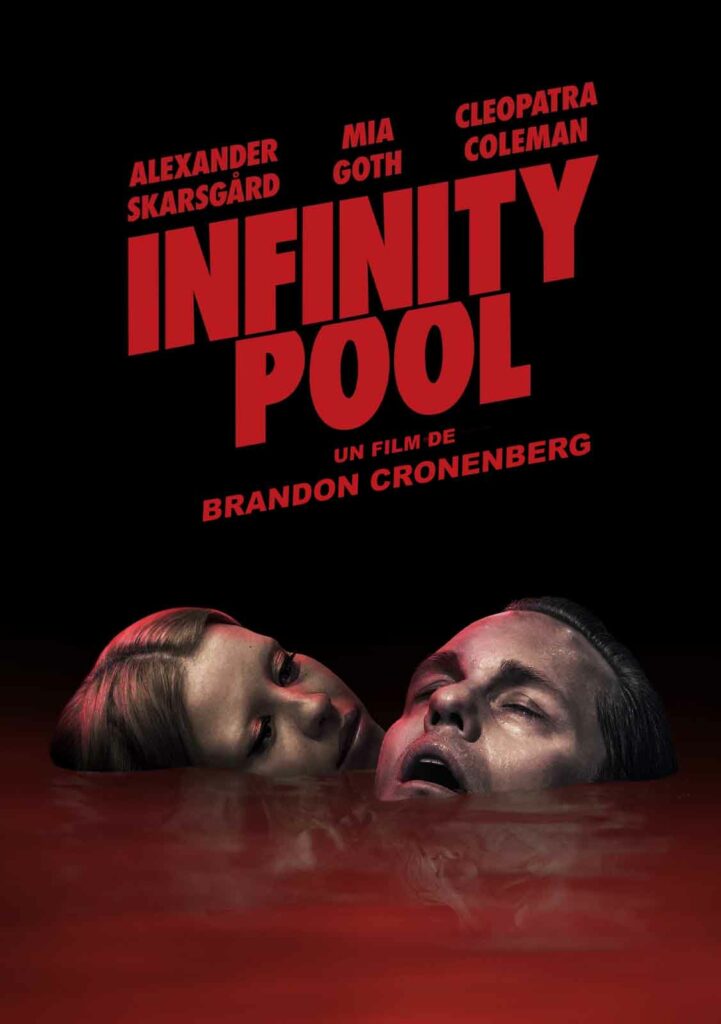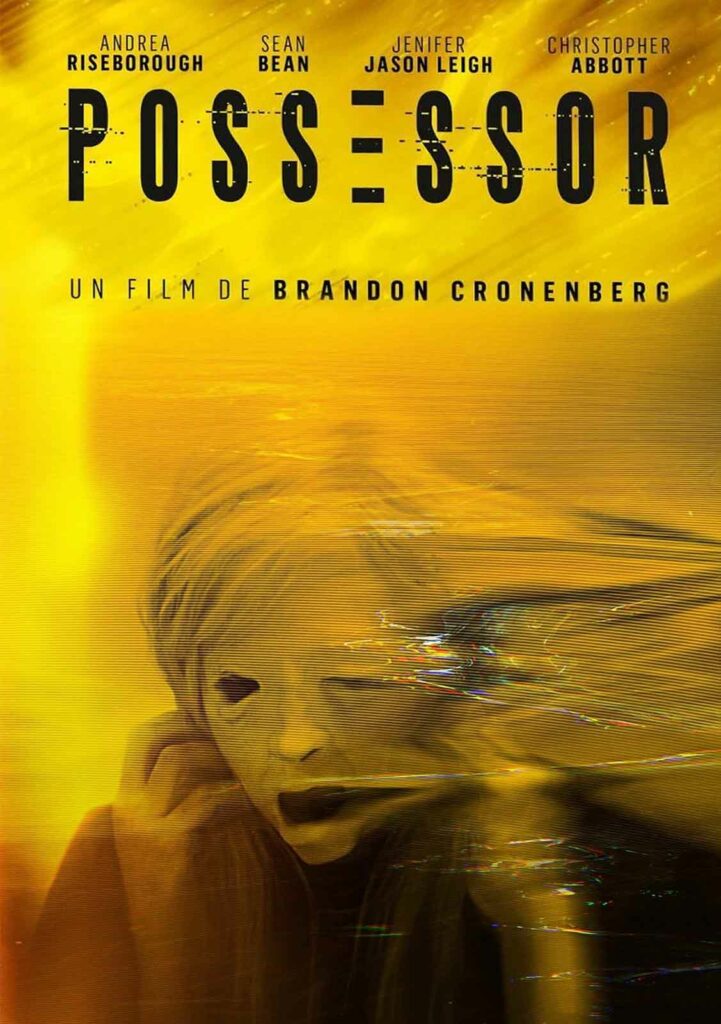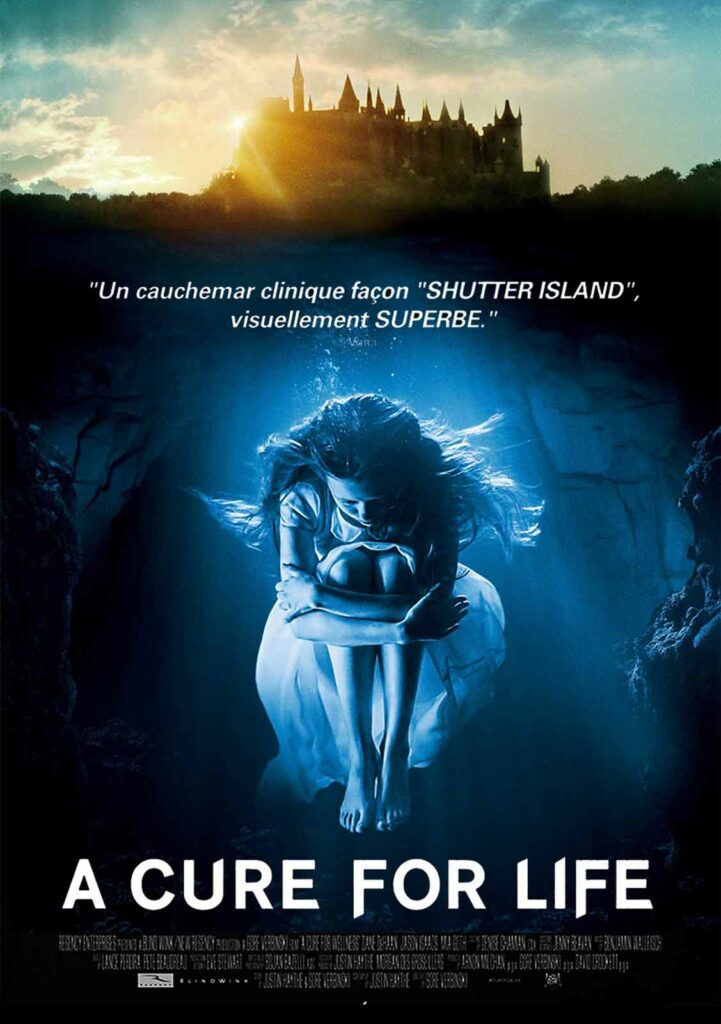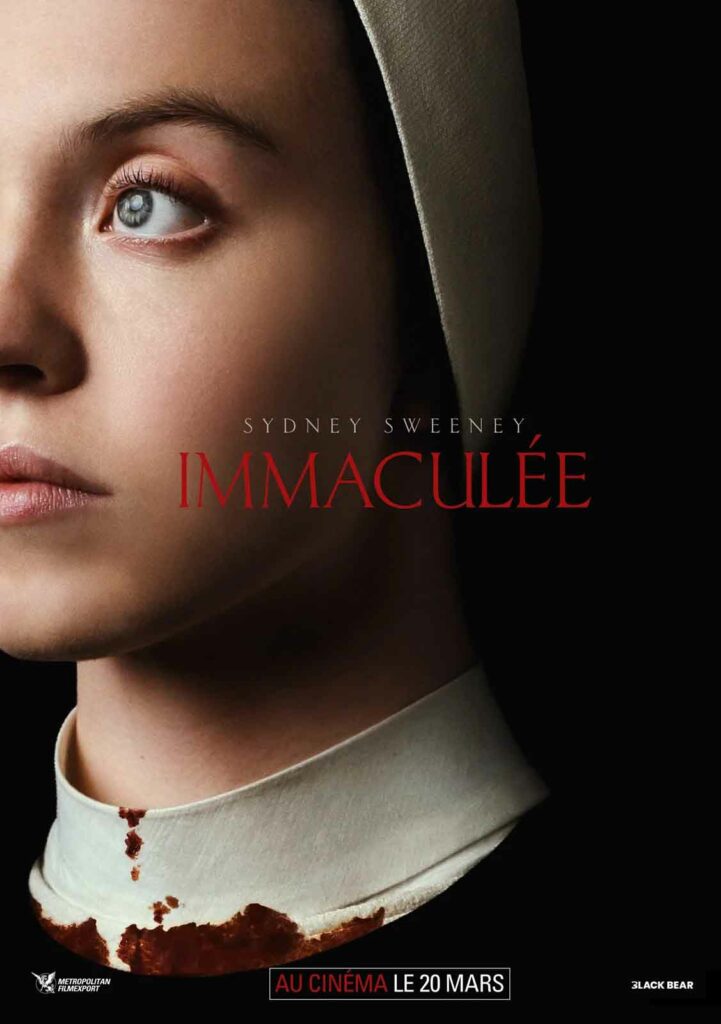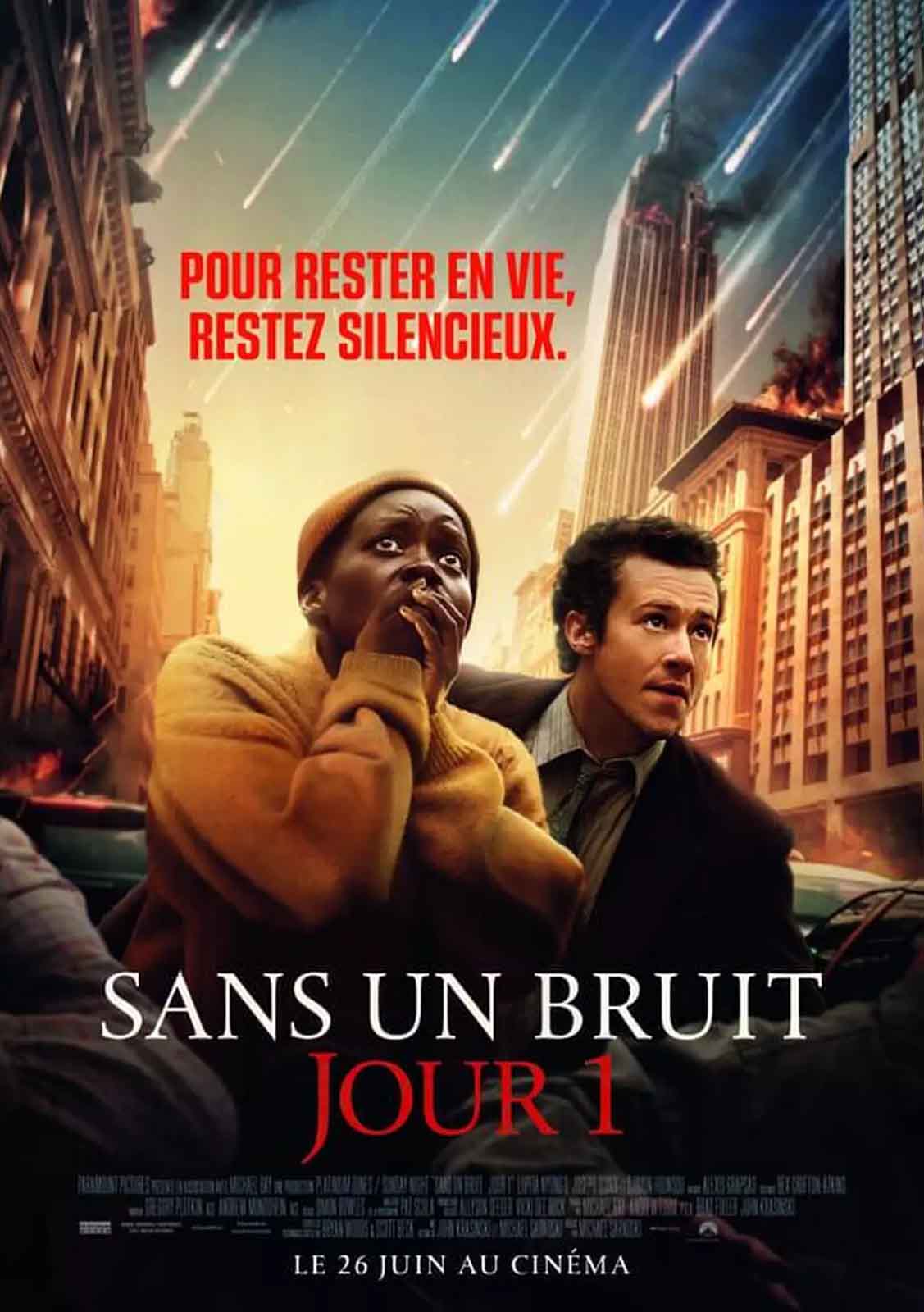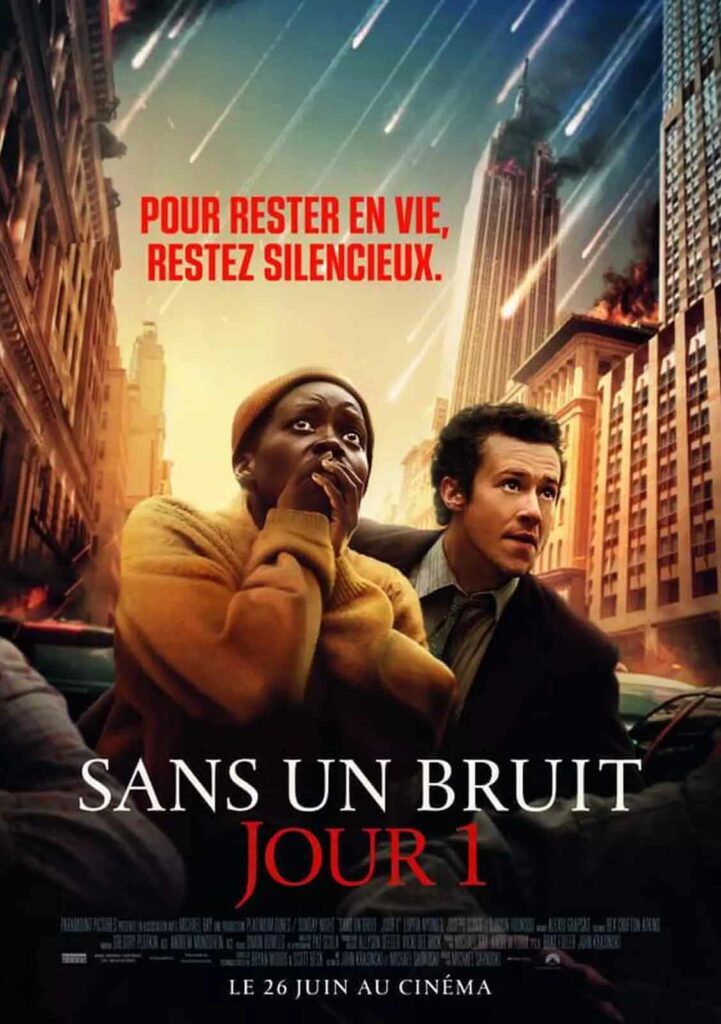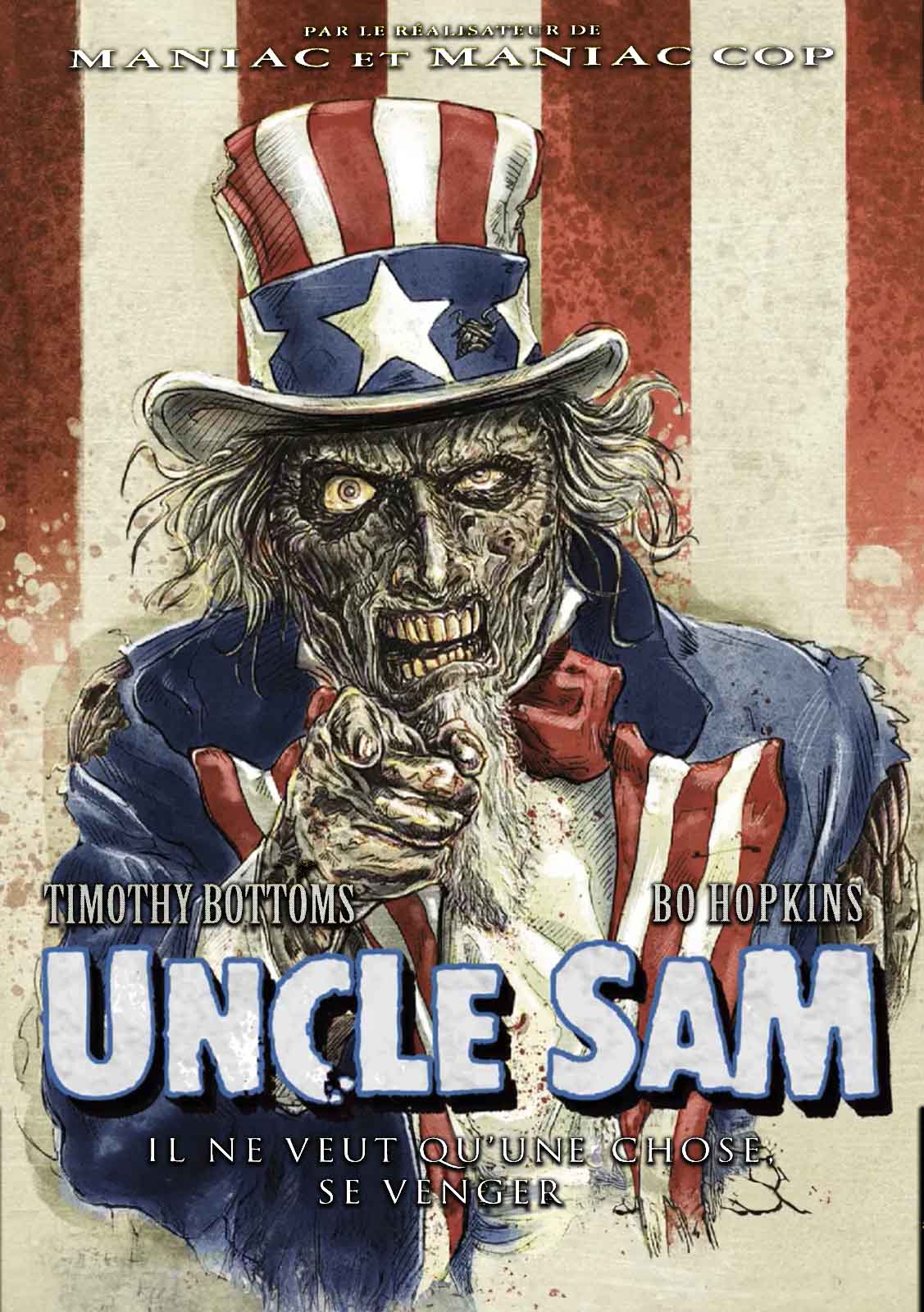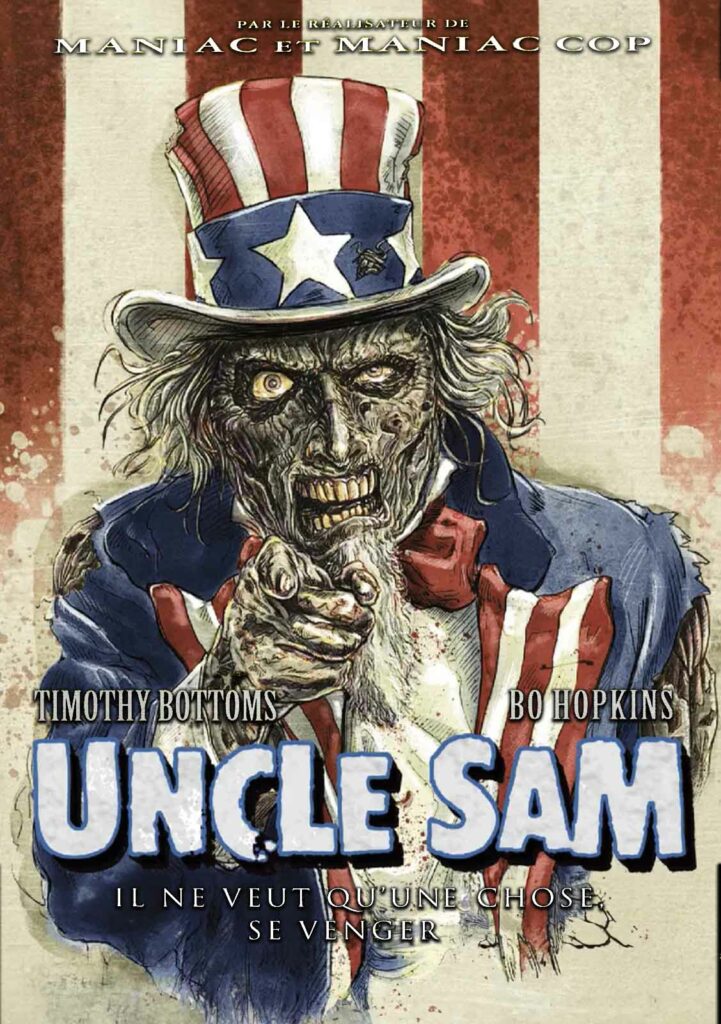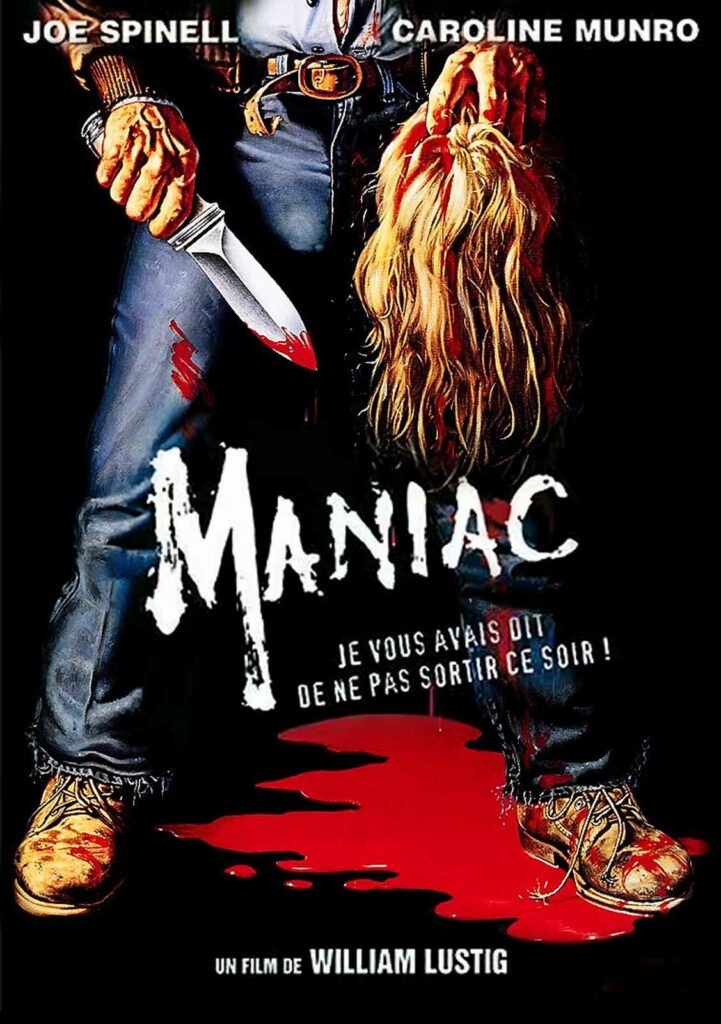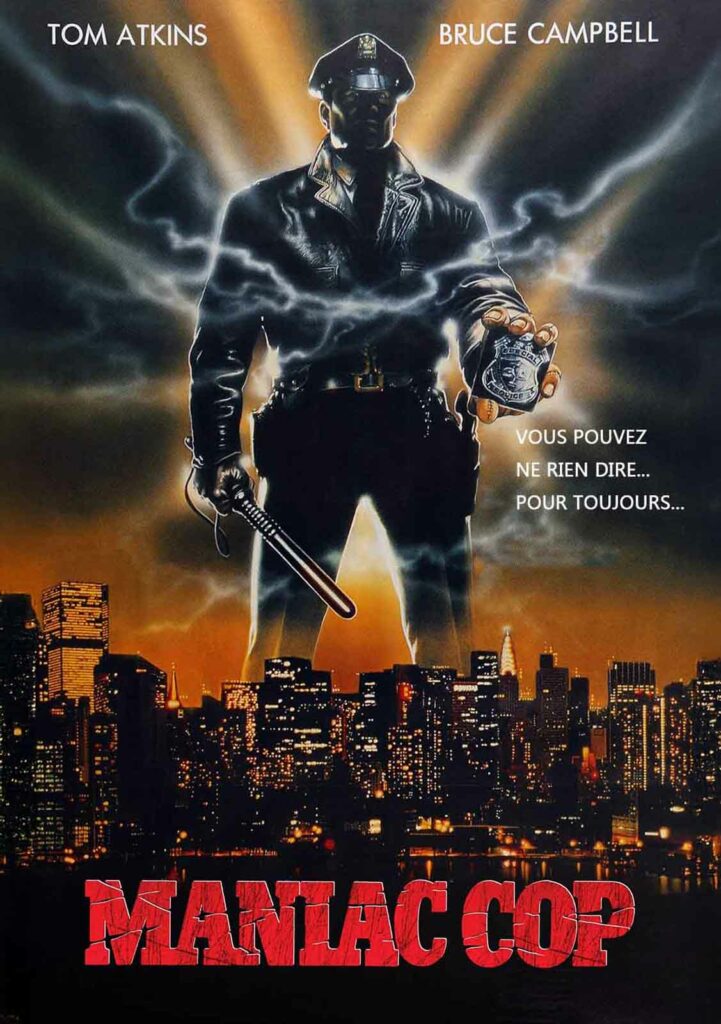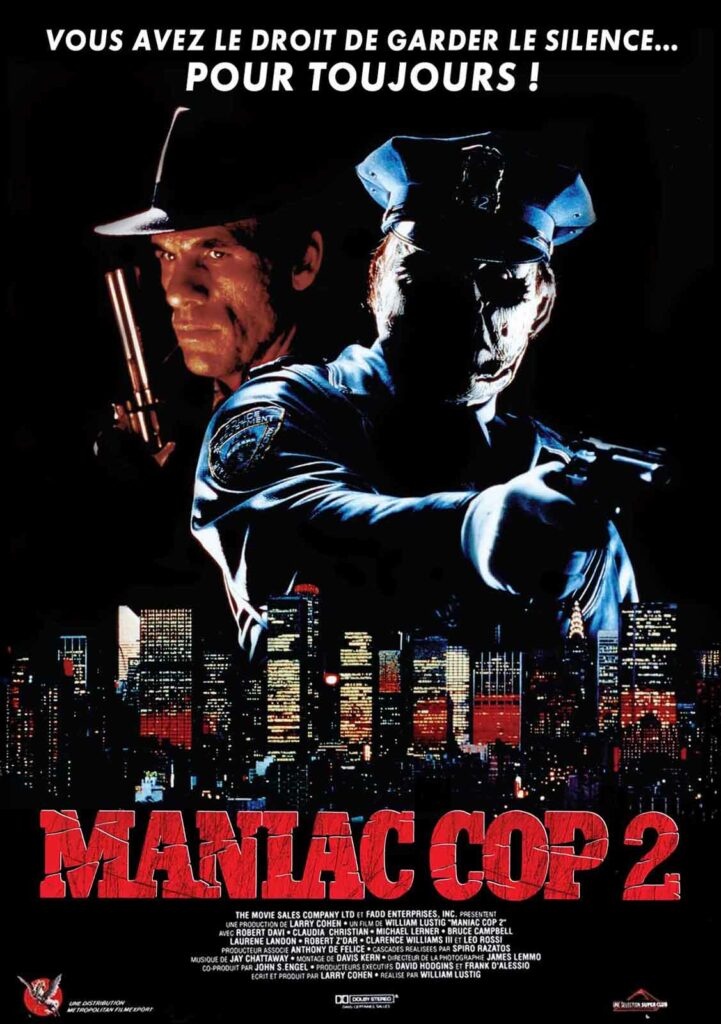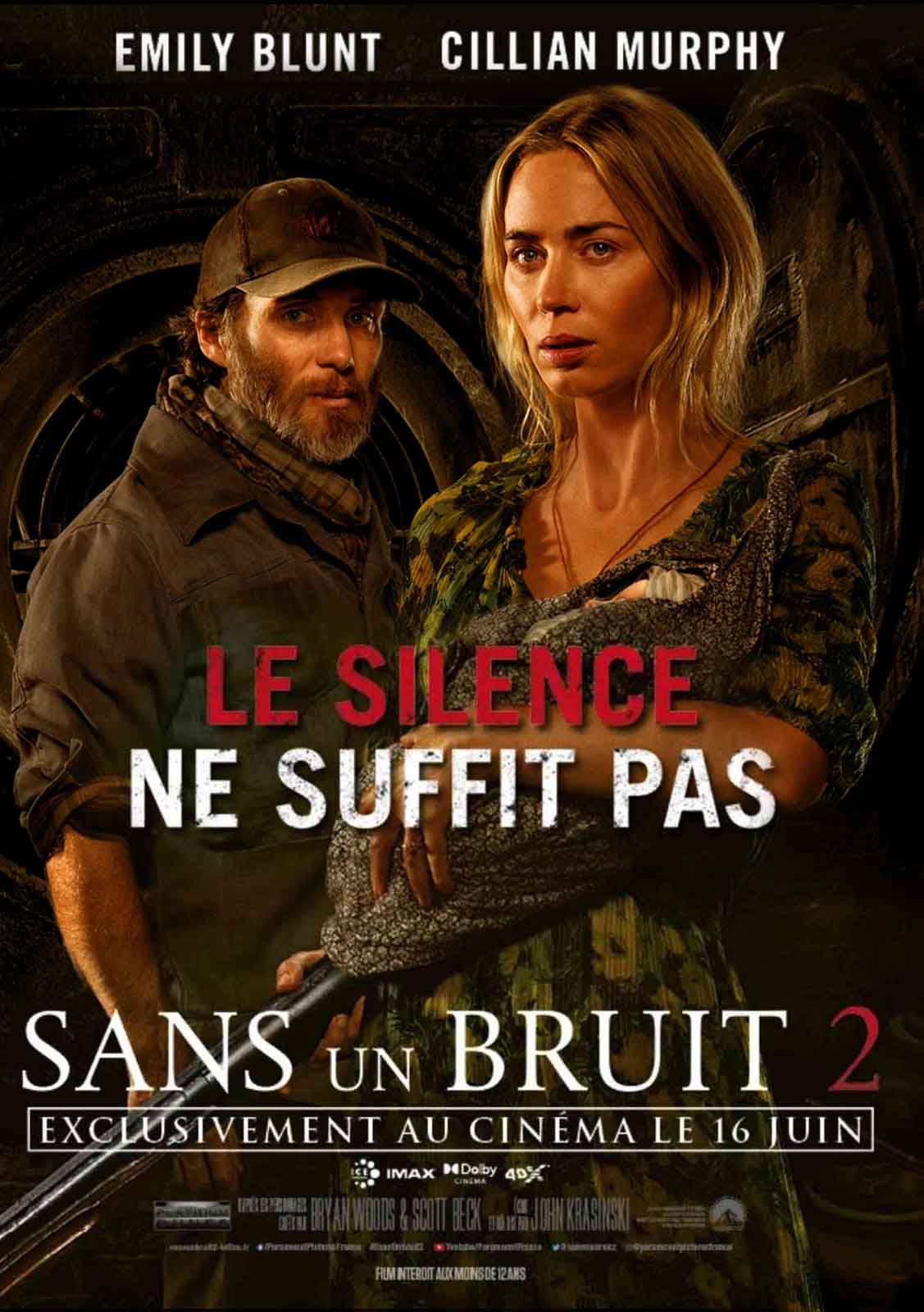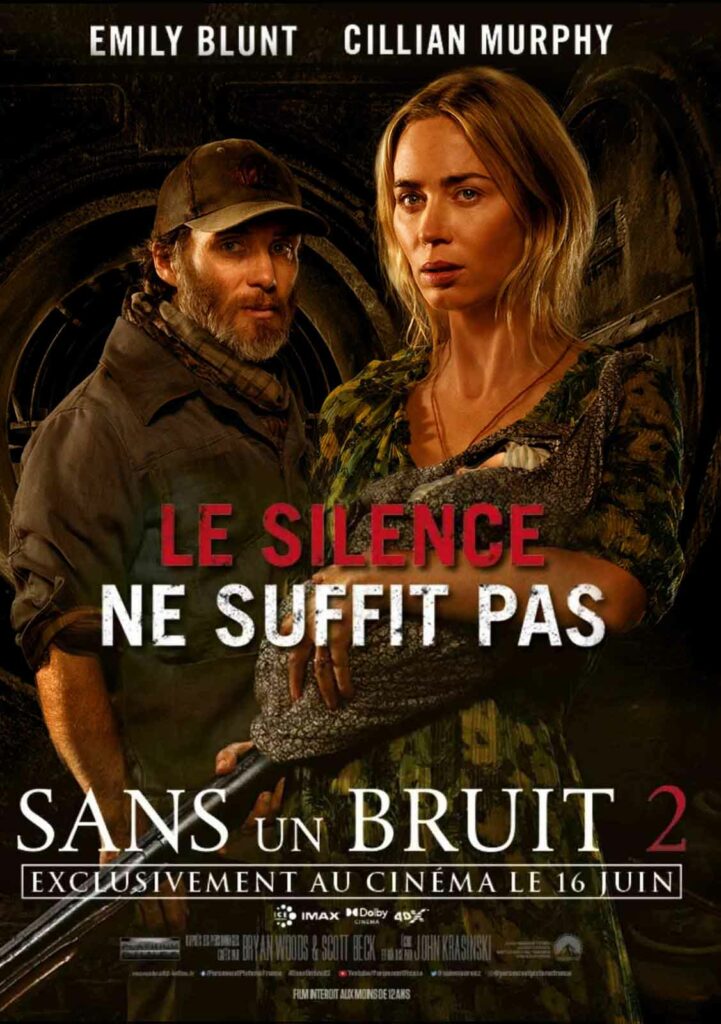Jon Favreau réalise un remake spectaculaire du classique animé de 1967 en plongeant son jeune héros dans un univers 100% virtuel…
THE JUNGLE BOOK
2016 – USA
Réalisé par Jon Favreau
Avec Neel Sethi et les voix de Bill Murray, Ben Kingsley, Idris Elba, Lupita Nyong’o, Scarlett Johansson, Giancarlo Esposito, Christopher Walken, Gary Shandling
THEMA EXOTISME FANTASTIQUE
Réalisateur chouchou de Disney depuis le succès d’Iron Man en 2008, Jon Favreau hérite quelques années plus tard de la mise en scène d’un nouveau Livre de la jungle qui revisite le long-métrage animé de 1967 en s’appuyant sur les toutes dernières avancées technologiques en matière d’images de synthèse. « Je pense que partir tourner dans la jungle en extérieurs ne nous aurait pas permis de retrouver la magie du film de 1967 », explique-t-il. « Or je voulais m’assurer que nous préservions cette qualité » (1). Les choix techniques du film sont donc radicaux. Si Mowgli est incarné par un être humain en chair et en os (en l’occurrence le débutant Neel Sethi, déniché au milieu d’un gigantesque casting de milliers d’enfants auditionnés aux États-Unis, en Angleterre, en Nouvelle-Zélande et au Canada), tous les animaux qui lui donnent la réplique sont des créations numériques, dans l’esprit du tigre créé par Rythm & Hues pour L’Odyssée de Pi. Les décors eux-mêmes n’existent pas. L’intégralité du tournage se déroule en effet en studio à Los Angeles, devant de grands fonds bleus. Le jeune comédien interagit certes pendant les prises de vues avec des marionnettes grandeur nature créée par le Jim Henson’s Creature Shop, mais celles-ci sont ensuite remplacées par leurs contreparties numériques, confiées aux compagnies MCP et Weta Digital.


Après la version réalisée par Stephen Sommers en 1994 et le téléfilm mis en scène quatre ans plus tard par Nick Marck, il s’agit de la troisième adaptation « live » des écrits de Kipling produite sous la houlette de Disney, et il fallait créer l’événement. Le pari technique était sacrément osé, sans garantie de succès, malgré les énormes pas en avant effectués par des films comme Avatar ou La Planète des singes : les origines et l’affrontement. Or force est de reconnaître que de ce point de vue, Le Livre de la jungle de Favreau est une réussite. En immersion dans une forêt indienne imaginaire reconstituée de toutes pièces, ce remake se dote d’une atmosphère fantasmagorique bienvenue qui n’est pas sans évoquer une autre adaptation, le fameux Livre de la jungle d’Alexandre Korda. Le scénario recycle dans les grandes lignes celui du classique de Wolfgang Reitherman, qui prenait lui-même énormément de libertés avec le matériau littéraire original. Élevé par une meute de loups et menacé par le tigre Shere-Khan, notre « petit d’homme » entame une nouvelle fois son grand voyage en direction d’un village humain, sous la protection de la panthère noire Bagheera, et multiplie les rencontres inattendues…
Digital world
Nous avons sans conteste affaire ici à l’un des meilleurs remakes dont Disney ait cru bon d’affubler ses dessins animés les plus célèbres depuis le début des années 2010, mais il faut reconnaître que la concurrence n’était pas rude. Face à La Belle et la Bête, Aladdin, Pinocchio ou La Petite sirène (qui seront réalisés dans la foulée), Le Livre de la jungle de Favreau ferait même presque office de chef d’œuvre. Mais ce long-métrage nous laisse tout de même une étrange impression liée à sa nature hybride mais aussi à son absence de positionnement stylistique. La quête d’hyperréalisme visuel (les animaux, la végétation, les pelages, les regards) nous emmène très loin des graphismes joyeux et volontairement caricaturaux du dessin animé des sixties. Pourtant, Favreau se sent obligé de payer son tribut à son prédécesseur en réutilisant les célèbres chansons de Baloo, King Louie et Kaa. Voir ces animaux numériques « zoologiquement corrects » pousser la chansonnette a quelque chose de très bizarre qui suscite presque un certain malaise. Les choses deviennent même absurdes lorsque le singe ajoute un couplet à son fameux « I wanna be like you » pour nous expliquer qu’il n’est pas un orang-outan mais un gigantopithèque, histoire de justifier auprès des spectateurs sa taille inhabituelle. En refusant de trancher et d’adopter un point de vue clair, en cherchant à faire plaisir à tout le monde, en se mettant en quête à la fois de la performance technique et de la séduction des fans du classique original, Favreau finit par se perdre dans cette jungle de pixels. Il nous offre certes un très joli film, mais la coquille est un peu vide.
(1) Extrait d’un entretien paru dans « Business Standard » en février 2016
© Gilles Penso
À découvrir dans le même genre…
Partagez cet article