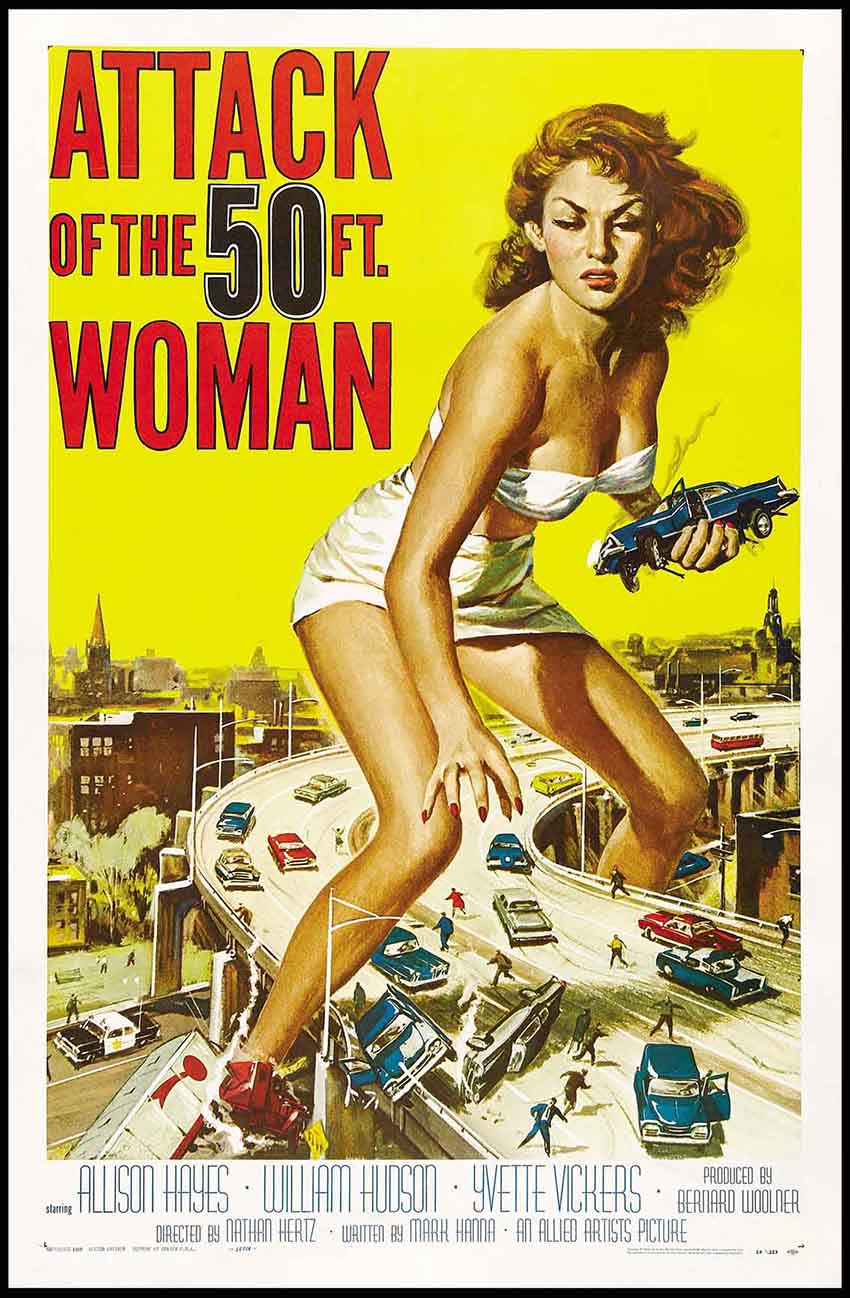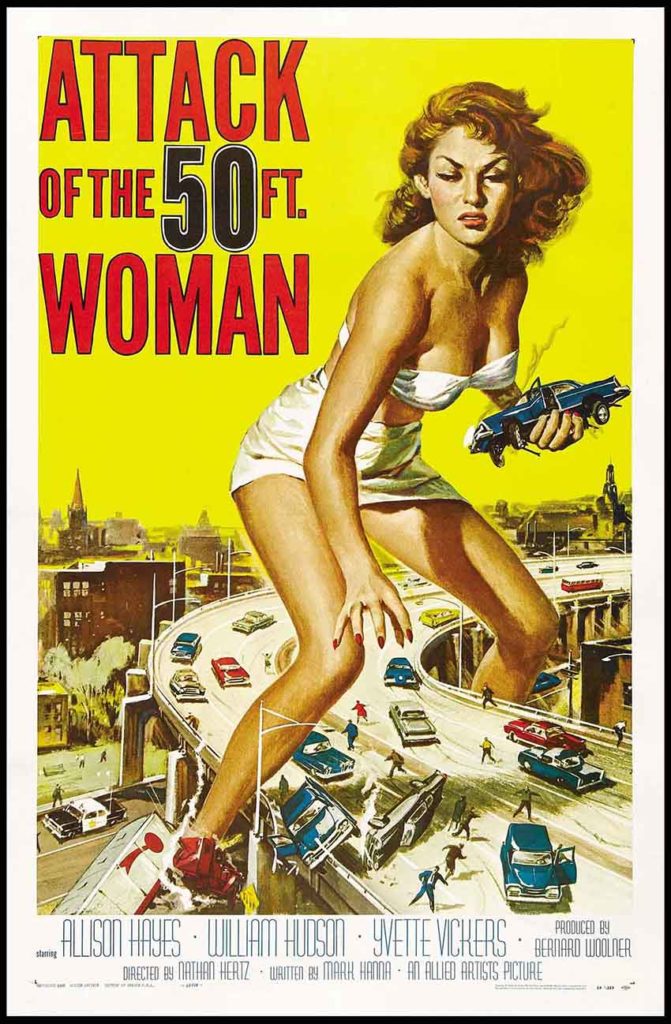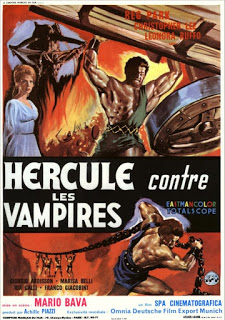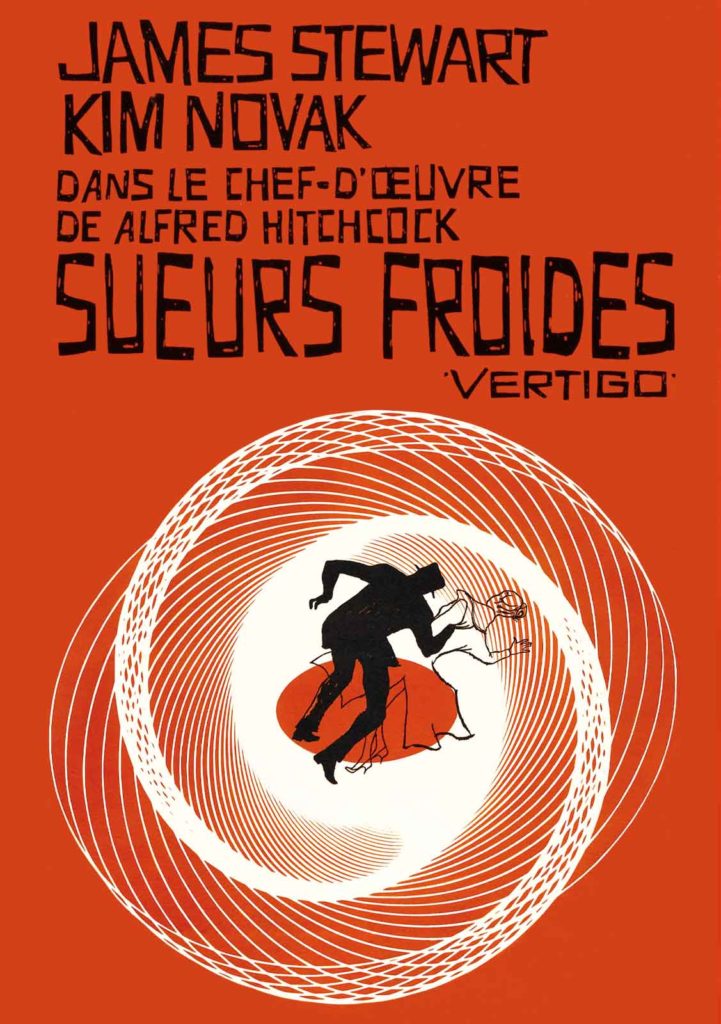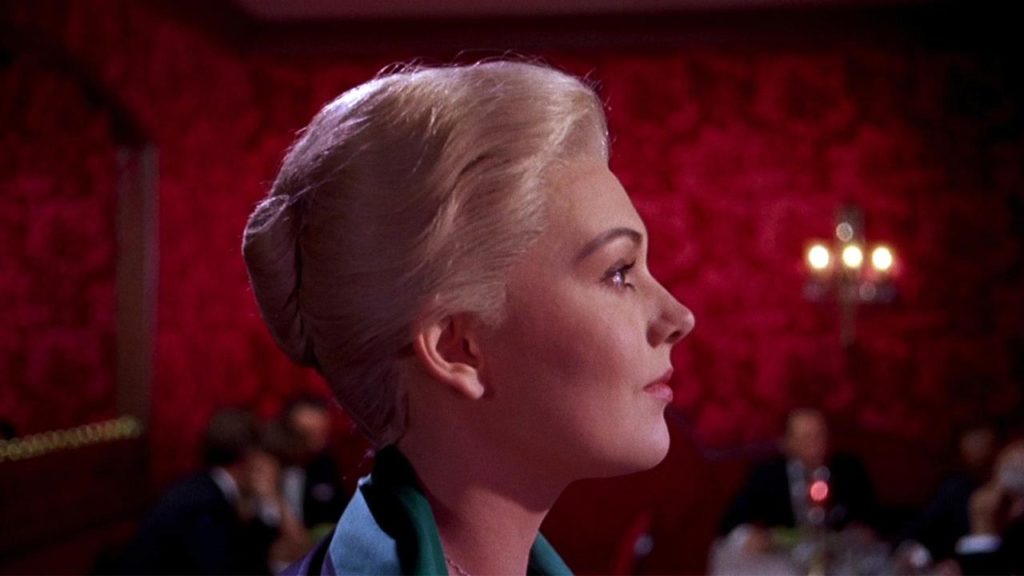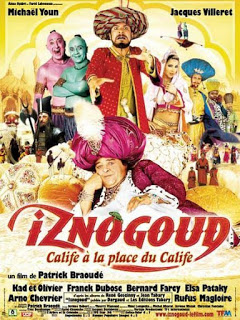Un téléfilm de politique-fiction peu connu que tous les amateurs de Joe Dante doivent absolument découvrir !
THE SECOND CIVIL WAR
1997 – USA
Réalisé par Joe Dante
Avec Beau Bridges, James Earl Jones, James Coburn, Ron Perlman, Kevin Dunn, Dick Miller, Robert Picardo, Kevin McCarthy
THEMA POLITIQUE-FICTION


Une guerre nucléaire venant d’éclater entre l’Inde et le Pakistan, de nombreux orphelins pakistanais doivent se réfugier aux États-Unis. Or le président est un être faible incapable de prendre la moindre décision sans son conseiller en communication, tandis que le gouverneur de l’Idaho décide de fermer les frontières de son état pour empêcher ces nouveaux immigrants d’envahir le pays. Cette situation entraine un conflit interne qui s’annonce comme une véritable nouvelle guerre de Sécession, l’ensemble des événements étant retransmis par la chaine d’information Newsnet. L’humour du film est souvent grinçant, et le drame affleure parfois sous la comédie, comme en témoigne cette réplique lourde de sens prononcée en voix-off par James Earl Jones : « Parfois, le fil tendu qui sépare la paix de la guerre, la pérennité de la destruction, peut se briser à cause d’un geste, d’un mot, d’une inflexion de voix. Après toute crise majeure, on ne peut s’empêcher de regarder en arrière pour tenter d’apercevoir le moment où ce fil a été rompu sans espoir d’être renoué. »
Un humour volontiers grinçant
Partagez cet article