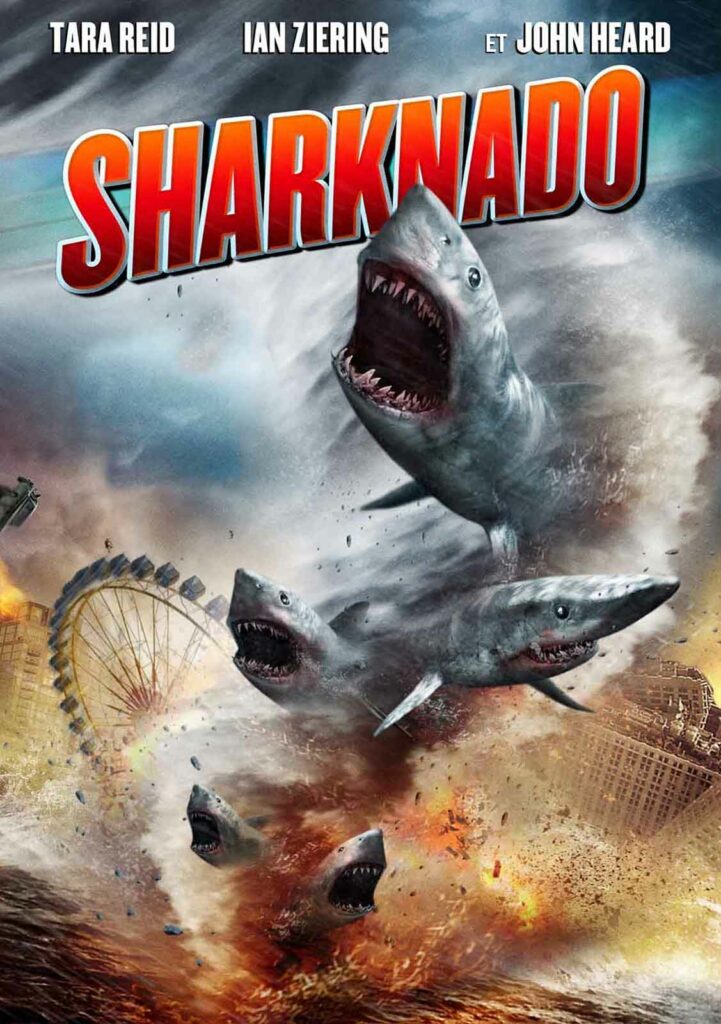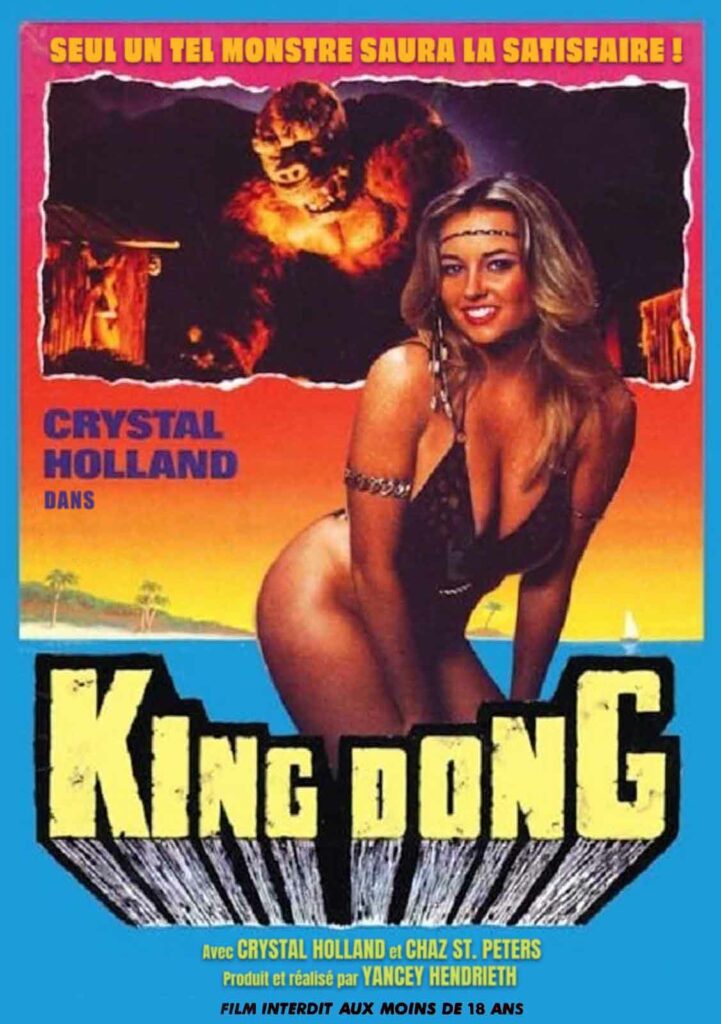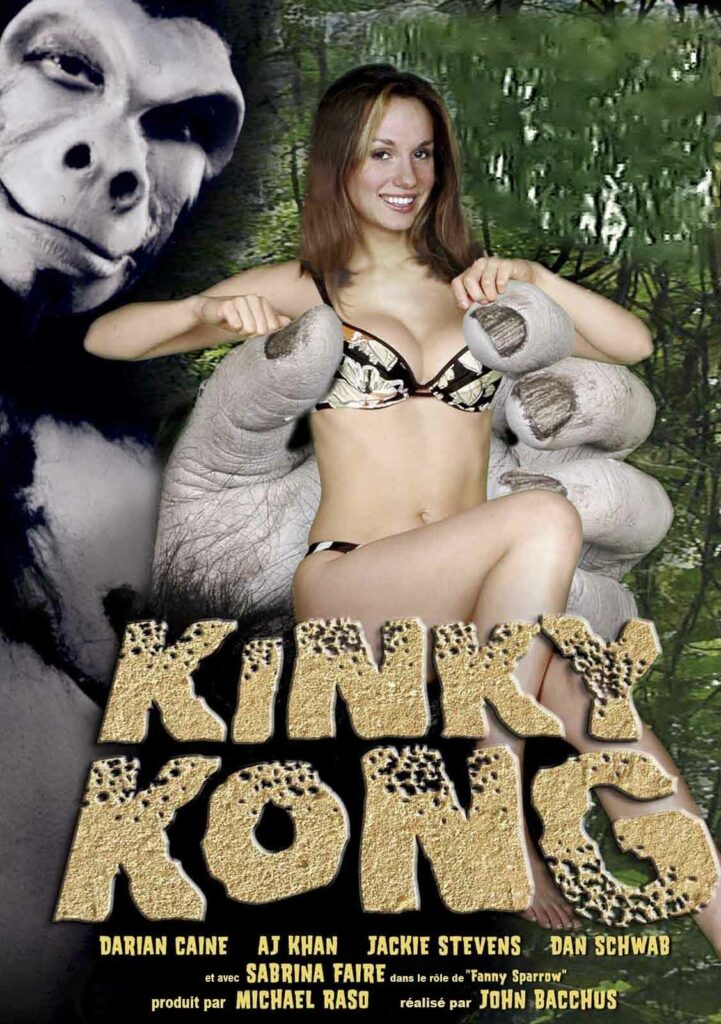Cette vague adaptation d'un comics lui-même vaguement inspiré du roman de Mary Shelley n'aura pas convaincu grand-monde
I, FRANKENSTEIN
2014 – USA / AUSTRALIE
Réalisé par Stuart Beattie
Avec Aaron Eckhart, Miranda Otto, Bill Nighy, Jai Courtney, Caitlin Stasey, Yvonne Strahovski
THEMA FRANKENSTEIN
Après Underworld 3 , I, Frankenstein, adaptation du comic book de Kevin Grevioux (scénariste des Underworld), devait être le second long métrage du maquilleur Patrick Tatopulos en tant que réalisateur. Auteur d’effets spéciaux qui dépotent dans des films qui ne dépotent pas toujours autant (Stargate, Godzilla, Silent Hill, Je suis une Légende), le frenchie a malheureusement perdu le poste au profit de Stuart Beattie, réalisateur du pas si mal Demain, quand la guerre a commencé mais aussi scénariste sur la saga Pirates des Caraïbes. Un revirement probablement décisif pour ce qui s’apparente au final au premier gros nanar de 2014. Que reste-t-il véritablement du classique de Mary Shelley dans cette adaptation d’un comics déjà très librement inspiré du mythe du Prométhée moderne ? Rien, ou pas grand-chose si l’on compte une intro nous décrivant en 3 minutes chrono la fin tragique de ce chef d’œuvre de la littérature. Très rapidement donc, on retrouve la créature de Frankenstein confrontée à des démons et une secte de gargouilles se faisant la guerre dans un cadre gothique qui n’est pas sans rappeler Underworld. Sauf qu’Adam (rebaptisé ainsi par les chimères) se pose des questions sur sa nature, questions auxquelles des scientifiques, qui tentent de réactiver des corps sans vie sous les ordres d’un démon supérieur, pourraient bien apporter des réponses.


Rarement aura-t-on vu une telle injure au roman original. Revisiter Frankenstein, pourquoi pas : Terence Fisher en a fait des déclinaisons parfois remarquables (Le Retour de Frankenstein), Mel Brooks a signé une parodie succulente en 1974 (Frankenstein Junior), la créature a rencontré d’autres monstres sacrés au fil des années (Dracula, le loup-garou,…) et Tim Burton a même déliré sur une version canine (Frankenweenie). Mais le faire avec si peu d’égard, de talent et d’idée, c’est juste insupportable ! Prévisible de bout en bout, le tensiomètre à zéro, la mise en scène sur-découpée, une créature qui s’apparente à un bien fade anti-héros de plus dont les caractéristiques et l’ambiguïté ne sont jamais exploitées…
L'impardonnable profanation d'un classique
I, Frankenstein est réellement sans intérêt. Et ce n’est pas la présence d’Aaron Eckhart, dont la carrière part en vrille dans des DTV et autres purges du genre, ni celle de Bill Nighy en mode « je ne me casse pas plus le cul que dans Underworld, de toute façon c’est moins bien », qui changent la donne : aux côtés d’autres acteurs mono-expressifs façonnés pour jouer dans ce genre de production (Jai Courtney et Kevin Grevioux himself), ils ne dénotent pas, bien au contraire. Quelle pitié ! Et vous ai-je signalé que même visuellement c’était immonde, avec bouillie d’effets numériques indigeste et maquillages copiés sur ceux de la série Buffy contre les vampires au menu ? En dessous de Van Helsing et d’Underworld, on placera désormais I, Frankenstein, profanateur d’un classique de la littérature pourtant déjà maintes fois adapté et retourné dans tous les sens.
© Samuel Tubez
Partagez cet article