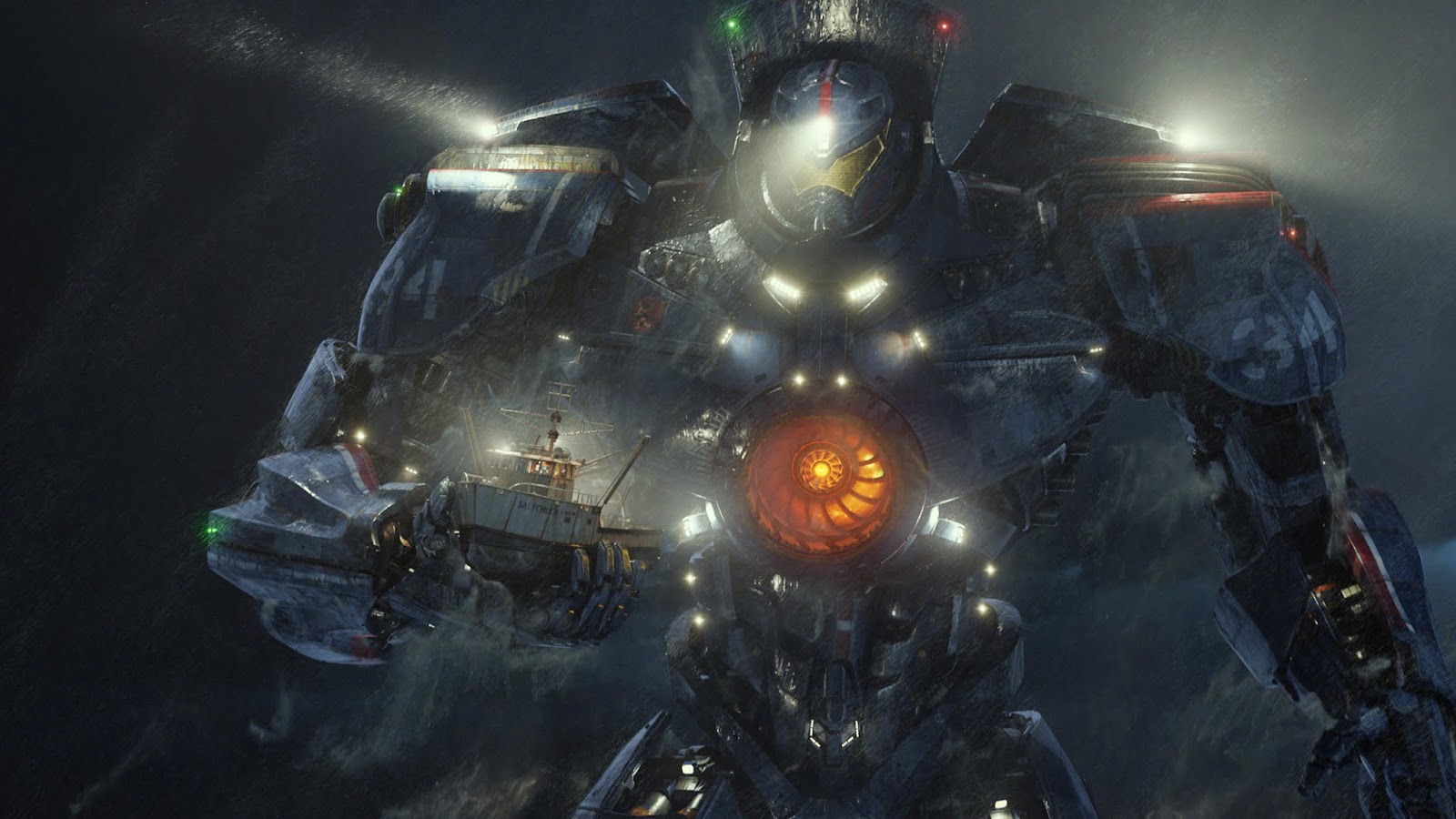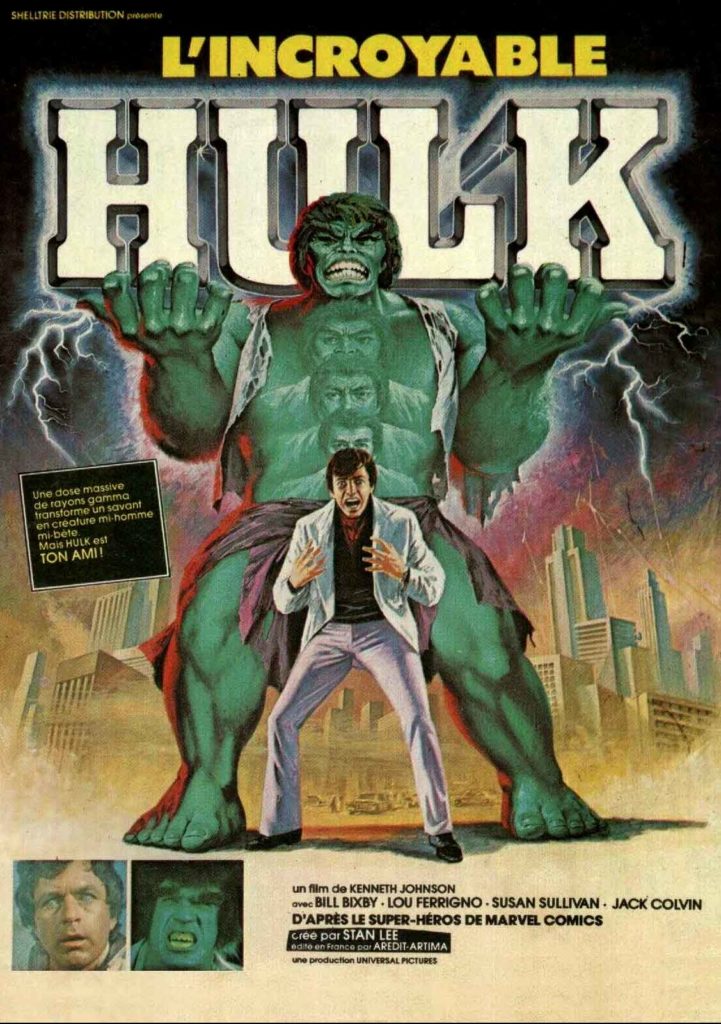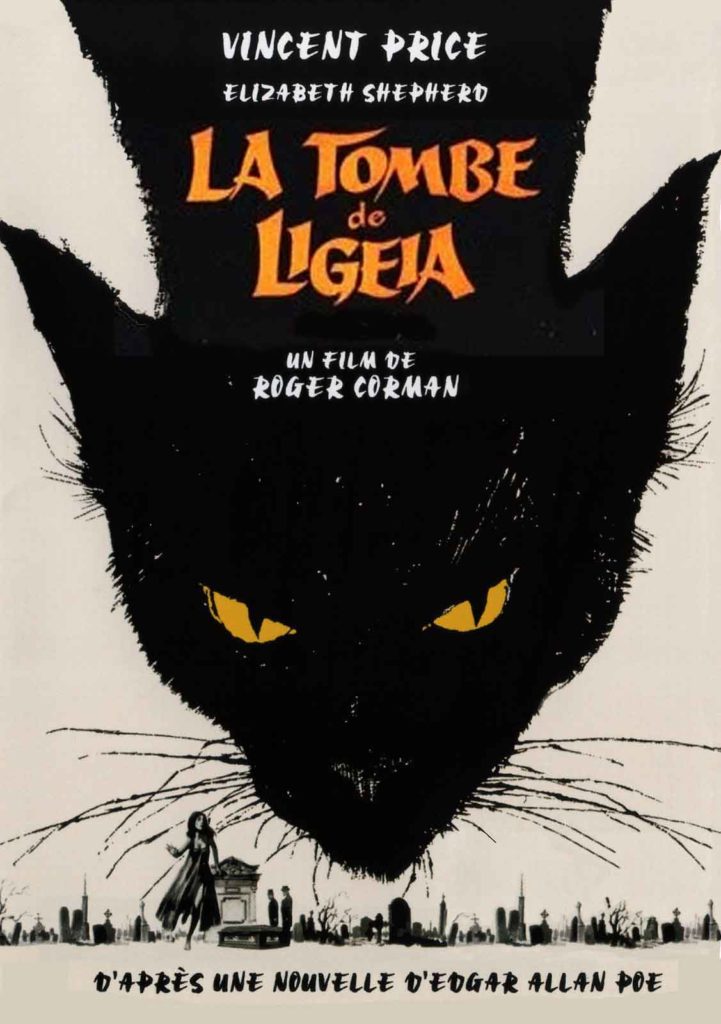James Mangold se réapproprie le plus célèbre des X-Men pour le transformer quasiment en samouraï partagé entre son humanité et sa bestialité
THE WOLVERINE
2013 – USA
Réalisé par James Mangold
Avec Hugh Jackman, Hiroyuki Sanada, Tao Okamoto, Rila Fukushima, Famke Janssen, Will Yun Lee
THEMA SUPER-HÉROS I MUTATIONS I SAGA X-MEN I MARVEL
Depuis sa création par le scénariste Len Wein en 1974, Wolverine s’est taillé la part du lion au sein des X-Men, acquérant bien vite le statut du plus populaire de tous les mutants issus des ateliers Marvel. Aussi a-t-il droit à sa propre série de films, parallèlement à ceux consacrés à l’équipe complète. Après un X-Men Origins : Wolverine n’ayant pas convaincu les aficionados, Logan revient donc sous le feu des projecteurs pour un nouveau long-métrage situé cette fois-ci après X-Men 3. Fidèles à leur penchant pour les crossovers et les spin-offs – illustré avec brio dans la franchise Avengers – les studios Marvel, associés ici avec la Fox, tissent ainsi les liens complexes d’une épopée dont le point culminant aura été la prodigieuse préquelle X-Men, le commencement dirigée par Matthew Vaughn. Ici, c’est James Mangold qui tient les rênes, un choix qui peut sembler curieux dans la mesure où le cinéaste, signataire d’indéniables réussites dans le domaine du polar (Copland), du thriller (Identity) ou du western (3h10 pour Yuma), est ici loin de son registre habituel. Mais dès les premières minutes de Wolverine : le combat de l’immortel, tous les doutes se dissipent.


Avec une maestria proche du Steven Spielberg d’Empire du Soleil, Mangold plante ses caméras dans le Nagasaki de 1945 et plonge son héros dans la tourmente d’un bombardement atomique à l’issue duquel il se lie d’amitié avec Yashida, un soldat japonais qu’il sauve in-extremis des flammes nucléaires. Les années ont passée et Logan a vécu de nombreux tourments, le moindre n’étant pas la mort de sa bien-aimée Jean Grey. Désormais hanté par des cauchemars récurrents, il est tiré de sa vie d’ermite par Yukio, une jeune Japonaise experte en arts martiaux qui fait office de messagère. Logan est attendu à Tokyo où Yashida, prêt à exhaler son dernier souffle, souhaite lui faire ses adieux. Mais dans le pays du soleil levant, l’homme aux griffes d’adamantium est un parfait étranger, et l’ennemi qu’il s’apprête à rencontrer dépasse tout ce qu’il a pu affronter jusqu’alors.
Les luttes intérieures de Logan
Wolverine nous offre des séquences d’action étourdissantes (le kidnapping en plein centre-ville, le combat nocturne contre les ninjas ou encore cette incroyable course-poursuite sur le toit d’un train ultra-rapide qui fera date dans l’histoire des cascades et des effets spéciaux) et jette notre héros en pâture à des adversaires hauts en couleurs (la fascinante et vénéneuse « Vipère », le très impressionnant « Samouraï »). Mais le film ne repose pas majoritairement sur son caractère spectaculaire. Les luttes intérieures de Logan, traduites à merveille par le jeu intense d’Hugh Jackman, n’ont jamais été aussi violentes. Partagé entre deux cultures (l’Occident et l’Orient), deux natures (l’homme et le monstre), deux instincts (le repli sur soi ou le sacrifice altruiste), Wolverine est déchiré, et la remise en cause de son immortalité entame son habituelle détermination. Wolverine porte en son sein l’une des images les plus fortes de l’histoire du film de super-héros, celle d’un homme vaincu, genou à terre, le dos percé de centaines de projectiles tissant derrière lui une inextricable toile d’araignée, mais luttant toujours pour rendre justice coûte que coûte. Et la citation d’Elie Wiesel, décrivant le légendaire Golem, nous revient alors en mémoire : « Connaissez-vous des êtres qui n’existent que pour autrui, qui vouent le moindre souffle, le moindre battement de paupières, la plus infime parcelle de leur existence à une vocation unique et sacrée : celle de protéger la vie ? » Avec Wolverine, la saga X-Men s’orne ainsi d’un de ses plus beaux opus, dont l’épilogue déconcertant et ouvert attise fortement notre curiosité.
© Gilles Penso
À découvrir dans le même genre…
Partagez cet article