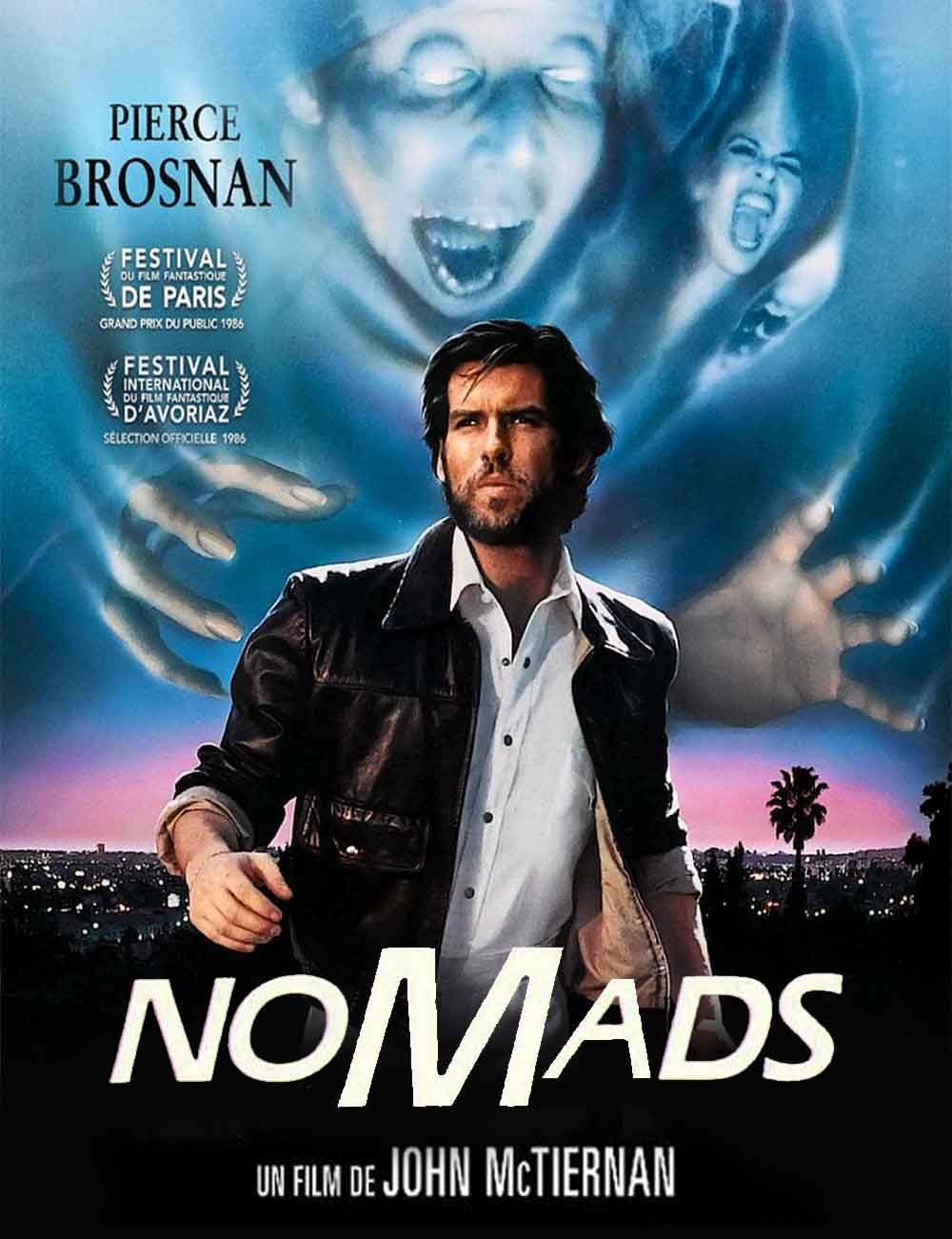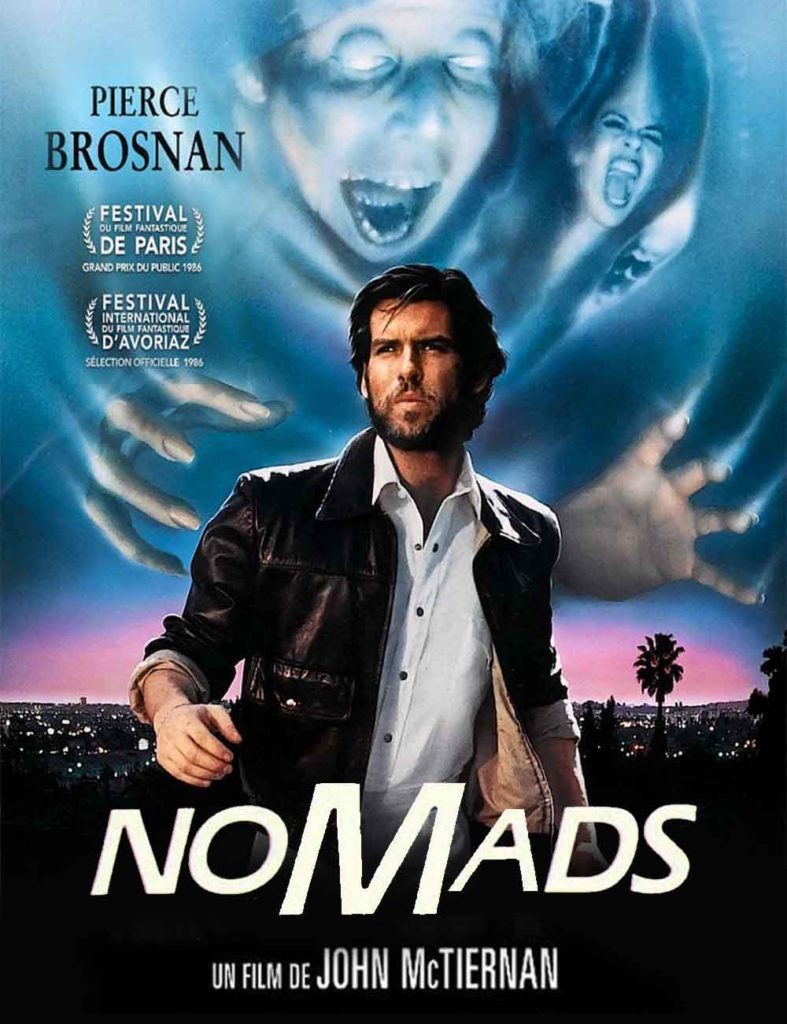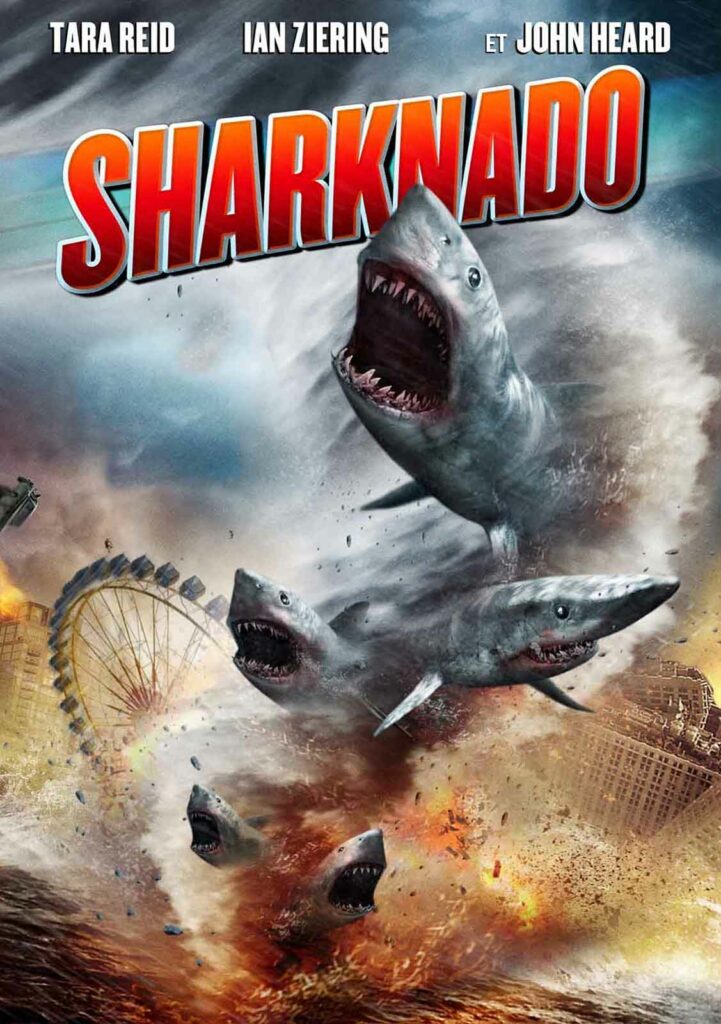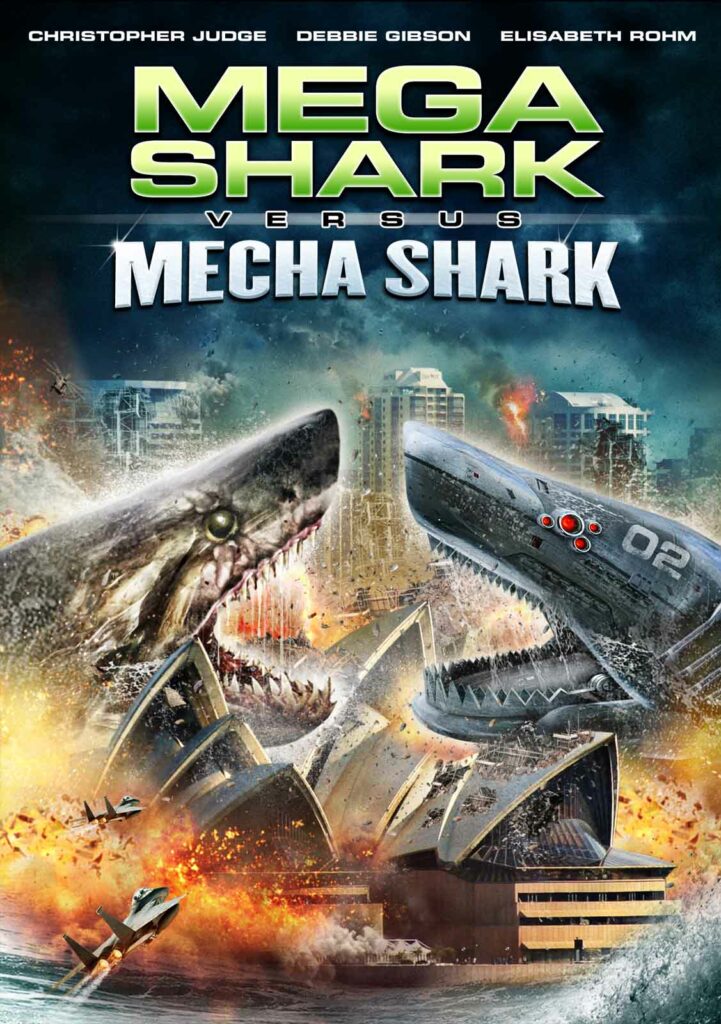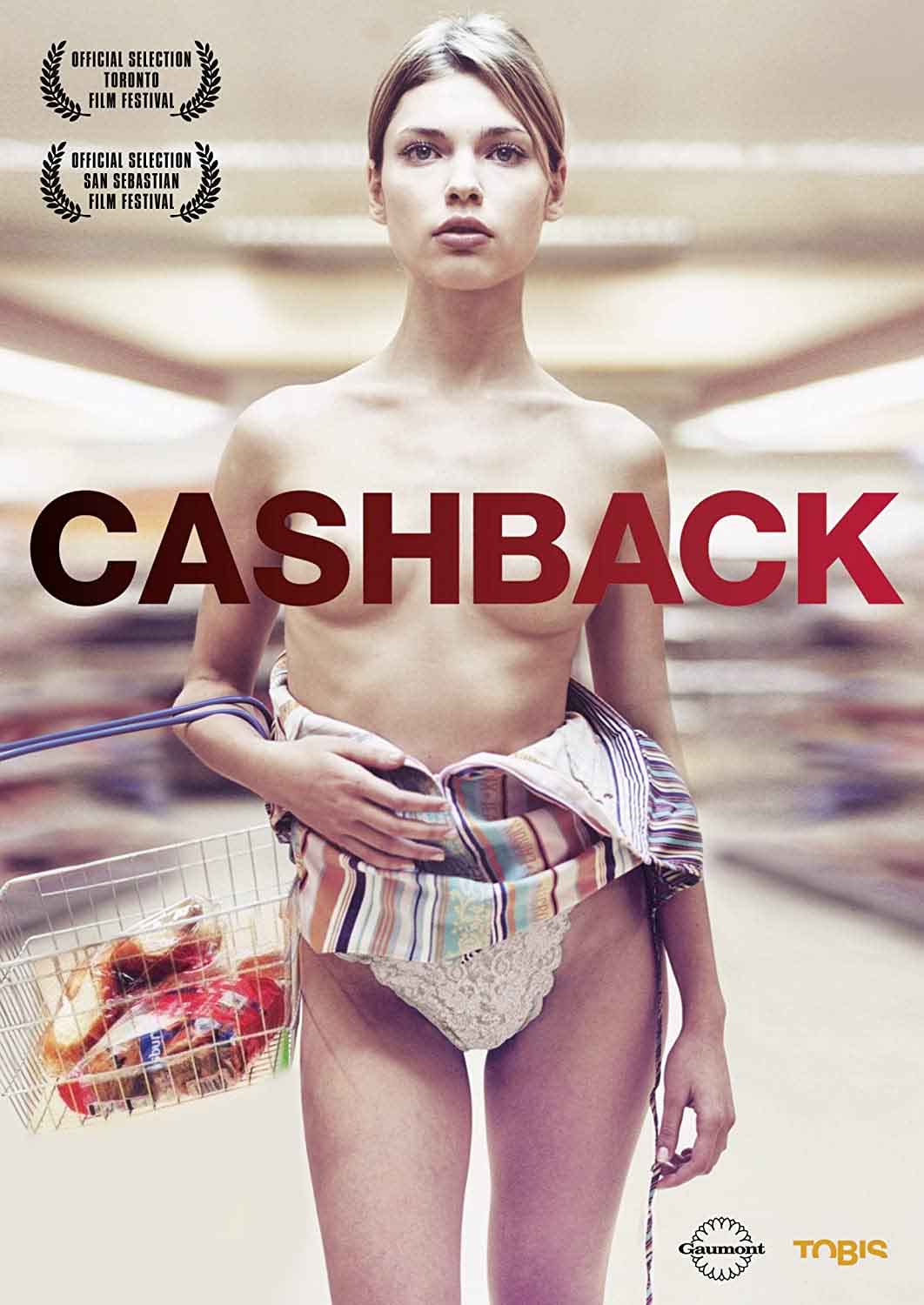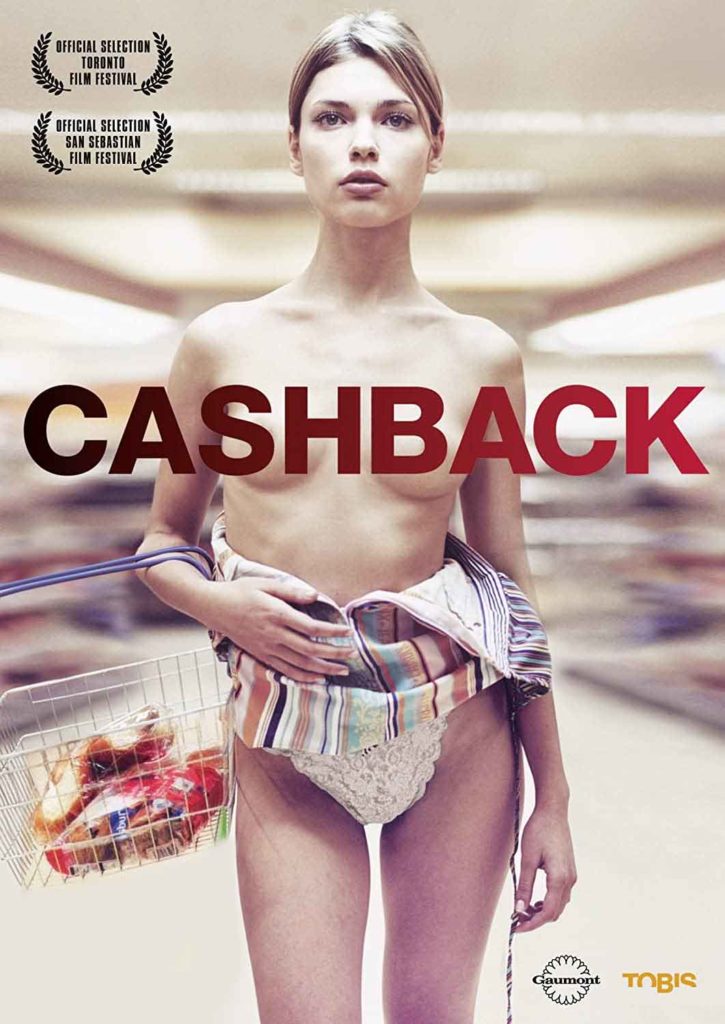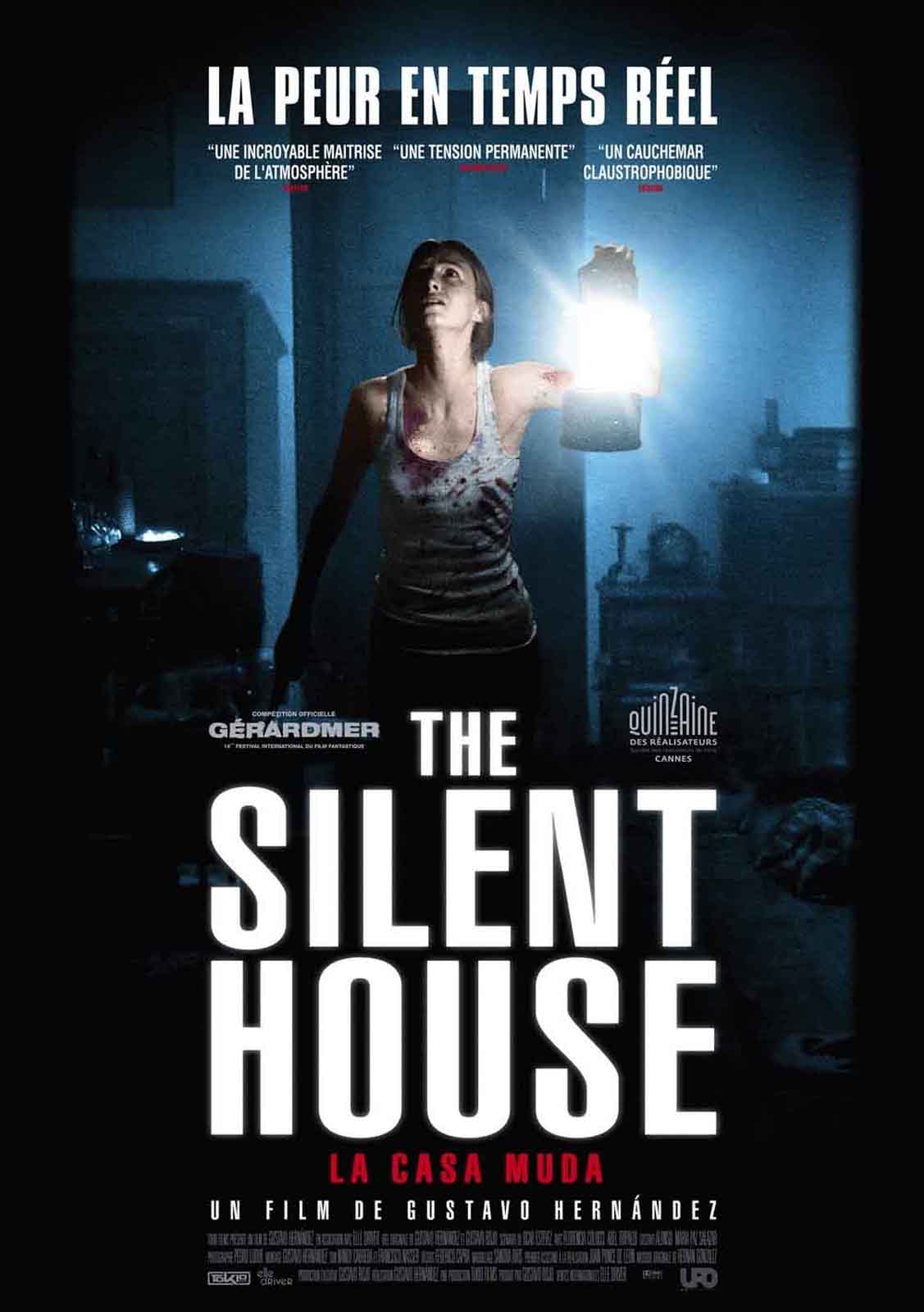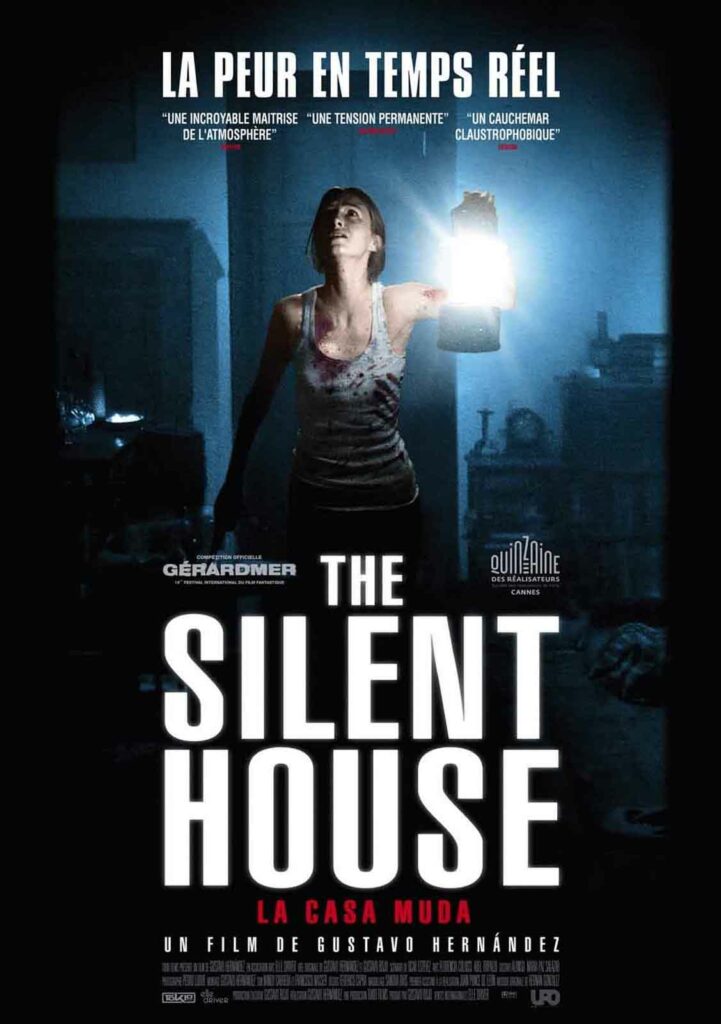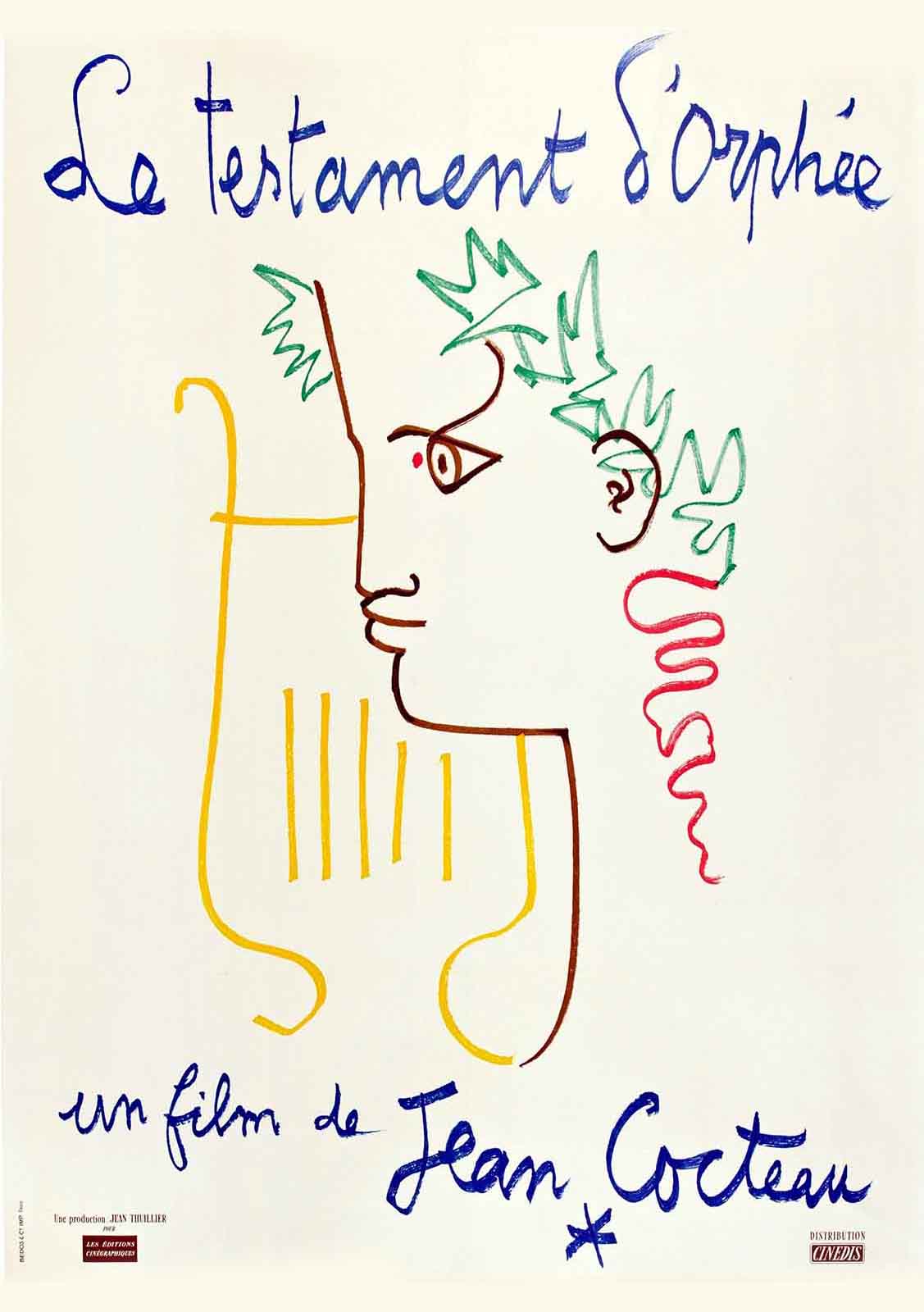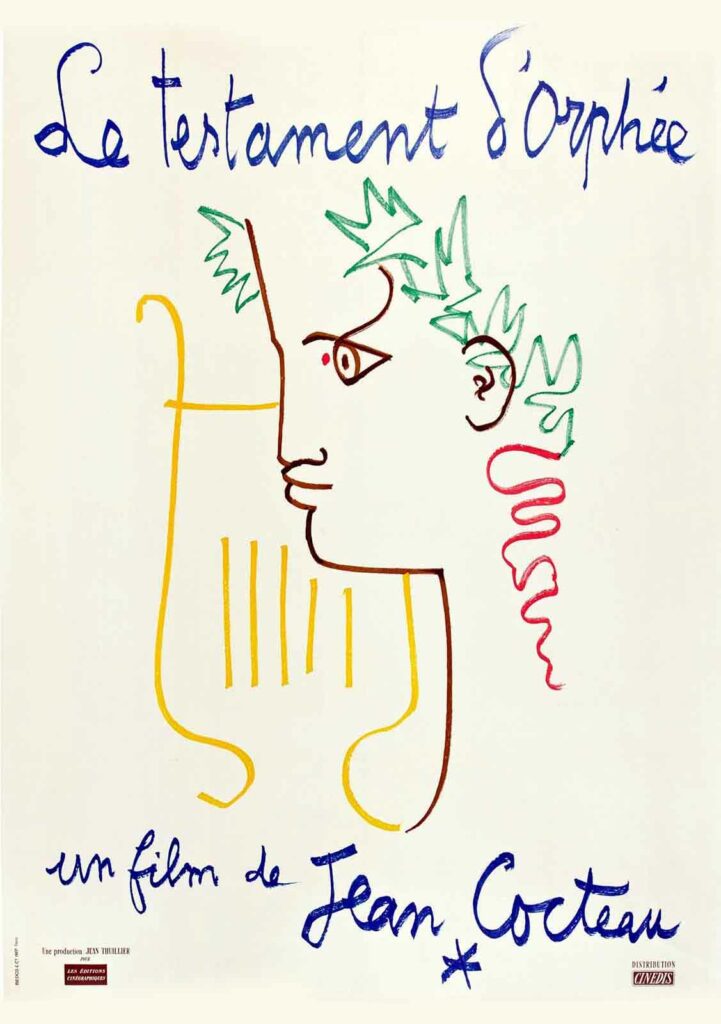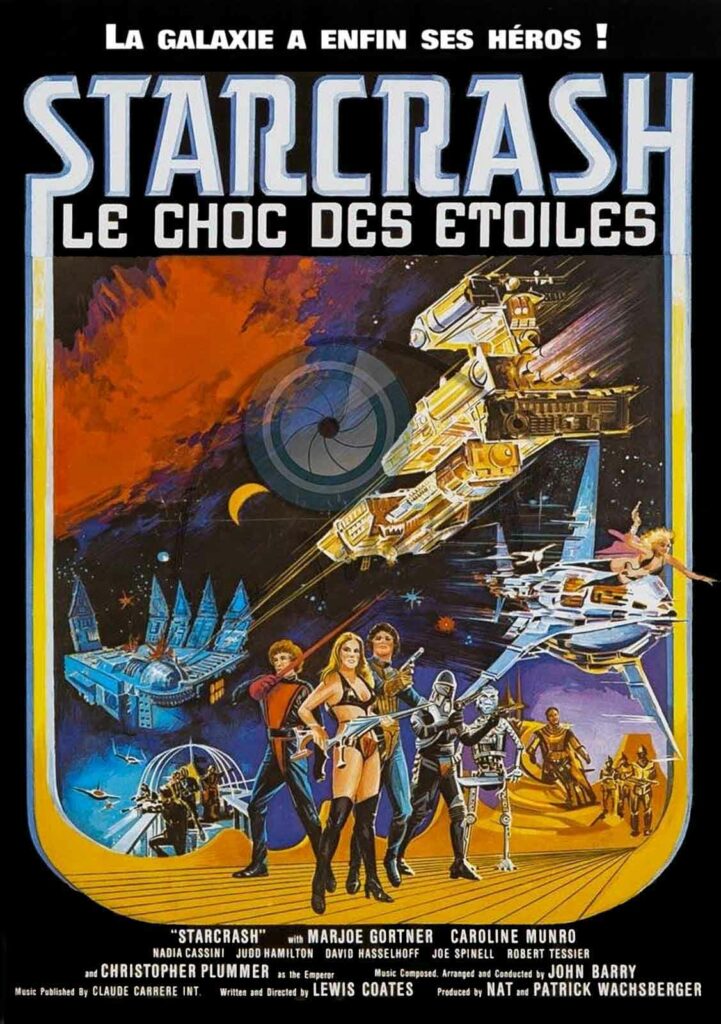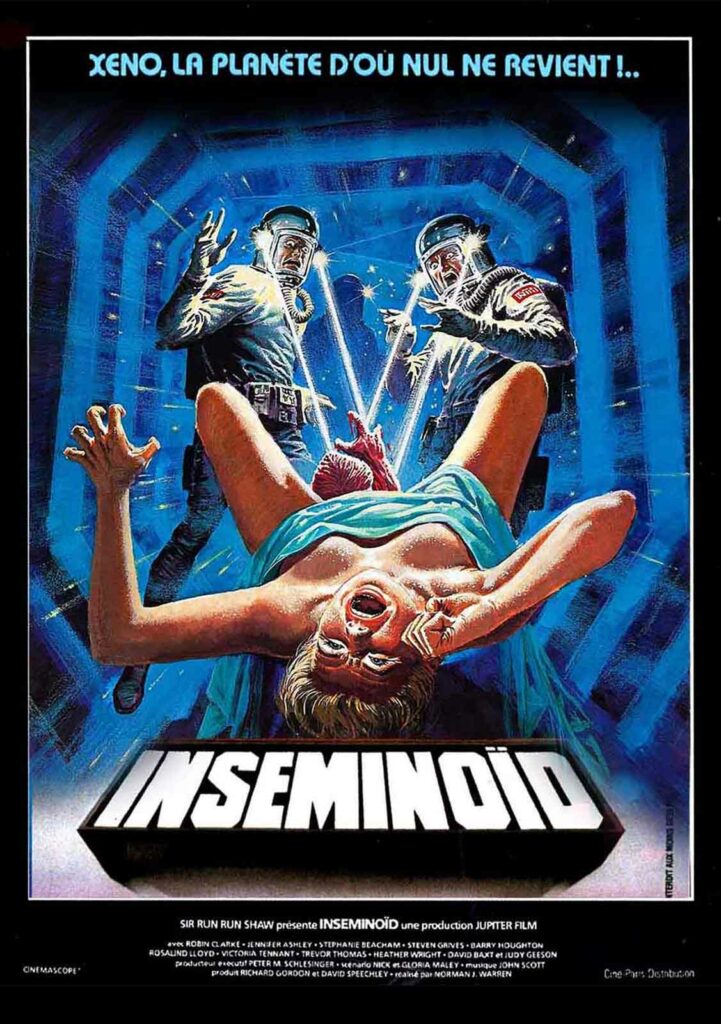Steve Martin incarne un médecin spécialiste dans l’opération du cerveau qui a mis au point une technologie révolutionnaire
THE MAN WITH TWO BRAINS
1983 – USA
Réalisé par Carl Reiner
Avec Steve Martin, Kathleen Turner, David Warner, Paul Benedict, Peter Hobbs, Richard Brestoff, Earl Boen, David Byrd, Francis X. McCarthy, James Cromwell
THEMA MÉDECINE EN FOLIE
Rob Reiner a tant séduit les cinéphiles à travers sa filmographie riche et éclectique (Stand by Me, Princess Bride, Quand Harry rencontre Sally, Misery, Des Hommes d’honneur) qu’il en a presque éclipsé l’œuvre impressionnante de son père. Les talents multiples de Carl Reiner (acteur, réalisateur, producteur, scénariste écrivain) se sont pourtant déployés pendant sept décennies, placées principalement sous le signe de la comédie. Son septième long-métrage en tant que metteur en scène, Les Cadavres ne portent pas de costard, fut un beau succès critique et public. Il faut dire que le concept avait de quoi séduire les cinéphiles de tous poils : dans le rôle d’un détective privé à l’ancienne, le comédien Steve Martin y menait une enquête loufoque en croisant les plus grandes stars des années 40, grâce à un montage virtuose lui permettant d’interagir avec des extraits empruntés à une vingtaine de classiques du film noir. Michel Hazanivicius et Dominique Mézerette s’en souviendront lorsqu’ils concocteront le cultissime film patchwork La Classe américaine. Sur sa lancée, Carl Reiner décide de reformer le trio gagnant des Cadavres… en co-signant un nouveau scénario parodique avec George Gipe et Steve Martin, ce dernier étant une fois de plus réquisitionné pour jouer le rôle principal. Après les films noirs, ce sont les séries B de science-fiction qui sont dans la ligne de mire des trois auteurs, et tout particulièrement Donovan’s Brain dont il reprend l’argument principal. La référence est assumée par un extrait diffusé sur un téléviseur, le héros avouant aussitôt qu’il s’agit de son film préféré.


Steve Martin entre ici dans la peau de Michael Hfuhruhurr, un médecin dont le patronyme imprononçable constituera l’un des nombreux gags à répétition du film. Encore sous le choc de son récent veuvage, cet éminent spécialiste du cerveau a inventé une méthode révolutionnaire pour les opérations à crâne ouvert : la calotte qui se visse et se dévisse ! Exubérant, vantard, névrosé, il attire malgré tout notre sympathie. On ne peut pas en dire autant de Dolores Benedict (Kathleen Turner), une femme séduisante et cupide qui vient de provoquer la mort par apoplexie de son vieil époux (dans l’espoir de toucher son héritage) et se met désormais en tête de convoiter la fortune de Hfuhruhurr. Celui-ci tombe immédiatement sous son charme vénéneux et l’épouse, mais elle se refuse à lui et le mène par le bout du nez. Frustré au-delà de toute mesure, le médecin rend un jour visite à un collègue autrichien, Alfred Necessiter (David Warner). Ce dernier a mis au point une technique permettant de maintenir en vie des cerveaux sans corps dans un liquide de son invention. Or un lien télépathique se crée soudain entre Hfuhruhurr et le cerveau féminin d’une certaine Anne Uumellmahaye (à qui Sissy Spacek, l’inoubliable héroïne de Carrie, prête sa voix sans en être créditée). Une romance hors-norme s’établit dès lors entre le savant et la matière grise flottante…
Romance cérébrale
Comme toujours, Steve Martin excelle dans le registre excentrique qu’il cultive depuis les premiers sketches du « Saturday Night Live » qui le révélèrent. Dans le registre ultra-nerveux de l’homme frustré sexuellement, il s’avère hilarant. Mais pour lui donner la réplique, il fallait une partenaire de choix. En ce domaine, Kathleen Turner est époustouflante. Séduite par ce rôle qui lui permet de tourner en dérision sa propre prestation de femme fatale dans La Fièvre au corps de Lawrence Kasdan, elle n’en est encore qu’au tout début de sa carrière et crève déjà l’écran. L’année suivante, A la poursuite du diamant vert la consacrera définitivement comme superstar des années 80. Ce duo de choc se complète avec la prestation merveilleusement décalée de David Warner en archétype du savant fou qui veut greffer des cerveaux humains dans des corps de gorilles. L’œil attentif du fantasticophile repèrera aussi dans un tout petit rôle d’interne en médecine – déjà ! – le futur Herbert West de Re-Animator, autrement dit Jeffrey Combs. Mené à un train d’enfer, le scénario de L’Homme aux deux cerveaux est truffé de gags de toutes natures : visuels, sonores, dialogués, absurdes, parodiques… Certains sont dignes d’un cartoon (la porte d’un appartement qui s’ouvre sur un immense château gothique, les mains-ventouses, le flipper humain), d’autres évoquent l’humour des ZAZ (l’improbable séance d’alcootest). D’autres ont hélas bien du mal à traverser les frontières (chez nous, la star de la télé américaine Merv Griffin est un parfait inconnu). Toujours est-il que la générosité du film, ses excès, son absence de retenue et l’abattage de ses comédiens emportent immédiatement l’adhésion.
© Gilles Penso
Partagez cet article