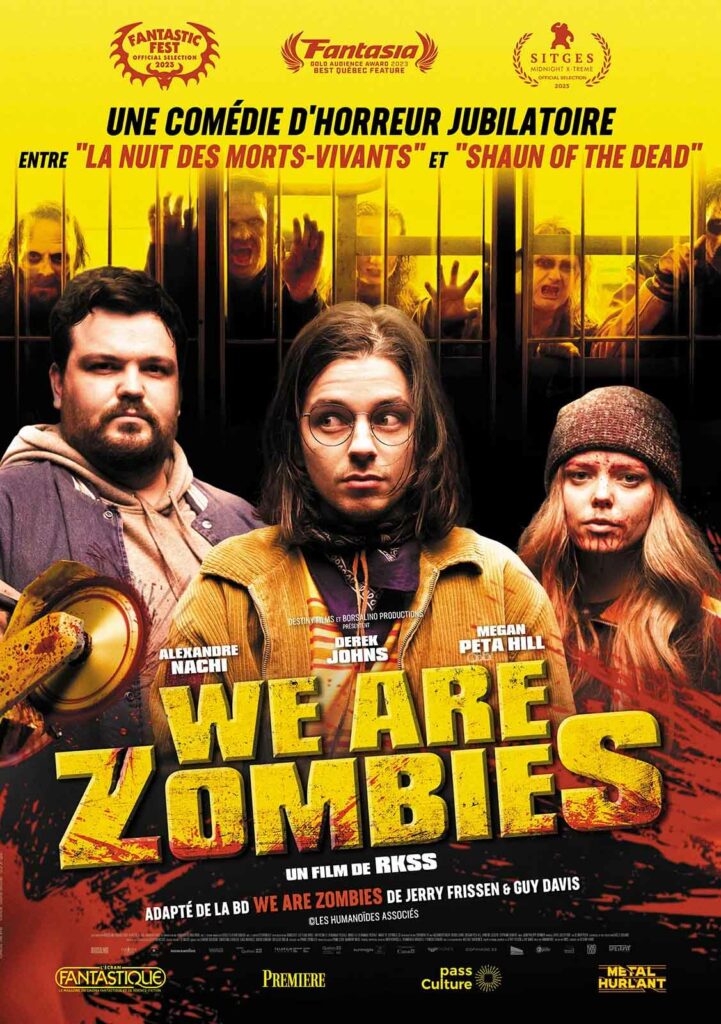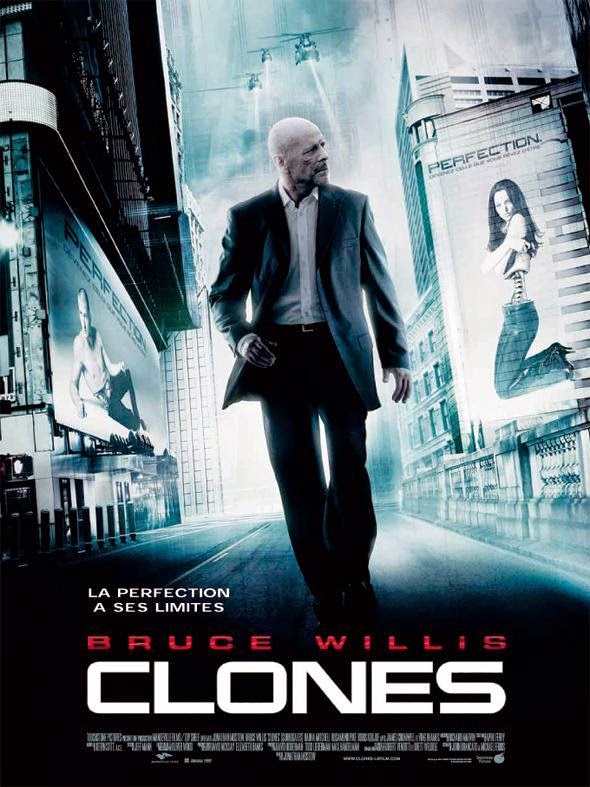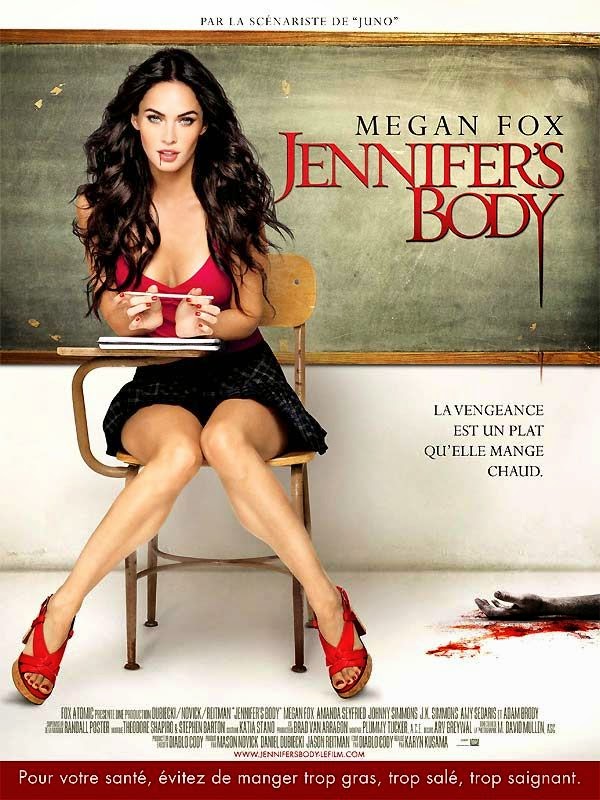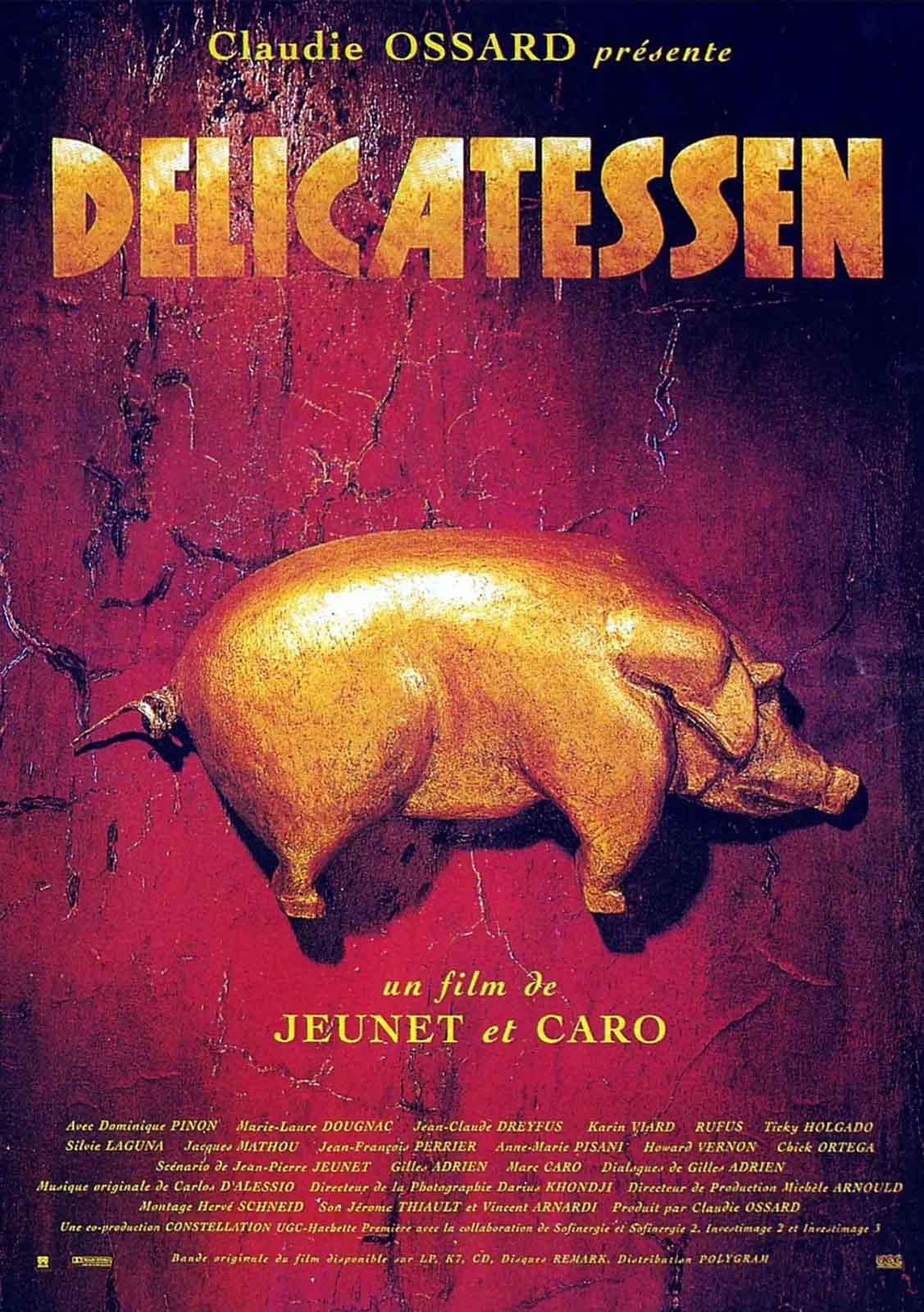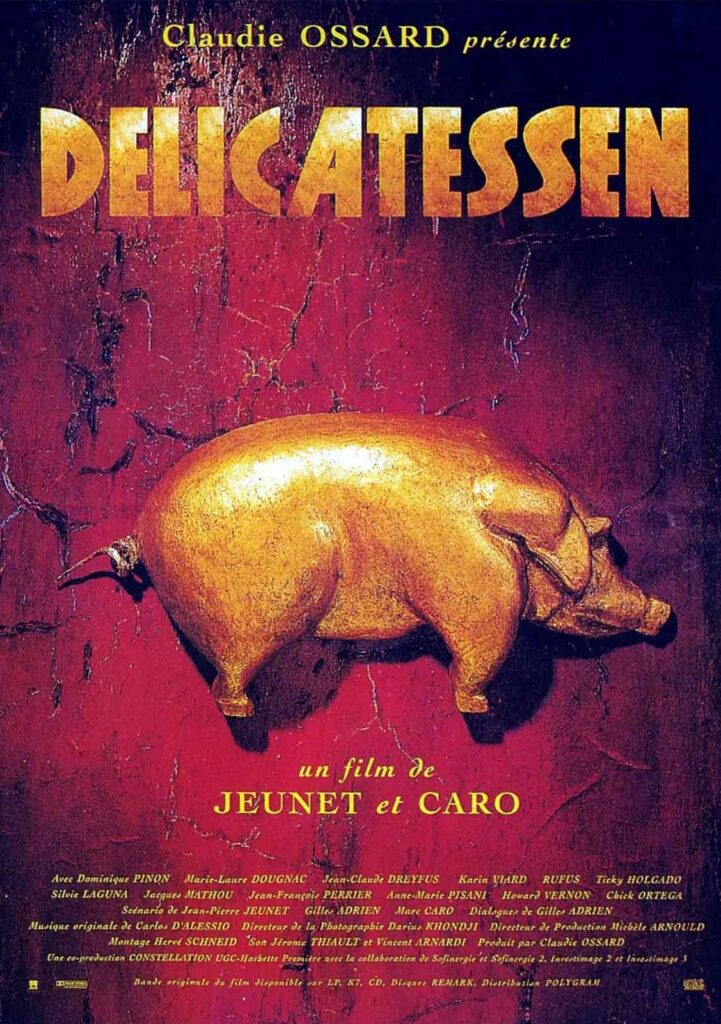Échoués sur une île tropicale, des amis fêtards se retrouvent confrontés à une horde de créatures primitives agressives
THE FORGOTTEN ONES
2009 – PAYS
Réalisé par Jorg Ihle
Avec Jewel Staite, Justin Baldoni, Marc Bacher, Nikki Griffin, Kellan Lutz, Helena Barrett, Mohit Ramchandani, Terry Notary
Vendu comme un croisement entre Predator et The Descent, The Tribe risque gros en se permettant de telles comparaisons. D’autant qu’après un pré-générique très classique situé dans les Caraïbes des années 20, le film démarre avec la finesse d’un hippopotame. Le sempiternel groupe d’amis partis festoyer pour les vacances est ainsi fidèle au poste, avec sa cohorte de clichés archétypaux : la bimbo vénale et écervelée, le beau gosse taciturne marqué par une rupture récente, le lourdaud maladroit et pseudo-comique, le sportif infidèle mais attachant, la fille futée et un peu plus intelligente que les autres… Fort heureusement, dès que le yacht emprunté par les vacanciers essuie une tempête et sombre, le film change de cap et la caractérisation s’améliore. Échoués sur une plage tropicale digne de Lost, les protagonistes se débarrassent dès lors d’une partie de leurs oripeaux caricaturaux pour gagner quelque peu en profondeur et en humanité. A peine a-t-on le temps de s’intéresser enfin à eux que les événements se précipitent sans crier gare. Car l’île est habitée par une peuplade de créatures sauvages, hargneuses et anthropophages qui ne laissent bientôt aucun répit à nos héros.


Certes, les situations qui s’ensuivent n’évitent pas certains lieux communs et font souvent écho à The Descent, justement. Mais le cadre exotique, capté dans de magnifiques extérieurs du Costa Rica, permet à The Tribe de se démarquer habilement de son glorieux aîné britannique. Quant aux créatures conçues par l’équipe de Barney Burman (membre d’une célèbre dynastie de maquilleurs spéciaux et créateur entre autres des effets de The Ring 2, Mission Impossible 3 et Star Trek), elles constituent l’attraction principale du film et savent éviterles ressemblances physiques avec les « crawlers » de Neil Marshall, malgré d’inévitables points communs comportementaux. Se dévoilant un peu plus à chaque apparition, ces monstres humanoïdes au corps velu et au faciès bestial s’affichent comme des chaînons manquants que l’évolution aurait oublié (d’où le titre original The Forgotten Ones), quelque part entre le singe, l’homme de Néanderthal et le Sasquatch. Interprétés par des cascadeurs costumés et maquillés, sans le moindre recours aux images de synthèse, ils sont au cœur de séquences de suspense plutôt bien troussées.
La belle et les bêtes
La conviction de Jewel Staite (héroïne récurrente des séries Chérie j’ai rétréci les gosses, Stargate Atlantis et Firefly) – que le réalisateur ne peut s’empêcher de mettre en sous-vêtements pour les dernières péripéties du film ! – contribue beaucoup à l’efficacité d’un récit somme toutes très simple. Dommage que certaines facilités scénaristiques jalonnent çà et là le film (bien pratique cette machette qu’on découvre plantée dans un arbre juste au moment où on en avait besoin !) et que la dernière bobine du métrage ne parvienne pas à se clore sur un climax digne de ce nom. Bref, un « creature feature » sympathique qui n’entrera certes pas dans les annales mais se laisse apprécier sans déplaisir et présente le mérite de redynamiser le thème moribond du film de yéti et de chaînon manquant.
© Gilles Penso
Partagez cet article