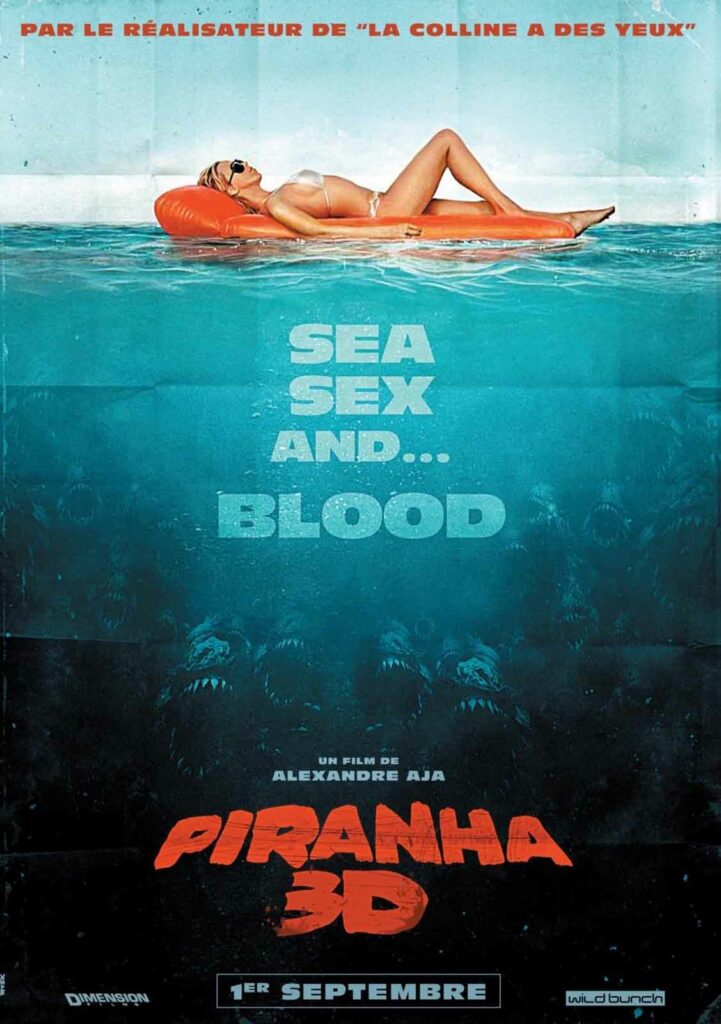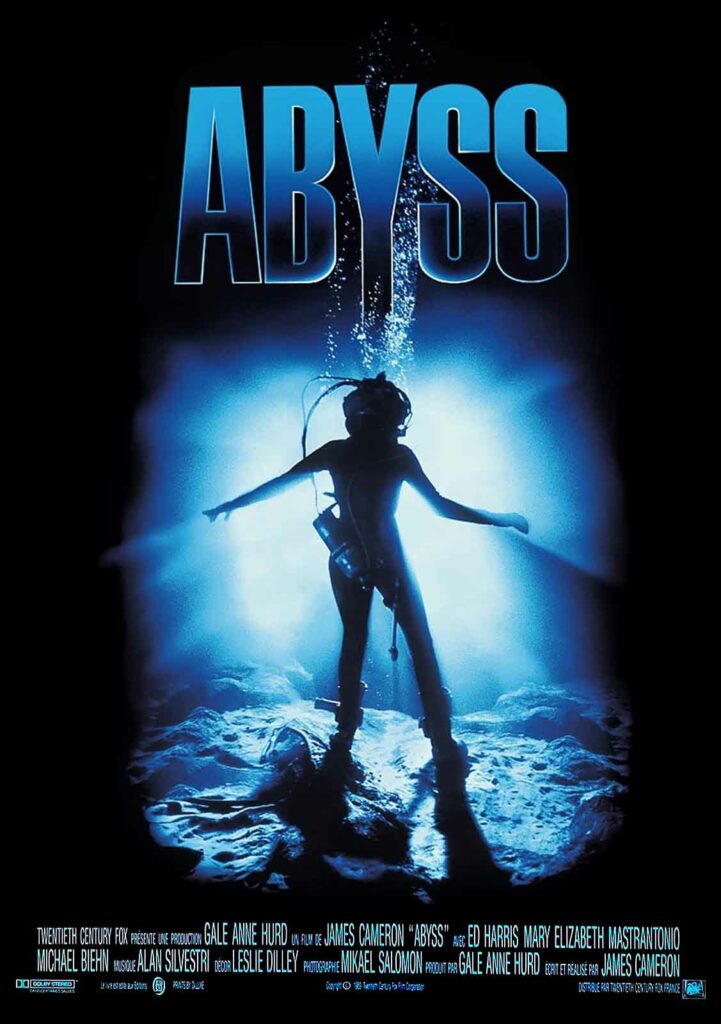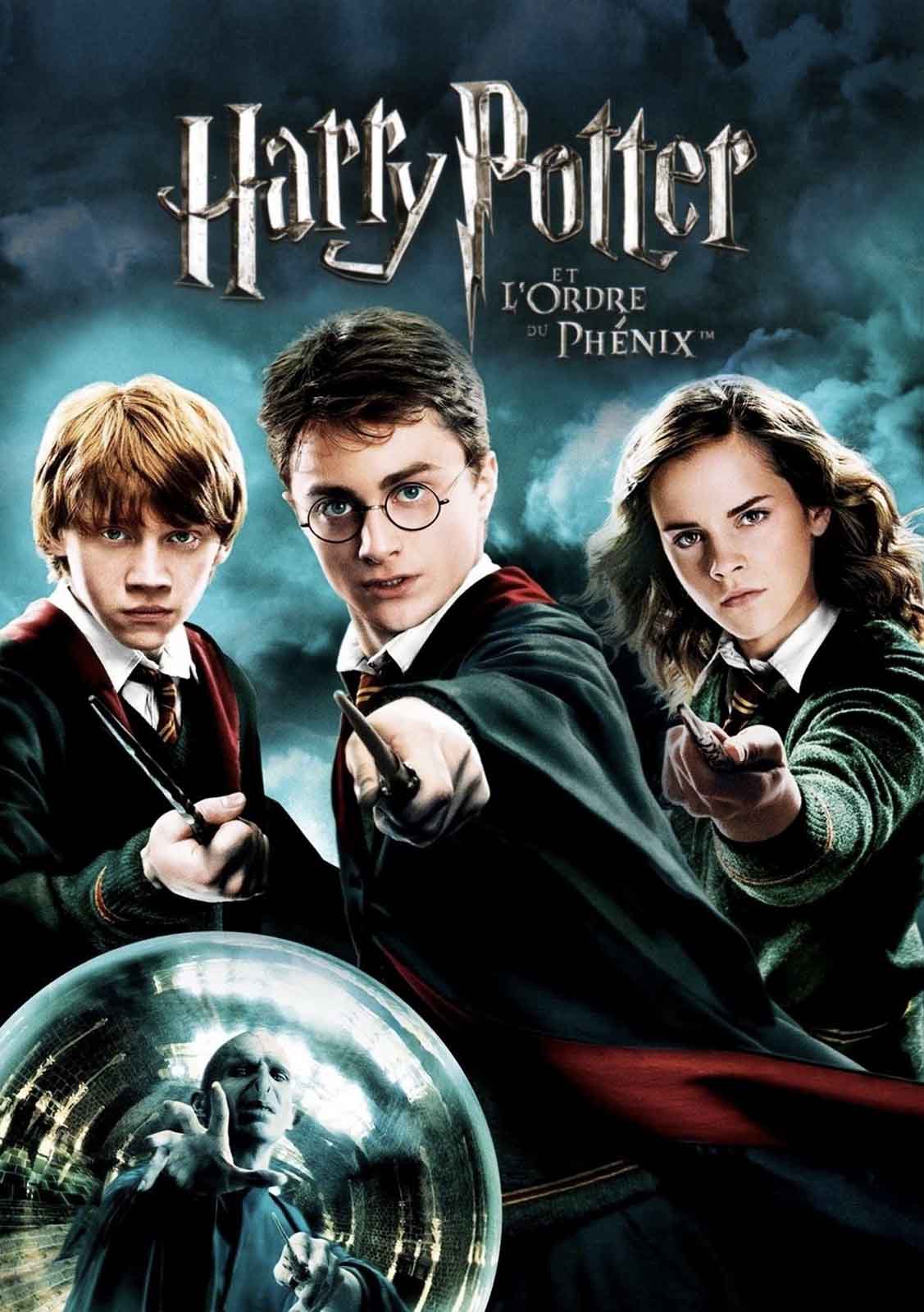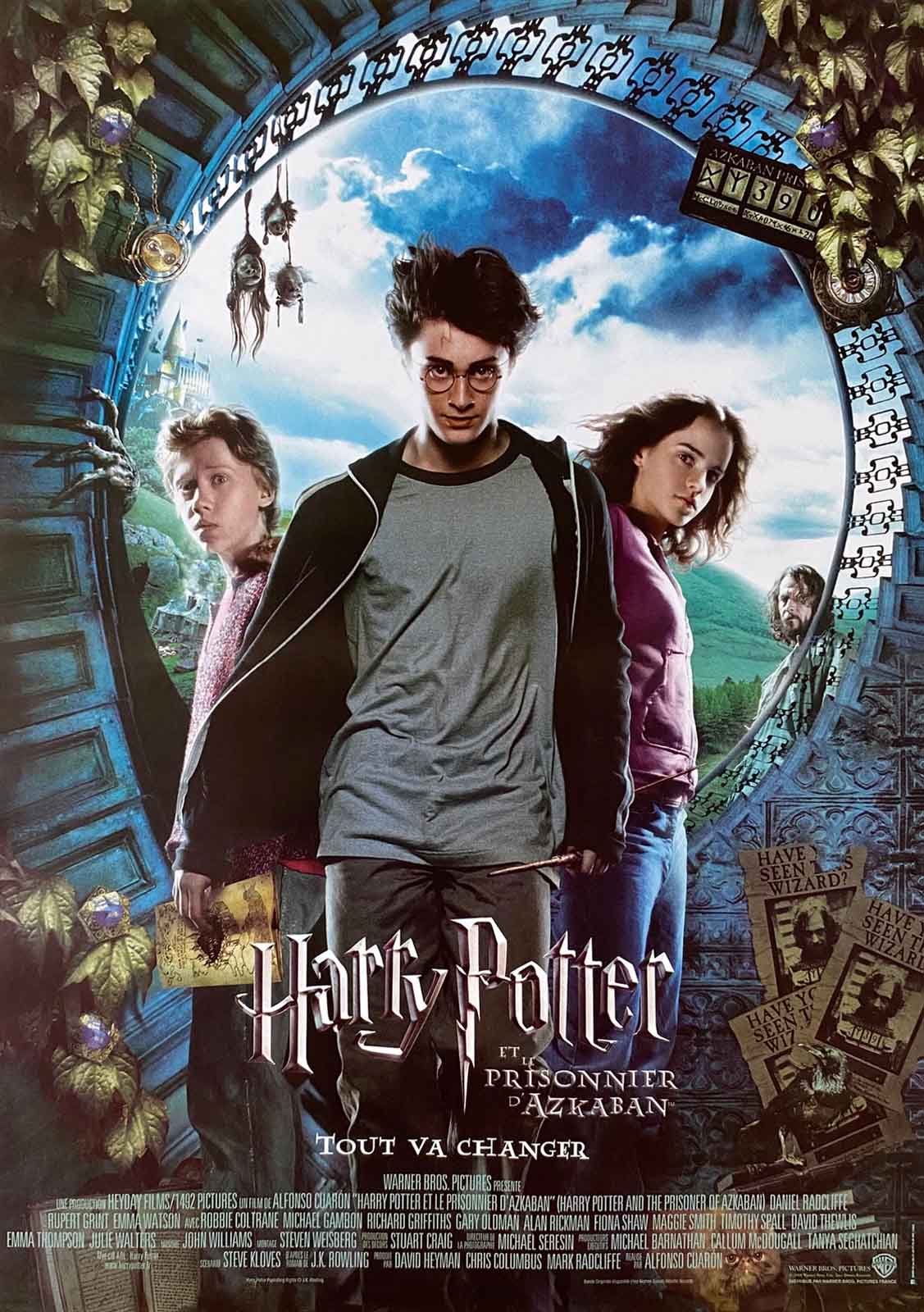Le premier long-métrage de James Cameron est une séquelle très maladroite du sympathique Piranhas de Joe Dante
PIRANHA PART 2 : THE SPAWNING
1981 – USA
Réalisé par James Cameron
Avec Tricia O’Neil, Steve Marachuk, Lance Henriksen, Ricky Paull Goldin, Ted Richert, Leslie Graves, Carole Davis
THEMA MONSTRES MARINS I SAGA PIRANHAS
Le premier Piranhas imitait avec une touchante maladresse Les Dents de la mer, échappant au ratage grâce au style et à l’ironie de Joe Dante. Rien de tel ici, et si la plupart des filmographies officielles de James Cameron oublient volontairement de mentionner Piranhas 2, c’est que cette improbable séquelle ne fait pas très bon effet sur un CV. Cela dit, avant de réaliser Terminator, Aliens, Abyss et Titanic, il fallait bien que le cinéaste fasse ses premières armes. Il trouva de quoi s’occuper dans la société New World Pictures de Roger Corman, œuvrant tour à tour comme maquettiste (Les Mercenaires de l’espace), peintre sur verre (New York 1997), designer (La Galaxie de la terreur, Androïde). Le flair de Corman l’incita à pousser ce jeune homme derrière une caméra. Voici donc Cameron aux commandes de Piranhas 2 dont le scénario se contente de piocher un maximum d’idées dans les deux premiers Jaws. Lance Henriksen, en shérif, remplace ici Roy Scheider, avec qui il présente quelques similitudes physiques. Comme dans Jaws 2, il part en hélicoptère à la recherche de son fils perdu en mer. Ici encore, l’armée américaine finance des recherches pour créer des « machines à tuer » indestructibles destinées aux rivières du Vietnam. Mais il y a quelques bavures, et parmi elles la création involontaire d’une nouvelle race de piranhas munis d’ailes.


S’il n’y a pas grand-chose à sauver de cette entreprise, dont l’humour gras lorgne carrément du côté de Police Academy, deux séquences surnagent un peu et valent presque le détour : l’attaque des piranhas volants sur la plage, et le regroupement des poissons voraces dans l’épave, au moment du climax. Ces séquences doivent leur efficacité à la nervosité du montage et aux astucieux effets spéciaux de Gianetto de Rossi, maquilleur attitré des films gore de Lucio Fulci. Les analystes percevront tout de même déjà quelques composantes récurrentes de l’univers de James Cameron : les prises de vues sous-marines, bien sûr, les éclairages bleutés, également, mais aussi et surtout la mise en scène d’un protagoniste féminin volontaire, fort et héroïque, prélude aux personnages d’Helen Ripley et Sarah Connor.
La guerre du montage
Pour le reste, la médiocrité semble être le maître mot de Piranhas 2, mais les conditions étranges dans lesquelles le film fut réalisé expliquent sans doute en partie cet état de fait. Peu satisfait des images tournées par Cameron, le producteur Ovidio G. Assonitis décida de reprendre les rênes du film, d’en tourner lui-même de larges séquences et d’exclure le metteur en scène de la salle de montage. Cameron, qui n’était déjà pas du genre à se démonter, décida d’entrer par effraction dans les locaux de la production, en pleine nuit, afin de remonter le film à sa guise ! Hélas, le cinéaste rebelle fut surpris en flagrant délit et interrompu sur le champ. Le montage que nous connaissons est donc l’œuvre d’Assonitis, dont les crédits de metteur en scène comptent des œuvres aussi impérissables que Le Démon aux tripes ou Tentacules. Des années plus tard, au faîte de sa gloire, Cameron citera avec cynisme Piranhas 2 comme « le film le plus subtil jamais réalisé sur des piranhas volants » !
© Gilles Penso
À découvrir dans le même genre…
Partagez cet article