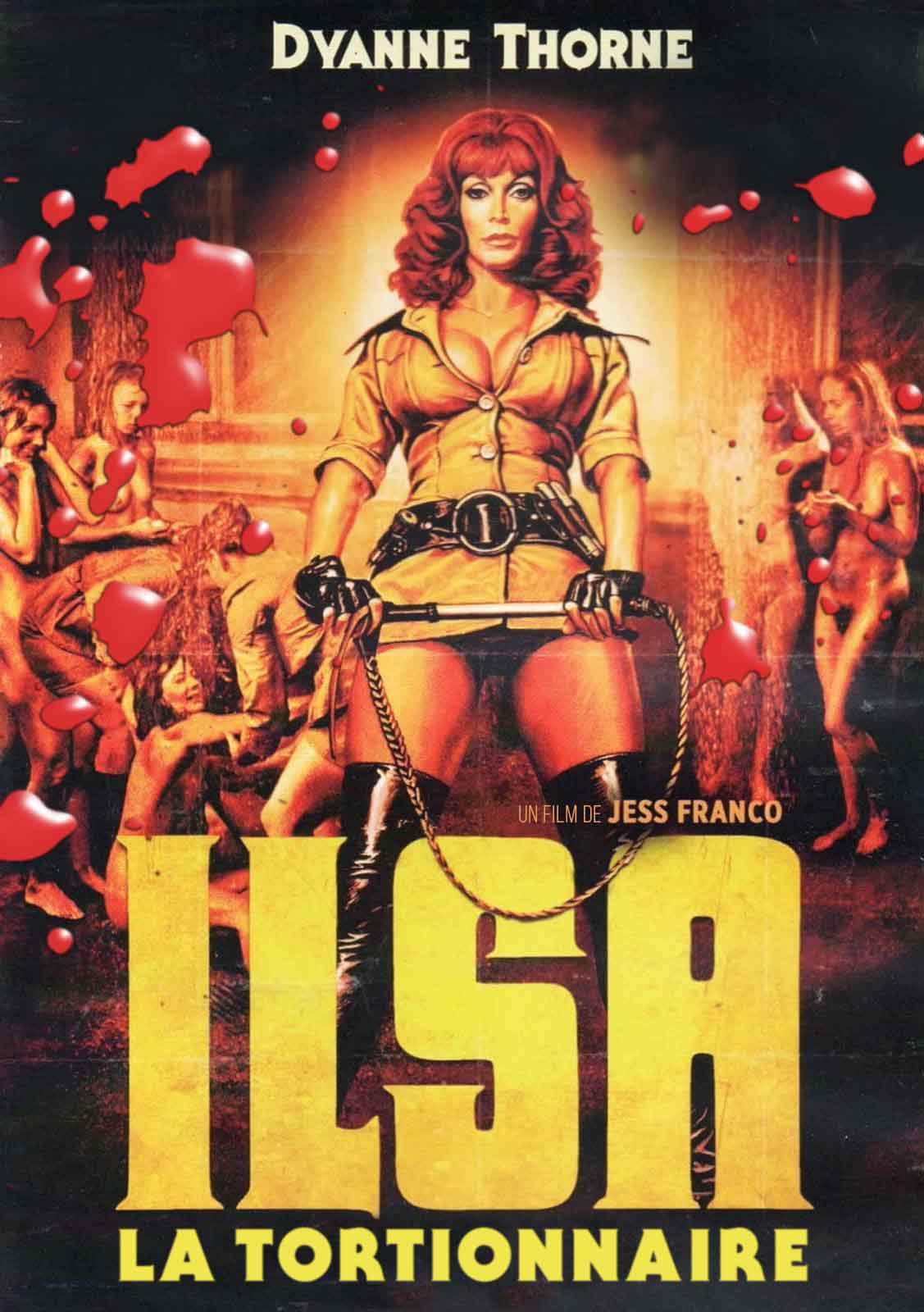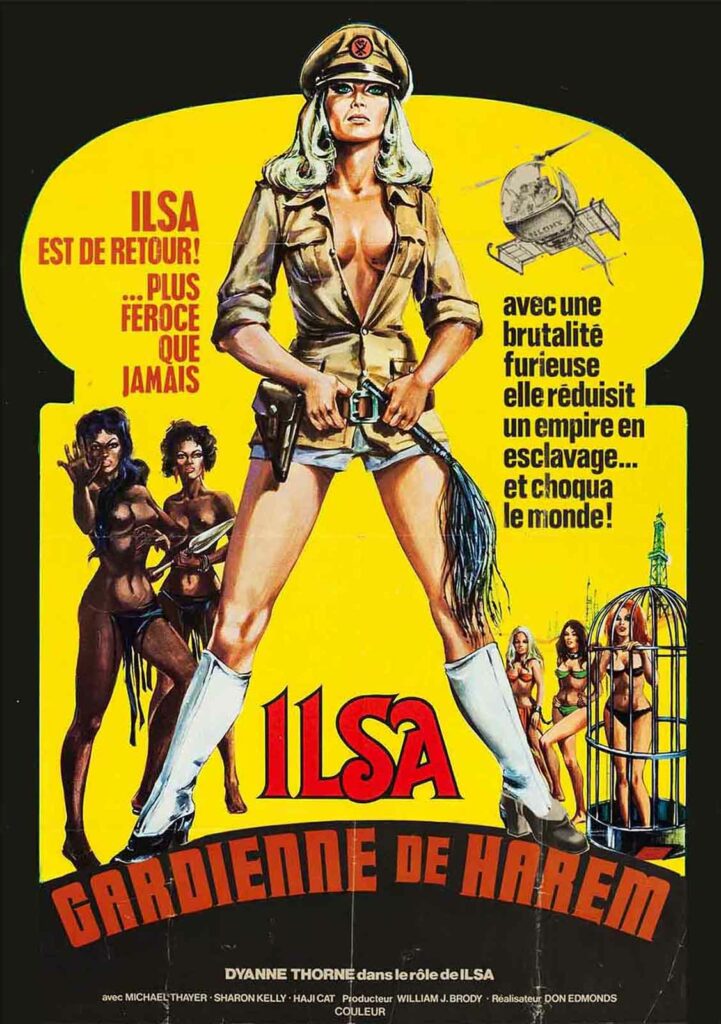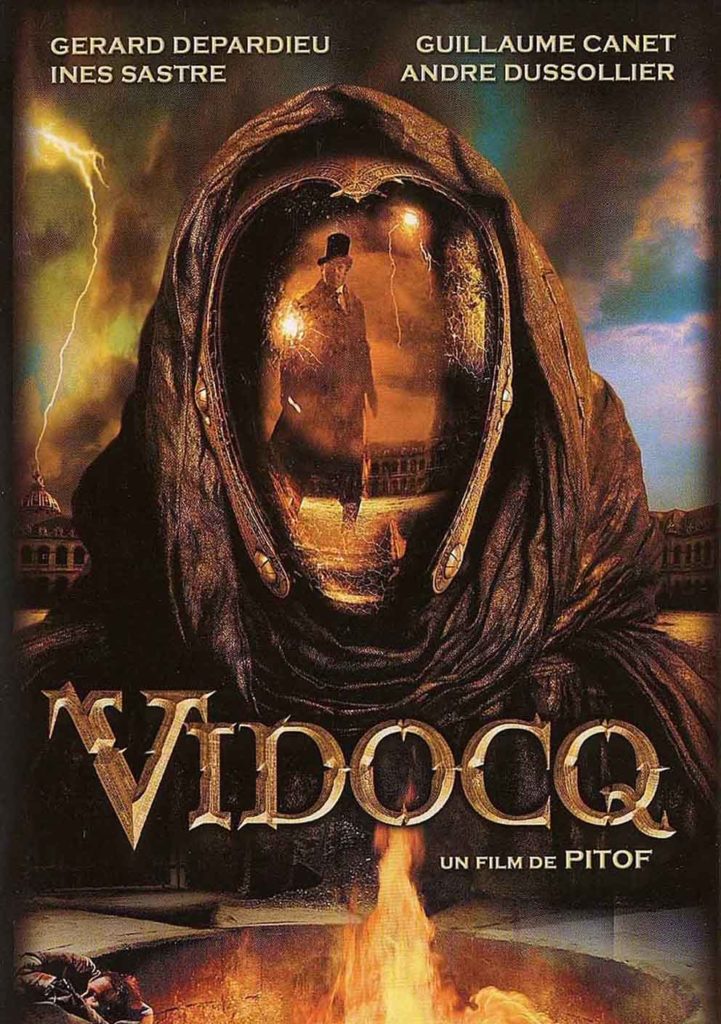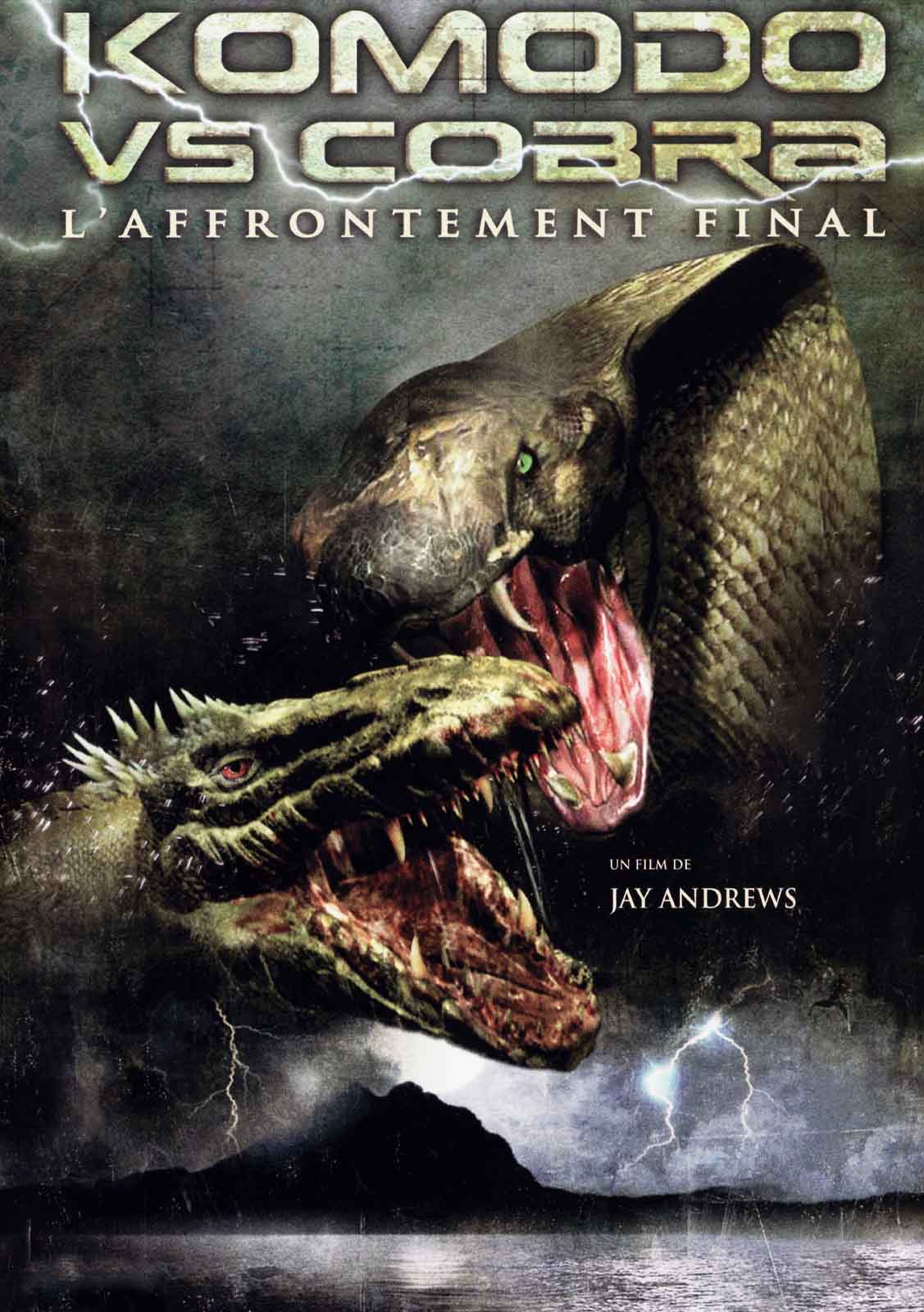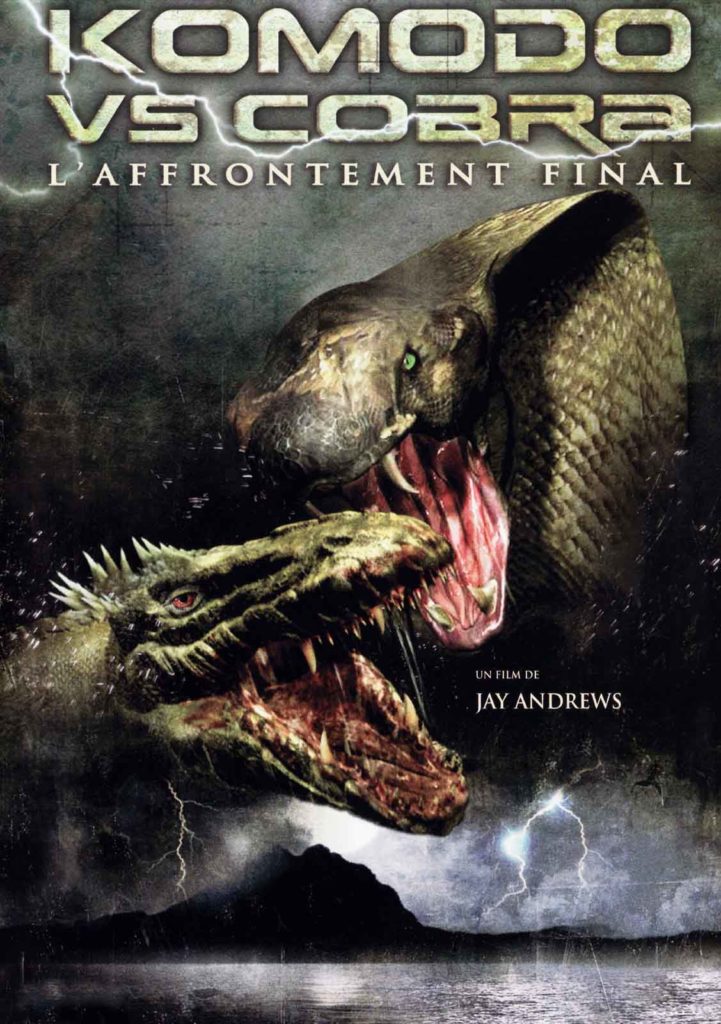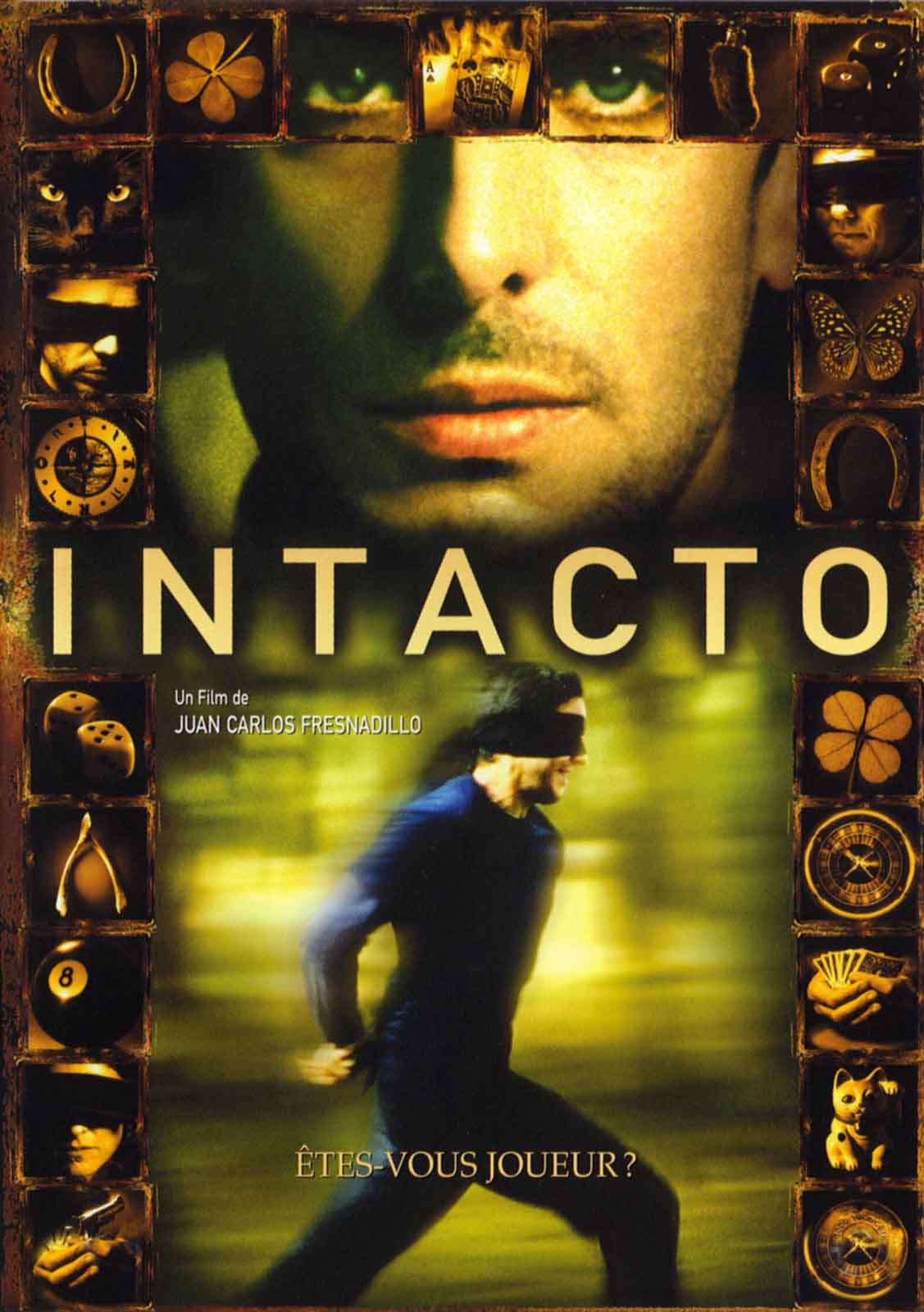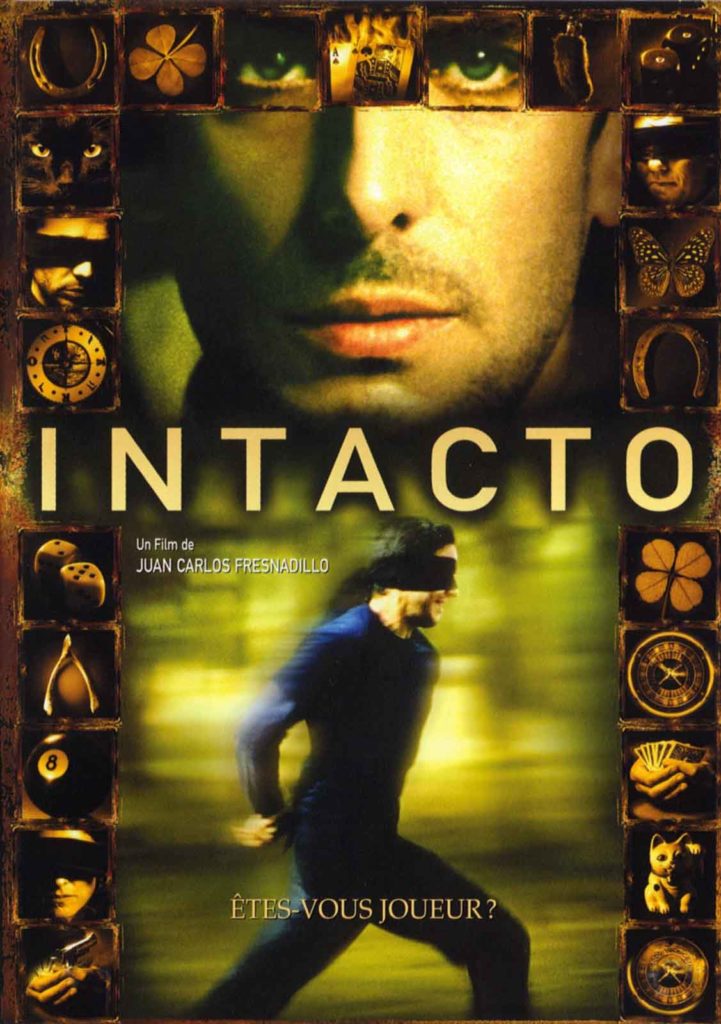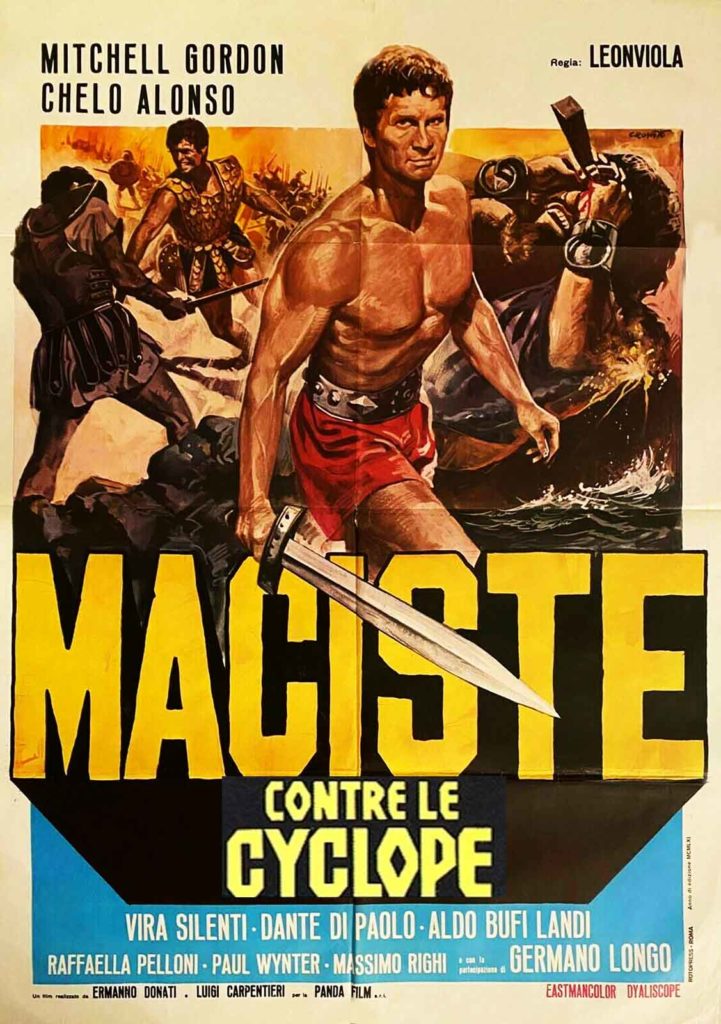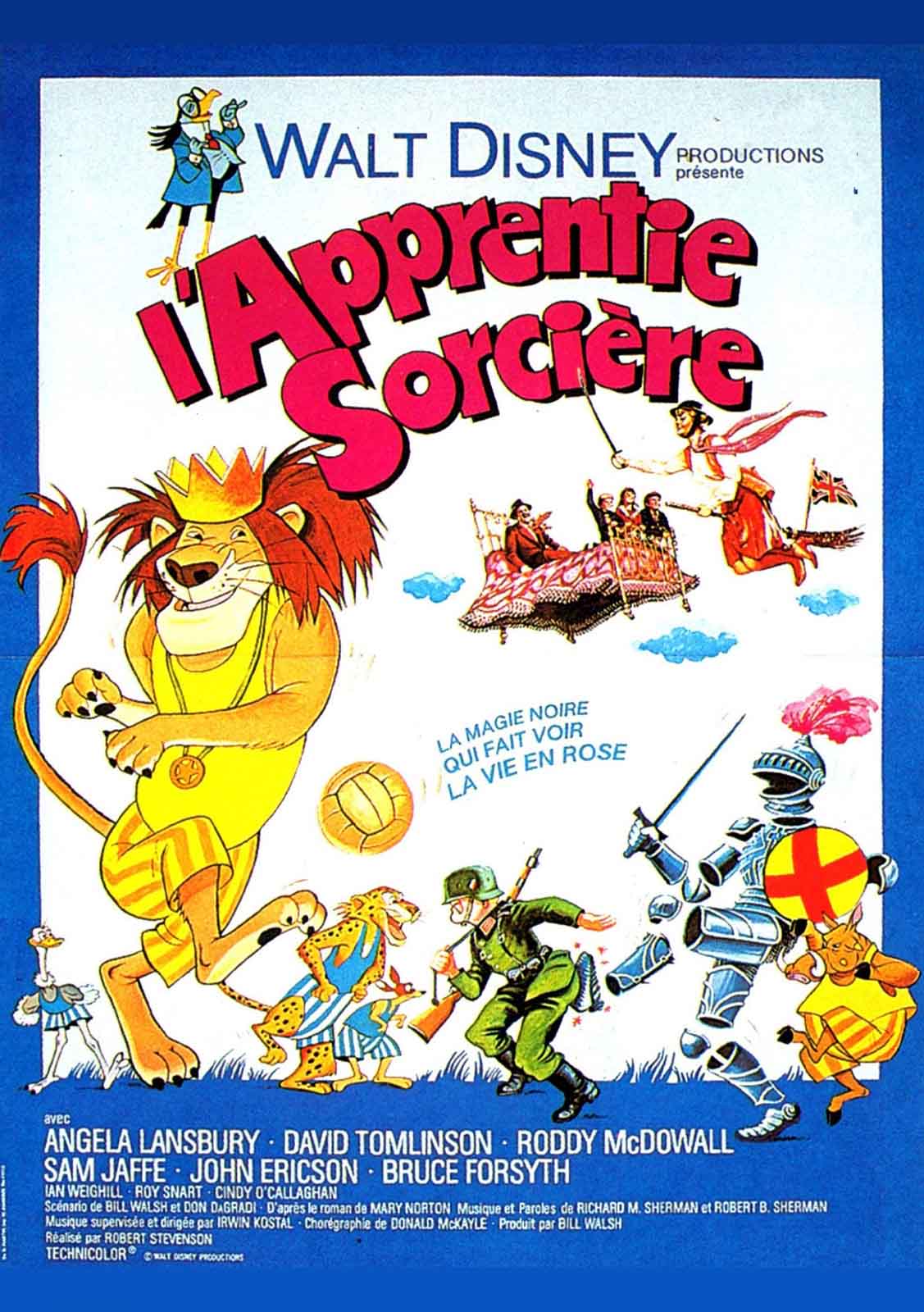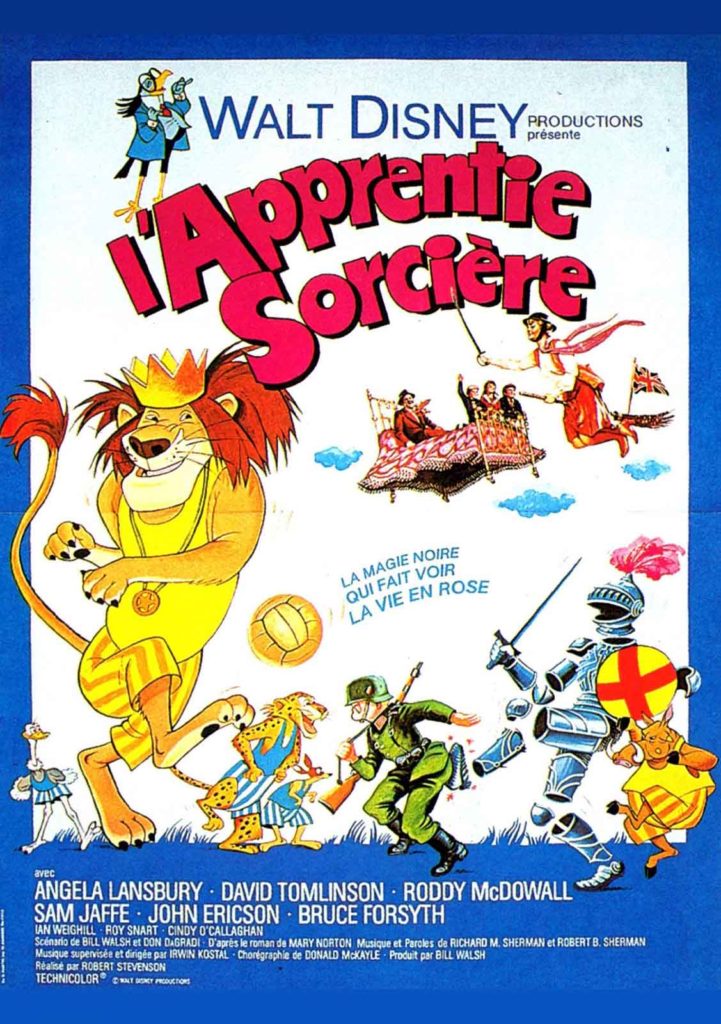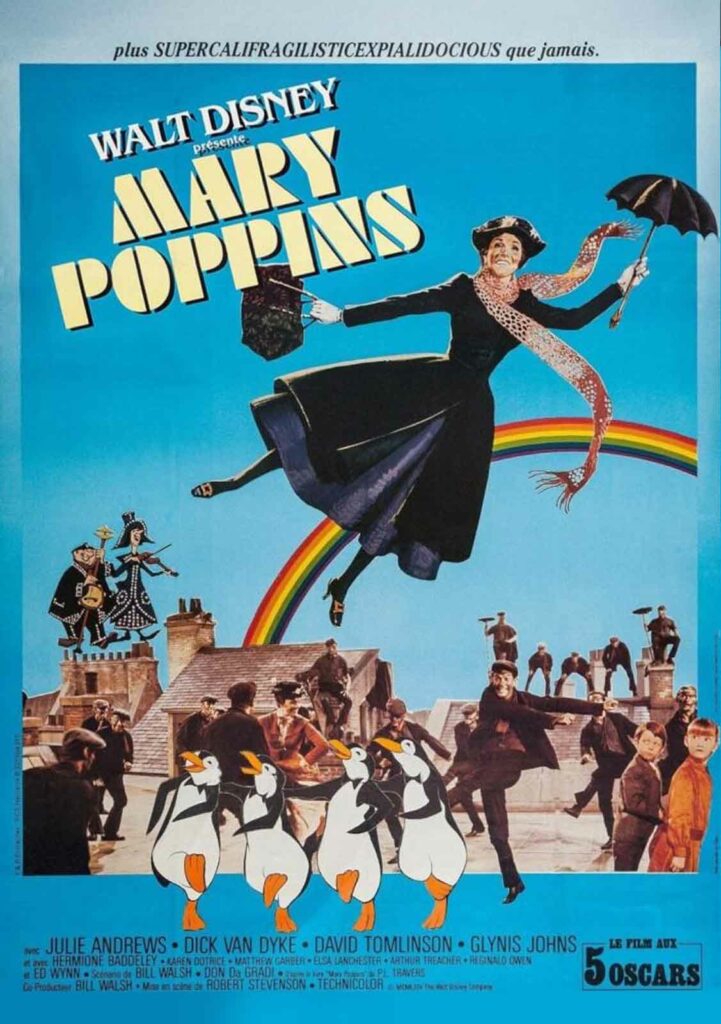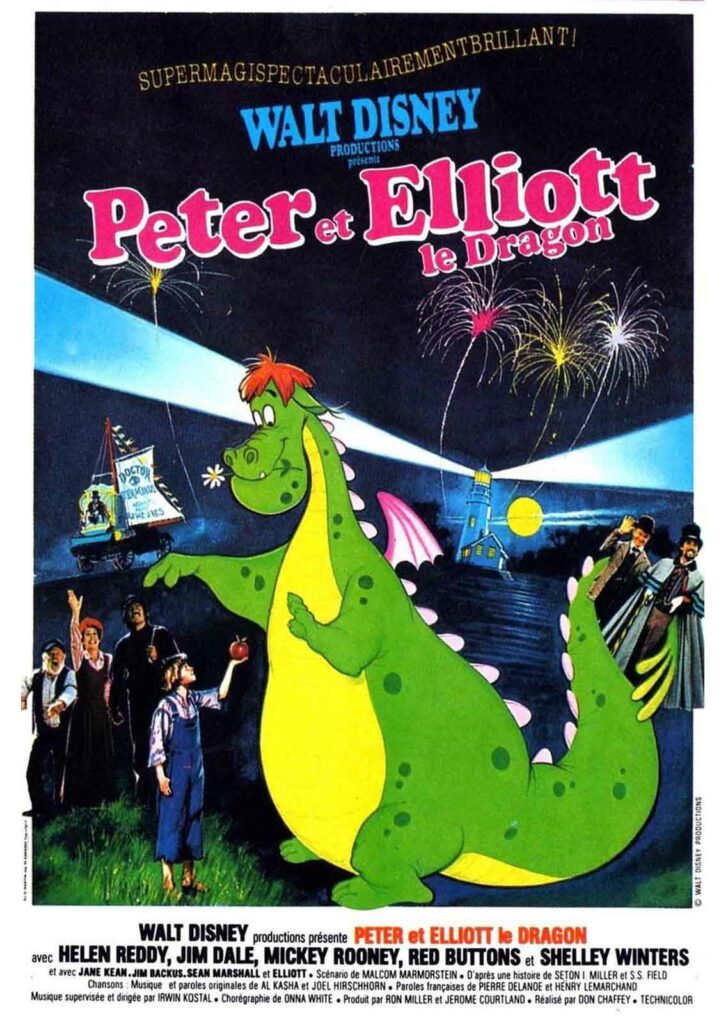Cet ultime volet d’une trilogie mexicaine consacrée aux suceurs de sang multiplie les idées surprenantes et les séquences rocambolesques…
EL MUNDO DE LOS VAMPIROS
1961 – MEXIQUE
Réalisé par Alfonso Corona Blake
Avec Mauricio Garces, Erna Martha Bauman, Silvia Fournier, Guillermo Murray, Jose Baviera, Yolanda Margain
THEMA VAMPIRES
Pour cette troisième incursion mexicaine au pays des vampires après Les Proies du vampire et Le Retour du vampire, un ravalement de façade complet a été effectué. Ainsi, à l’exception du producteur Abel Salazar, l’équipe a changé du tout au tout. Exit donc le casting principal, ainsi que le réalisateur Fernando Mendez, remplacé ici au pied levé par Alfondo Corona Blake. Le lien entre ce film et les deux précédents est donc des plus ténus, d’autant qu’ici, le traitement de l’épouvante s’avère plus frontal et bien moins insidieux. A la tête d’une armée de vampires souterrains, le maléfique comte Subotai complote pour pouvoir se venger du dernier descendant de la famille Colman, dont l’ancêtre fut l’ennemi de sa famille en Hongrie. Pour y parvenir, il s’efforce de vampiriser ses deux ravissantes nièces. Le changement de ton est annoncé d’emblée, avec cette séquence pour le moins improbable dans laquelle le comte Subotai dirige un sacrifice rituel au nom d’une prétendue divinité antique, invoquant évasivement la cabale et déclamant de grands textes explicatifs face à la caméra.


Le décor de cette cérémonie occulte est une catacombe ornée de torches qu’on croirait issue d’un péplum, les adeptes de la cérémonie sont des dizaines de jeunes femmes outrancièrement maquillées ainsi que des vampires affublés de masques rigides grotesques aux yeux globuleux, aux oreilles pointues et aux dents proéminentes. Quant à Subotai, il dirige ses serviteurs improbables en pianotant sur un orgue constitué d’ossements humains et jette ses victimes dans un puits hérissé de pointes. Le scénario l’affuble même d’un assistant bossu et difforme qui semble vaguement hérité des Frankenstein d’Universal. On l’aura compris, nous nageons ici dans une ambiance assez proche du serial et de la bande dessinée. Corona Blake persévèrera d’ailleurs dans cette voie, notamment en réalisant plusieurs épisodes de la fameuse saga consacrée au catcheur Santo.
Les vampires n’aiment pas le piano !
Le Monde des vampires se permet au passage quelques variantes fort surprenantes autour de la mythologie des suceurs de sang. Ici, en effet, l’arme la plus susceptible de les anéantir n’est ni le pieu, ni le crucifix, ni l’ail, mais une mélodie jouée au piano ! Quant à la transformation progressive des humains en vampire, elle passe par une étrange étape au cours de laquelle des poils hirsutes se mettent à couvrir le dos des mains avant de s’attaquer au visage. Comme si lycanthropie et vampirisme se confondaient quelque peu en une seule et même malédiction. Le film se pare même de quelques visions surréalistes du plus curieux effet, comme cette image très furtive d’une jeune fille au corps de chauve-souris. Guillermo Murray ne démérite guère dans le rôle du machiavélique comte vampire Subotai, d’autant que sa ressemblance physique avec Christopher Lee est assez frappante, mais l’absence de German Robles, héros inoubliable des deux films précédents, se fait cruellement sentir. Ce segment est donc le plus anecdotique des trois, mais il comporte les mêmes qualités graphiques et formelles que ses deux modèles, tout en reprenant la majeure partie de la bande originale composée par Gustavio Carrion pour Les Proies du vampire.
© Gilles Penso
Partagez cet article