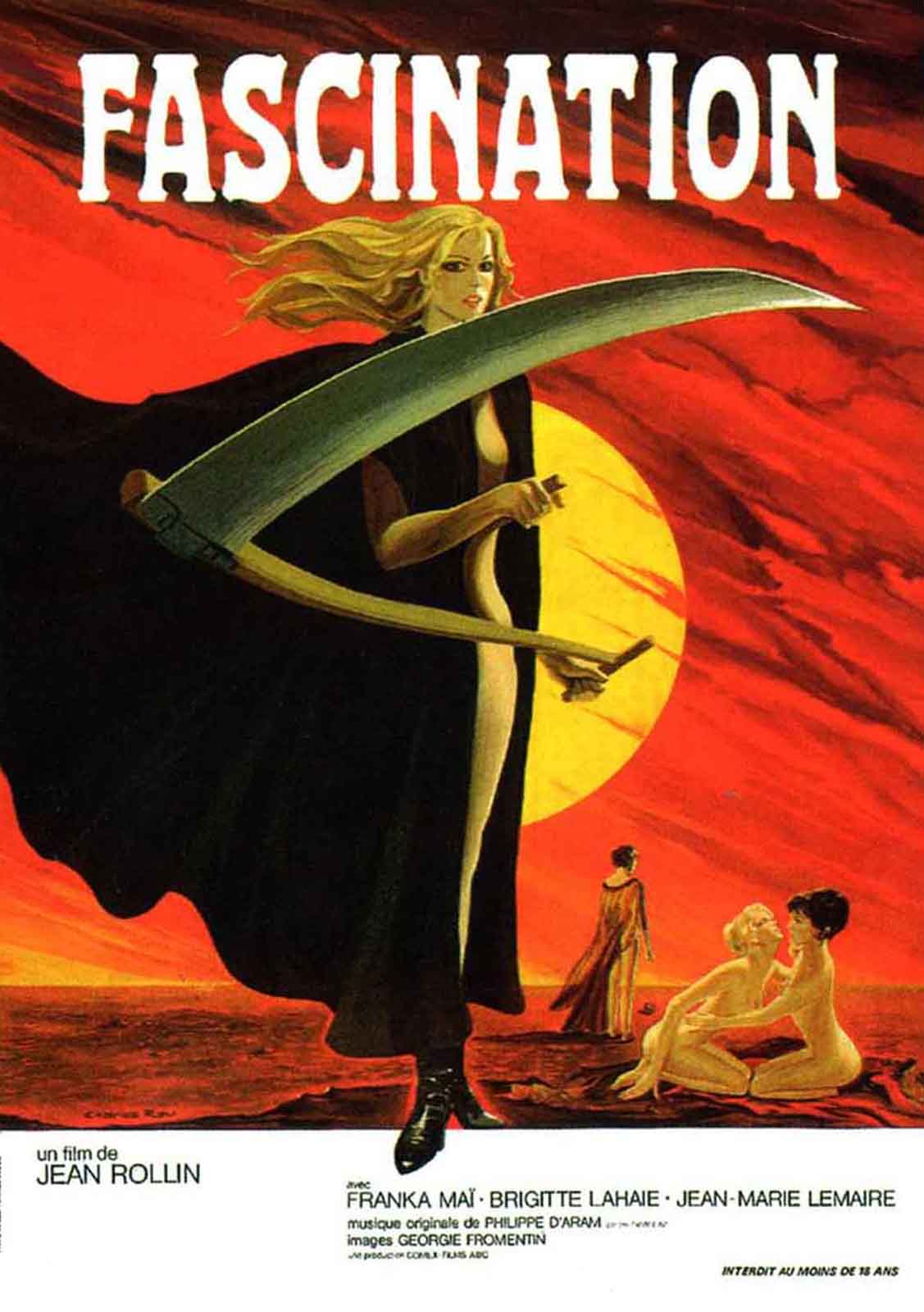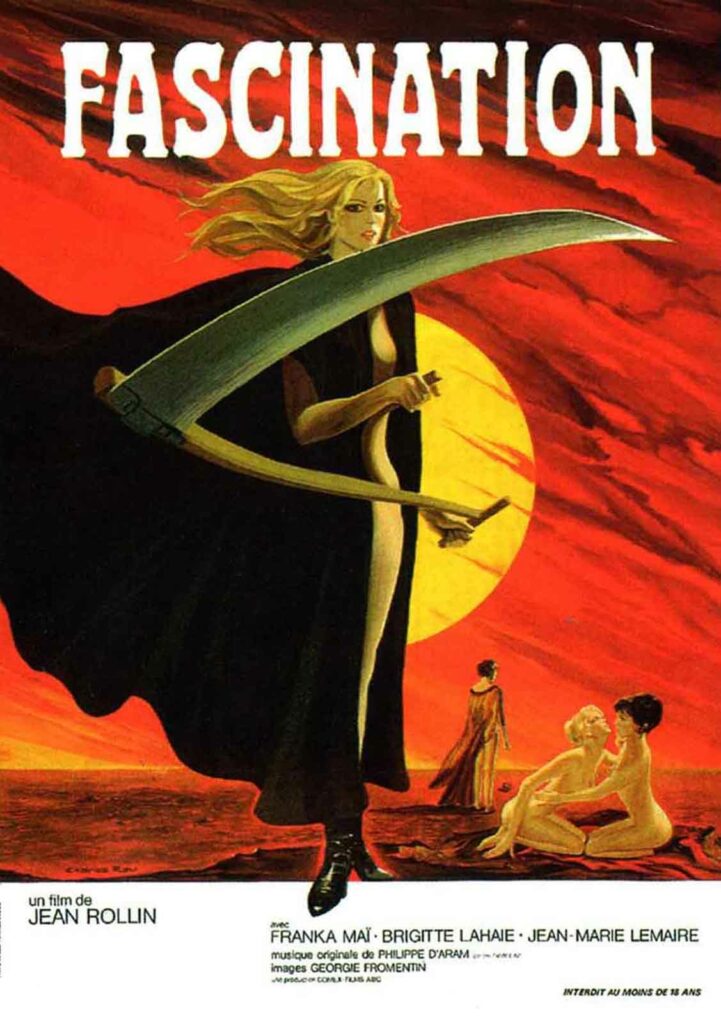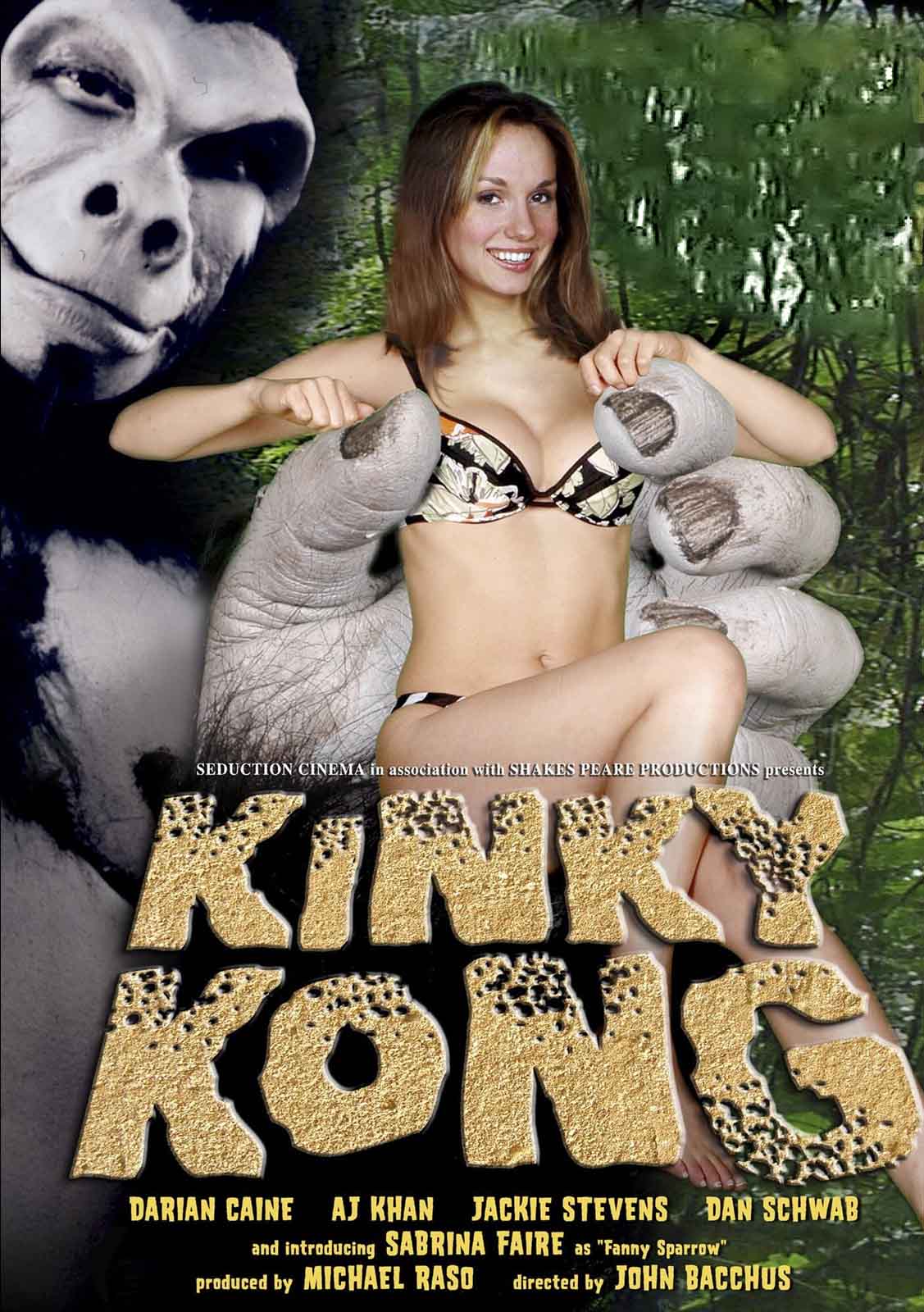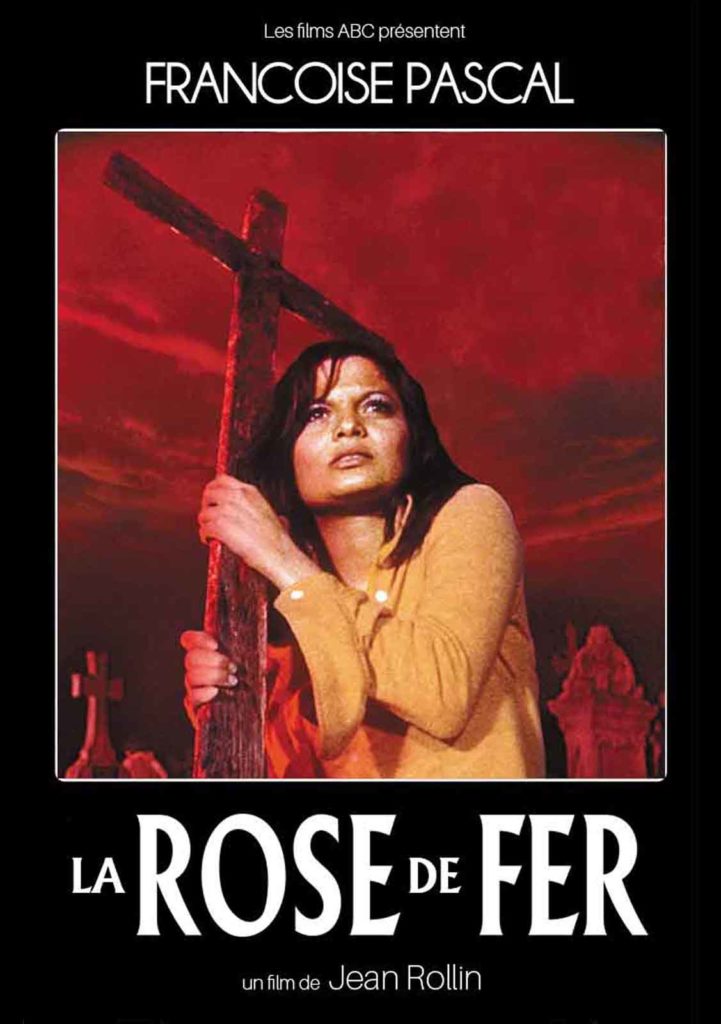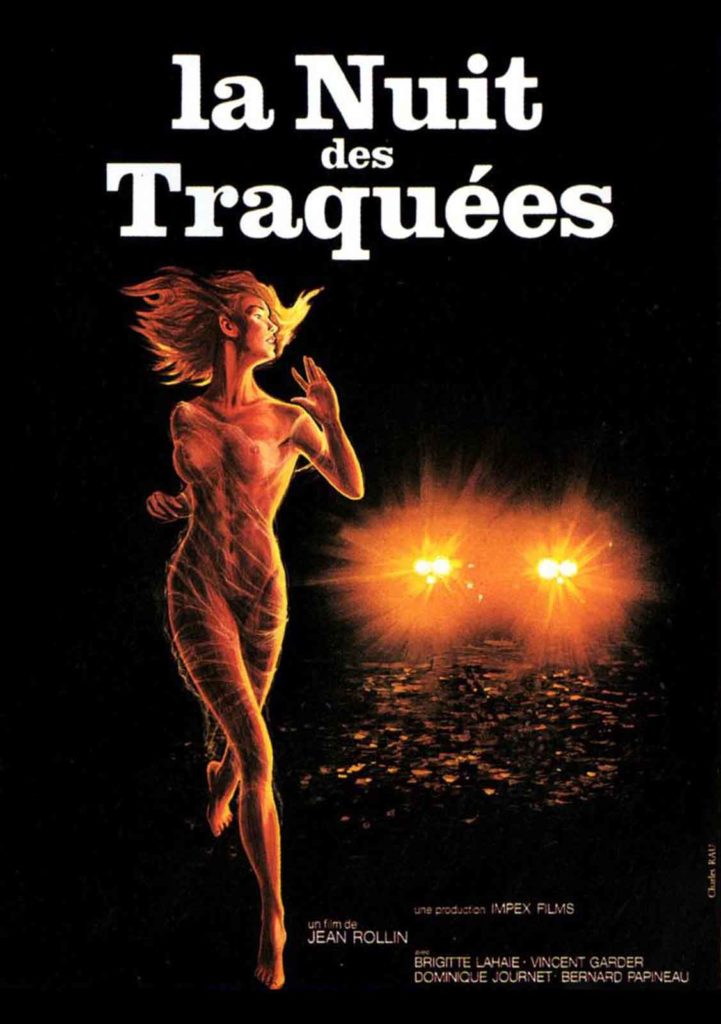Bardé de clichés gentiment datés, voici le film qui a lancé la vogue du cinéma catastrophe… et servi de modèle à Y a-t-il un pilote dans l’avion ?
AIRPORT
1970 – USA
Réalisé par George Seaton
Avec Burt Lancaster, Dean Martin, Jean Seberg, Jacqueline Bisset, George Kennedy, Van Heflin, Dana Wynter
THEMA CATASTROPHES I SAGA AIRPORT
Airport est le long-métrage qui a officiellement propulsé les films catastrophe au rang de sous-genre cinématographique, et l’on ne s’étonnera donc pas d’y trouver tous les tics et lieux communs inhérents à cet exercice de style très calibré. L’inspiration provient ici d’un best-seller d’Arthur Hailey publié en 1968. Dès le générique de début, la musique ultra-dynamique d’Alfred Newman happe le spectateur. Nous y découvrons l’aéroport de Lincoln et son activité humaine débordante. A cause d’une tempête de neige particulièrement virulente, un avion vient de rater son atterrissage. L’incident est sans gravité, certes, mais l’appareil est maintenant immobilisé au sol, obstruant la seule piste encore praticable. Les premières séquences du film multiplient à outrance les effets de split-screen, pour visualiser les conversations téléphoniques abondantes ou nous asséner quelques flash-back liés aux personnages principaux. Les femmes trompent leurs maris, les pilotes engrossent les hôtesses, les couples se font et se défont, bref le prologue d’Airport, c’est un peu Santa Barbara dans les airs.


Parallèlement à cette accumulation d’histoires sentimentales, de peines de cœur et de coucheries, le film joue la carte de la chronique quotidienne d’un aéroport et de ses cocasseries. D’où une forte allusion à la rivalité légendaire qui oppose les « rampants » et les « volants », ainsi qu’une petite galerie de portraits truculents, comme la vieille passagère clandestine qu’on débusque ou la femme peu scrupuleuse qui essaie de faire passer des diamants et des fourrures à la douane. Au bout d’une longue heure de mise en place, le Boeing 707 de la compagnie imaginaire Trans Global Airlines, qui relie Chicago à Rome, décolle enfin. À son bord, on trouve un bel échantillon de stéréotypes taillés au burin, notamment le pilote arrogant (Dean Martin) et l’hôtesse amoureuse (Jacqueline Bisset). Parmi les passagers, un homme étrange transporte fébrilement une mallette au contenu mystérieux. Comme on pouvait s’y attendre, c’est par lui que la catastrophe va arriver.
Panique en plein ciel
Car ce malheureux, récemment licencié par son employeur, a décidé de se suicider en faisant sauter une bombe artisanale, afin que son épouse puisse toucher la prime d’assurance. Mises au courant, les autorités s’affolent. Au sol, le mécanicien Joe Patroni (George Kennedy) se met au travail pour tenter de dégager la piste et le directeur de l’aéroport Mel Bakesfield (Burt Lancaster) ne sait plus où donner de la tête, tandis que le désastre tant attendu survient en plein vol… Le film a beau sembler documenté sur les coulisses d’un aéroport, il manque singulièrement de crédibilité. Ainsi, avant même le décollage du fameux 707, tout le monde semble pouvoir entrer dans l’avion comme dans un moulin, sans le moindre contrôle de sécurité. Quant au climax, il n’a franchement pas l’ampleur espérée. Bref, tout ça ne vole pas très haut, mais il faut reconnaître qu’on ne s’y ennuie guère et que le le réalisateur George Seaton assure le spectacle. Le succès fut d’ailleurs colossal : Airport, qui coûta 10 millions de dollars, en rapporta finalement dix fois plus, engendrant trois séquelles et un grand nombre d’imitations, la plus réjouissante étant bien sûr Y a-t-il un pilote dans l’avion ?
© Gilles Penso
À découvrir dans le même genre…
Partagez cet article