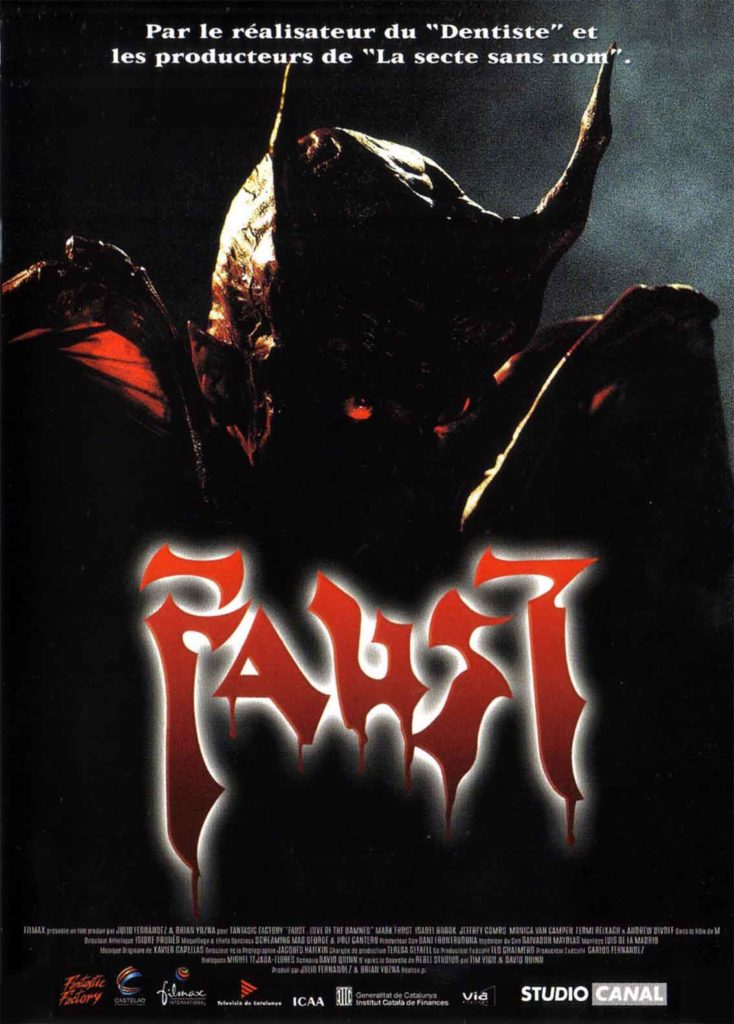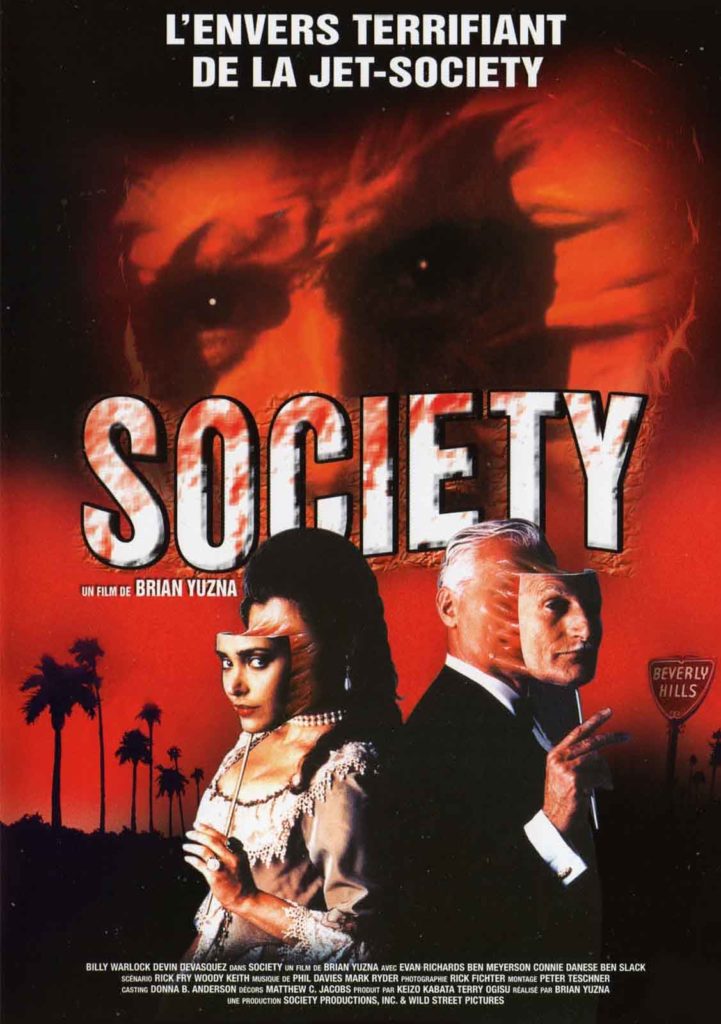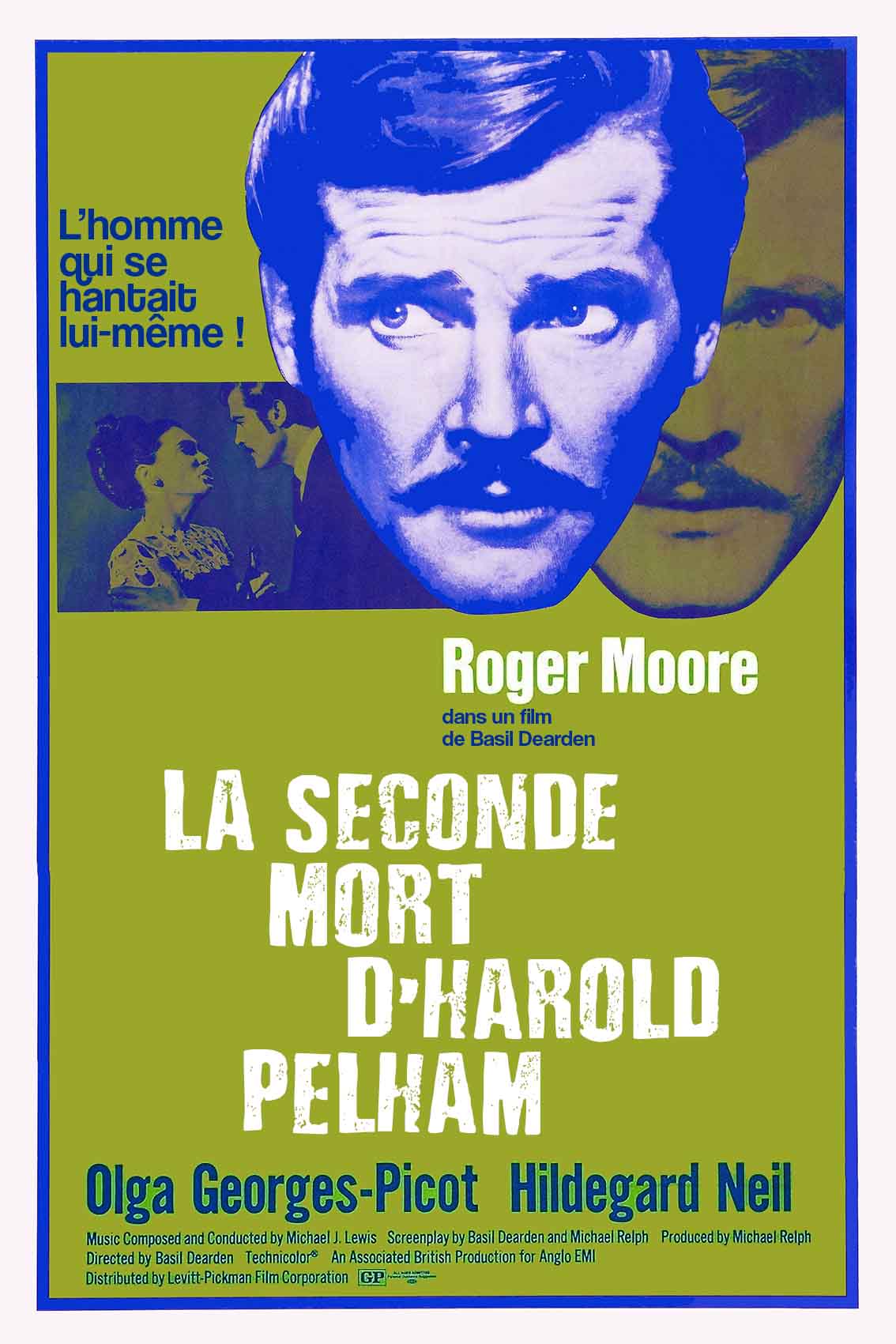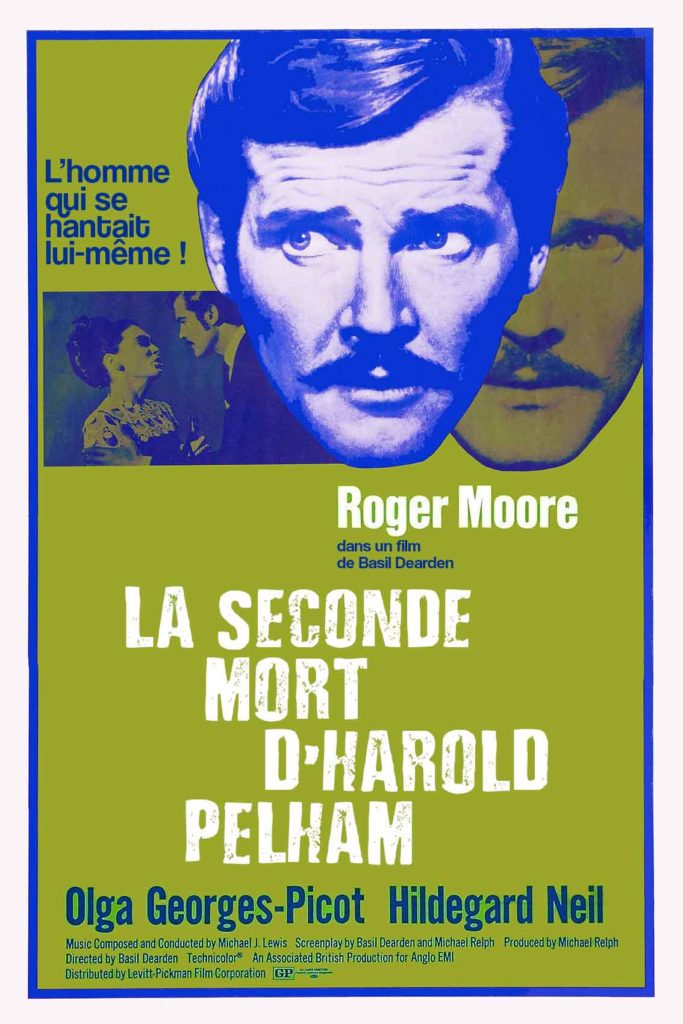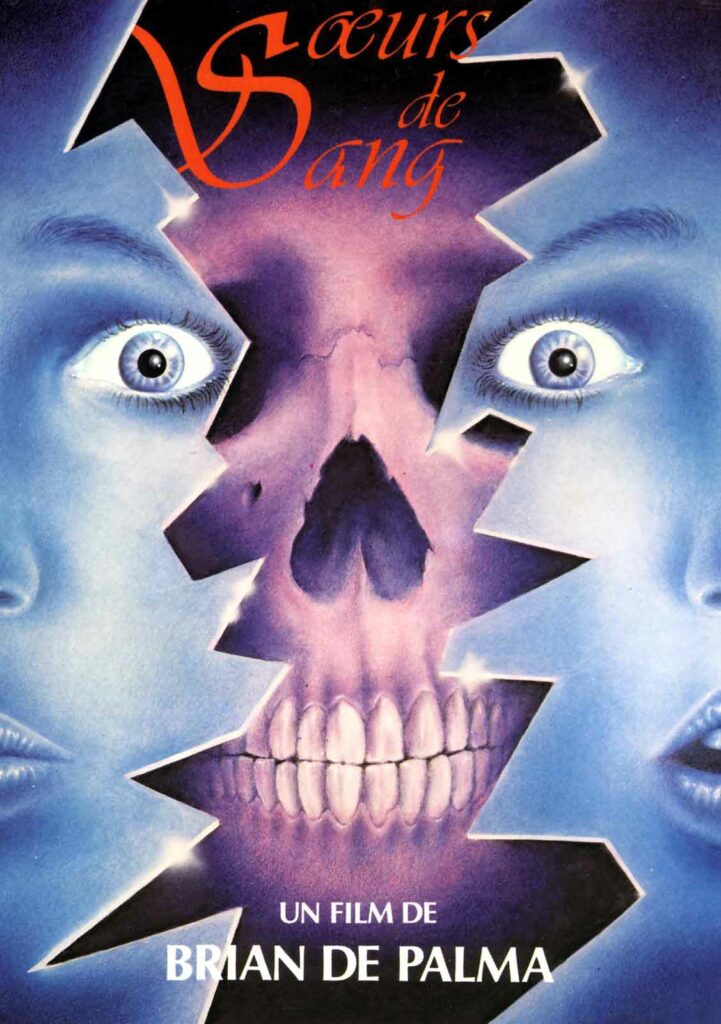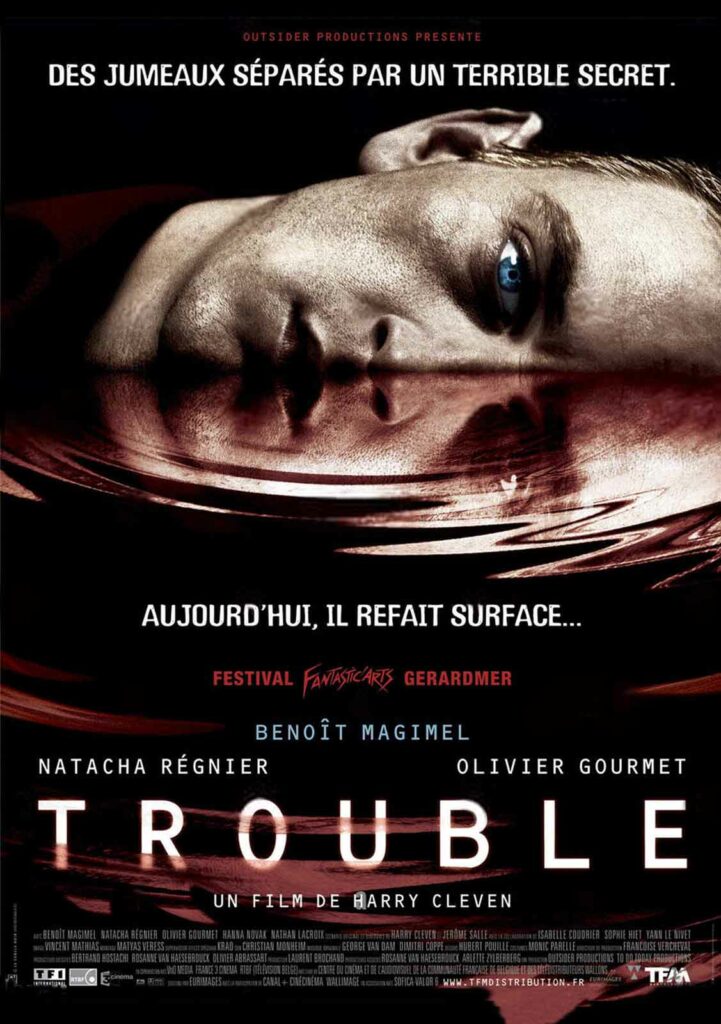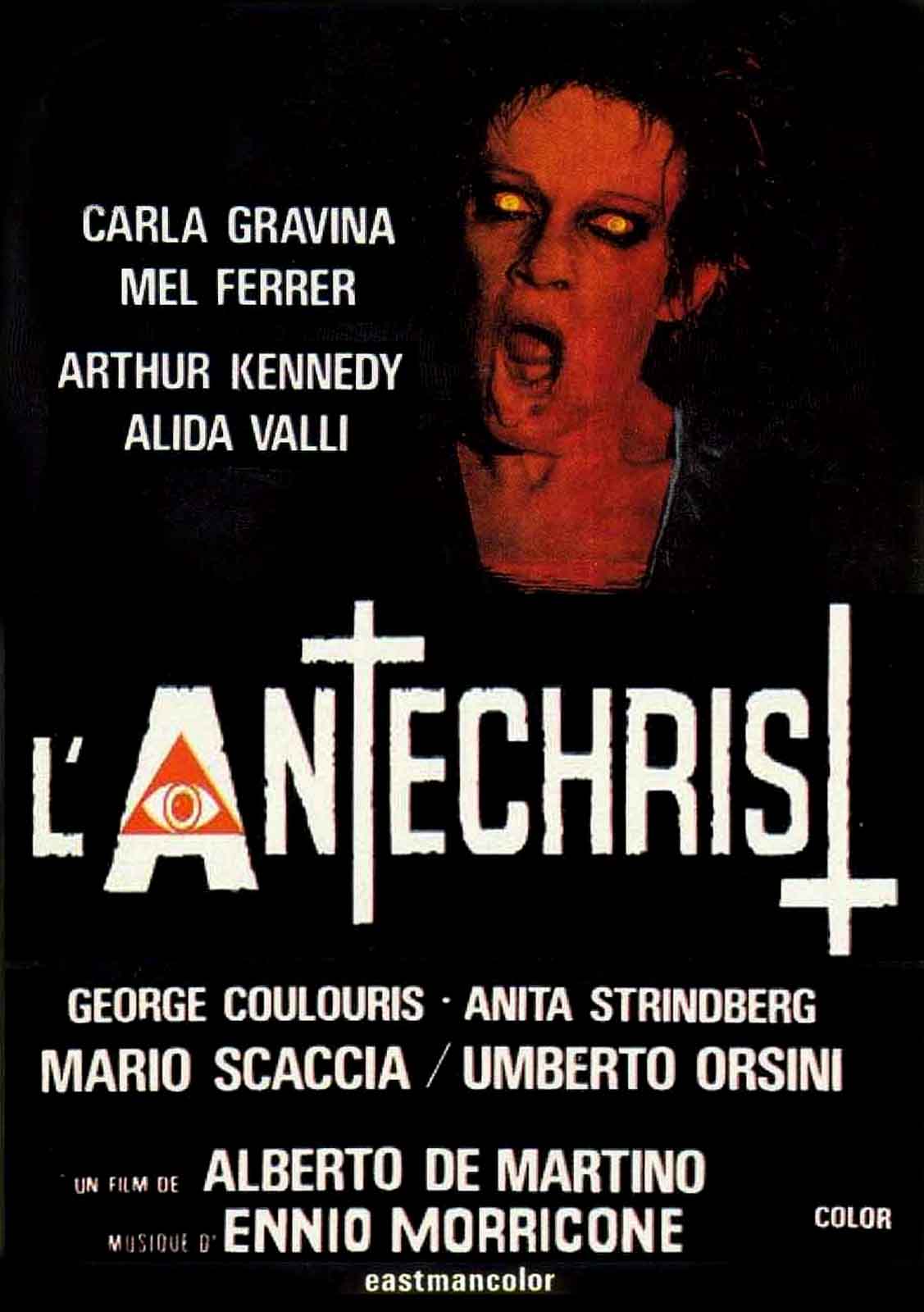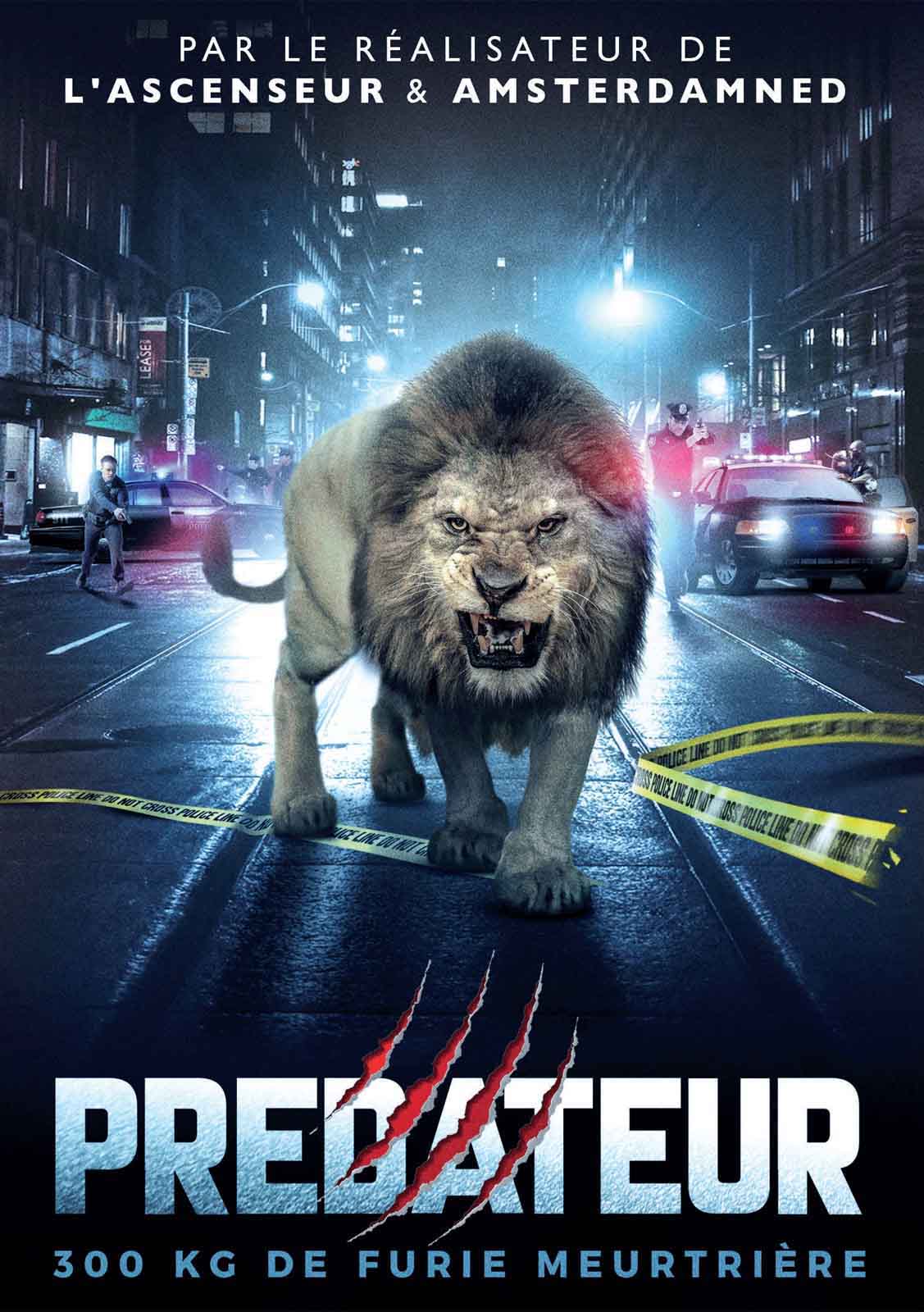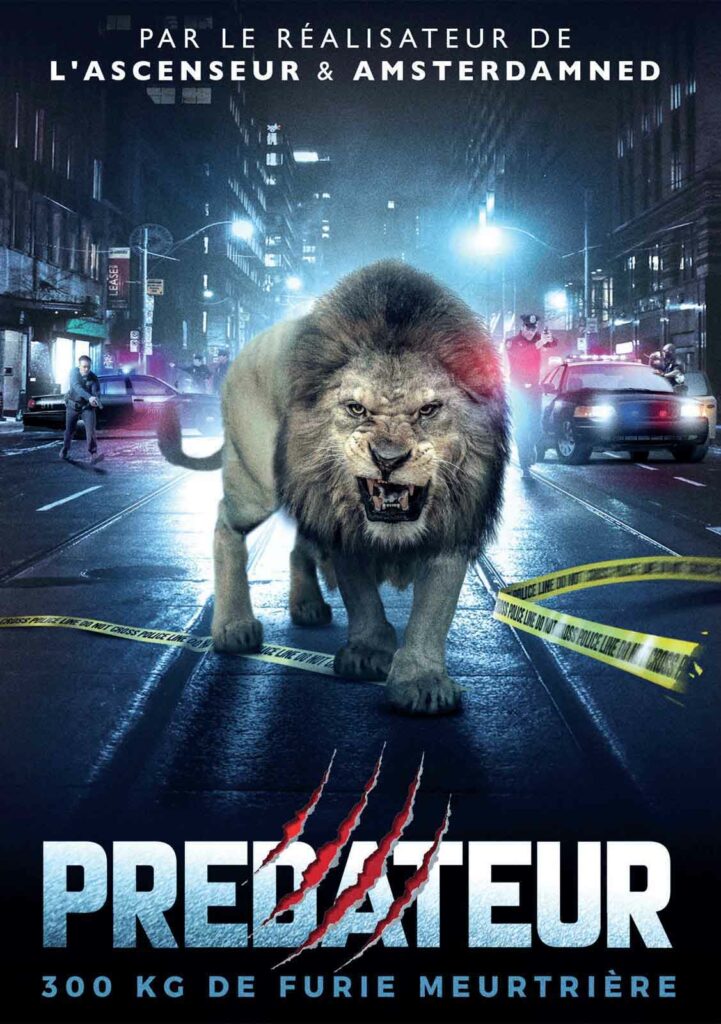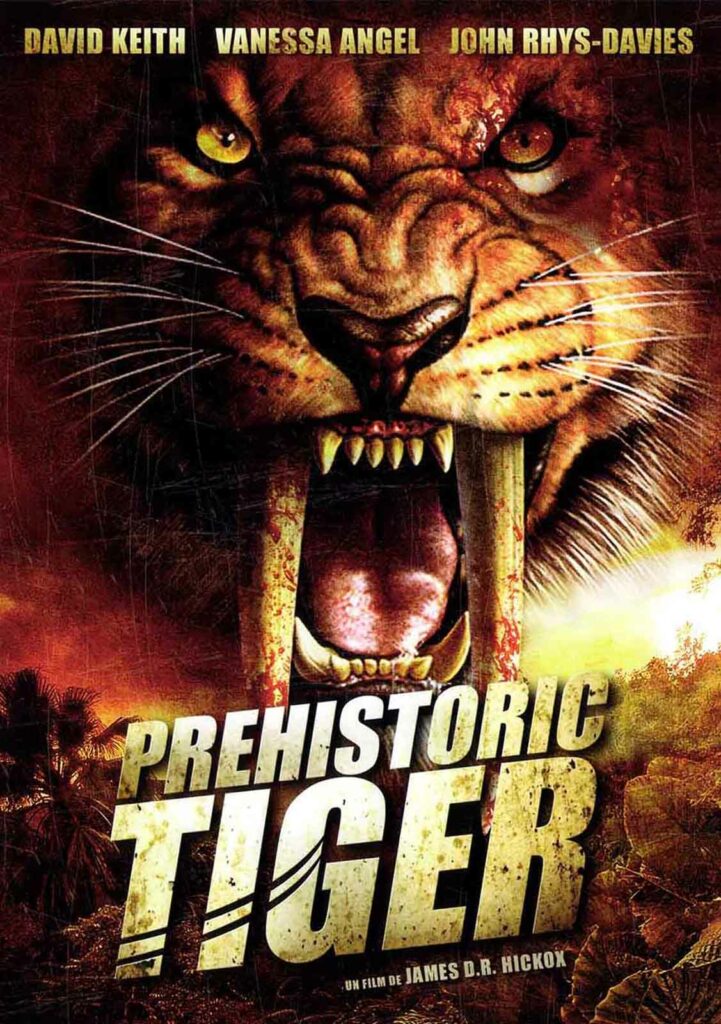Les célèbres plombiers de Nintendo font leur baptême du grand écran à l’occasion d’un long-métrage un peu embarrassant…
SUPER MARIO BROS
1993 – USA
Réalisé par Rocky Morton et Annabel Jankel
Avec Bob Hoskins, John Leguizamo, Dennis Hopper, Samantha Matis, Fisher Stevens, Richard Edson, Lance Henriksen
À travers les multiples trouvailles visuelles et les effets de style de leur série TV Max Headroom puis de leur premier long-métrage Mort à l’arrivée, remake inventif d’un classique du film noir, le couple de cinéastes Rocky Morton et Annabel Jankel semblait pouvoir devenir la nouvelle coqueluche d’Hollywood. Le défi que représentait Super Mario Bros semblait taillé sur mesure pour ces duettistes virtuoses. D’autant que pour transposer sur grand écran les péripéties du jeu vidéo original, Morton et Jankel se sont entourés de l’équipe idéale. Face à la caméra, Mario et Luigi, simples plombiers propulsés dans une aventure démentielle qui les dépasse totalement, sont interprétés par les sympathiques Bob Hoskins (Qui veut la peau de Roger Rabbit) et John Leguizamo (58 minutes pour vivre). Le duo fonctionne plutôt bien, selon le principe maintes fois éprouvé du couple antithétique (notons qu’à l’origine, c’est Danny de Vito qui était pressenti pour incarner Mario). Aux frères plombiers s’oppose le redoutable Koopa, interprété avec emphase par l’immense Dennis Hopper (Blue Velvet). La conception de la cité imaginaire de Dinohattan, caricature claustrophobique et survoltée de New York reconstituée dans une usine désaffectée de Caroline du Nord, a été confiée à David Snyder (Blade Runner). Et c’est Alan Silvestri (Retour vers le futur) qui s’est vu confier l’écriture d’une musique trépidante en accord avec les folies visuelles du film. Bref, du beau monde.


Malgré tous ces atouts et un potentiel énorme, force est de constater que les deux réalisateurs ont spectaculairement raté le coche et que le film entier, après un prologue pourtant prometteur, finit par ressembler à une énorme blague. SI l’édifice s’écroule autant, c’est principalement à cause de l’extrême fragilité de ses fondations, autrement dit un scénario qui n’aura cessé d’être écrit, réécrit, construit et déconstruit en cours de production. Du coup, si chaque séquence bénéficie d’un rythme propre et d’idées visuelles intéressantes, l’agencement de tous ces éléments au sein de la structure générale du récit n’a pas plus d’homogénéité que le visage balafré du monstre de Frankenstein. Ce manque de cohésion s’explique en partie par le jeu vidéo qui est à l’origine du film, et dont le principe repose sur la traversée de tableaux successifs et autonomes. En voulant imiter servilement cette structure au lieu de se mettre en quête d’une progression dramatique solide, le film finit par ressembler à un fourre-tout sans queue ni tête.
Oh Mario, si tu savais…
Les effets spéciaux eux-mêmes, éléments majeurs d’un film de cet acabit, ne sont pas toujours le fruit du choix le plus judicieux. Certes, on ne peut qu’admirer l’animation mécanique du petit Yoshi, le dinosaure mascotte de l’héroïne, et des Goombas, colosses écervelés à la minuscule tête reptilienne. De même, les effets numériques ouvrent la porte à des visions inédites, comme le long plan séquence qui traverse la mégapole pour se resserrer sur la princesse Daisy (Samantha Mathis) à sa fenêtre, l’allongement ophidien de la langue de Koopa ou encore la transformation finale et furtive du même Koopa en tyrannosaure. Mais l’accumulation de morphings et d’images de synthèses dont abuse le film confine rapidement à l’indigestion. A l’issue d’un récit décousu et totalement incohérent, Super Mario Bros s’achève sur un dénouement ouvert, calqué fidèlement sur celui de Retour vers le futur. Fort heureusement, l’accueil glacial que le film reçut lors de sa sortie dissuada les producteurs de le doter de la moindre séquelle. Super Mario Bros ouvrit cependant une brèche, celle des adaptations cinématographiques de jeux vidéo. En ce domaine, le film de Morton et Jankel se plaça en précurseur. Mais les deux cinéastes ne se remirent jamais vraiment de ce colossal échec artistique, disparaissant aussi vite des radars hollywoodiens qu’ils y étaient apparus.
© Gilles Penso
Partagez cet article