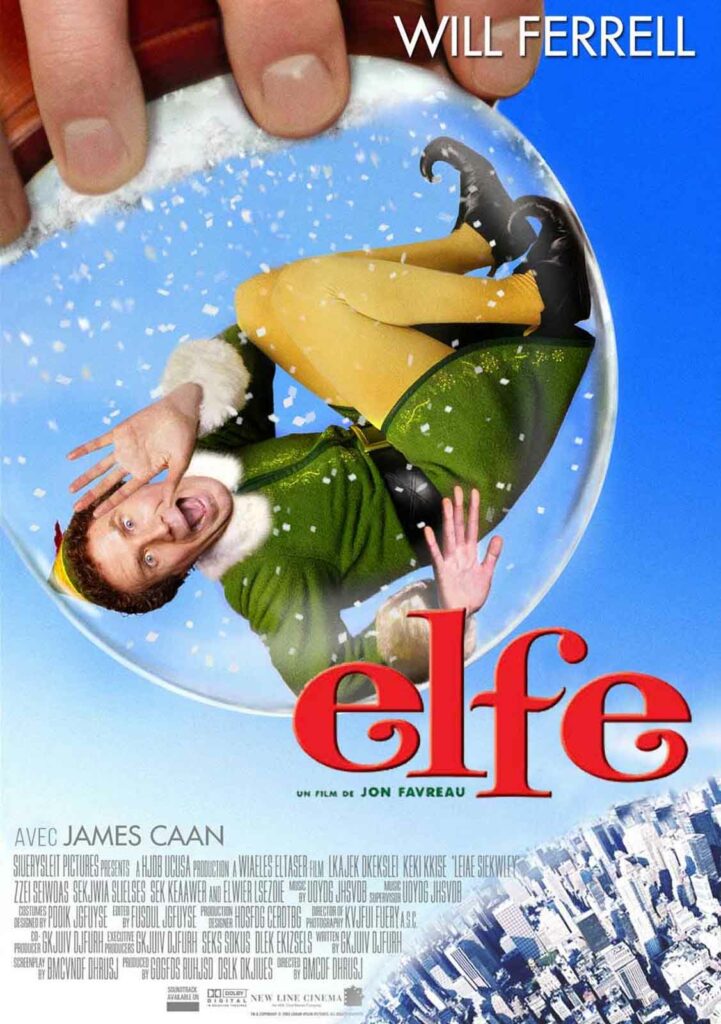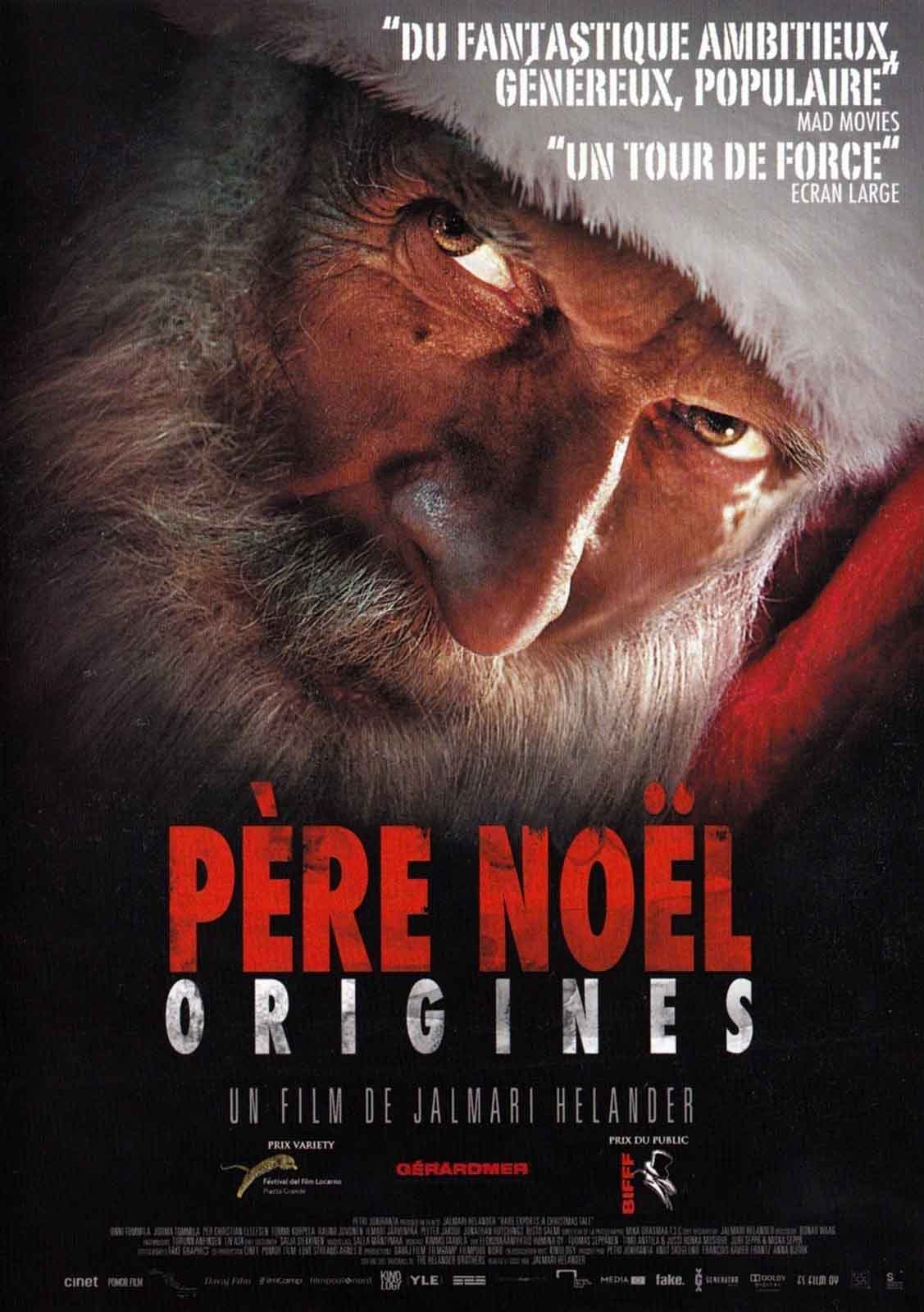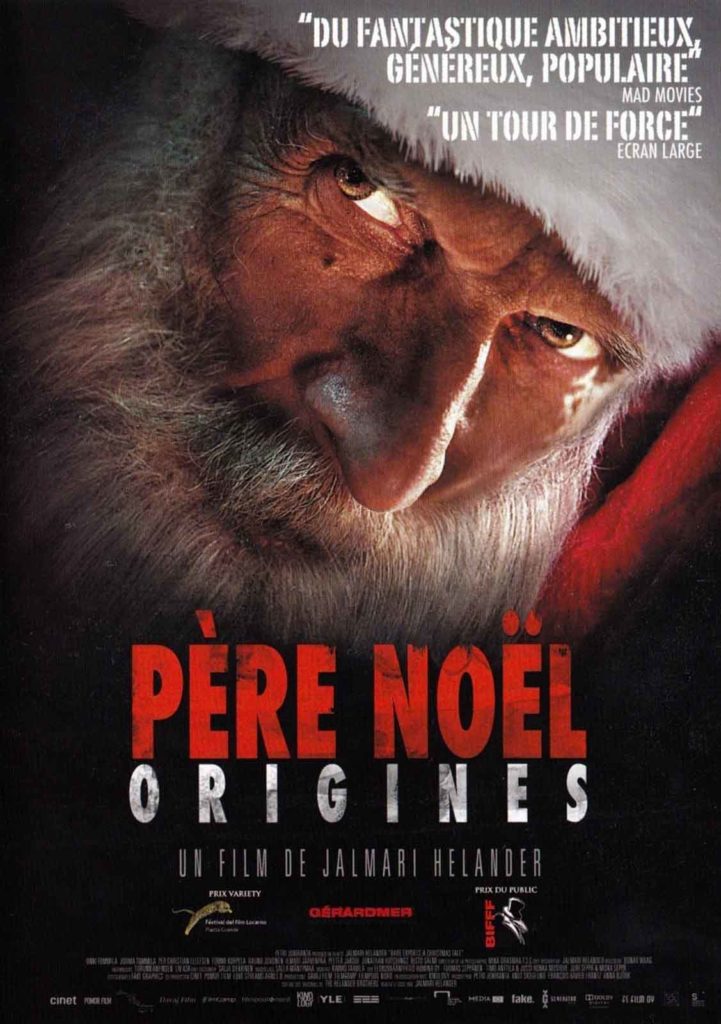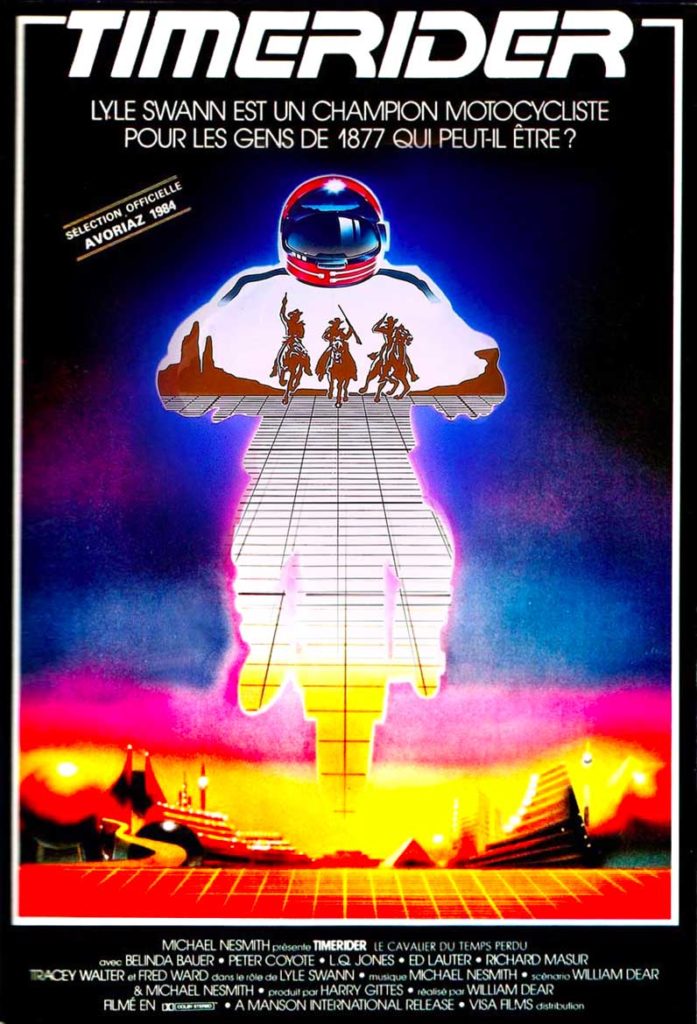Revenue du merveilleux monde d'Oz, Dorothy fuit l’internement que lui réservait sa tante pour regagner son univers… imaginaire ?
RETURN TO OZ
1985 – GB / USA
Réalisé par Walter Murch
Avec Fairuza Balk, Nicol Williamson, Jean Marsh, Piper Laurie, Matt Clark, Deep Roy, John Alexander, Brian Henson
THEMA CONTES
Dans les années 80, alors que le genre fantastique a désormais établi résidence dans les villes de banlieue américaines (les slashers et toutes les productions Amblin) et s’adresse volontiers aux adolescents, le corollaire de cette évolution est de chercher à rompre avec ce quotidien en offrant aux enfants de s’évader dans des mondes imaginaires. La Guerre des étoiles a déjà préparé le terrain, mais le conte connait un retour en grâce à sa suite avec Dark Crystal, Labyrinthe, L’Histoire sans fin, Legend ou Princess Bride. Le studio Disney, toujours en pleine traversée du désert depuis les années 70, apporte sa contribution au genre avec Oz, un monde extraordinaire. Le scénario trouve un habile équilibre pour satisfaire les parents ayant grandi avec Le Magicien d’Oz sans s’aliéner le jeune public. Les événements du film original sont ainsi évoqués dans le prologue, alors que Dorothy (Fairuza Balk) raconte ses aventures au docteur Woley (Nicol Williamson). Mais pour autant, il ne s’agit pas d’une suite puisque l’héroïne n’est âgée que de 9 ans (contre 16 dans le film original) et qu’il n’est plus question ici de numéros musicaux. Oz, un monde extraordinaire peut donc s’appréhender comme l’histoire indépendante d’une fillette soupçonnée d’affabulations. Ce qui pousse le médecin à lui prescrire une séance d’électrochocs dans ce qui ressemble plus à un asile qu’à un hôpital. Heureusement, un orage survient, causant une rupture de courant salvatrice. Une autre pensionnaire aide alors Dorothy à s’enfuir à travers bois mais elles chutent toutes deux dans une rivière et sont emportées. Ayant perdu connaissance, Dorothy se réveille dans le monde de Oz et découvre que ses habitants ont été pétrifiés par un méchant roi (interprété également par Nicol Williamson pour établir le lien entre réalité et rêverie), qui retient prisonnier l’épouvantail rencontré lors de son premier séjour. Accompagnée d’un soldat mécanique, d’un épouvantail et d’un homme-citrouille, Dorothy part au secours de son ami.


Le film nous emmène à Oz après une petite bobine – mais quelle bobine ! Pour un conte tout public, qui plus est produit par Disney, Dorothy n’est pas ménagée, promise à un calvaire proche de celui enduré par Baby Doll dans Sucker Punch. Un aspect cauchemardesque que l’on retrouve plus tard dans une scène qui marquera à coup sûr les plus jeunes, lorsque Dorothy s’infiltre dans une galerie arborant des têtes coupées sous vitrine que la maitresse des lieux, décapitée, peut utiliser à sa guise. Et la reine étêtée de se lancer à la poursuite de la petite intruse ! Terry Gilliam n’est pas loin et la séquence n’aurait pas dépareillé dans Le Baron de Munchausen. Force est d’ailleurs de reconnaitre que si Oz, un monde extraordinaire est une production américaine, il n’en exhale pas moins un parfum tout britannique. Et si le spectateur a envie de s’écrier : « j’ai l’impression que nous ne sommes plus au Kansas ! », c’est parce que le film a été tourné intégralement en Angleterre, ce que la photo de David Watkins et la direction artistique de Norman Reynolds semblent trahir à chaque instant. Le fait que le Kansas soit un brin plus verdoyant qu’on ne l’imagine n’entrave en rien la crédibilité des scènes du monde réel. En revanche, d’autres extérieurs intégrés dans le pays d’Oz contrarient notre suspension d’incrédulité car la lumière naturelle, très plate, contraste avec celle, plus travaillée et chaude, des séquences en studio et des divers décors peints. Néanmoins, bien que son film soit visuellement moins abouti que celui de son concurrent direct Labyrinthe, Walter Murch utilise tous les trucages à sa disposition pour raconter son histoire, dont un remarquable travail de marionnettes confié à Brian Henson, mais surtout l’omniprésence de la « claymation » – de la pâte à modeler animée image par image – une discipline rarement vue dans des productions de ce calibre.
Une production houleuse…
Les cinéphiles noteront qu’il s’agit de l’unique réalisation de Walter Murch, monteur (image et son) oscarisé de quelques classiques pour ses amis Francis Coppola et George Lucas. Bien que son implication personnelle dans ce projet l’ait amené à en cosigner le scénario, les pontes de Disney n’eurent de cesse de douter de ses compétences, si bien qu’il fut évincé après quelques jours de tournage. Il ne retrouvera son poste que grâce à l’intercession de ses deux amis susmentionnés, et la garantie que Lucas prenne la relève derrière la caméra si les choses devaient mal se passer. En revanche, Gary Kurtz, producteur émérite des deux premiers épisodes de La Guerre des étoiles ne sera pas repêché et se verra remplacé par Paul Maslansky, célèbre par la suite pour son « travail » sur la saga Police Academy. Malgré ces tensions en coulisse, Oz, un Monde extraordinaire propose une aventure cohérente dans son genre, et si personnages et effets spéciaux ne génèrent pas le même émerveillement que d’autres fantaisies produites à la même période, on peut regretter cette époque où certains films n’hésitaient pas à provoquer quelques sains et inoffensifs frissons chez les enfants. Un des buts du Fantastique n’est-il pas d’exorciser les peurs et les cauchemars ?
© Jérôme Muslewski
À découvrir dans le même genre…
Partagez cet article