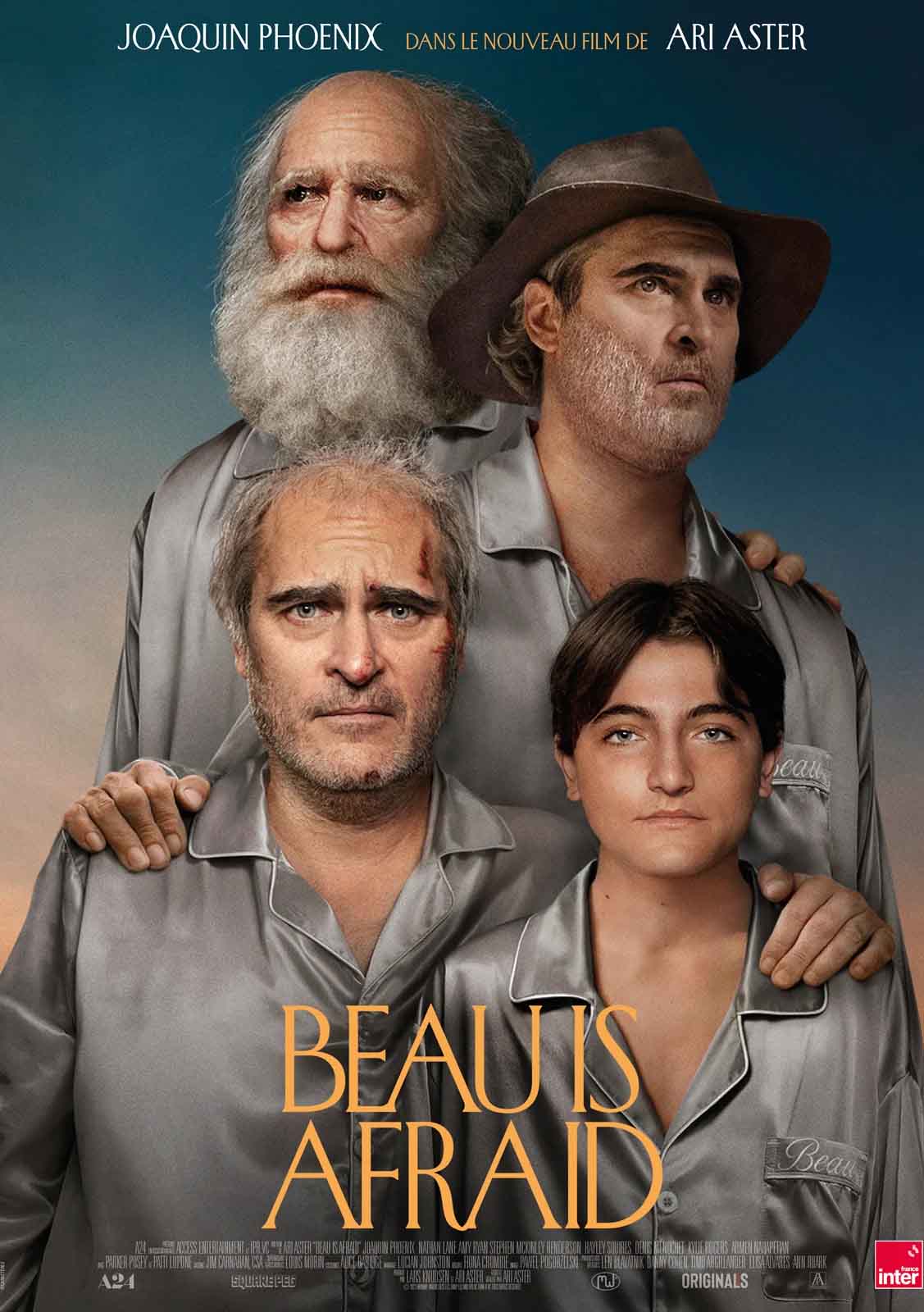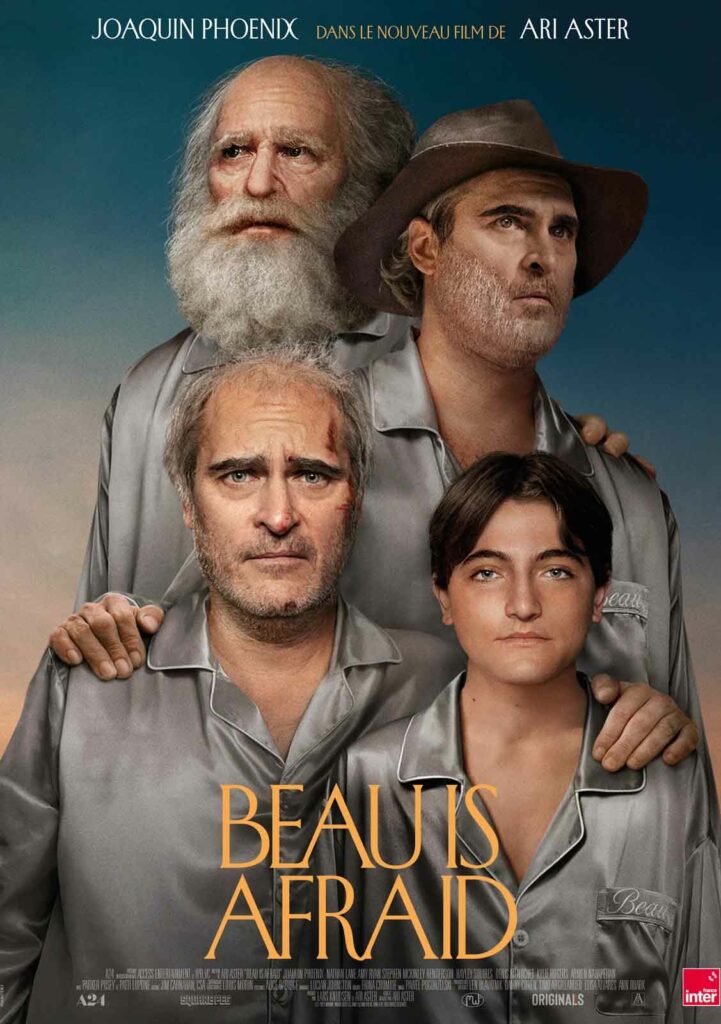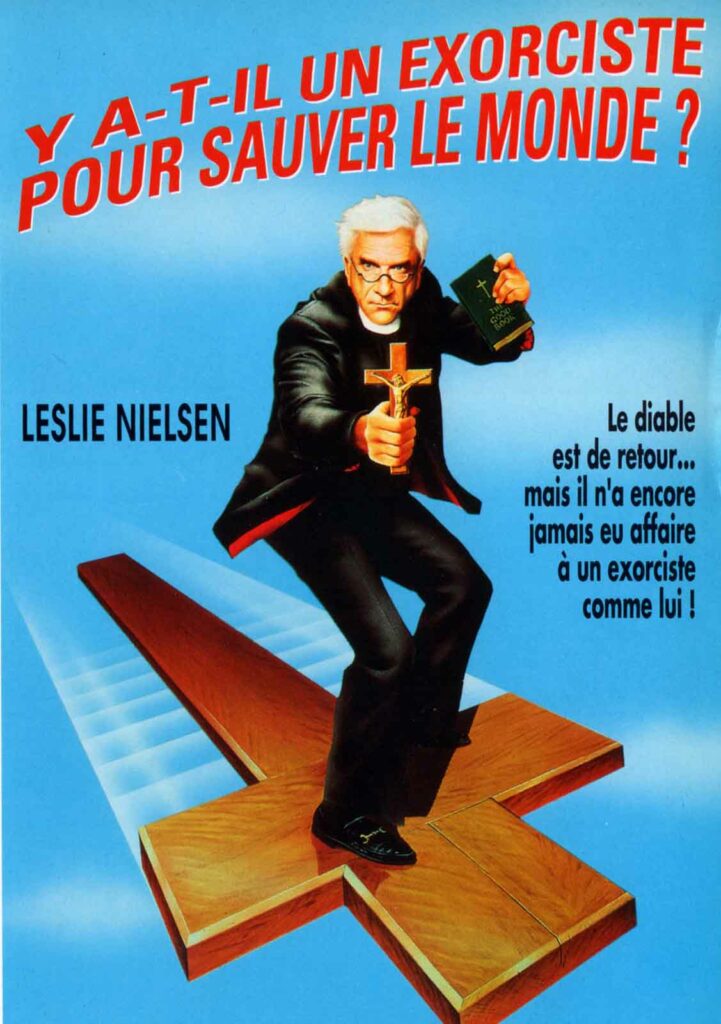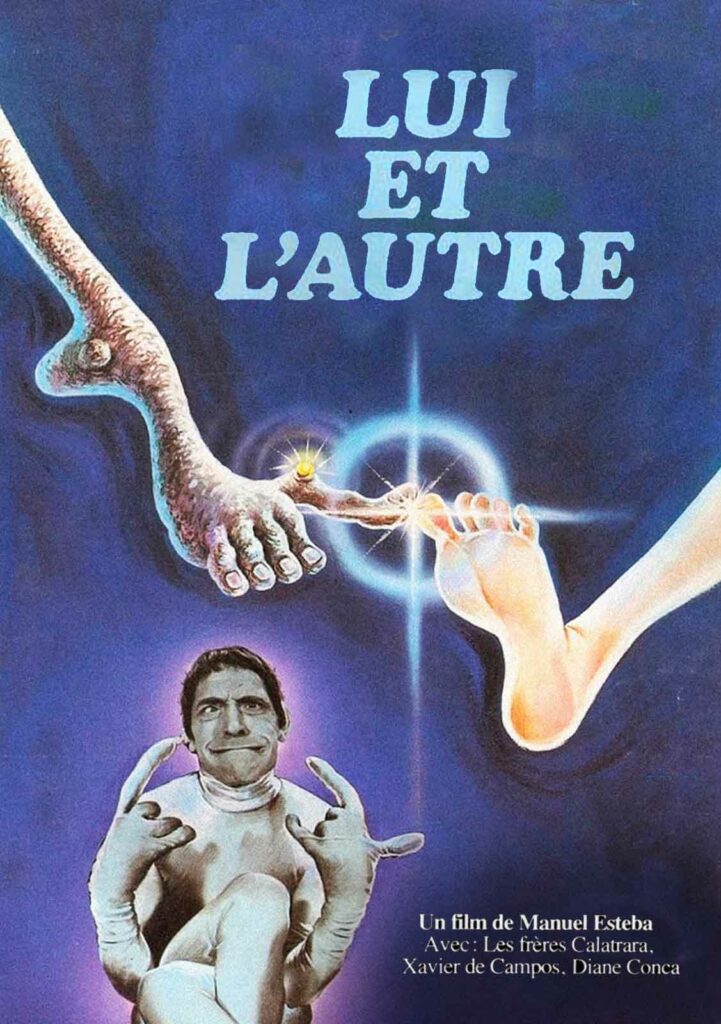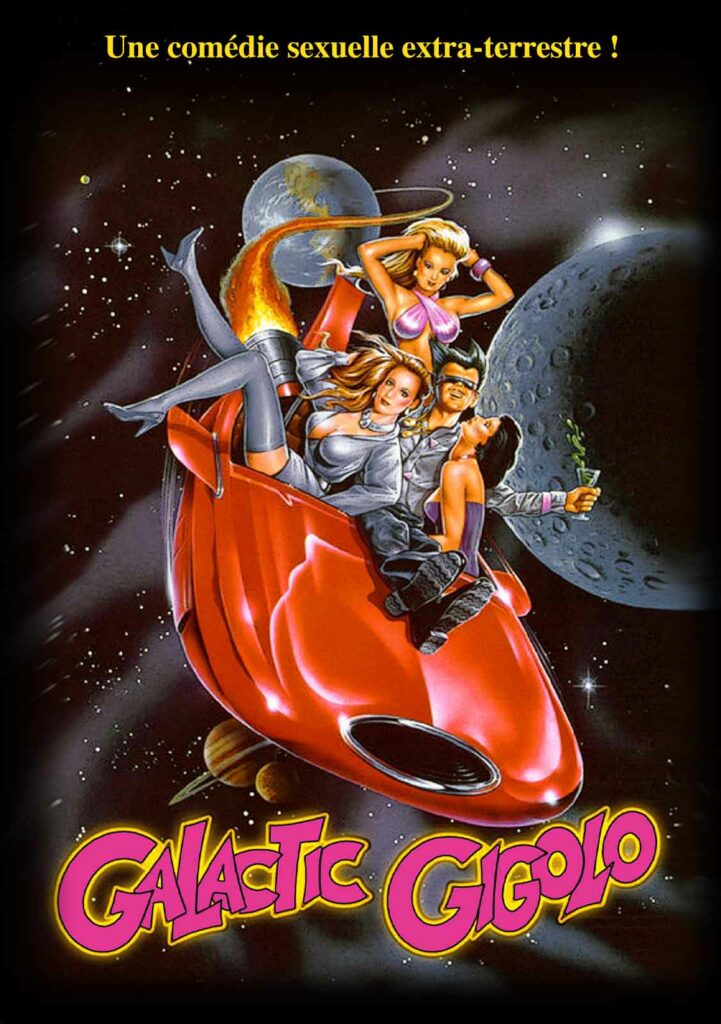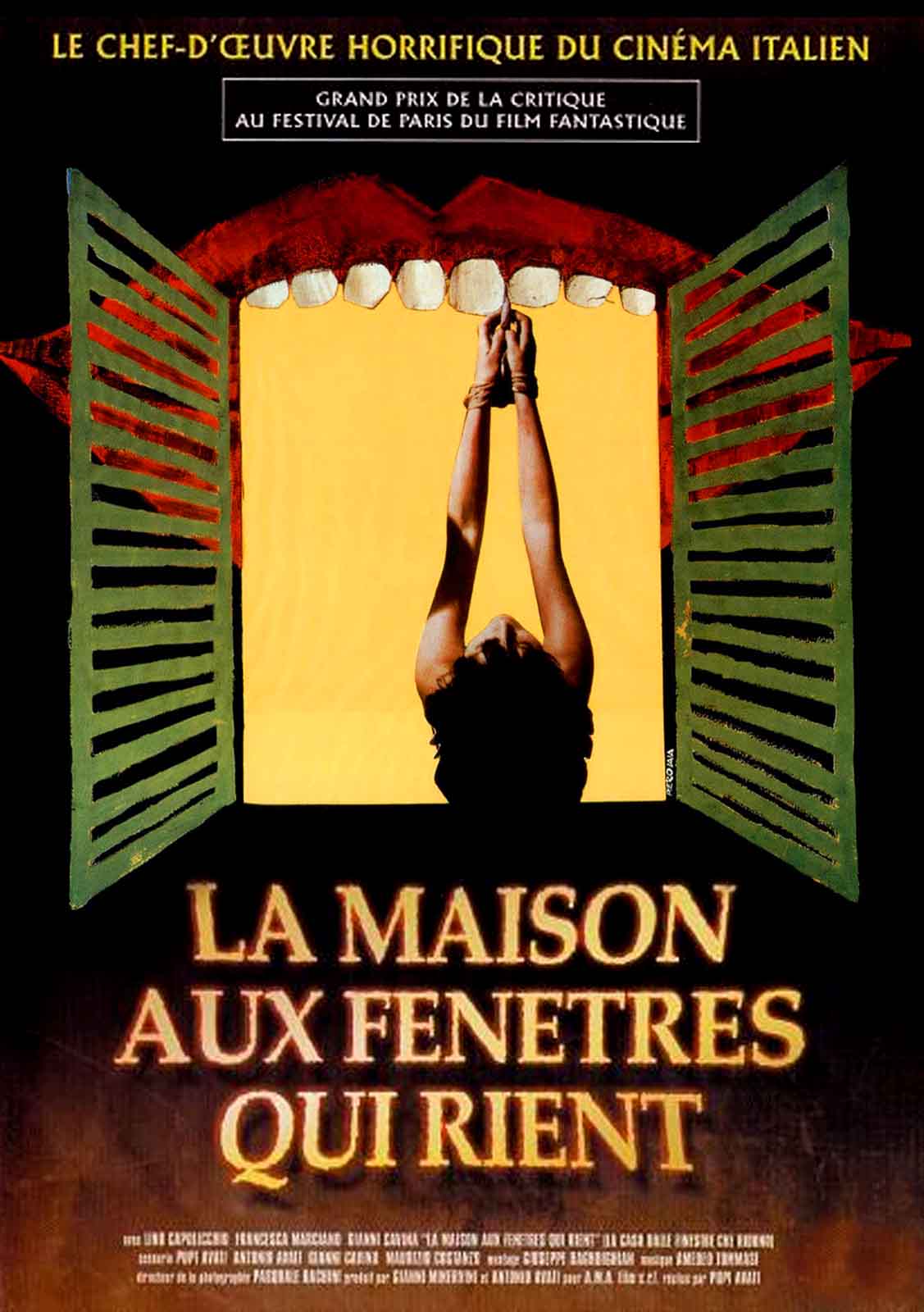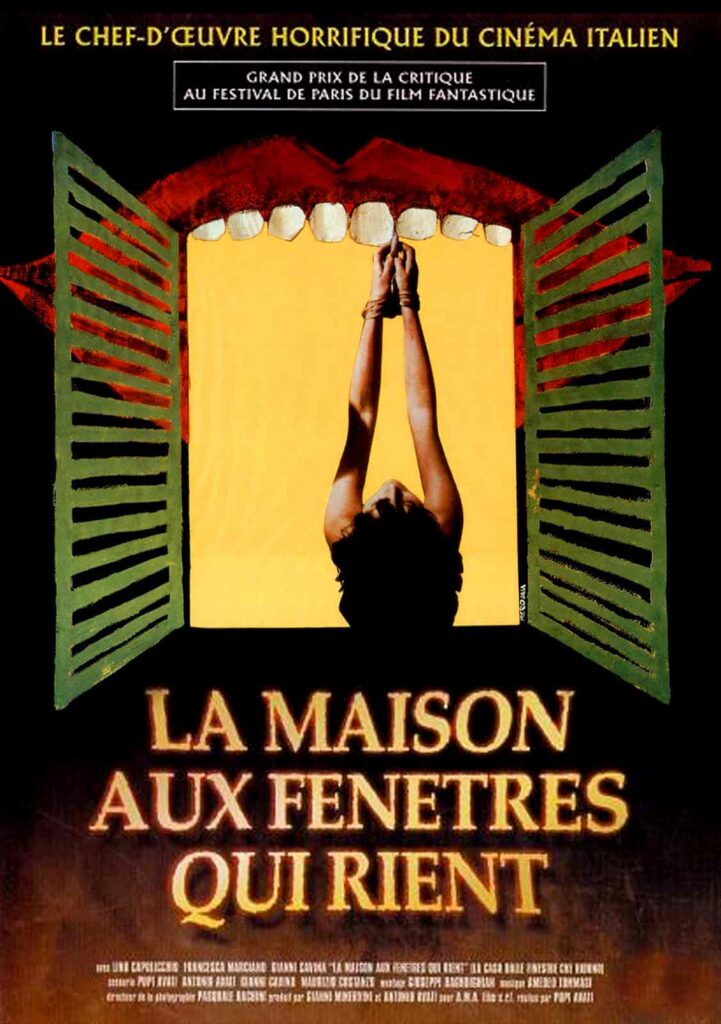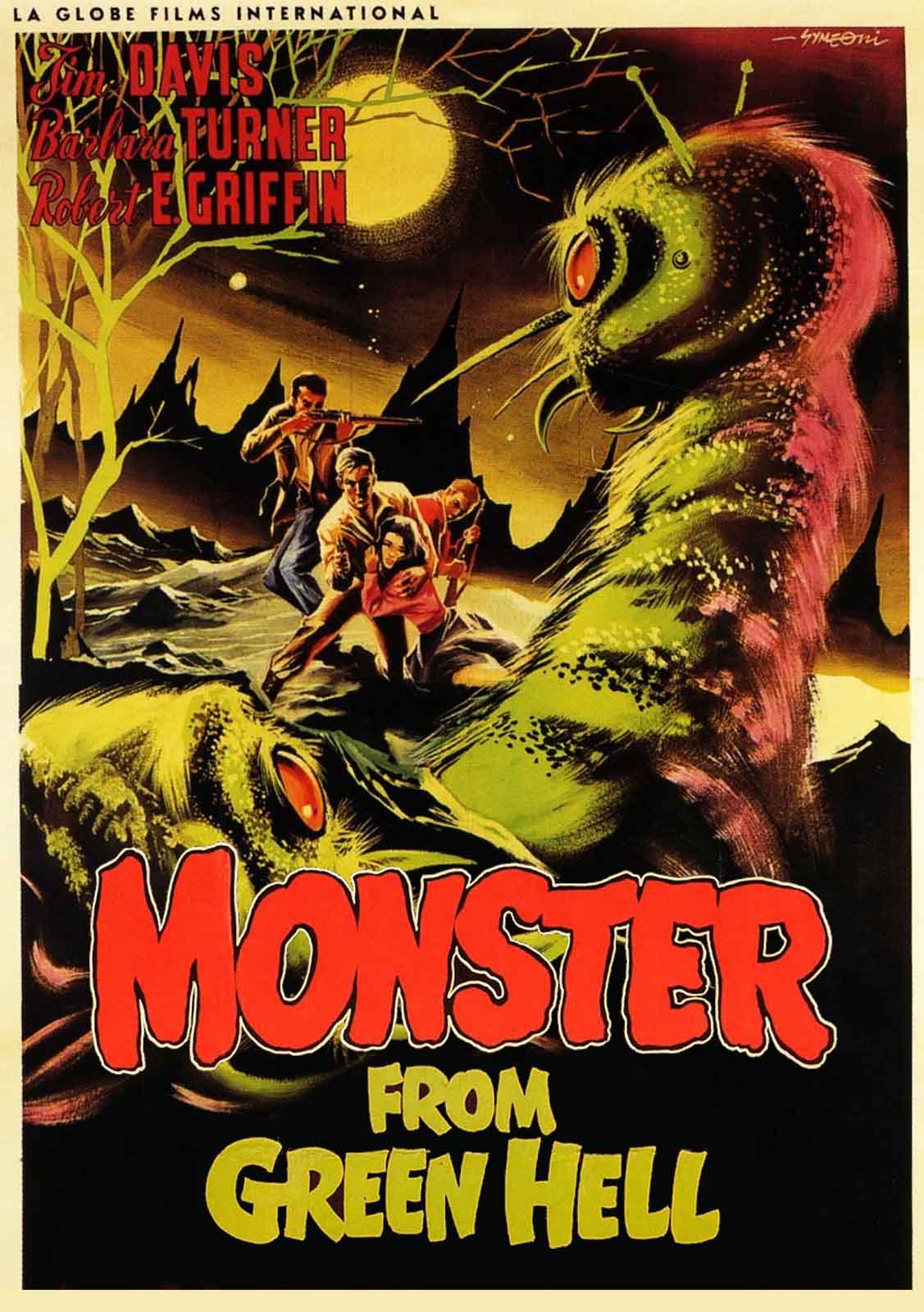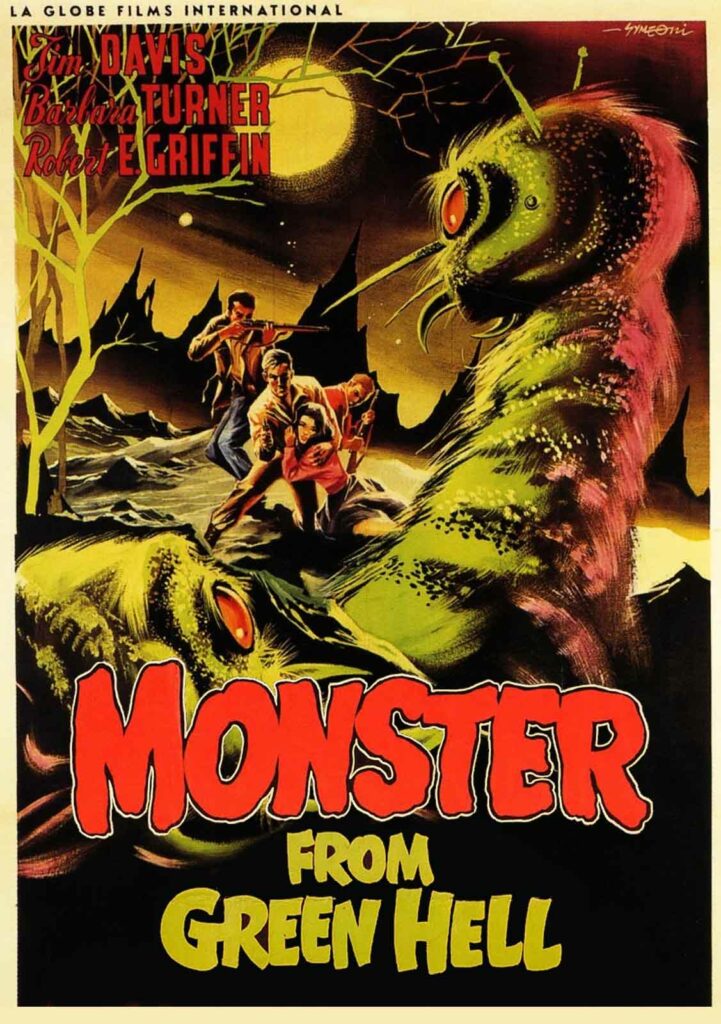Une suite étrange de La Féline dans laquelle l’héroïne du film précédent réapparaît sous forme d’un fantôme…
THE CURSE OF THE CAT PEOPLE
1944 – USA
Réalisé par Robert Wise et Gunther Von Fritsch
Avec Simone Simon, Kent Smith, Jane Randolph, Julia Dean, Ann Carter, Eve March, Elizabeth Russell, Erford Gage, Sir Lancelot
THEMA FANTÔMES
Lorsque les dirigeants de la RKO demandèrent au producteur Val Lewton de mettre en chantier une suite à La Féline, qui n’avait pas coûté bien cher et avait remporté un franc succès, l’homme fut quelque peu embarrassé, car son histoire était bel et bien terminée et son héroïne trépassée. Peu soucieux de s’adonner à la redite, Lewton contourna le problème en initiant un film ne conservant que peu d’attaches avec son prédécesseur et abandonnant le sortilège ancestral frappant des êtres mi-humains mi-félins pour se lancer dans une histoire de fantôme en forme de conte pour enfants. Du coup, le titre La Malédiction des hommes chats semble bien peu approprié. Amy Reed (Ann Carter), la fillette d’Olivier Reed et Alice Reed (Kent Smith et Jane Randolph) – qui se mariaient à la fin de La Féline – est une gamine de six ans un peu à part. Elle rêvasse, est lunatique, vit dans un jardin secret et ne se mêle pas aux autres enfants, ce qui inquiète quelque peu Madame Callahan (Eve March), son institutrice. Un jour, Julia Farren (Julia Dean), une vieille et étrange voisine qui vit dans une grande demeure un peu à l’écart et délaisse cruellement sa propre fille, lui fait don d’une bague.


Persuadée qu’elle peut exaucer tous les vœux, Amy demande à cette bague une camarade de jeux. Apparaît alors une jeune femme dont la ressemblance avec Irena, la première femme d’Olivier Reed, est troublante (et à qui la charmante Simon Simon, prête une fois de plus ses traits). « Je viens du pays des ténèbres et de la paix éternelle » dit-elle à une Amy émerveillée. A partir de ce postulat, le scénariste Dewitt Bodeen construit une histoire gorgée de guimauve et franchement peu palpitante, le principal conflit étant lié au fait qu’Amy est la seule capable de voir Irena et que les adultes pensent qu’elle affabule. S’agit-il d’ailleurs d’un fantôme ou d’une hallucination ? Est-elle bienveillante ou fomente-t-elle quelque plan machiavélique ? Le fossé entre Amy et ses parents ne risque-t-il pas irrémédiablement de se creuser ? La fillette ne court-elle pas le danger de sombrer dans la folie, comme jadis sa défunte mère ?
Guimauve et bons sentiments
Qu’on se rassure, tout finira bien dans le meilleur des mondes, en un happy end dégoulinant de bons sentiments. Étant donné que La Malédiction des hommes chats fut projeté aux soldats américains pour leur remonter le moral pendant les combats, on comprend mieux son côté exagérément gentillet et ses pesantes séquences liées à la soirée de Noël, au sapin, aux cadeaux et aux chants d’allégresse. Tout à fait indigne de la première Féline avec laquelle, on l’aura compris, elle n’entretient que peu de lien, cette co-réalisation de Gunther Von Fritsch (un ancien monteur né en Croatie qui allait se spécialiser dans la série télévisée à partir de 1950) et Robert Wise (futur metteur en scène du Jour où la Terre s’arrêta et La Maison du diable) se suit donc sans déplaisir, mais ne présente qu’un intérêt limité. Il faudra attendre que Jacques Tourneur tourne L’Homme léopard pour que la thématique de la bestialité humaine soit à nouveau traitée frontalement.
© Gilles Penso
Partagez cet article