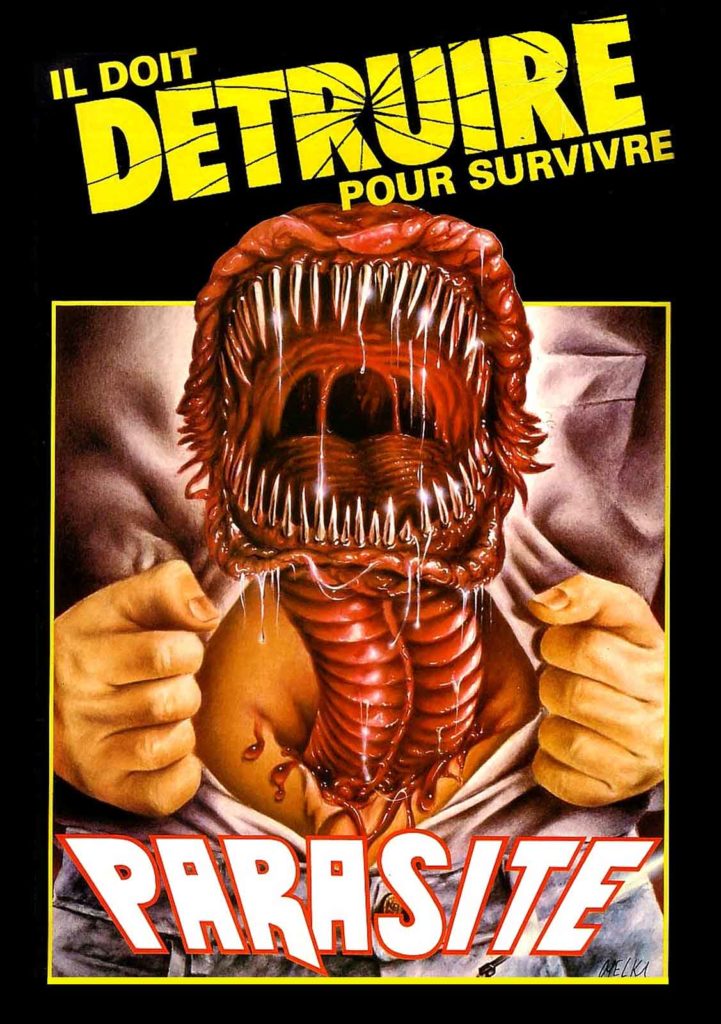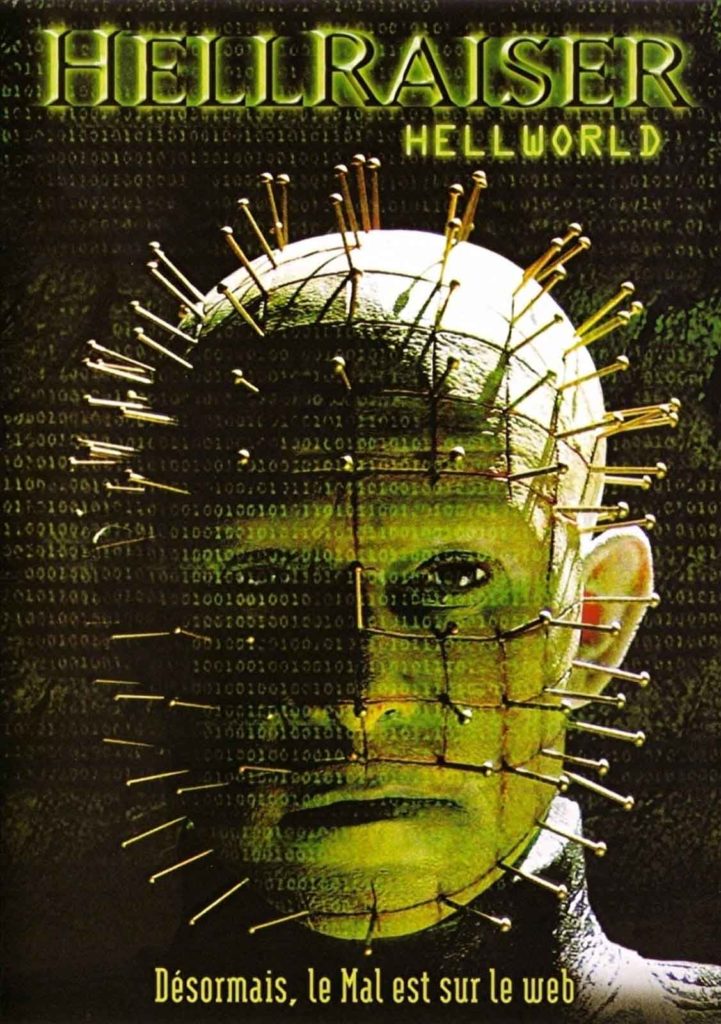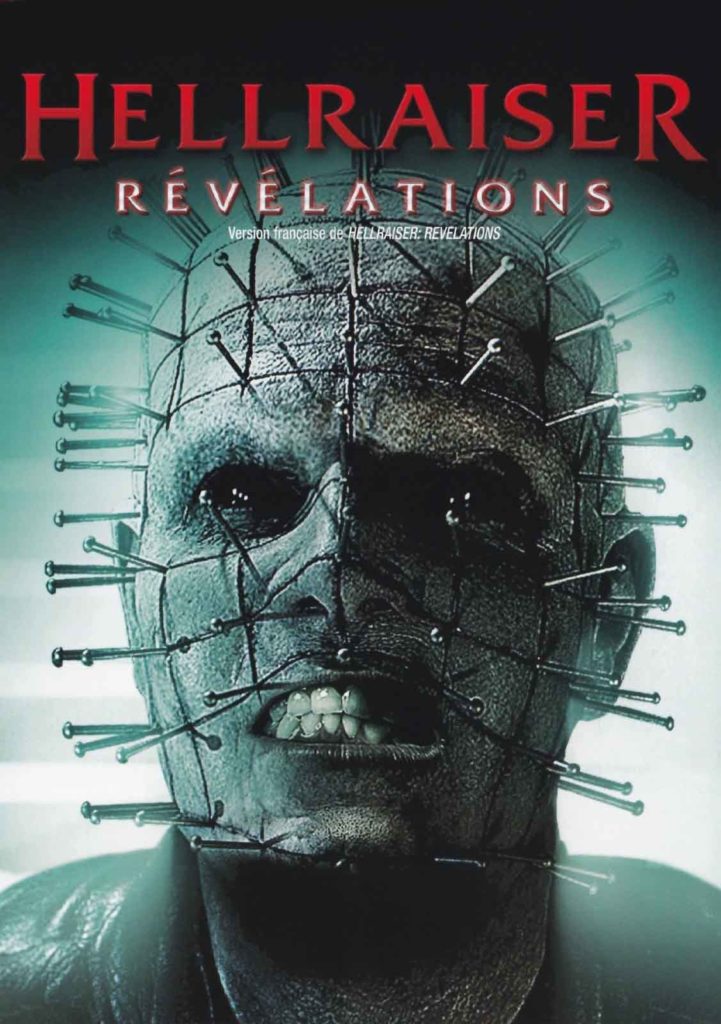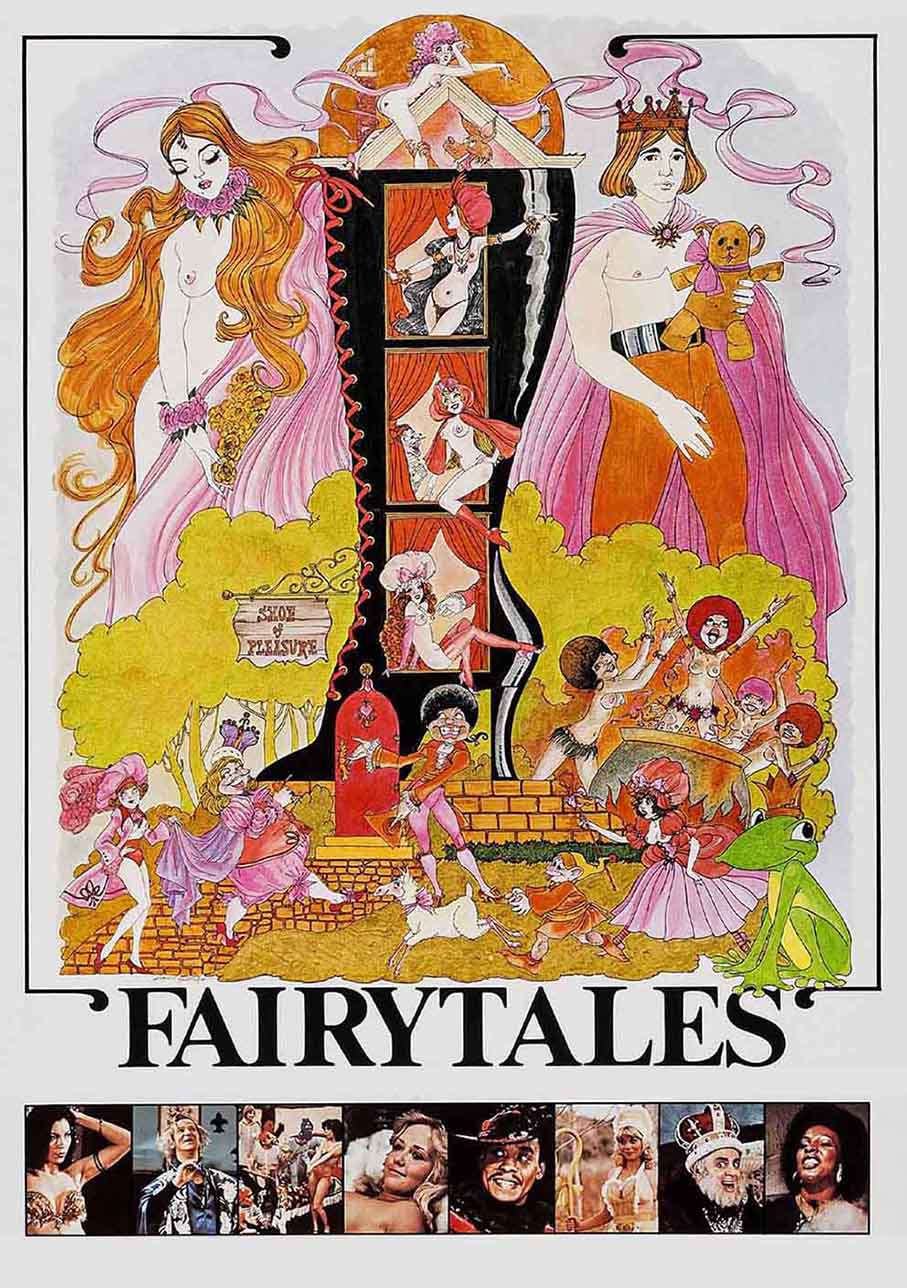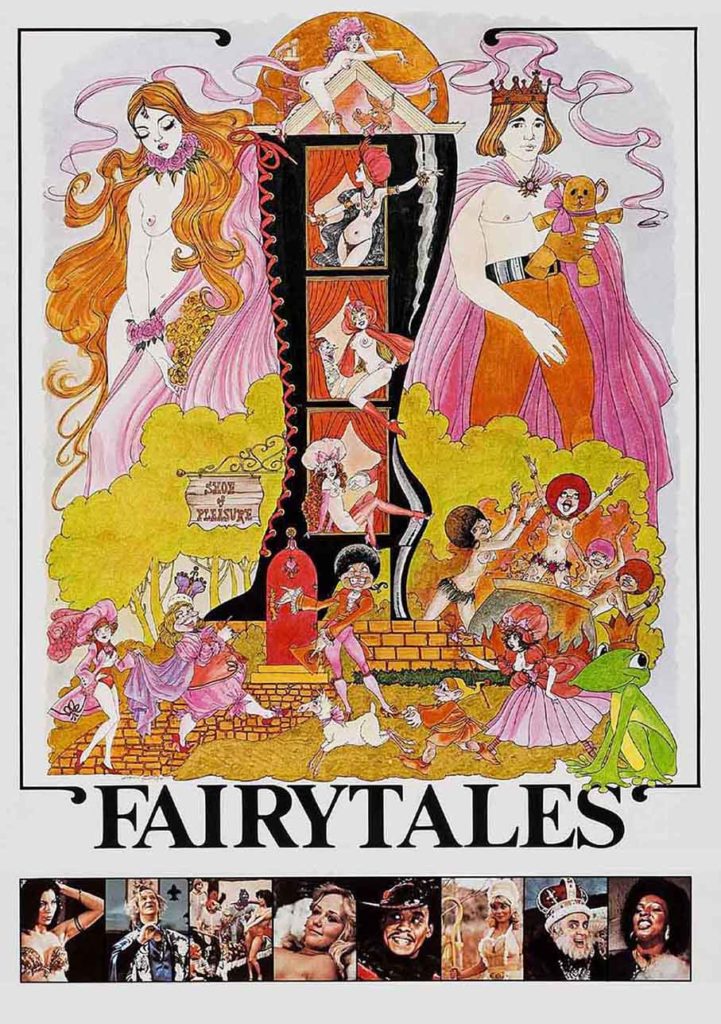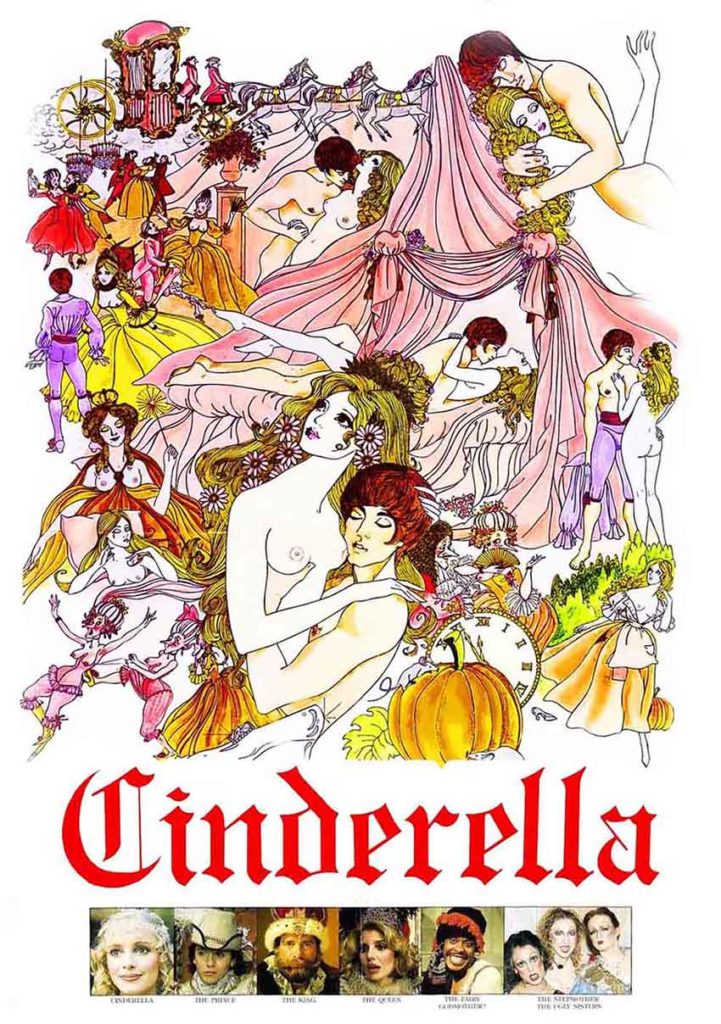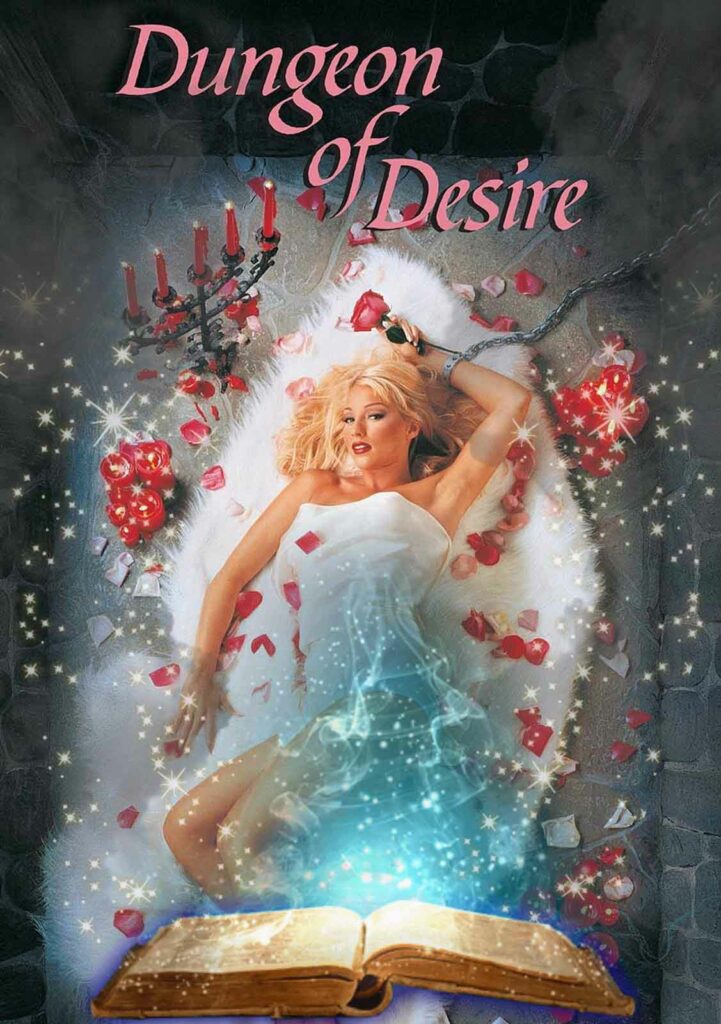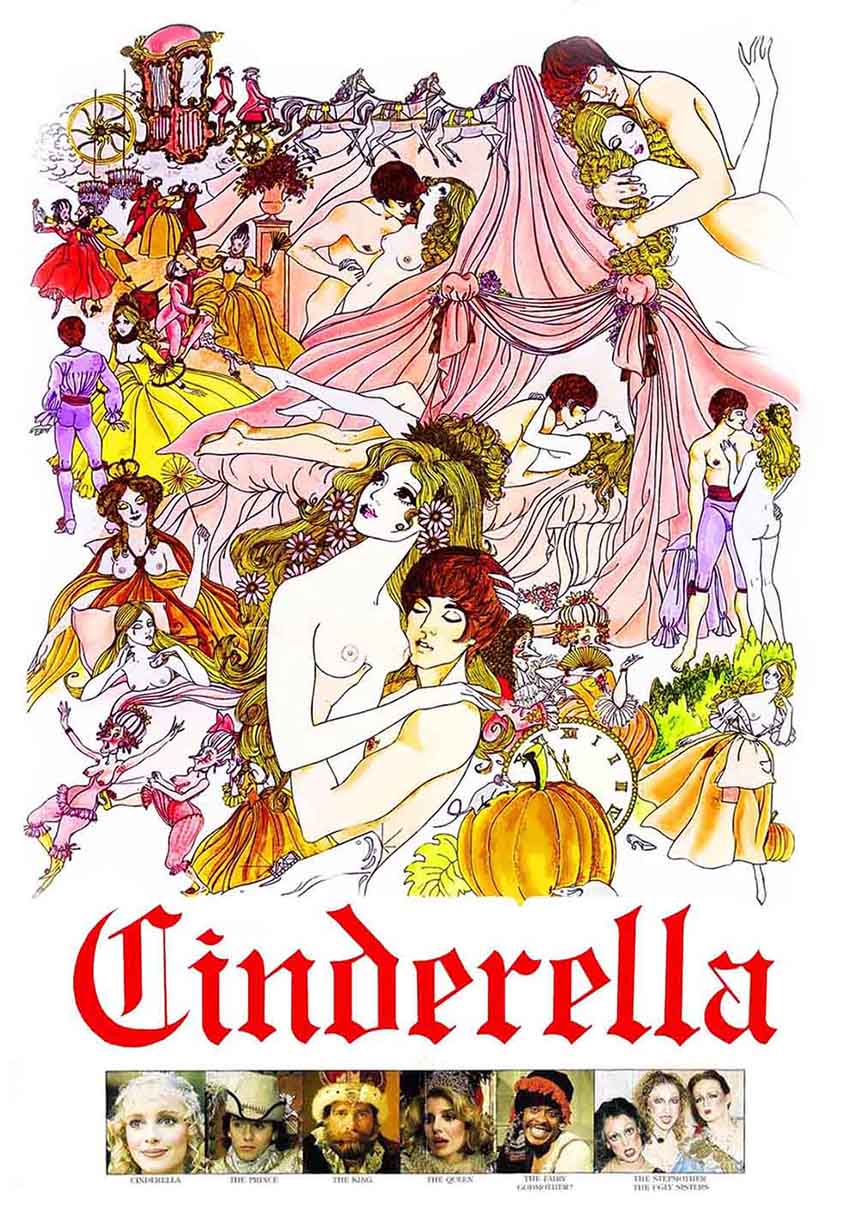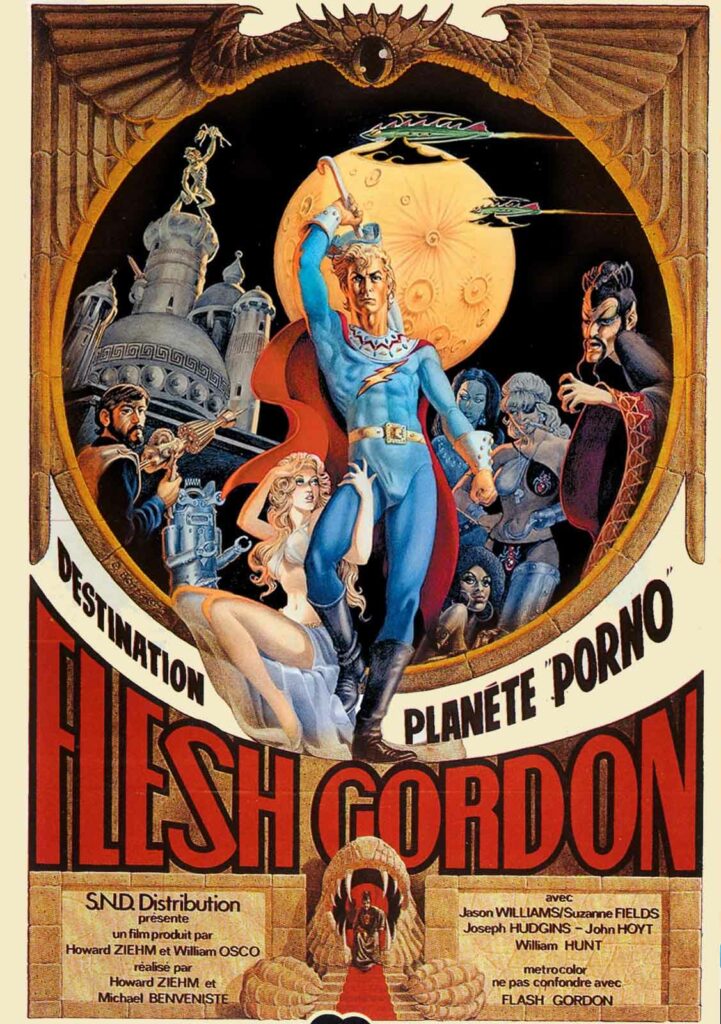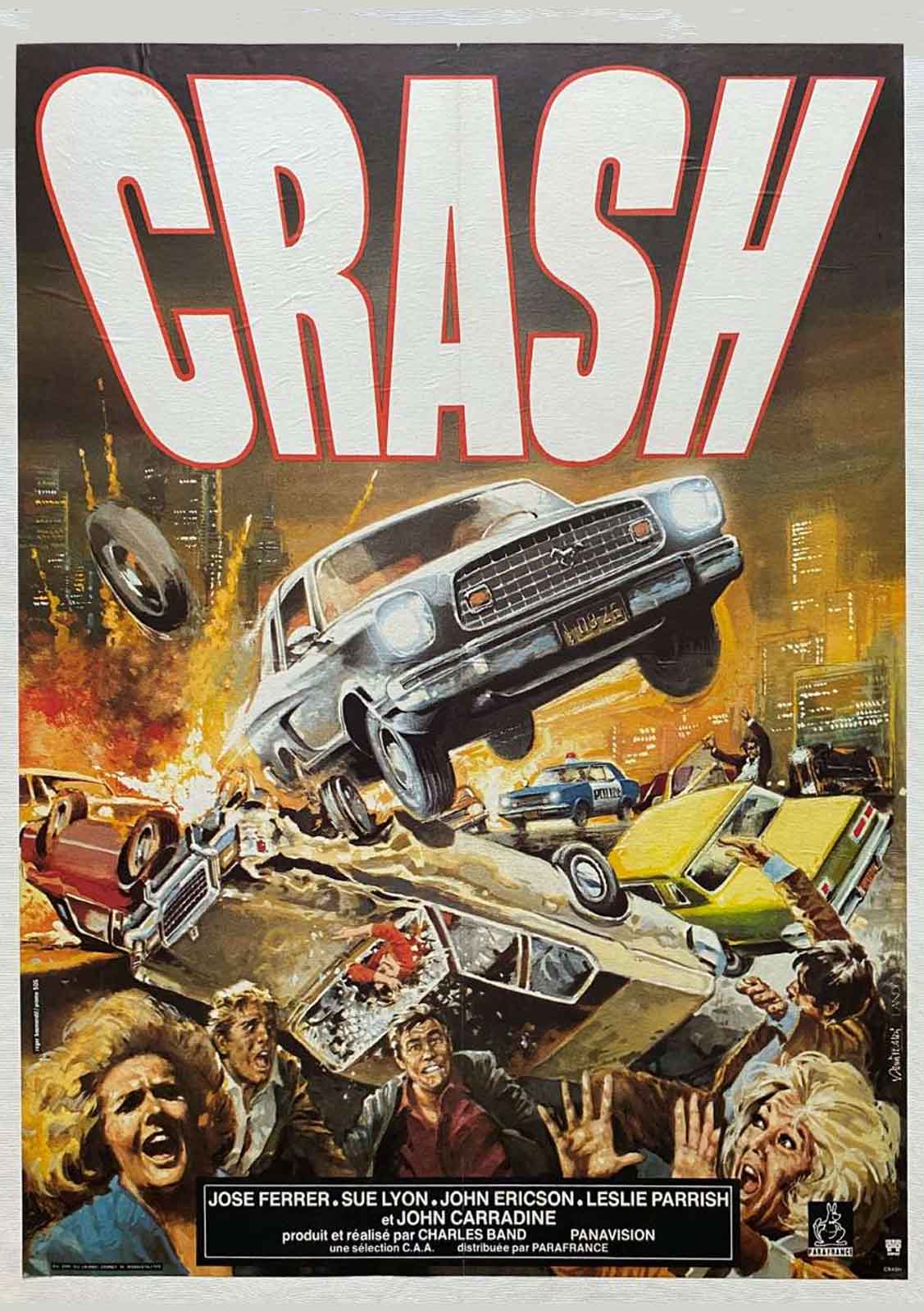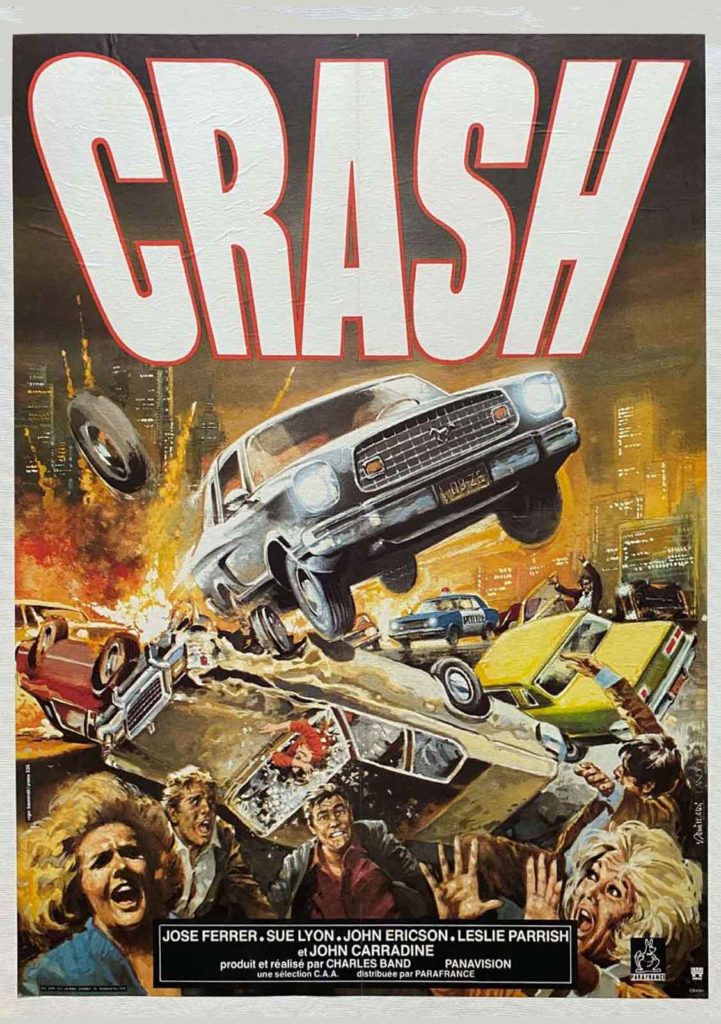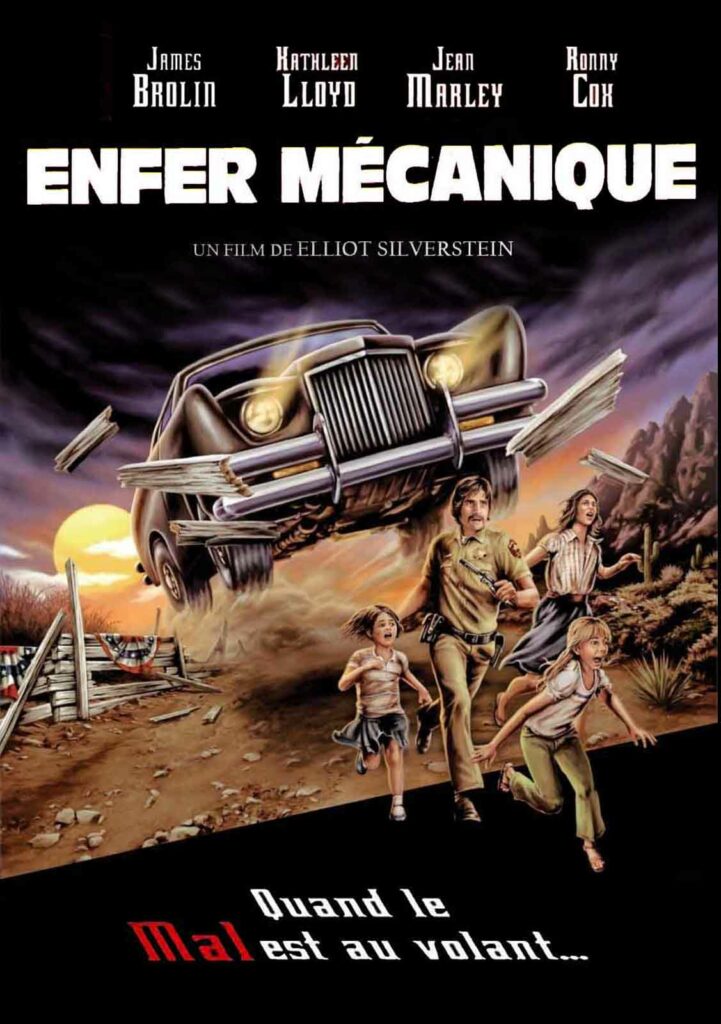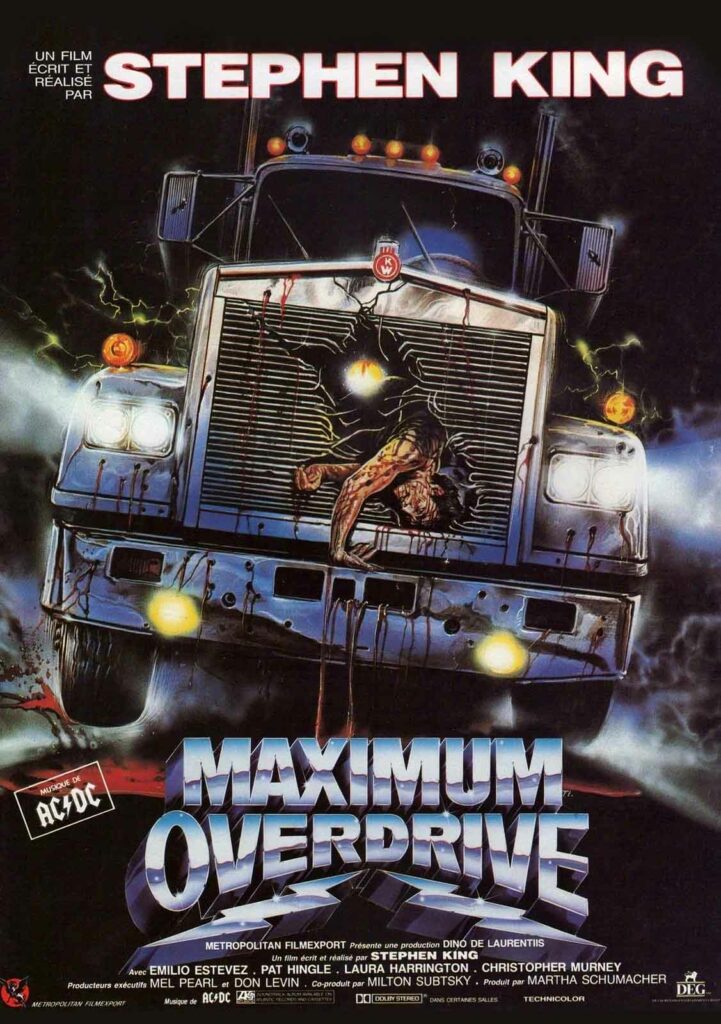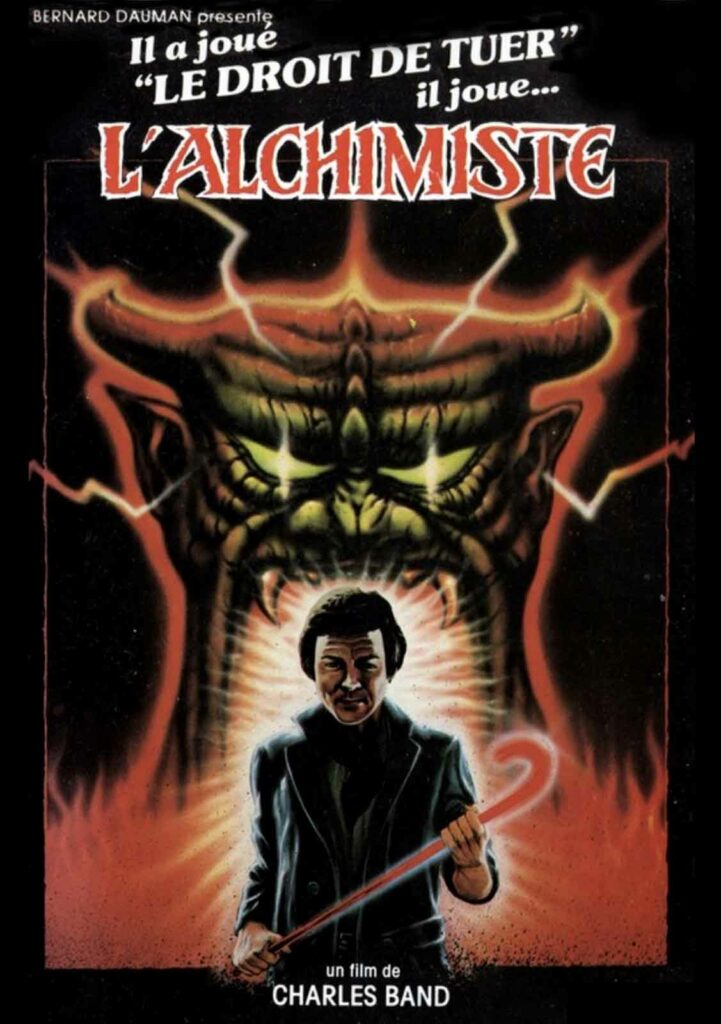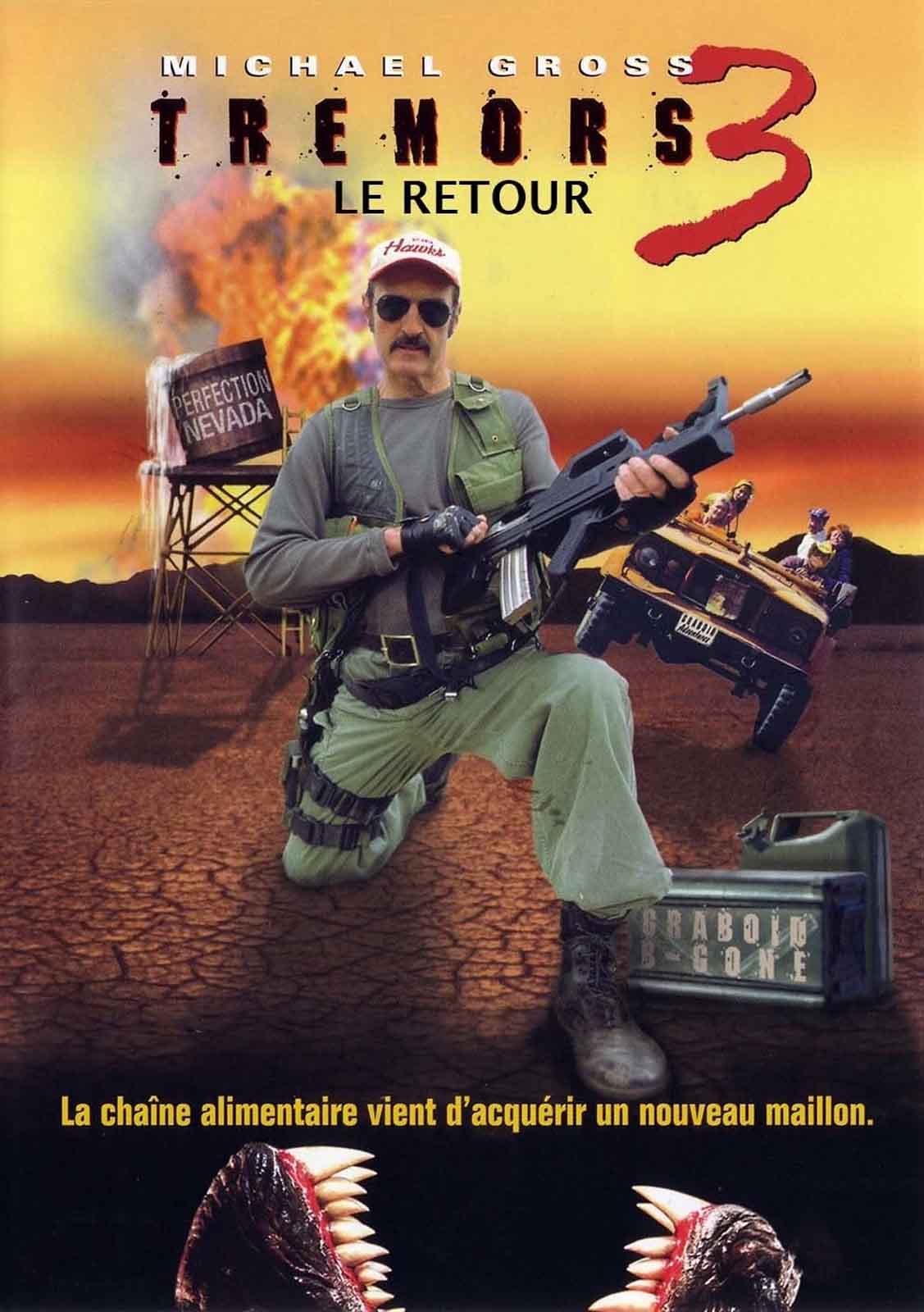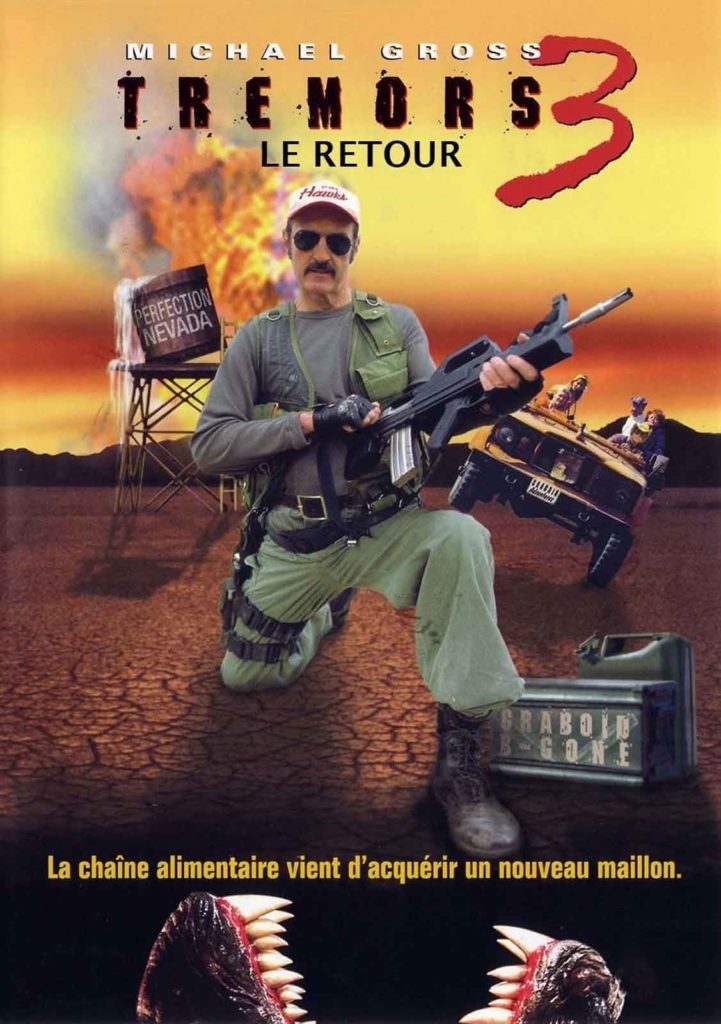Le réalisateur de Flashdance, 9 semaines 1/2 et Liaison fatale signe l’un des films les plus terrifiants de tous les temps…
JACOB’S LADDER
1990 – USA
Réalisé par Adrian Lyne
Avec Tim Robbins, Elizabeth Peña, Danny Aiello, Matt Craven, Eriq La Salle, Ving Rhames, Makaulay Culkin
THEMA MORT
L’idée de L’Échelle de Jacob trotte dans la tête du scénariste Bruce Joel Rubin depuis les années 70, mais visiblement aucun producteur ne s’intéresse à cette relecture modernisée et macabre d’un des épisodes de la Genèse. Entretemps, Rubin (qui semble vouer une véritable obsession à la mort et à l’au-delà) écrit les scénarios à succès de Brainstorm, L’Amie mortelle et surtout Ghost. Désormais dans la ligne de mire des studios hollywoodiens, l’auteur ressort son script et finit par attirer du monde. Le réalisateur Adrian Lyne tombe aussitôt sous le charme (si l’on peut dire) de ce récit éprouvant et refuse aussitôt de mettre en scène Le Bûcher des vanités (qui atterrira finalement entre les mains de Brian de Palma) pour diriger L’Échelle de Jacob. Voilà qui peut surprendre de la part de l’homme qui signa des films aussi universels que Ça plane les filles, Flashdance, 9 semaines ½ ou Liaison fatale, même si ce dernier laissait déjà entrevoir une noirceur jusqu’alors insoupçonnée dans l’univers du cinéaste. Lyne travaille donc en étroite collaboration avec Rubin pour réécrire l’histoire et notamment l’alléger de ses références bibliques trop marquées. Dans le rôle principal, Tom Hanks est le premier choix du réalisateur, mais l’acteur préfère – via un jeu de chaises musicales qui ne manque pas d’ironie – jouer dans Le Bûcher des vanités ! C’est là qu’entre en scène Tim Robbins, heureux de pouvoir changer de registre après les nombreuses comédies où il promena sa silhouette.


Robbins entre dans la peau de Jacob Singer, un vétéran de la guerre du Vietnam rapatrié aux États-Unis après une blessure. Depuis son retour au pays, il est obsédé par les images de ce conflit qui hantent son esprit. Mais il y a bien pire. Désormais, il se sent pourchassé par des démons sans visage qui surgissent partout dans son quotidien et sent autour de lui des forces hostiles qui cherchent à le tuer. Contacté par ses anciens camarades de guerre, Jacob découvre des preuves que l’armée a secrètement expérimenté sur leur unité un hallucinogène qui développe des pulsions homicides. Les terrifiantes illusions dont il est victime s’expliqueraient-elles par la prise de cette drogue ? Tandis qu’il se perd en conjectures, sa capacité à faire le tri entre la réalité palpable et les visions infernales est de plus en plus amoindrie et sa vie finit par se muer en affreux cauchemar dont il ne voit aucune issue…
Les paliers de l’horreur
Le scénario à tiroirs de L’Échelle de Jacob, entrelaçant flash-backs, flash-forwards, rêves et hallucinations, propose à priori plusieurs interprétations. Mais l’imagination du spectateur ne vagabonde pas au hasard, car le nombre possible d’explications est limité et chacune d’entre elles fonctionne selon sa propre logique. Le plan final, cependant, n’en laisse subsister qu’une, remettant en cause tout ce que nous venons de vivre avec l’infortuné protagoniste de cet épouvantable parcours du combattant. En se laissant inspirer par de nombreux peintres aux styles variés tels que William Blake, H.R. Giger ou Francis Bacon, mais aussi par les photographes Diane Arbus et Joel-Peter Witkin, Adrian Lyne parvient à bâtir un climat de tension et de terreur d’une intensité rarement atteinte au cinéma. Une peur sourde et indicible s’empare bien souvent du spectateur, s’identifiant parfaitement aux tourments de Jacob. Les visions d’épouvante sont d’autant plus puissantes qu’elles sont furtives, atypiques, à la fois tangibles et surréalistes, soutenues par une bande son en dents de scie signée Maurice Jarre. Mixant un thème au piano minimaliste avec des nappes synthétiques, des percussions ethniques et des sonorités inquiétantes, la partition du compositeur de Lawrence d’Arabie accompagne pas à pas l’univers trouble du film de Lyne. Longtemps après son générique de fin, L’Échelle de Jacob continue à hanter les spectateurs, dont les nerfs et la sensibilité furent rarement soumis à si rude épreuve. Ce classique de l’horreur psychologique ne remporta pas le succès escompté lors de sa sortie mais gagna peu à peu ses galons mérités d’œuvre culte.
© Gilles Penso
Partagez cet article