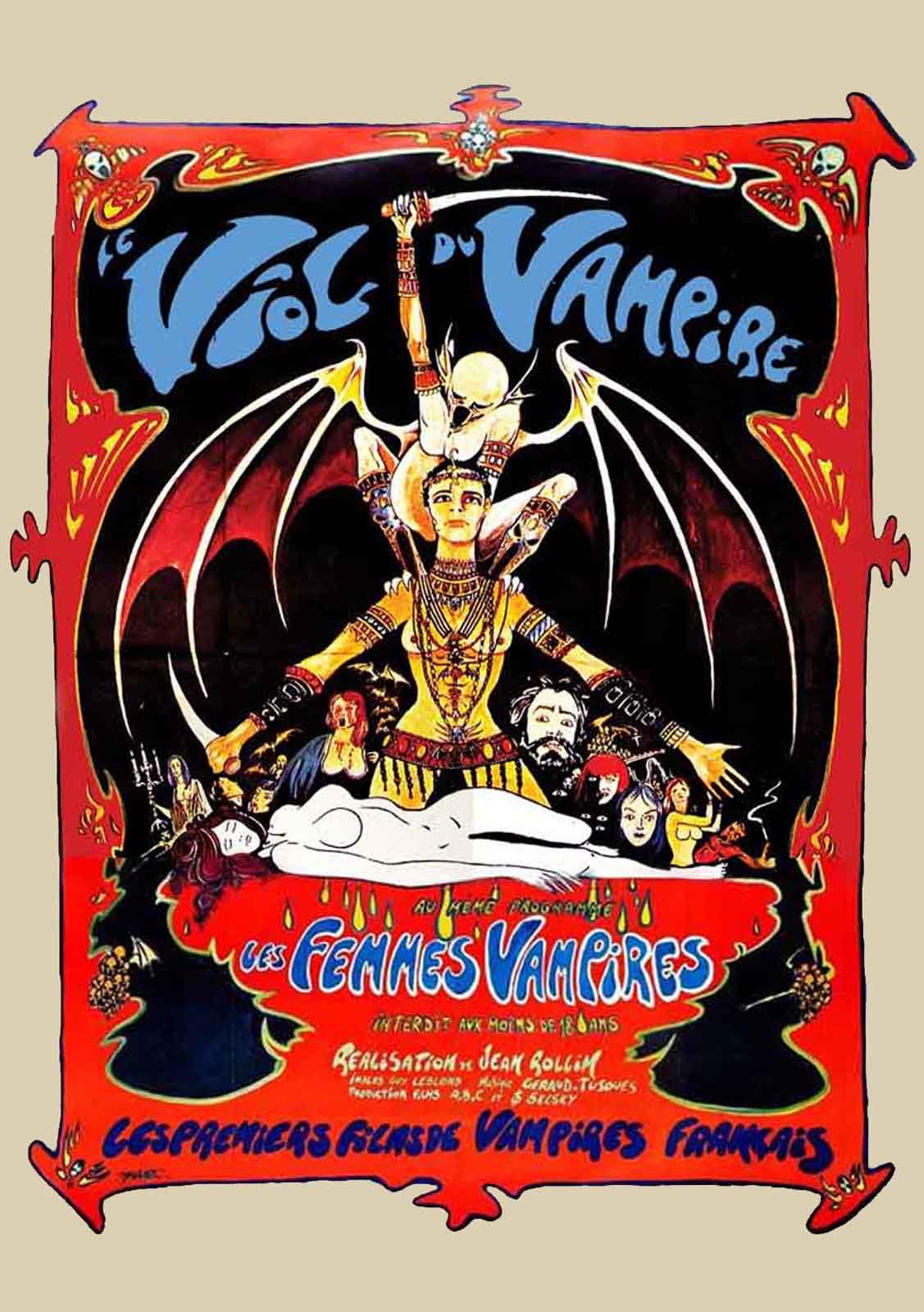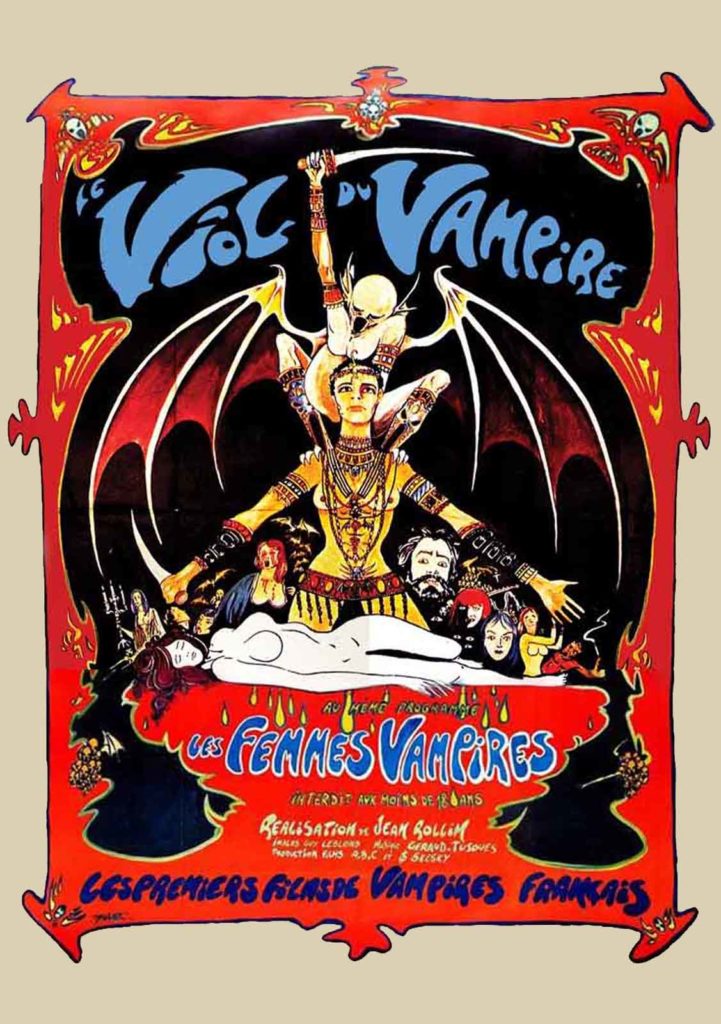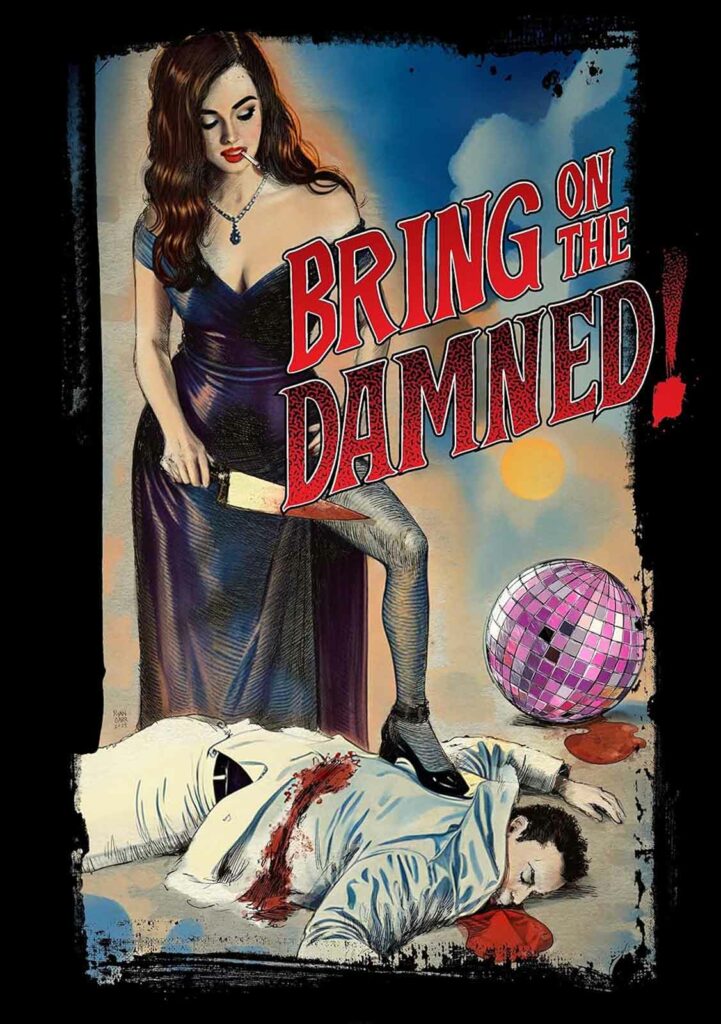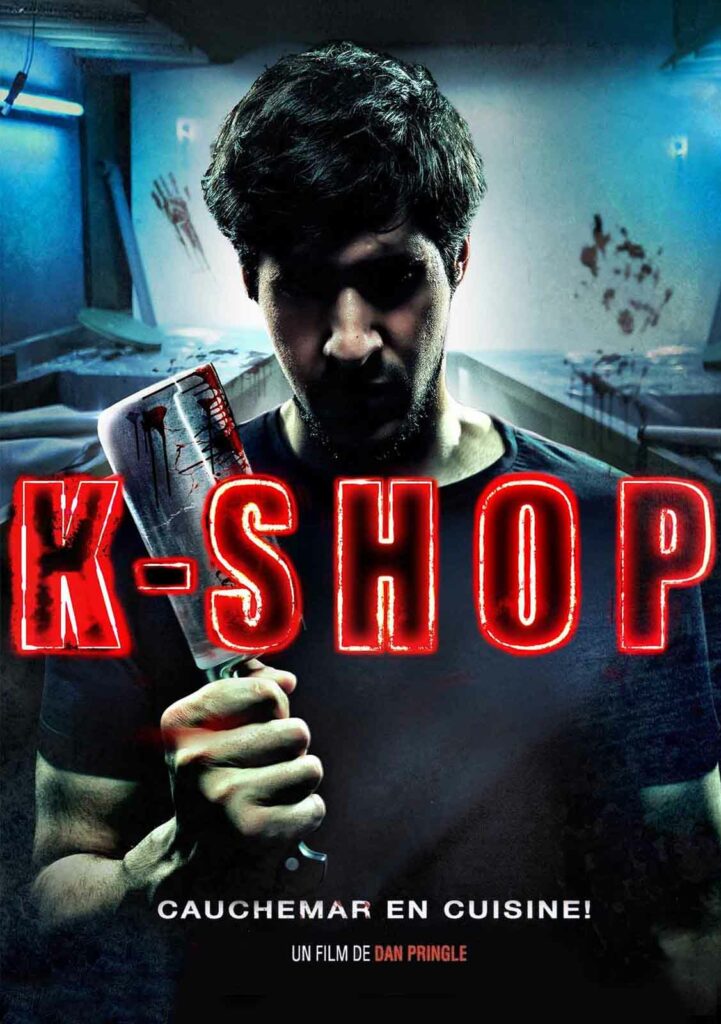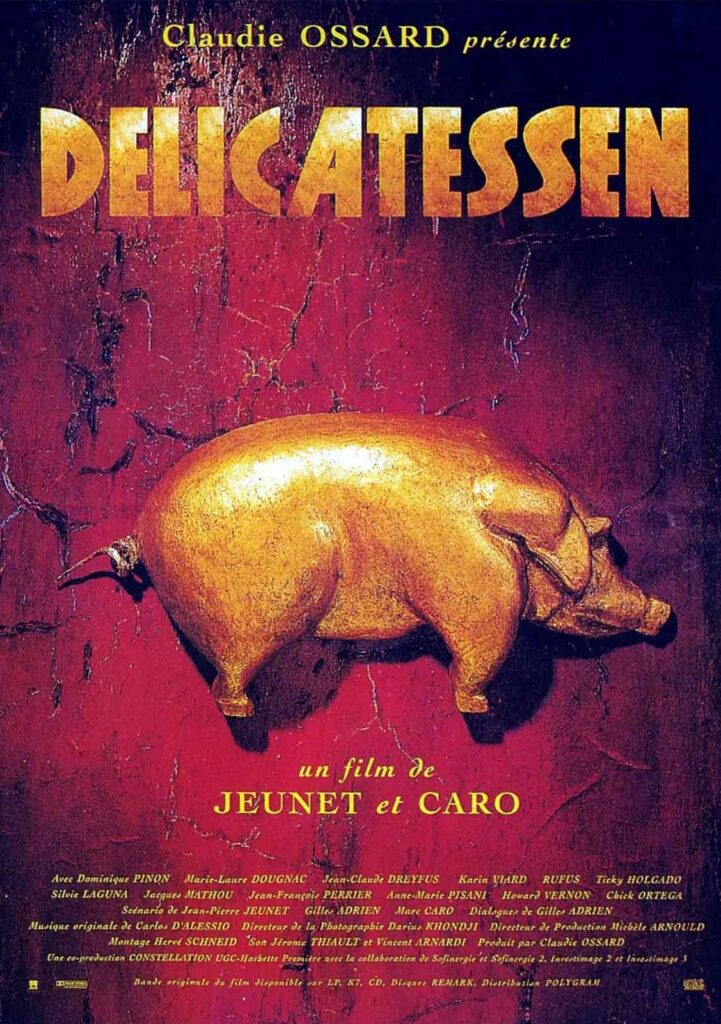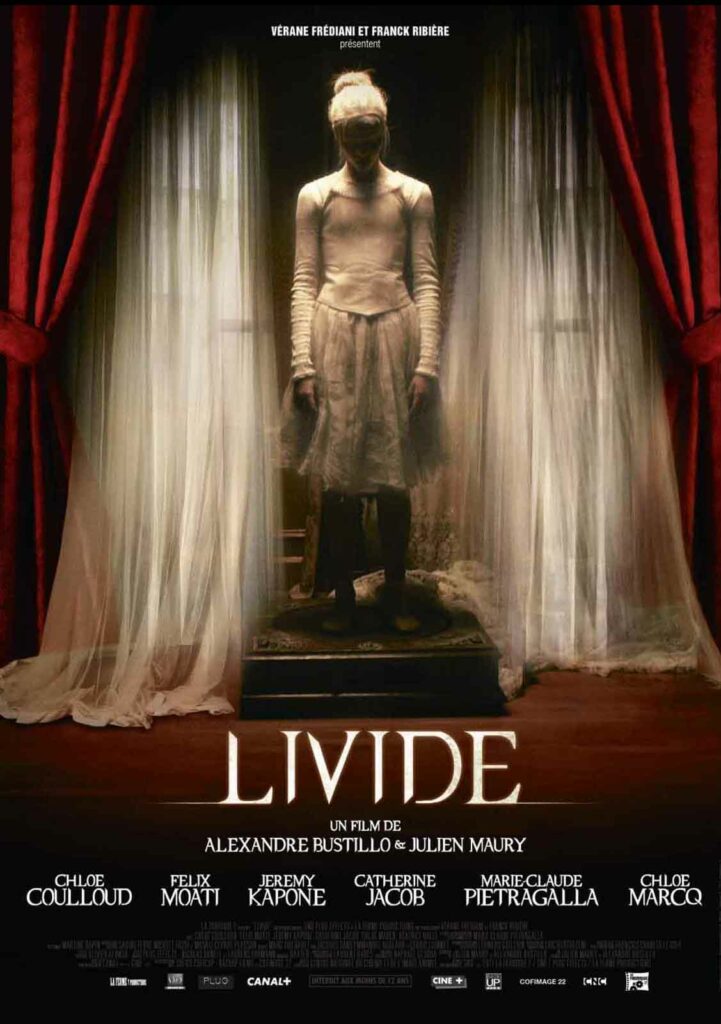La même année que Jurassic Park, Godzilla renaît de ses cendres pour affronter son célèbre double robotique
GOJIRA TAÏ MEKAGOJIRA
1993 – JAPON
Réalisé par Takao Ogawara
Avec Masahiro Takashima, Ryoko Sano, Megumi Odaka, Yusuke Kawazu, Kenji Sahara, Akira Nakao, Koichi Ueda
THEMA DINOSAURES I ROBOTS I SAGA GODZILLA
Contrairement à Godzilla contre Mothra, ce Godzilla contre MechaGodzilla ne présente quasiment aucun rapport avec son modèle réalisé dans les années 70, si ce n’est la présence du fameux robot géant. Car si, dans Godzilla contre Mecanik Monster, cette bête métallique avait des origines extra-terrestres, ici elle est de fabrication terrienne et vise le statut d’ultime machine de guerre anti-Godzilla. Son armure est en alliage, son cœur est un réacteur atomique, et les techniciens de la « Force G » l’ont créé en s’inspirant de la technologie futuriste ayant donné naissance au King Ghidroah cyborg (deux films plus tôt, pour ceux qui suivent). À l’exception d’une tête plus effilée et de cuisses plus larges qui lui donnent les proportions générales d’une sorte de fusée, le design de ce monstre mécanique est très proche de celui qui le précéda quelque vingt ans plus tôt. Tandis que les derniers rouages sont huilés, une expédition scientifique découvre sur une île de la mer de Bering un œuf géant.


Alors que les savants s’apprêtent à ramener l’œuf en ville, Godzilla et le ptéranodon géant Rodan font leur apparition et s’affrontent au cours d’un pugilat nocturne riche en étincelles et en nuages de poussière. Rodan est laissé pour mort, et l’œuf est transporté à Kyoto. Tout le monde s’attend à en voir sortir un cousin de Rodan, or lorsqu’il éclot, c’est un dinosaure bipède qui fait son apparition. A peine moins ridicule que le bébé Godzilla des films précédents, cet étrange bestiau est aussitôt identifié par les savants comme un godzillasaurus, autrement dit un cousin de la famille de Godzilla mais plus mignon, plus inoffensif, et végétarien de surcroît ! Lorsque le grand dinosaure radio-actif se met à provoquer des explosions en chaîne sur les docks voisins, au cours d’une séquence fort spectaculaire, MechaGodzilla intervient et la première manche a lieu dans le bruit et la fureur. Le robot vole, lance des rayons thermiques par la gueule, des lasers par les yeux, des grenades plasma par le ventre, des missiles paralysants par les épaules et des câbles à électrochocs par les doigts, rien que ça ! Godzilla passe donc un mauvais quart d’heure, mais il en a vu d’autres, et finit par mettre son adversaire hors d’état de nuire.
Place à… SuperMechaGodzilla !
Les scénaristes assemblent alors leurs folles idées éparses au cours d’un climax tonitruant au cours duquel Rodan s’éveille sur son île, se gonfle d’énergie radioactive, survole les villes en détruisant tout sur son passage (en un remake fort bien troussé des meilleures séquences du Rodan de 1956) et capture le bébé godzillausaurus. Après une révision complète, Mecha-Godzilla vient lui botter les fesses, aidé du vaisseau Garuda qu’on croirait issu de la série San Ku Kaï. Lorsque Godzilla refait son apparition, le robot et le vaisseau s’assemblent comme de bons vieux Transformers, donnant naissance à SuperMechaGodzilla (!), et tout s’achève dans un festival de rayons destructeurs et d’explosions, au son de la partition martiale d’Akira Ifukube. Bien moins sérieux que Godzilla contre Mothra, ce nouvel épisode s’avère surtout beaucoup plus délirant et autrement plus distrayant, témoin de brainstormings fumants dans les salles de réunion de la Toho.
© Gilles Penso
Partagez cet article